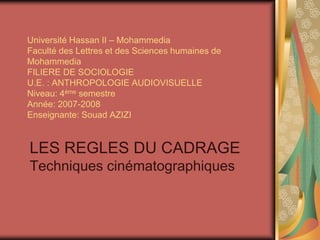
Les règles du cadrage
- 1. Université Hassan II – Mohammedia Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Mohammedia FILIERE DE SOCIOLOGIE U.E. : ANTHROPOLOGIE AUDIOVISUELLE Niveau: 4ème semestre Année: 2007-2008 Enseignante: Souad AZIZI LES REGLES DU CADRAGE Techniques cinématographiques
- 2. LES REGLES DU CADRAGE I. VOCABULAIRE II. REGLES DE COMPOSITION 2
- 3. I. VOCABULAIRE 1. Unités de construction d’une vidéo 2. Les types de champ 3. Les échelles de plan 4. Les types d’angle de vue 5. Les mouvements de la caméra 3
- 4. II. REGLES DE COMPOSITION 1. Éléments du cadre 2. Règles de composition 3. Règles de continuité 4
- 5. Qu’est-ce que le cadrage ? L’organisation de l’image délimitée par le cadre (les 4 côtés de l’écran). Le cadrage joue avec l’échelle des plans, les angles de prises de vues, la profondeur de champ, les mouvements de caméra, l’éclairage et la composition. 5
- 6. I.1 – Les unités de construction d’une vidéo 1. – Le Plan 2. – La Séquence 3. – Le Plan-Séquence 4. – Les Prises 6
- 7. LE PLAN Unité de base d’une vidéo Le plan est tourné sans interruption et ne subit aucune coupure au moment du montage. 7
- 8. LA SEQUENCE Ensemble de plans successifs constituant une unité de temps, de lieu ou d’action. 8
- 9. LE PLAN-SEQUENCE Une séquence qui se déroule en un seul plan (pas d’arrêt au moment du filmage et pas de coupure au moment du montage). Les plans-séquences utilisent souvent un mouvement de caméra. Ils sont pour cela difficiles à réaliser. 9
- 10. LES PRISES Filmages répétés d’un même plan. Identifications des différentes prises par l’usage d’un clap sur lequel sont notés les numéros de la séquence, du plan et de la prise. 10
- 11. I.2. LES TYPES DE CHAMP LE CHAMP : C’est l’espace que peut voir le spectateur sur l’écran. 11
- 12. LE CONTRE-CHAMP C’est l’opposé d'un champ. La technique du champ/contre-champ est très utilisée pour filmer des dialogues. Elle permet de passer d’un personnage à l’autre. 12
- 13. LE HORS-CHAMP L’espace qui n’est pas visible au spectateur sur l’écran. Les réactions des personnages à ce qui se passe dans le hors-champ (notamment les jeux de regards : effroi, étonnement, amusement, etc.) permettent de créer un certain suspens. 13
- 14. LA PROFONDEUR DE CHAMP C’est la mise en perspective des avants et arrières plans par le jeu de la netteté de l’image. 14
- 15. LE BLOC OPTIQUE 15
- 16. LE BLOC OPTIQUE Un jeu de lentille qui projettent l’image cadrée sur le capteur CCD. Permet d’assurer la luminosité globale du caméscope et la qualité du piqué des images. 16
- 17. Son réglage assure: LE ZOOM (ou focale) L’OUVERTURE (diaphragme) LA NETTETE DE L’IMAGE (focus) 17
- 18. LE ZOOM Réglage manuel qui permet d’éloigner ou de rapprocher le sujet cadré. Une petite focale correspond à un grand angle (éloignement du sujet cadré) et une grande focale correspond à un zoom (rapprochement du sujet cadré). 18
- 19. L’OUVERTURE Une série de pièces mécaniques (le diaphragme) qui se ferment ou s’ouvrent pour laisser passer plus ou moins de lumières après les lentilles. Ceci permet d’adapter la quantité de lumière sur le CCD pour assurer un éclairement ni trop fort, ni trop faible. En plein été le diaphragme sera fermé au maximum; pour un sujet à l’ombre il s’ouvrira pour compenser. 19
- 20. LA NETTETE DE L’IMAGE Généralement automatique ( autofocus). L’autofocus se cale sur une zone centrale et assure en permanence le réglage qui permet d’avoir cette zone le plus nette possible. Si le sujet principal n’est pas au centre mais sur un bord l’autofocus risque de se perdre et l’image devient “flou”... Si une personne passe en avant-plan du sujet, l’aufocus cale sa netteté sur ce passant. Possibilité de débrailler l’automatisme pour passer en manuel. 20
- 21. La profondeur de champ dépend de plusieurs paramètres : distance du sujet (focus) ouverture du diaphragme (luminosité) focale de l’objectif (zoom) 21
- 22. Influence de ces paramètres Plus le sujet est éloigné du caméscope plus la profondeur de champ augmente. Plus la focale est petite (éloignement virtuelle du sujet cadré), plus la profondeur de champ augmente. Plus l’ouverture est petite (diaphragme fermé) plus la profondeur de champ augmente. 22
- 23. I.3. LES ECHELLES DE PLAN LE PLAN D’ENSEMBLE (ou plan général) Cadrage très large qui permet de présenter les lieux où se déroule l’action. Souvent utilisé en début de scène pour situer l’action et en fin de séquence pour donner aux spectateurs l’impression de quitter le lieu de l’action. 23
- 24. PLAN DE DEMI-ENSEMBLE (ou plan large) Cadrage large qui permet de présenter une partie des décors et plusieurs protagonistes de l’action. 24
- 25. PLAN MOYEN Cadrage qui permet de présenter le(s) personnage(s) en pied. 25
- 26. PLAN ITALIEN Cadrage présente seulement la partie du corps des acteurs au dessus des genoux. 26
- 27. PLAN AMERICAIN Cadrage qui coupe le corps des acteurs à mi-cuisse. Souvent utilisé pour filmer les scènes de duels dans les westerns, d’où son nom. 27
- 28. PLAN RAPPROCHE (ou plan buste) Cadrage qui coupe les personnages au niveau de la ceinture. Dans les films de fiction, le plan rapproché permet aux spectateurs d’entrer dans l’intimité des personnages. 28
- 29. GROS PLAN Cadrage serré qui permet de présenter le visage (ou une autre partie du corps) d’un acteur ou d’un objet. Dans les films de fiction, ce type de cadrage permet de dramatiser, et de mettre l’accent sur les émotions exprimées par les personnages et d’amener ainsi les spectateurs à les ressentir. 29
- 30. TRES GROS PLAN Gros plan très serré sur les yeux ou les mains par exemple. Dans les films de fiction, le très gros plan est utilisé pour attirer l’attention sur un détail dramatiquement important dans le récit. 30
- 31. On peut faire varier l’échelle d’un plan grâce aux mouvements de caméra et grâce au zoom. 31
