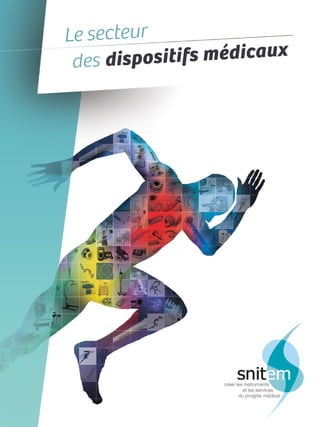
Tout savoir sur le DM !
- 2. Sommaire 3 Les dispositifs médicaux : une grande famille 6 Les caractéristiques des dispositifs médicaux et du secteur 9 Cycle des évolutions technologiques dans le domaine des dispositifs médicaux 10 Exemples d’évolution dans l’histoire des dispositifs médicaux 22 R & D et innovation 24 Evolution de la réglementation des dispositifs médicaux 25 L’essor de l’e-santé 26 L’accès au marché – le remboursement des DM 28 Évolution du secteur 29 Données clés du secteur 35 Galerie photos Un tissu industriel constitué de 94 % de PME Une grande pluralité Des produits utilisateurs-dépendants Un rôle structurant dans l’organisation des soins Des circuits de distribution diversifiés Des cycles d’innovation des produits généralement courts Aides techniques et compensation du handicap Gastro-digestif Anesthésie réanimation Gynécologie Aide à la prévention des escarres Orthèses Audiologie Neurologie Plaies et cicatrisation Opthalmologie Bloc opératoire Orthopédie Diabète Respiration Cardiologie Urologie Dialyse Injection – perfusion Imagerie Emploi et métier Le marché du DM et le tissu industriel E-santé Recherche et développement Les consommables, implantables, matériel à usage unique et matériel à usage individuel Le matériel réutilisable Les équipements, technologies et produits connectés 3 grandes catégories 3Le secteur des dispositifs médicaux
- 3. Un dispositif médical est un ins- trument, appareil, équipement, matière, produit, logiciel ou méthode qui a pour fonction de prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer, compenser, rempla- cer…, une blessure, une maladie, un handicap, un organe ou une fonction physiologique ou mécanique. Il peut être utilisé seul ou en association avec d’autres dis- positifs médicaux ou d’autres produits de santé. Le dispositif médical se situe au carrefour de multiples techno- logies : mécanique, électrique, électronique, informatique, bio- matériaux, textile, chimie… Les dispositifs médicaux contri- buent de manière significative aux progrès médicaux. Chaque année, des millions de patients marchent, voient, respirent, entendent… survivent grâce à un dispositif médical. Les dispositifs médicaux : une grande famille Quel est le point commun entre une IRM, une prothèse de hanche, une pompe à insuline, des bas de compression, un lit, un défibrillateur cardiaque implantable, un pansement et un robot chirurgical ? Ils appartiennent tous à la même famille, celle des dispositifs médicaux. 3grandes catégories de dispositifs médicaux (DM) On peut distinguer Consommables, implantables, matériel à usage unique et matériel à usage individuel : destinés à un seul patient pour une seule ou plusieurs utilisations. • Implant (défibrillateurs cardiaques, stents, valves cardiaques, prothèses orthopédiques implantables, électrodes de stimulation cérébrale, implant ophtalmique, implant cochléaire…) • Cathéter, gant, aiguille… • Dispositifs de plaies et cicatrisation • Pansements • … Matériel réutilisable : Dispositifs médicaux pouvant être utilisés chez plusieurs patients en subissant, si nécessaire, entre chaque patient des procédures de désinfection et/ou de stérilisation • Ancillaire • Instrument de chirurgie • Spéculum • Dispositif d’aide à la respiration à domicile • Sonde d’échographie endocavitaire • Canule de trachéotomie réutilisable • Tensiomètre • … Équipements, technologies et produits connectés : destinés à être utilisés en général chez plusieurs patients et comportant de la mécanique, de l’électronique de l’électrique, de l’informatique • Scanner, IRM, échographe, PET Scan… • Lit médical • Logiciel • Matériel de bloc opératoire • Matelas anti-escarres • Dispositif d’aide à l’insuffisance rénale • Dispositif de télémédecine et e-santé • … 1 2 3 54 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 4. Des produits utilisateurs-dépendants Le dispositif médical est un pro- duit utilisateur-dépendant, dont l’action est liée à l’acte d’un professionnel de santé ou plus largement de tout utilisateur. Ils peuvent être aussi utilisés au quotidien ou à domicile, comme par exemple la pompe à insu- line, les appareils d’assistance respiratoire, … Cette caractéristique de produit utilisateur-dépendant doit abso- lument être prise en compte lorsque l’on règlemente les dis- positifs médicaux. Elle nécessite notamment une information/for- mation à l’utilisation des pro- duits. Un rôle structurant dans l’organisation des soins Les DM accompagnent, au gré des évolutions technologiques, l’évolution des pratiques médi- cales et jouent un rôle majeur dans l’organisation des soins : • Baisse de la durée d’hospita- lisation, • Réduction de la durée d’in- tervention chirurgicale, une moindre invasivité chirurgicale, • Prise en charge des patients en ambulatoire, • Développement du maintien à domicile des patients, • Diagnostics de plus en plus précoces permettant de nou- veaux modes de prises en charge… La prise en compte de ces ca- ractéristiques dans l’évolution de la réglementation sur les plans réglementaire ou économique est indispensable pour parvenir à des textes adaptés à ce sec- teur et pour répondre in fine aux besoins des patients et des pro- fessionnels de santé qui en sont les bénéficiaires/utilisateurs. Un tissu industriel constitué de 94 % de PME Une des raisons expliquant cette proportion particulièrement éle- vée de PME tient aux nombreux marchés dits « de niche » avec de petites séries de fabrication qui répondent à des populations de patients en nombre limité. des dispositifs médicaux et du secteur Le dispositif médical demeure encore trop souvent assimilé à tort au médicament(1) . Les dispositifs médicaux sont des produits de santé à part entière qui répondent à une définition et à des caractéristiques communes. Les caractéristiques (1) « L’industrie du dispositif médical est parfois consi- dérée, à tort, comme un sous-secteur de l’indus- trie du médicament », citation de Vincent Chriqui, directeur du Centre d’analyse stratégique (CAS) dans le rapport du CAS sur le dispositif médical innovant (2013). (2) Estimation Snitem 2013. En France(2) sont posés près de • 1 200 endoprothèses aortiques thoraciques, • près de 7 000 endoprothèses aortiques abdominales, • près de 15 000 défibrillateurs cardiaques implantables, • plus de 25 000 valves cardiaques LE SAVIEZ-VOUS ? Une grande pluralité Cette diversité est le résultat de produits devant répondre par des fonctionnalités, des tailles, des poids, une angulation, (...) variables à des besoins extrê- mement ciblés (populations de patients réduites et très nom- breux référencements) dans les domaines diagnostique, théra- peutique ou de compensation d’un handicap. • Plus de 1 000 entreprises • 94 % de PME • 65 000 emplois en France En savoir plus Compte tenu des dispositions légales auxquelles elles sont soumises, les entreprises ont pour obligation de : • prendre en compte les connaissances techniques, l’expérience, l’éducation et la formation et, lorsque cela est possible, l’état de santé et la condition physique des utili sateurs auxquels les disposi tifs sont destinés (conception pour les utilisateurs profanes, professionnels, handicapés ou autres), • d’accompagner chaque dispo sitif des informations néces saires pour pouvoir être uti lisé correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connais sances des utilisateurs poten tiels et pour permettre d’iden tifier le fabricant. 76 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 5. Des circuits de distribution diversifiés 1. Établissements de santé (ventes directes ou via des distributeurs), 2. Officines (ventes directes ou via des distributeurs), 3. Distributeurs spécialisés (au- diologie, optique, ortho-pro- thésistes, etc.), 4. Prestataires de produits de santé (location ou achat), 5. Grande distribution. Cette variété se retrouve dans les modèles de prise en charge. LE SAVIEZ-VOUS ? En matière d’essais cliniques pour les dispositifs médicaux, doivent être pris en compte : • l’importance de l’action méca nique dans les résultats cliniques rend beaucoup plus prédictifs les essais pré cliniques en termes d’efficacité • les populations cibles souvent très réduites ne permettent pas d’essais de grande am pleur. Dans certaines situa tions, la population nécessaire à l’étude peut être égale à la population cible du DM • le lien très fort avec l’acte médico-chirurgical • la notion de courbe d’appren tissage et les éventuelles variations de pratiques • les essais comparatifs sont parfois inutiles ou impossibles à mener Des cycles d’innovations des produits généralement courts Les cycles d’innovation d’un produit donné se situent en moyenne entre 2 et 5 ans. Dans nombre de cas, il s’agit d’évolutions technologiques gra- duelles qui, sur la durée, au bout d’une dizaine d’années (cf. « Le cycle des évolutions tech- niques », p. 9), apportent des changements majeurs en termes de prise en charge diagnostique, médico-chirurgicale ou de com- pensation d’un handicap. Si chaque modification incré- mentale devait répondre à des exigences réglementaires dis- proportionnées, c’est l’accès des patients à l’innovation qui serait remis en cause et les pertes de chances qui se mul- tiplieraient. des dispositifs médicaux et du secteur Les caractéristiques Naissance d’un DM Prévenir, diagnostiquer, soigner, suivre l’évolution d’une maladie, compenser un handicap À partir de la 3ème année : Évolutions technologiques progressives successives du DM Apports aux patients et à l’organisation des soins À partir de la 8ème année : Nouvelle rupture dans la prise en charge Développement possible dans d’autres applications médicales Au bout de 8 ans d’évolutions technologiques progressives, la prise en charge médicale se trouve transformée. Perfectionnement progressif de la technologie / amélioration de la prise en charge médicale (ex. défibrillateurs avec simple chambre puis double chambre, audioprothèse à programmation numérique, pansements détectant la présence de bactéries…) Ces progrès technologiques ont un impact en termes de qualité de vie des patients et en termes d’organisation des soins : – diminution de la taille / du volume, – moins d’invasivité des DMI, – réduction de la durée d’hospitalisation, – reprise plus rapide d’une activité normale par le patient, – moins de ré-intervention chirurgicale, plus de confort d’utilisation, – meilleure ergonomie d’utilisation par le professionnel de santé et / ou le patient, – meilleure qualité de vie du patient (ex. patient plus autonome / prise en charge à domicile). Technologie prenant sa source dans différents secteurs : mécanique, électronique, informatique, la chimie…) Issue très souvent de la rencontre d’un médecin avec un ingénieur et plus largement des travaux de recherche de professionnels de santé, de chercheurs publics ou privés. Cycle des évolutions technologiques dans le domaine des dispositifs médicaux (schéma présenté à titre indicatif) 98 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 6. 1 dans l’histoire des dispositifs médicaux L’essor des dispositifs médicaux (DM) remonte à la seconde moitié du XXème siècle. Exemples d’évolution Ce secteur se situe au croise- ment de multiples disciplines (mécanique, électronique, infor- matique, chimie, physique, …) qui, appliquées à la santé, per- mettent de concevoir, dévelop- per et fabriquer des produits adaptés aux besoins extrême- ment diversifiés des patients. Leur très grand nombre et leur extrême diversité interdisent toute approche exhaustive sur leurs évolutions technologiques dans ce livret. Quelques exemples de progrès technologiques puisés à l’inté- rieur de grandes familles de dis- positifs médicaux permettent toutefois de mieux explorer la richesse de ce secteur. Le défibrillateur implantable Les consommables, implantables, matériel à usage unique et matériel à usage individuel LES IMPLANTABLES ACTIFS Découverte du courant continu et alternatif Première défibrillation au cours d’une intervention chirurgicale Création du 1er DAI implantable par le Dr Michel Mirowski Il devient automatique, s’autorégule en diagnostiquant lui-même la fibrillation ventriculaire du patient et ne pèse plus que quelque 60 g ! XIXème SIÈCLE 1947 1970 AUJOURD’HUI Jean-Louis Prévost et Frédéric Battelli, établissent un lien entre une fibrillation ventriculaire et la stimulation électrique. Michel Mirowski réduit à 300 g le DAI qui pesait entre 13 et 18 kg LE SAVIEZ-VOUS ? LE SAVIEZ-VOUS ? L’ère de l’homme augmenté a débuté Audiologie Imagerie Dialyse Orthèses Neurologie Escarres Injection - perfusion Plaies cicatrisation Ophtalmologie Dentaire Cardiologie Gastro-digestif Diabète Urologie / gynécologie Orthopédie Respiration/Monitorage/ Anesthésie 1110 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 7. La prothèse de hancheLES IMPLANTABLES NON ACTIFS dans l’histoire des dispositifs médicaux Exemples d’évolution Les chirurgiens orthopédiques cherchent à remplacer le cartilage perdu mais aucune interface ne convient : trop fragile, trop souple, trop toxique. La toute première seringue à lavement est inventée par Mario Gatenaria tout d’abord en bois, puis en métal. Aux USA, le Dr Smith- Petersen parvient à des résultats convaincants en utilisant de fins moules de verre intercalés entre les deux surfaces de la hanche. Parallèlement en Angleterre, le Pr Ernest W. Hey-Groves propose de remplacer la tête fémorale par une sphère d’ivoire. Le chirurgien français Dominique Anel crée une seringue beaucoup plus petite. Elle est améliorée et permet alors les prémices des injections sous- cutanées. La céramique vient concurrencer le Téflon. En effet, le Pr Pierre Boutin propose une prothèse totale de hanche mixant cotyle en céramique et pièce fémorale en deux parties : tête en céramique sur un corps en acier. Le Dr Charles S. Venable démontre la supériorité de l’alliage chrome-cobalt- molybdène. Le Dr Harold Bohlman met au point la première prothèse fémorale utilisant ce métal. En France, les professeurs Jean et Robert Judet innovent en utilisant le plexiglas pour remplacer la tête fémorale. Avec l’apparition du Téflon, il devient possible de réduire le coefficient de friction entre la rotule et sa coiffe. DÈS 1920 1720 XIXème SIÈCLE 1936 1939 APRÈS 1945 1959 La toute première seringue en verre dite « moderne » est créée par un souffleur de verre français du nom de Fournier. 1894 La maîtrise du plastique (notamment les qualités du plastique en matière de sécurité, y compris pour le transport et le stockage, la transparence, la légèreté ainsi que le moindre coût de production) aura pour conséquence l’abandon du verre au profit de cette nouvelle matière, et verra l’apparition de la seringue à usage unique. ANNÉES 1970 (3) Le Point, 21 août 2014 (4) Tiré du Que sais-je « Le dispositif médical », 1ère édition 2009 citant le Dr François Prigent « L’histoire des prothèses de hanche » DÉBUT DU XIXème SIÈCLE XIVème SIÈCLE ANNÉES 1970 La seringueLES CONSOMMABLES Les dispositifs médicaux dits « consommables » s’étendent de la seringue en passant par les cathéters, les pansements ou les gants médicaux. Une seringue sans aiguille fonctionnant à l’électricité et permettant ainsi d’adapter la force d’injection selon le patient pourrait bientôt voir le jour ! Parallèlement au développement des matériaux, les voies d’abord (nom d’une technique d’approche chirurgicale) ont éga lement considérable ment évolué. De la voie d’abord antérieure de la hanche mise au point par le Dr Marius Smith-Pertersen dans les années 1920 au développement des voies mini-invasives dans les années 2000, l’histoire de la prothèse croise celle de l’acte chirurgical(4) . Chaque année, près de 140 000 personnes(3) ont recours à la pose d’une prothèse de hanche dans un hôpital ou une clinique pour soigner une arthrose sévère de cette articulation, ou une fracture du col du fémur Cette intervention, d’une durée de deux heures en moyenne, permet à la personne opérée de retrouver mobilité et indépendance. LE SAVIEZ-VOUS ? 1312 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 8. Les pansements se développent et s’améliorent parallèlement à la généralisation de l’asepsie. La nécessité d’effectuer des pansements stériles et propres s’impose ; le coton et la gaze remplacent les linges de lin ou de chanvre utilisés comme pansement. Ainsi, pendant près d’un siècle, la pratique du pansement aura surtout pour but de prévenir l’infection, en faisant barrière entre la plaie et le monde extérieur, mais sans avoir vraiment de rôle dans la cicatrisation. Auguste Lumière met au point un pansement révolutionnaire, le Tulle gras, semi occlusif, non adhérent et surtout stérile. Il établit par ailleurs les règles d’un bon pansement : changé tous les jours au début, puis un jour sur deux. Théorisation par Albert Einstein. Le laser fut mis au point par le physicien T. Maiman qui réussit à obtenir une émission laser au moyen d’un cristal de rubis. Apparition des pansements hydrocellulaires pour tous types de plaies, puis les hydrogels pour les plaies trop sèches et les alginates et hydrofibres pour les plaies suintantes(5) . DÉBUT DU XXème SIÈCLE 1917 1960 ANNÉES 1990 On commence à penser que la composition et les propriétés du pansement peuvent jouer un rôle sur la cicatrisation. À PARTIR DES ANNÉES 1960 Les travaux de Winter sur les animaux montrent les effets bénéfiques d’une cicatrisation en milieu humide par rapport aux plaies cicatrisant à l’air libre. Ces résultats ont été confirmés chez l’homme un an plus tard. 1962 À partir de cette invention, plusieurs types de laser virent le jour tels que le laser au gaz ou encore le laser à liquide, tous inventés grâce à de nombreuses découvertes scientifiques liées à la physique, à l’optique ou même à l’électronique quantique. 1961 Utilisation du laser pour une intervention chirurgicale oculaire. Au cours des années 90, ces nouvelles techniques seront peu à peu améliorées ce qui permettra alors de corriger la myopie ou l’hypermétropie efficacement et sans douleur. ANNÉES 1980 Les laboratoires mettent au point des pansements hydrocolloïdes permettant une cicatrisation en milieu humide. ANNÉES 1980 (5) Tiré de « Le pansement : toute une histoire ! », Magazine « Pharmélia », n° 63, mars 2013. XIXème SIÈCLE De nouveaux lasers toujours plus performants sont créés permettant ainsi de corriger d’autres maladies oculaires autrefois incurables. AUJOURD’HUI 2Le matériel réutilisable pouvant etre utilisé chez plusieurs patients en subissant, si nécessaire, entre chaque patient des procédures de désinfection et/ou de stérilisation Le pansementLES CONSOMMABLES Le concept de pansement existe depuis l’Égypte ancienne et a progressé de pair avec les nombreux conflits militaires qui ont émaillé les siècles. De simple soutien à la désinfection puis la cicatrisation, les écoles se sont affrontées longtemps avant d’arriver à la technologie actuelle où chaque type de plaie ou d’individu, peut trouver « son » pansement adapté. L’infirmière va être la principale actrice de la mise en place des pansements. Le laser dans le domaine de la chirurgie oculaireMATÉRIELS DE BLOC ET INSTRUMENTATION MÉDICO-CHIRURGICALE Ces dispositifs médicaux constituent des auxiliaires indispensables au travail des pro fessionnels de santé. Du trocart utilisé pour les ponctions et les biopsies en passant par les différents types de pinces (à dissection, pinces triangulaires, pinces plates Kocher, etc.) jusqu’à l’utilisation du laser aujourd’hui, les instruments chirurgicaux illustrent une nouvelle fois l’extrême diversité ainsi que les progrès technologiques du secteur. C’est l’ophtalmologiste qui a été le premier médecin spécialiste à utiliser le laser. LE SAVIEZ-VOUS ? dans l’histoire des dispositifs médicauxExemples d’évolution 1514 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 9. Le 1er appareil français pour l’anesthésie conçu et fabriqué à Marseille par le Dr Angelo Oddo. 1er aérosol dosé pressurisé (spray). 1er traitement à domicile pour les patients en insuffisance respiratoires. Développement de l’oxygénothérapie liquide, 1er appareil portatif, apparition des ventilateurs barométriques. Description du syndrome d’apnées obstructives du sommeil. 1er ventilateur autonome en air. Débuts de la ventilation par pression positive continue pour traiter les apnées du sommeil. 1ère utilisation d’oxygène liquide à domicile. Début du télésuivi et développement de technologies favorisant le confort des patients. Essor de la ventilation non invasive (masque).1er concentrateurs d’oxygène et 1er ventilateur en pression positive utilisé en réanimation. Invention du spirophore du Dr Eugène Woillez ventile par application d’une variation de pression externe. Début du monitorage (pression vasculaire, température et même pléthysmographie). 1848 1956 1967 1970 1976 1979 1981 1989 ANNÉES 2000ANNÉES 1980 ANNÉES 1960 18762ème MOITIÉ DU XIXème SIÈCLE Louis-Marie Ombrédanne invente pour l’anesthésie un dispositif de ventilation manuelle pour délivrer de l’éther. 1902 Premières ventilations mécaniques de longue durée. C’est la grande époque du poumon d’acier et des premières machines construites en grandes séries. Émergence de l’impression continue de la pression artérielle et de la visualisation continue de l’ECG sur un oscilloscope. Naissance de la ventilation invasive. 1ère MOITIÉ DU XXème SIÈCLE 1937-1938 1952 LA RESPIRATION Parce que la respiration est une fonction vitale, les soignants n’ont eu de cesse depuis toujours de rechercher des solutions pour pallier le dysfonctionnement et tenter de sauver les patients atteints de troubles et maladies respiratoires. dans l’histoire des dispositifs médicauxExemples d’évolution Réanimation, ventilation, monitorage, respiration à domicile 1716 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 10. Naissance de l’imagerie médicale avec la découverte des rayons X par le physicien W. Röntgen. Le premier échographe est mis au point par le médecin britannique John Julian Wild et l’électronicien John Reid. Développement des TEP. L’apparition des premiers TEP/ TDM va permettre des examens d’imagerie médicale par scintigraphie(6) capables de détecter à des stades de plus en plus précoces des anomalies du métabolisme et notamment le caractère cancéreux ou non de tumeurs (médecine nucléaire). L’ingénieur britannique Sir Godfrey Newbold Hounsfield invente la tomodensitométrie appelée couramment « scanner ». En 1973, développement de l’imagerie à résonance magnétique (IRM) grâce aux travaux sur la résonance magnétique nucléaire de Felix Bloch et Edward Purcell et notamment ceux de Paul Lauterbur et de Sir Peter Mansfield. Cette technique permet une exploration non invasive du corps humain par la détection des signaux de résonance magnétique nucléaire émis par les atomes d’hydrogène des tissus. Essor de la radiographie (grâce à Marie Curie) pour faire face aux nombreux blessés de guerre. On s’appuie de plus en plus sur l’aide qu’apportent les rayons X et la radiographie, dont la maîtrise mûrit chaque jour. Naissance de la tomographie par émission de positrons (TEP). 1895 1951 À PARTIR DES ANNÉES 1970 ANNÉES 2000 1971 1973DURANT LA 1ère GUERRE MONDIALE ANNÉES 1950 3Les équipements, technologies et produits connectés destinés à être utilisés en général chez plusieurs patients et comportant de la mécanique, de l’électronique, de l’électrique, de l’informatique L’IMAGERIE Les dispositifs médicaux liés à l’imagerie médicale ont révolutionné la médecine grâce aux nombreux progrès de l’informatique en permettant de rendre compte visuellement de l’anatomie, de la physiologie ou encore du métabolisme du corps humain. dans l’histoire des dispositifs médicauxExemples d’évolution Étudiant les rayons cathodiques,W. Röntgen remarque que ces derniers, une fois déchargés de leurs électrons, peuvent déterminer une certaine fluorescence en fonction du support utilisé. Il a alors l’idée de placer sa main entre ces rayons et le support : les ombres de l’os sur l’image sont plus sombres que celles de la main. Il vient de découvrir le principe de la radiographie. LE SAVIEZ- VOUS ? (6) Injection d’un traceur faiblement radioactif par voie intraveineuse. Les machines développées de nos jours sont des appareils inte- ropérables qui, d’année en année, permettent, avec une précision plus grande, de dépister, prélever, gérer la douleur, et soigner. En 1917, grâce à l’invention de Paul Langevin et Constantin Chilowski sur la détection sous-marine par ultra-sons appelée SONAR, naît la technique d’échographie dans le domaine de la médecine. LE SAVIEZ- VOUS ? Godfrey Newbold Hounsfield entreprend la construction d’un ordinateur prenant comme données des clichés radiographiques pris selon différents angles d’un même objet pour reconstruire une image de l’objet en tranches.A ses débuts, il fallait plus de deux heures à un scanner pour calculer une seule coupe tomographique du cerveau.Aujourd’hui, grâce à des ordinateurs beaucoup plus puissants et rapides, un scanner peut visualiser l’ensemble du corps, et cela en quelques secondes seulement. LE SAVIEZ-VOUS ? 1918 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 11. La création des tout premiers appareils auditifs est intimement liée aux études de la propagation des ondes sonores. Paul Langevin étudie la propagation et la réflexion des ondes sur des objets. Ses recherches ont largement été approfondies pour des raisons militaires avec la naissance du système de détection anti sous-marins, appelé « Sonar ». Les progrès scientifiques permettent de réduire considérablement la taille des appareils afin que ces derniers contournent l’oreille. Les avancées numériques permettent aux audioprothèses de devenir à programmation numérique. Les audioprothèses deviennent totalement numériques. Quant aux avancées électroniques et informatiques, elles aboutiront à l’amplification du nombre de transistors à l’intérieur de chaque appareil pour leur donner une puissance et une finesse toujours plus impressionnante. Miller Reese Hutchinson invente la première aide portative constituée d’un micro, d’un amplificateur et d’une batterie. Toutes ces études ont ainsi eu pour conséquence indirecte l’élaboration et l’amélioration des appareils auditifs. Les premiers appareils électriques font la taille d’une valise. DÉBUT DES ANNÉES 1830 1910 ANNÉES 1950 1987 1996 1905 ANNÉES 1920 AIDES TECHNIQUES Les aides techniques pour les personnes en situation de handicap sont tous les produits, instruments, équipement ou systèmes techniques, adaptés ou spécialement conçus, qui permettent de compenser, totalement ou en partie, une limitation d’activité d’une personne du fait de son handicap(7) . dans l’histoire des dispositifs médicaux Exemples d’évolution (7) Associations des Paralysés de France. Aides auditives à conduction aérienne Aujourd’hui, les appareils auditifs possèdent environ 2 500 000 transistors intégrés sur un circuit numérique de 10 mm2 réalisant 1 milliard d’opérations par seconde. LE SAVIEZ- VOUS ? 2120 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 12. et innovation Si beaucoup d’innovations du domaine des dispositifs médicaux représentent une révolution « en terme de prise en charge médicale » ou sur le plan de l’organisation des soins, d’autres se font plus graduellement, étape par étape sur un certain nombre d’années. R D Rappelons qu’un dispositif médical va épouser le rythme d’évolution technologique des différents secteurs dont il est issu (mécanique, électrique et électronique, informatique, nu- cléaire, etc.). (8) Rapport PIPAME 2011. (9) http://www.reseau-chu.org/mieux-connaitre-les-chu/1eres-medicales-mondiales/ Mise en place d’une bio prothèse pour rem- placement de la valve mitrale, Pr Alain Carpentier, AP-HP Prothèse totale de hanche sans ciment, (concept de fixation biologique de la prothèse par réhabitation osseuse directe de la surface métallique de la prothèse), Pr Robert Judet, AP-HP Implants cochléaires à huit canaux. L’implant multi canal permet au patient atteint de surdité de percevoir en plus du rythme et de l’intensité, la composition fréquentielle des sons, donc la parole. Pr Jean Louis Chouard, Pr Patrick Mc Leod et Pr Bernard Meyer, AP-HP Implantation d’une pompe à insuline chez un diabétique, Pr Jacques Mirouze, Pr Jean-Louis Selam, CHU Montpellier Pose du premier stent endo- coronnaire, Pr Jacques Puel en collaboration avec deux radiologues, les Prs Rousseau et Joffre, CHU Toulouse, Inserm U858 12MR Pose du premier stent carotidien, CHU Caen Opération à cœur ouvert assistée par ordinateur, Pr Alain Carpentier, AP-HP Implantation d’un prototype de pancréas artificiel, Pr Jacques Bringer, CHU Montpellier Premier implant du genou dessiné pour la femme, Pr Jean-Noël Argenson, AP-HM, 1ère mondiale en simultané avec le Pennsylvania Hospital (Philadelphie) Greffe d’un larynx artificiel sur un homme de 65 ans souffrant d’un cancer du larynx - Pr Christian Debry et son équipe 1ère implantation du cœur artificiel Carmat. Cette bioprothèse totalement autonome a été inventée par le Pr Alain Carpentier. L’intervention a été réalisée par le Pr Christian Latrémouille, chirurgien cardiovasculaire et le Pr Daniel Duveau, chirurgien thoracique Diabète, 1ère utilisation d’un pancréas artificiel autonome dans la vie courante - consortium de recherche international réunissant l’équipe d’Endocrinologie- Diabète du CHRU de Montpellier, les Universités de Padoue et de Pavie (Italie), et les Universités de Virginie à Charlottesville et de Californie à Santa Barbara (USA) Premier centre mondial d’implantation de pompes à insuline, Pr Jacques Bringer, CHU Montpellier 1968 1970 1974 1981 1986 1990 1998 2002 2006 2012 20132011 2004 Ce dynamisme de l’innovation dans le dispositif médical est le résultat d’une Recherche et Dé- veloppement (R D) publique et privée performante(8) . La France tient une place pré- pondérante dans le paysage des innovations et des pre- mières mondiales. QUELQUES EXEMPLES PARMI LES 101 PREMIÈRES MÉDICALES MONDIALES(9) DEPUIS 1958 : 2322 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 13. des dispositifs médicaux de l’e-santé Le marquage CE permet la mise sur le marché des DM dans l’ensemble des pays de l’union européenne. La réglementation des DM est relativement récente (1998 pour l’ensemble des dispositifs médicaux) et évolue dans le cadre de révisions successives en vue d’une amélioration continue (5 modifications des directives depuis 1998). Le monde numérique rencontre le monde de la santé et cela soulève bon nombre de questions pour l’ensemble des acteurs. Évolution de la réglementation L’essor Un nouveau projet de refonte des directives européennes sur les dispositifs médicaux est en cours d’examen par les institu- tions européennes. L’adoption définitive pourrait intervenir en 2015 ou début 2016 avec une entrée en vigueur en 2018/ début 2019. Il s’agit d’un ren- forcement sans précédent de la réglementation que propose la Commission européenne. Cette dernière en a entrepris la prépa- ration rapidement après avoir achevé la révision précédente intervenue en 2007 (directive 2007/47/CE). Les enjeux de la présente révision portent sur la nécessité de disposer de pro- cédures sûres au regard des exigences de sécurité sanitaire, et qui soient en même temps capables d’encourager l’inno- vation et de permettre ainsi un accès rapide aux patients et aux professionnels de santé. Il convient d’emblée de pré- ciser que toutes les solutions technologiques d’e-santé ne répondent pas nécessairement à la définition d’un dispositif médical, l’e-santé embrassant un domaine qui va au-delà de la télémédecine mais qui englobe notamment les objets connec- tés… dont tous ne sont pas des dispositifs médicaux. C’est en particulier au regard des critères d’utilisation des données par un profession- nel de santé et de finalité des données qu’une classification entre DM et non DM va pouvoir s’ordonner. Mais, on le voit bien, si certains objets connectés se situent davantage dans le péri- mètre du « bien-être » que dans celui de la santé, la frontière est parfois ténue et au demeurant toujours susceptible de s’affiner et d’évoluer avec le temps. Si l’on se tourne maintenant vers les DM connectés, on y trouvera des « objets connectés », des logiciels et enfin des DM com- municants tels que des défibril- lateurs cardiaques implantables communicants, des pompes à insuline communicantes ou des appareils de pression posi- tive continue communicants à l’usage des apnéiques du som- meil, etc. Ces derniers contri- buent à renforcer la qualité de service, la sécurité d’utilisation (capteurs embarqués ou am- biants, alarme notamment), la performance. Une profonde métamorphose dans l’organisation des soins Les bénéfices potentiels de la santé connectée commencent à être bien identifiés : une pré- vention accrue et une meilleure qualité de vie, un système de santé plus efficient et plus du- rable et une responsabilisation des patients. Il convient aussi de souligner que l’une des conséquences de la montée en puissance de l’e- santé est la multiplication expo- nentielle des données de santé, avec les problématiques asso- ciées d’exploitation, de fiabilité, de sécurité et de confidentialité de ces données. 2524 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 14. Acte remboursé ? DM marqué CE ACTE OUIOUI Inscription sur la LPPR et la liste en sus À renouveler tous les 5 ans maximum Auto- inscription sur la LPPR(13) Inscription sur la liste positive À renouveler tous les 5 ans maximum PAS de remboursement Auto- inscription sur la liste positive(13) Rembour- sement via le GHS Inscription sur la LPPR PAS de remboursement MIGAC MERRI Avis favorable Avis favorable Avis défavorable Avis favorable Avis défavorable Avis défavorable PAS d’utilisation possible du DM Inscription CCAM, NGAP… CEPS Tarification ! ! ! CNEDIMTS Évaluation médico- technique(11) UNCAM hiérarchisation Tarification de l’acte HAS CNEDIMTS Évaluation médico technique(10) CNEDIMTS Évaluation médico- technique(12) Description générique correspondant au DM ? Appartient à une catégorie homogène de DM inscrit sur la liste positive (L165-11) ? Prise en charge dans les GHS ? Prise en charge dans les GHS ? DM éligible à la LPPR ? ! ! nonnon nonnon nonnon NONNON nonnon nonnon nonnonouioui ouioui ouioui ouioui ouioui ouioui Description générique correspondant au DM sur la LPPR ? ANSM Validation de la conformité technique renforcérenforcé FORFAIT INNOVATION L 165-1-1 Pour les DM innovants (bénéfice clinique important et ou réduction des co ts) ne disposant pas de données cliniques suffisantes une prise en charge temporaire et dérogatoire peut tre envisagée après avis de la HAS et décision ministérielle sous condition de la réalisation d’une étude ACTE DM marqué CE ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé CCAM : Classification commune des actes médicaux CEEPS : Commission évaluation économique et de santé publique CEPS : Comité économique des produits de santé CNEDiMTS : Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé DM : Dispositif médical GHS : Groupe homogène de séjour HAS : Haute autorité de santé LPPR : Liste des produits et prestations remboursables MERRI : Missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation MIGAC : Missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation NGAP : Nomenclature générale des actes professionnels UNICAM : Union nationale des caisses d’assurance maladie Inscription CCAM, NGAP… PAS de remboursement Avis favorable Avis d’efficience Avis défavorable Autoinscription sur la LPPR(12) Inscription sur la LPPR Inscription sur la LPPR À renouveler tous les 5 ans maximum Soit pris en charge via l’acte, soit à la charge du patient Avis favorable Avis défavorable PAS de remboursement CEPS Tarification ! UNCAM hiérarchisation Tarification de l’acte NONNON CNEDIMTS Évaluation médico- technique(11) CEESP Évaluation médico- économique ANSM Validation de la conformité technique ! Description générique correspondant au DM ? Demander une inscription en nom de marque nonnonouioui nonnonouioui ! HAS CNEDIMTS Évaluation médico- technique(10) nonnon Acte nécessaire à l’utilisation du DM? OUIOUI DM éligible à la LPPR ?Acte remboursé ? ouioui classique renforcéclassique renforcé Produit innovant FORFAIT INNOVATION L 165-1-1 Pour les DM innovants (bénéfice clinique important et/ou réduction des coûts) ne disposant pas de données cliniques suffisantes, une prise en charge temporaire et dérogatoire peut être envisagée après avis de la HAS et décision ministérielle sous condition de la réalisation d’une étude au marché L’accès Le remboursement des DM à l’hôpital Le remboursement des DM en ville La HAS émet des avis. Le Ministre reste souverain de la décision publique (publication au JO)La HAS émet des avis. Le Ministre reste souverain de la décision publique (publication au JO) Exigence forte de données cliniques et médico-économiques pour l’accès et le maintien sur le marché Possibilité d’exigence d’études post-inscriptions! ! (10) Dépôt d’une demande d’évaluation et d’inscription de l’Acte par la ou les Société(s) Savante(s) (11) Dépôt d’une demande d’inscription sur la LPPR par l’entreprise auprès de la CNEDiMTS et du CEPS (12) Dépôt d’une demande d’inscription sur la liste L165-11 par l’entreprise auprès de la CNEDiMTS (13) Révision des lignes génériques tous les 5 ans 2726 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 15. du secteur Évolution Aujourd’hui en 2015, la France doit rester un terreau d’innova- tions, ce qui passe nécessaire- ment par la capacité qui sera laissée dans les années qui viennent aux nouveaux entre- preneurs et plus largement aux entreprises présentes sur notre territoire à continuer à faire de la recherche et à produire. Or depuis quelques années, les entreprises du secteur des dis- positifs médicaux (DM) connaissent une accélération sans précédent des exigences juridico-réglementaires qui leur sont opposables et ce, le plus souvent en procédant malheu- reusement par « copier-coller » du modèle en vigueur dans le médicament. Par ailleurs, l’em- prise grandissante « du principe de précaution » dans notre so- ciété renchérit sans cesse le coût d’accès à l’innovation et met à mal l’objectif d’une médecine pour tous. Enfin, l’impact pra- tique des nouvelles sujétions de- mandées aux entreprises en termes de transparence (éthique) ou de filières environnementales, pour ne prendre que ces deux exemples, est considérable sur un secteur composé à plus de 94 % de PME. Ces éléments doivent absolument être pris en compte par les autorités de notre pays. A cet égard, l’existence du Conseil Stratégique des indus- tries de santé (CSIS) constitue une plateforme essentielle pour absorber les questions d’attracti- vité que se posent ces industries. 28 Le secteur des dispositifs médicaux 29Le secteur des dispositifs médicaux du secteur Données clés La France s’illustre dans les avancées médicales touchant au secteur des dispositifs médicaux. Ce secteur est le fruit d’une recherche médicale d’excellence portée par une formation et des infrastructures performantes. Mais il a également été rendu possible par le « foisonnement technologique » du secteur des dispositifs médicaux sur la période considérée (1958/2008).
- 16. La part des ouvriers est en re- vanche inférieure à la moyenne de l’industrie manufacturière car les entreprises du dispositif médical présentent en moyenne des organisations soutenues en RD et des positionnements souvent fortement ancrés sur la commercialisation, l’instal- lation et/ou l’après-vente. Les fonctions transverses sont en constante évolution (qualité, af- faires réglementaires, …). Les évolutions de l’environne- ment du secteur (demande, technologie et réglementation) ont fortement impacté les mé- tiers et les compétences des en- treprises de dispositifs médicaux au niveau de toutes les familles professionnelles. Répartition des effectifs selon leur statut Cadres Employés Techniciens, professions intermédiaire Ouvriers 28% 43% 11% 18% Répartition des effectifs selon le niveau d’études 8% 15% 11% 20% 22% 19% 5% Autres CEP Bac +3/4 Bac +2 Bac +5 Bac CAP, BEP Sans diplôme Répartition : métiers/effectifs des adhérents Snitem RD Maintenance / Installation / Application Qualité / Affaires règlementaires / Accès au marché transverse Marketing Commercialisation Administratif financier Autres Production 28% 33% 8% 9% 4% 14% 4% Sources : rapport CEP 2010/rapport PIPAME 2011. industrie de la santé (médicaments humain et vétérinaires, dispositifs technologies médicales et diagnostic in vitro) rassemble 175 000 salariés. Le dispositif technologie mé- dical emploie à lui seul plus de 65 000 personnes. Le Snitem représente 375 en- treprises et emploie environ 35 000 personnes. Les effectifs sont stables depuis 2009 car la pression sur les prix et le renforcement de la régle- mentation ont conduit les ac- teurs du secteur des dispositifs médicaux à s’internationaliser et à rationaliser leurs coûts. Le profil des salariés résulte éga- lement de la nature de l’activité, à la fois industrielle, technolo- gique et médicale du secteur. Ainsi, la répartition des effectifs par niveau d’études laisse appa- raître une forte proportion de niveaux CAP/BEP, Bac et Bac +2. onnées clésDo du secteur L’ LES MÉTIERS DE LA PRODUCTION : • Une montée en puissance des filières contrôle et assurance qualité pour répondre au renforcement des exigences réglementaires et à l’émergence des problématiques liées à l’environnement • Un renforcement des compétences de pilotage et de management de la performance portés par les grandes entreprises dans le cadre des changements organisationnels induits par l’automatisation des process et l’informatisation des équipements • Une orientation observée des métiers de la maintenance vers le conseil et la diffusion de méthode LES MÉTIERS DE LA RD : • Un décloisonnement des spécialités et un renforcement du travail collaboratif • Des doubles profils scientifique et réglementaire très recherchés • Un renforcement des compétences techniques et technologiques de pointe pour faire face à l’évolution rapide des technologies, la diversité et la sophistication croissante des produits et à la combinaison de plusieurs savoir-faire pour la conception d’un même dispositif et les évolutions technologies connexes • Une intégration croissante des problématique RSE dès l’amont des projets LES MÉTIERS DE LA COMMERCIALISATION : • Une maîtrise des connaissances techniques produits plus pointues et le développement d’une posture de conseil qui la relation client au centre des préoccupations des acteurs du marché • Une montée en compétences en vente et en négociation et renforcement de la dimension éthique du métier face à la nouvelle organisation des achats hospitaliers et aux évolutions des relations entre profes- sionnels de santé et industriels • Un renforcement et une élévation du niveau de compétences techniques en maintenance nécessitée par le développement d’offres complètes de services De nombreuses formations diplômantes conduisant à ces métiers, existent sur le territoire national, en formation initiale et continue ainsi que par la voie de l’alternance. Pour plus d’informations, consulter le site de l’institut des métiers et formations des industries de santé : www.imfis.fr Emploi et métier 3130 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 17. Sources : « Étude sur la télésanté et la télémédecine en Europe », ASIP Santé/FIEEC, mars 2011/Les Échos du 21 décembre 2011.Source : rapport PIPAME 2011/Eucomed. onnées clésDo du secteur STRUCTURATION DU MARCHÉ FRANÇAIS : • Le marché global de l’informatisation de la santé serait compris entre 2,2 et 3 milliards d’euros par an • Celui de la télésanté entre 200 et 300 millions d’euros • Le marché de la télémédecine entre 80 et 140 millions d’euros • 200 acteurs présents sur ce marché. 30 seulement avec un chiffre d’affaires allant de 700 000 euros à 5 millions d’euros • Les éditeurs assurent 39 % du marché, les SSII 16 %, les constructeurs 14 % L’EMPLOI : • Le secteur de l’informatisation des soins : 22 500 et 30 700 emplois équivalent temps plein (ETP) en France, dont 75 % environ dans le secteur IIEC • La télémédecine : 1 500 à 2 000 ETP en France, tous secteurs confondus, dont 800 à 1 400 dans le secteur de l’ingénierie, de l’informatique, des études et du conseil (IIEC) • La télésanté : 2 000 à 3 000 ETP • Le domaine de l’informatique (éditeurs de logiciels + SSII) est le principal gisement d’emplois (respectivement 35 et 30 %) • 1 500 à 2 000 embauches par an seraient possibles LES ÉCONOMIES POTENTIELLES RÉALISÉES GRÂCE À LA E-SANTÉ : • Les gains financiers liés au seul déploiement de la télémédecine et portant sur quatre pathologies chroniques majeures sont estimés entre 925 et 12 035 euros par patient et par an • Les maladies chroniques concernent environ 15 millions de Français • Selon le réseau de télémédecine Medcom à l’hôpital universitaire d’Odense au Danemark, les bénéfices enregis- trées grâce à l’utilisation du réseau de communication de télésanté au niveau national sont un gain de 50 minutes par jour et par médecin, une diminution de 66% des appels téléphoniques de patients et 2,3 euros d’économie par transaction soit 60 millions d’euros par an • Grâce à une application de télédermatologie aux Pays-Bas, le temps de réponse du spécialiste a été réduit à 4 ou 5 heures au lieu des 6 à 8 semaines dans le parcours de soins traditionnel • Selon certaines études, la télésanté pourrait contribuer à réduire le nombre d’hospitalisations de 30 à 50 % et allongerait la vie des patients de 15 à 55 %. E-santé Le marché du DM et le tissu industriel MONDE En 2010, le marché mondial des DM est évalué à environ à environ 200 milliards d’euros. EUROPE 25 000 entreprises. Plus de 575 000 salariés composée à 95 % de PME. En 2010, le marché européen est estimé à environ 100 milliards d’euros (soit 50 % du marché mondial) et croît au rythme de 4 %. Répartition du marché par type de dispositif médical Usage individuel Diagnostic in vitro E-santé Équipements Source : rapport PIPAME juin 2011 64% 21% 13% 2% FRANCE Plus d’un millier d’entreprises. Plus de 65 000 salariés. En 2010, le marché français est estimé à 20 milliards d’euros soit près de 10 % du marché global. La France est le 4ème acteur mondial, le 2ème acteur européen (en termes de CA produit sur son territoire) et le 2ème en taille de marché après les USA. En France, plus de 1 000 entreprises (auxquelles il faut ajouter 350 sous-traitants et 354 distributeurs spécialisés) 75 % sont localisés dans 4 régions : Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA, Alsace. 94 % de PME, dont 45 % de TPE et 2 % d’ETI. À savoir : La filière des implants orthopédiques représente 10 000 emplois en France - 1/3 de la production mondiale (dont 65 % est exportée). Plus de 1 000 fabricants implantés en France sont des filiales24% sont d’origine française76% SNITEM 375 adhérents, représentant 35 000 salariés composés à 89 % de TPE/PME. En 2013, le Snitem a un périmètre correspon- dant à un chiffre d’affaires de 12 milliards. L’e-santé peut être définie comme « l’application des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé » et/ou « la fourniture de soins à distance » La révolution numérique est en mesure de perme re un développement considérable de la médecine personnalisée et préventive, avec un profond bouleversement du système de santé (aspects médicaux et économiques) : En savoir plus : À ce jour, les pays qui exportent le plus sont les Etats-Unis pour l’Amérique du Nord et l’Allemagne pour l’Europe. Étude prospective menée par PricewaterhouseCoopers : les pays émergents tels que la Chine, l’Inde ou le Brésil auront, d’ici 10 ans, dépassé les Etats-Unis dans leur capacité à produire les dernières technologies innovantes. 3332 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux
- 18. 35Le secteur des dispositifs médicaux Données clés du secteur n 2013, 41 % des inno- vations viennent d’Europe soit 10 000 nouveaux bre- vets dans ce secteur, soit 1 nouveau brevet déposé toutes les 50 minutes en Europe. Un cycle d’innovation qui se situe entre 18 et 24 mois. Plus de 1 000 fabricants fran- çais et d’origine étrangère sont implantés en France. L’industrie des dispositifs médicaux béné- ficie en France d’un potentiel collaboratif de RD important, constitué de laboratoires au sein des universités, de CHU, et de grands organismes de recherche (CEA, CNRS, INRIA, INSERM, etc.). 76 % des entreprises ont des activités dédiées à la RD. La France se place en 5ème posi- tion pour le nombre de dépôt de brevets européens et internatio- naux. La France représente environ 10 % des brevets déposés en Europe. Le chiffre d’affaires investi en RD par les entreprises implan- tées en France ayant une activité de recherche et/ou de produc- tion est d’environ 6 %. E Recherche et développement 34 Le secteur des dispositifs médicaux photos Galerie
- 19. 3736 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Aides techniques et compensation du handicap Collant de compression Prothèse de membre inférieur Culotte collant de compression Fauteuil roulant manuel Bandage pneumatique de coude Dispositif de contention-compression, non tubulaire, ajustable Bas de compression autofixant Prothèse de main Retire bas Fauteuil roulant électrique Tubes à prélèvement pour analyses biologiques Chaussettes de compression Chaussettes de compression Prothèse de membre inférieur Prothèse de membre inférieur Tire-lait Bande de compression veineuse
- 20. 3938 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Défibrillateur Moniteur Moniteur multi-paramétrique compact / de transport / à réseau sans fil Respirateur de soins intensifs, réanimation Moniteur Respirateur de ventilation non-invasive Défibrillateur Moniteur de surveillance Anesthésie réanimation Bouée de maintien et cale-tête Coussin de siège en gel visco élastique Chausson de protection des zones à risque des escarres du pied Positionnement du talon Matelas mousse Matelas thérapeutique automatique à air Talonnière en mousse Coussin d’aide à la prévention des escarres à cellules pneumatiques Coussin fibre pour décubitus latéral Système de décharge coccygiène Aide à la prévention des escarres
- 21. 4140 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Audiologie Kit main-libre Aide auditive pour enfant Processeur d’implant cochléaire avec antenne Implant du tronc cérébral Émetteur audio TV Station de charge Implant oreille moyenne Implant du tronc cérébral Protection étanche baignade Processeurs d’implant cochléaire Implant cochléaire Kit main-libre Processeur de son Aide auditive Aide auditive Aide auditive Tour de cou pour connexion téléphone et télévision Aide auditive Aide auditive Aide auditive Aide auditive Aide auditive Télécommande et relais audio
- 22. 4342 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Pansement à l’alginate de calcium Système de prise en charge des incisions chirurgicales Set et pack stériles Compresses et tampons en non tissé Bande de crêpe Set et pack stériles Traitement des plaies par pression négative Plaies et cicatrisation Pansement de fibres de CMC Pansement hydrocellulaire sacrum Traitement des plaies par pression négative Set de soin postopératoire Bande de contention Sutures cutanées adhésives sur déchirure ou incision chirurgicale Pansement interface Sutures adhésives Pansement adhésif avec compresse Pansement hydrocellulaire silicone absorbant
- 23. 4544 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Bloc opératoire Micro-ciseaux Trocart Antiseptique à base de chiorexidine Masque chirurgical avec élastique Plombs de verrouillage pour conteneurs de stérilisation Moteur électrique pour ORL, neurochirurgie et chirurgie du rachis Composants trousse chirurgicale Trousse de coelioscopie bariatrique Porte-aiguille Moteur à batterie pour la chirurgie de la main et du pied Gant de chirurgie standard Aiguilles à stylos pour patients en auto traitement Pompe externe à insuline et système de mesure du glucose en continu Lecteur de glycémie Lecteur de glycémie Système intégré couplant un capteur de glucose en continu à une pompe externe à insuline Stylos injecteurs Aiguilles à stylo sécurisées Système de pompe implantable par voie intrapéritonéale Aiguilles pour stylo injecteur Diabète
- 24. 4746 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Cardiologie Stent vasculaire Stent coronaire à élution de principe actif Défibrillateur cardiaque implantable Stimulateur cardiaque double chambre et sondes de stimulation Stent coronaire en Cobalt-Chrome expansible par ballonet Bioprothèse valvulaire péricardiaque Système de dénervation rénale par radiofréquence Moniteur cardiaque implantable Stent biorésorbale en polymère expansible par ballonet Simulateur cardiaque sans sonde Système de défibrillation et de monitorage modulable tripartie Cathéterisme veineux central à insertion périphérique Prothèse valvulaire cardiaque biologique Valve mécanique Valve mécanique Stent coronaire en chrome cobalt
- 25. 4948 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Dialyse Cycleur d’hémodialyse à domicile Générateur de dialyse plus particulièrement utilisé en auto dialyse Cathéter de dialyse chronique Equipement d’hémodialyse quotidienne à domicile Set artério veineux Cathéter pour dialyse en réanimation Système de monitorage d’hémodialyse pour la surveillance des abords vasculaires Aiguille à fistule sécurisée Système de dialyse péritonéale automatisé Logiciel de monitorage de la dialyse Table de radiologie numérique Mobile de radiologie Système numérique pour examens mammographiques Système d’imagerie par opératoire numérique Tomographie par émission de positions (TEP) Echographe portable Système d’imagerie par résonance magnétique Système guidé par image pour la radiologie interventionnelle Table de radiologie Scanner Système d’imagerie par résonance magnétique Échographe Imagerie
- 26. 5150 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Gastro-digestif Implant semi-résorbable pour la chirurgie herniaire Trocart endorectal sous assistance vidéo Cathéter de pose d’implant de contraception définitive Patch herniaire avec système d’introduction destiné au traitement chirurgical et mini-invasif des hernies ombilicales, des éventrations sur trous de trocart et des petites éventrations Poche de stomie Implant tubulaire de contraception définitive Système d’irrigation transanale Ciseaux laparoscopiques Implant pour traitement des prolapsus par voie cœlioscopique Gynécologie Orthèses Orthèse pouce Orthèse poignet Chevillère Attelle d’immobilisation du genou Ceinture lombaire Ceinture lombaire pour femme enceinte Attelle d’immobilisation de cheville Ceinture lombaire Genouillière Chaussure pour plâtre Orthèse Genou
- 27. 5352 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Neurologie Instruments d’implantation Moniteur de nerfs près opératoire Stent intracrânien Gammes d’électrodes Système de stimulation cérébrale profonde Dispositif pour thrombectomie Electrode intracérébrale Système de stimulation cérébrale profonde Microcoil Traitements de RCMI Appareil de mesure des défauts optiques Implant monofocal Implant accommodatif à double optique Laser pour correction de défauts visuels Implant multifocal Ophtalmologie Salle Biplan Système d’angiographie
- 28. 5554 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Orthopédie Système d’ostéosynthèse postérieureCage plaque cervicale pour arthrodèse cervicale Système d’ancrage vissé de réinsertion de la coiffe des rotateurs absorbables Prothèse totale du genou Prothèse totale de genou à charnièreProthèse totale d’épaule inversée Tige fémorale courte de première intention sans ciment Gris foncé : tige cimentée Gris clair : tige non cimentée Clou pour fractures du fémurProthèse de disque cervicale pour la chirurgie du rachis Montage d’implants vertébraux pour correction de déformation rachidienne infantile Prothèse d’épaule Prothèse de disque lombaire modulaireSubstitut osseux synthétique en seringue Instrumentation rachidienne rachidienne thoraco-lombaire Prothèse totale de hanche sans ciment Implant avec ancrage et option d’injection d’un ciment osseux Tige courte Prothèse d’épaule inverséeProthèse d’épaule Os temporal synthétiqueClou centromédullaire Cage intersomatique lombaire
- 29. 5756 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Respiration Aérosol pneumatique sonique Prothèse d’avancée mandibulaire Masque nasal pour le traitement de l’apnée du sommeil et de l’insuffisance respiratoire Dispositif de ventilation Masque narinaire pour le traitement de l’apnée du sommeil Solution de télésuivi multi PPC Compresseur nébuliseur enfant Oxygénothérapie de déambulation - bouteille remplie avec station de remplissage Respirateur à domicile Solution de télémedecine pour l’apnée du sommeil ou l’insuffisance respiratoire Appareil de désencombrement bronchique Masque facial pour le traitement de l’apnée du sommeil Orthèse d’avancée mandibulaire dans le traitement de l’apnée du sommeil Nébuliseur pulmonaire Polygraphe polysomnographe Ventilateur Concentrateur d’oxygène transportable Aérosol Masque narinaire pour le traitement de l’apnée du sommeil Compresseur nébuliseur Dépistage des troubles du sommeil respiratoire Ventilateur mixte
- 30. 5958 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Urologie Set autosondage Panier endoscopique pour extraction de calculs salivaires Urétrotomefibroscope Poche de recueil urinaire Bandelette sous-urétrale à abord rétropubien Lithotripteur intracorporel / portatif Système d’endomicroscopie confocale par minisonde Sonde intermittente Tuteurs urétraux double crosse Fibre laser pour traitement lithiase et tumeur Sonde prostatique silicone Implant pour le traitement des prolapsus par voie cœlioscopique Lithotriteur modulaire Ciseaux laparoscopoque Mini-bandelette ajustable pour la correction de l’incontinence urinaire Sonde vésicale type Foley, forme droite, pour homme Poche de recueil Dispositif prothétique pour le traitement chirurgical de l’incontinence féminine d’effort Set de poches de recueil Sondage urinaire intermittent Set de sondage spécifique femme Prothèses testiculaires
- 31. 6160 Le secteur des dispositifs médicauxLe secteur des dispositifs médicaux Injection-perfusion Seringues sécurisées pour gaz du sang Pousse seringue Chambre à cathéter implantable Diffuseur portable Pompe à perfusion ambulatoire multithérapie double voie Valve bidirectionelle transparente Cathéters centraux veineux à insertion périphérique injectables sans valve intégrée Set de soins à domicile Pousse seringue Perfuseur 3 voies déroulé PICC line et ses éléments de pose Diffuseur portable Set de perfusion - pose de voie veineuse périphérique PICC lines Pompe à perfusion Composants d’un set destiné aux soins sur PICC line Aiguille de ponction veineuse ou artérielle sécurisée Aiguilles de Huber sécurisées Canule de trachéotomie Cathéter veineux périphérique sécurité active avec ou sans valve de contrôle reflux sanguin Cathéter court veineux Cathéter veineux périphérique sécurité passive Aiguille de Huber sécurisée Perfuseur de sécurité
- 32. Sources : • Que sais-je « Le dispositif médical », 1ère édition 2009 citant le Pr François Prigent « L’histoire des pro- thèses de hanche » • « Petites histoire des plaies et du pansement », de Thierry Le Guyadec • Associations des Paralysés de France • « L’industrie du dispositif médical est parfois considérée, à tort, comme un sous-secteur de l’industrie du médicament », citation de Vincent Chriqui, directeur du Centre d’analyse stratégique (CAS) dans le rapport du CAS sur le dispositif médical innovant (2013) • Guide pratique de la HAS « Parcours du dispositif médical » • Rapport PIPAME - Ministère de l’industrie, Juin 2011 • « Étude sur la télésanté et la télémédecine en Europe », ASIP Santé/FIEEC, mars 2011 • Rapport CAS (Centre d’Analyse Stratégique) - 2013 • www.reseau-chu.org/mieux-connaitre-les-chu/1eres-medicales-mondiales/ • « L’histoire de l’opération de la cataracte » (site du Syndicat National des Ophtalmologistes de France) • Site de l’apnée du sommeil • www.eucomed.org • CEP 2010 • Ministère de l’industrie • Le Point du 21 août 2014 • Les Échos du 21 décembre 2011 Conception / réalisation : EN COULISSES Crédits photo : Action d’éclat (couverture). 3M France. Abbott France. ABC. Accuray Europe SAS. Air Liquide Medical Systems. AMO France. Aspide Medical. AudioMedi. B. Braun Medical. Bard France SAS. Baxter SAS. BD France (Becton Dickinson). Biomatlante SA. Biomet France. Carefusion France. Carpenter France. Cizeta Medicali 2015. Cochlear. Collin SAS. Coloplast Laboratoire. Conceptus SA. Convatec Laboratoire. Cook Medical. Cooper (Cooperation Pharmaceutique Francaise). Cousin Biotech SAS. Covidien France SAS. DFT Medical - Diffusion Technique Française. Dixi Microtechniques. DJO France. Edap TMS. Edwards Lifesciences. Esaote Medical. Fresenius Medical care. Fujifilm Medical Systems France. GE Medical Systems SCS. Gibaud SASU. GN Hearing SAS. Hartmann Paul. Hemadialyse. Hemotech SAS. Invacare Poirier. Karl Storz Endoscopie France. Karl Storz Endoscopie France. KCI Medical. Landanger SAS. LDR Medical SAS. Lohmann et Rauscher. Maquet SAS. Mauna Kea Tech. Med-El Hearing Technology. Meditor SAS. Medtronic France. Mönlycke Health Care. Nihon Kohden. Otto Bock France. Perouse Medical SAS. PFM Medical France. Pharmaouest Industries. Philips France. Phonak France. Physidia SASU. Primax Imagerie Médicale. Prodition/Oticon. Prodition Groupe. Proteor Handicap Technologie. Raffin Pansements. Roche Diagnostics. Saint Jude Medical. Sanofi-Aventis France. SERF. Siemens Healthcare France. Sigvaris SAS. Sivantos SAS. Smith Nephew SAS. Smiths Medical France. SomnoMed France. Spineway SA. SRETT Medical. Stryker France. Synthes, DePuy et Ethicon / Cie JJ. Syst’am. Teleflex Medical. Tetra Medical. Theradial SAS. THT Bio Science. Thuasne / Studio Carterin. Tornier SASU. URGO Laboratoire. Vermeiren France. Vygon SA. Weinmann SAS. Winncare Group (Asklé Santé et Médicatlantic). Ypsomed AG. Zimmer France. Fotolia / ag visuell. @ 2015 SNITEM 62 Le secteur des dispositifs médicaux Injection-perfusion(suite) Aiguille de Huber sécurisée Système de seringue en verre pré-remplissable Cathéter péridural Dispositif d’auto-injection
- 33. Édition de juin 2015 92038 Paris-La Défense Cedex Tél. : 01 47 17 63 88 Fax : 01 47 17 63 89 www.snitem.fr info@snitem.fr SNITEM @SNITEM
