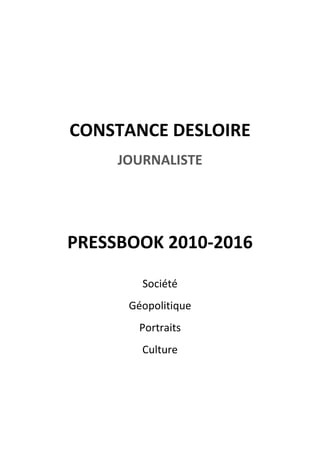
Pressbook C. Desloire 2016
- 2. SOCIÉTÉ
- 18. 961, la bière branchée qui veut éduquer les palais des Libanais En 2006, sous les bombes israélienness un entrepreneur de 33 ans crée une nouvelle marque de bière pour casser le monopole de la Almaza. C’est écolo, tendance, et sacrément bien markété. - - Acôté d’une gastronomie libanaise exceptionnelle, l’offre de bière n’est pas au niveau. C’est le constat que fait Mazen Hajjar il y a sept ans, et qui le décide à offrir aux consommateurs un réel choix. A trente-trois ans, influencé par l’Angleterre où il a accompli ses études, il ambitionne alors rien de moins que d’éduquer les palais libanais à la mousseuse, en duo avec un investisseur danois sentant le bon coup. Cheveux mi-longs et baskets, penché en arrière dans un fauteuil à roulettes au dernier étage de son usine des environs de Beyrouth, le PDG de la Bière 961 avance que «la bière aurait été inventée ici autour de – 9.000 avant JC. Dommage que la tradition se soit perdue…» Le marché de la bière au pays du Cèdre est un quasi monopole depuis des décennies. La bière nationale, c’est la Almaza. Pour se tailler une place au forceps à ses côtés, les deux entrepreneurs ont dû surmonter deux contraintes culturelles majeures. D’abord, l’influence française depuis le mandat colonial, qui veut que le vin soit noble, mais la bière faite pour les paysans. Ensuite, l’influence musulmane, qui interdit grosso modo l’alcool. Proposer une alternative Première approche tactique, 961 ouvre un bar entre 2007 et 2009 dans le quartier Mar Mikhael, devenu ces dernières années le point de rassemblement des artistes et des jeunes dans le vent. Objectif: faire découvrir autre chose que la Almaza, marque du groupe Heineken, «dégueulasse» nous dit Mazen Hajjar tout en chiquant une nouvelle feuille de tabac tous les quarts d’heure.
- 19. L’expérience permet de faire connaître la marque et tester différents goûts, même si elle ne rapporte guère financièrement. La société poursuit sa mission de diversification et propose aujourd’hui six bières de recettes différentes. Du jamais vu au Liban. La petite dernière mise en vente en octobre 2012, Pale Ale, n’est constituée que d’épices nationales: thym, sumac, anis, camomille, sauge et menthe. En ce moment les brasseurs expérimentent aussi aux Etats-Unis une recette au café et à la cardamone à huit degrés, tandis que la marque travaille sur une boisson hybride bière/vin… «Nous avons développé la culture de la bière au Liban, se targue Hajjar. A présent les gens veulent assortir leur bière à ce qu’ils mangent!» Pas encore adoptée partout Au rez-de-chaussée d’une auberge de jeunesse, logée dans une vieille maison du quartier Mar Mikhael, le restaurant-bar- chicha Oum Nazih est très prisé par les jeunes. On y sert de la 961 à la pression, en pichet ou dans des verres en plastique. Pourtant c’est une Almaza que Zahraa, jeune Libanaise de 28 ans, tient entre les mains: «Personnellement, je n’aime pas la 961. Même si à l’étranger, je prends plaisir à goûter d’autres bières, au Liban, je préfère boire Almaza pour son goût. Dans la 961, il y a une sorte d’amertume et un ajout d’épices…. Et puis c’est difficile d’imaginer qu’une bière remplace Almaza! Nous avons une attache sentimentale à cette marque.» Son amie Anne, une jeune Française habitant au Liban, a opté pour une 961 Red Ale: «C’est vrai que la Almaza est plus fraîche et si j’ai soif, je vote pour elle. Il fait souvent chaud au Liban. La 961, c’est quand je choisis de déguster: on prend le temps de l’apprécier et d’y déceler tous les arômes comme l’on ferait pour du vin. » Vieux réflexes Sensiblement au même prix que la Almaza, 961 est distribuée dans 300 points de vente du pays, et est servie en pression dans 35 bars de la capitale. Mais beaucoup de bistrots, même branchés, ne la proposent pas. «Les cafetiers nous demandent souvent ‘Pourquoi je proposerais ta bière? Qu’est-ce que tu m’offres?’ râle Mazen Hajjar. Il n’y a pas encore dans ce pays la culture du libre choix des consommateurs. Il faut que les gens se plaignent de ne pas nous trouver!» Mais visiblement, ce n’est pas encore le cas. Dans le nouveau centre ville chic, à Saifi Village, un barman soupire: «On est tellement habitués à la Almaza que je ne me pose pas de questions. Beaucoup de gens ici ne se posent pas de questions.» Chez Abou Elie, ancien bar communiste, le choix est clair. «Pourquoi nous n’avons pas de 961? Parce que je ne la trouve pas bonne, argumente Ali, son serveur emblématique. Mon patron ne la trouve pas bonne non plus et il n’y a pas de demande de la part des clients.» Le pari n’est pas encore gagné du côté des professionnels.
- 20. Patriotique et écolo Comme Almaza, qui est un emblème national, 961 se veut pourtant patriotique. 961 est l’indicatif téléphonique international du Liban, et la firme utilise autant que possible des ingrédients de producteurs nationaux. C’est aussi une bière écolo, proposée dans un verre brun et non vert, comme l’exigent les meilleures conditions de préservation à la lumière. 961 doit également être servie à tout prix dans un verre, et non bue au goulot. Plusieurs années durant, l’injonction apparaissait sur une étiquette collée aux bouteilles. L’entreprise refuse les additifs chimiques et poursuit un objectif d’empreinte carbone à zéro. La marque proclame rejeter toute forme de publicité sur aucun support media, en opposition aux lourdes campagnes de télévisions et d’affichage d’Almaza. Par le bouche à oreille, 961 s’est pourtant bâti un joli mythe fondateur qui contribue à son succès. Riche PDG d’une compagnie d’aviation aux Emirats, Mazen Hajjar se lasse et abandonne tout pour rentrer dans son pays. Sous les bombes israéliennes pendant la guerre de l’ été 2006, il commence peu après à brasser dans son arrière-cuisine en lisant l’autobiographie du patron de la Brooklyn Brewery, achetée sur Amazon. La passion, le fun... et l'argent 961 cultive une image de marque jeune, branchée et engagée, David contre Goliath. Le jeune chef d’entreprise parle, dans un anglais parfait, d’une aventure «fruit de la seule passion, jamais de l’esprit». Il montre aux journalistes plusieurs vidéos documentaires sur Google. L’une d’elles est l’enquête d’un journaliste suédois qui piège le patron du brasseur international Stella Artois, incapable de reconnaître ses propres produits au goût, les yeux fermés. Et Mazen transforme l’interview en dégustation. Mû, dit-il, par la seule volonté de sortir le public de l’aveuglement de la binouze unique et par la quête du «fun», Mazen Hajjar, par conséquent, ne souhaite pas parler d’argent. Il refuse d’indiquer combien rapporte aujourd’hui sa PME de quinze employés. Mais au Liban, il est extrêmement rare qu’une entreprise fournisse ses résultats chiffrés à la presse. Lorsqu’on l’interroge sur «Lebanese Brew », une autre marque que sa société développe depuis 2011 à destination d’un marché de masse beaucoup moins exigeant sur l’originalité de la recette, l’entrepreneur ne souhaite pas non plus s’étendre. Une source de revenus bien plus classique, qui permet de financer 961. «C’aurait été plus facile pour nous d’être intéressés par l’argent, mais on préfère éduquer les Libanais», claironne le patron. Aujourd’hui pourtant, l’entreprise semble rentable. La production est passée de 6.000 caisses de vingt-quatre bouteilles en 2006, à 250.000 en 2012. Les Libanais buveurs mais pas trop La marque aurait refusé il y a peu une offre de rachat par «une grosse entreprise libanaise d’agroalimentaire». On trouve aussi, désormais, 961 dans dix-neuf pays étrangers. Au Liban, la marque sponsorise aussi un grand nombre d’artistes locaux à raison de trois événements par semaine, ainsi que de petites ONG. En mai dernier, 961 organisait une grande soirée de concerts à Beyrouth, la «Summer Block Party». Les affiches étaient partout dans les rues de la capitale. Une pratique qui ressemble quand même beaucoup à de la publicité auprès des jeunes générations. «Je suis tellement heureux de voir que 961 peut donner une image positive du Liban, s’enthousiasme Mazen. Les gens sont surpris de voir que les Libanais sont des buveurs, ouverts d’esprits, et j’en suis fier!» assène-t-il. Le marché reste toutefois étroit. La consommation de bière au Liban ne dépasse pas cinq litres par an et par personne, soit l’équivalent de dix journées d’Oktoberfest à Münich, rappelle Mazen. Delphine Darmency et Constance Desloire
- 23. L a jeunesse, en Algérie, c’est un peu plus long qu’ailleurs… Aux jeunes Algériens, les cher- cheurs ont généreusement offert cinq années de plus que la four- chette 15-24 ans définie par l’Unesco. Causes de cette longévité: les années d’enfance perdues pendant la guerre civile et l’âge tardif du mariage dû au manque de ressources, caractéristiques d’un groupe méconnu qui représente pourtant 32 % de la population. D’ici deux ans, les résultats d’un son- dage national sur les aspirations des jeunes Algériens devraient être publiés. En attendant, Jeune Afrique est allé à leur rencontre, à Alger. Différente du reste de l’Algérie, la jeunesse de la capi- tale connaît pourtant, elle aussi, chô- mage, frustrations sociales… et amour du pays, malgré un sentiment de rejet. « Que ce gouvernement commence par nous montrer qu’il aime vraiment sa jeunesse! » lance Hichem, pianiste au quartier Hussein-Dey. « Ces dernières années, tous les maux sociaux ont pris de l’ampleur, analysait en avril 2009, pour l’AFP, Mustapha Khiati, de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le déve- loppement de la recherche (Forem). Mais la majorité silencieuse des jeunes fait des études et cherche du travail. » Enquête sur ces jeunes Algérois de la classe moyenne. UN AVENIR FLOU Début octobre. Il fait exceptionnel- lement beau à Alger et 1,23 million d’étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres sous le soleil. Pour leur avenir, les jeunes comptent ALGER Ce que veulentCe que veulent les jeunesles jeunes Emploi, logement, sorties... Rien nʼest simple pour les 15-29 ans de la capitale, même issus de la classe moyenne. Jeune Afrique est allé à la rencontre dʼune génération peu écoutée, mais qui tente de se prendre en main. Dans le public du Festival culturel européen, sur l’esplanade de Riadh el-Feth, en mai 2010. LOUIZAAMMIPOURJ.A. ▲ ▲ ▲ MARS 2002 Que l’épouse du roi, Commandeur des croyants, ait une activité publique au côté de son mari offre sans doute la meilleure image du nouveau Maroc. COUVERTURES J.A.50ans JEUNE AFRIQUE N° 259 8 -259 9 • DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2010 147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 147147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 147 21/10/10 16:40:5821/10/10 16:40:58
- 24. sur un diplôme de l’université publique, gra- tuite – et depuis 2008, sur quelques écoles privées. Mais pour les jeunes Algé- rois, mener des études à terme est une gageure. Obte- nir un crédit étudiant relève du parcours du combattant et une bourse en médecine, par exemple, n’est que de 4000 dinars (environ 38 euros) pour trois mois. Une fois inscrit, l’étudiant se heurte d’emblée au manque de transports publics, même s’il prend les bus scolaires. Anis, 19 ans, y passe parfois deux ou trois heures, matin et soir, pour rejoindre son école d’électronique. « En une semaine, j’ai déjà manqué une matinée à cause des embouteillages et j’ai peur que ça joue sur mes notes. » Les jeunes critiquent aussi largement la qualité des cours, même si cette année l’évaluation des établissements d’enseignement supérieur devient obli- gatoire. « L’université forme des chô- meurs, se plaint Djamel, 24 ans. Il y a trop de théorie et pas de pratique, pas de stages. » Beaucoup d’élèves préfèrent arrêter leurs études et commencer à tra- vailler: les employeurs réclament tous plusieurs années d’expérience… Pour ceux qui obtiennent leur diplôme, il faut encore compter avec les aberrations administratives. Hakim a décroché il y a plus d’un an son diplôme de cho- colatier. Mais depuis, il attend que les services de la formation professionnelle le lui délivrent. Sans quoi il ne peut pas être embauché… Pas étonnant dans ces conditions que, en 2007, 62,8 % des jeunes scolarisés voyaient « leur avenir flou », selon le Centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement (Ceneap). CHÔMEURS DIPLÔMÉS En septembre 2010, 25 % des jeunes Algériens étaient au chômage, d’après la Banque mondiale. Une grande partie des jeunes Algérois non qualifiés se sont tournés vers le secteur informel: ven- deurs à la sauvette, « parkingueurs », fournisseurs de films téléchargés sur internet… Mais il n’y a pas de garantie non plus pour les diplômés. Les jour- naux regorgent d’annonces de deman- deurs d’emploi de 29 ou 30 ans, surqua- lifiés, en interprétariat ou comptabilité. La crise de 2008 a rendu le marché de l’emploi encore moins accessible aux jeunes. Et l’éternelle ma’rifa, le « pis- ton », conditionne toujours largement les embauches. Les initiatives de l’État, dotées de bud- gets solides, se sont pourtant multipliées ces dernières années. L’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) valide le projet de microentreprise d’un jeune chômeur… mais les banques DES QUARTIERS POPULAIRES À HYDRA, sur les hauteurs d’Alger où siè- gent de nombreuses ambassades, les jeunes veulent se rendre utiles. À l’hôpital Mustapha, les étudiants de l’association Le Souk accueillent les enfants malades dans un petit local. Une cinquantaine de jeunes organi- sent pour eux des sorties dans le pays ou à l’étranger, des collectes et des grandes fêtes. En parallèle, ils mènent des campagnes de sensibilisation. « Pendant quelques jours, on s’est déplacés dans une wilaya pour parler du sida avec les jeunes, raconte Ahcène, 25 ans, étudiant en sociologie, tee-shirt à la mode et barbe épaisse. C’est plus facile pour nous de briser ce tabou que pour une institution ou un médecin. » Prochaine campagne au programme: la violence contre les femmes. « Si les autorités n’y par- viennent pas, nous, nous pouvons connecter les jeunes entre eux », ajoute Farid, 24 ans. À quelques kilomètres à peine, à Bab el-Oued, c’est la même volonté de pallier les carences des officiels qui anime les membres de SOS Culture. « L’État a fait beaucoup pour les jeunes, mais ce n’est pas suffisant, estime Nasser, le directeur. Nous sommes la seule association culturelle d’un quar- tier qui compte peut-être 80000 habitants. » Promotion des groupes de musique, soutien scolaire, cinéclubs… Ici, les 70 membres actifs prêtent main-forte aux projets de leurs pairs. « Les jeunes d’ici n’ont pas grand-cho- se, mais dès qu’on a besoin d’eux, ils répondent présent », conclut Nasser. Un peu plus âgés, un peu plus à l’aise financièrement, les membres du Rotaract Alger La Baie, filiale du club Rotary International, mènent aussi des actions de charité. Réunis initialement pour promouvoir le leadership chez les jeunes, ils organisent des soirées caritatives au profit des nomades ou de familles défavorisées pendant le ramadan. « Ça fait du bien de faire du bien », résume Naila, céramiste et membre du club. ■ CONSTANCE DESLOIRE PLUS SOLIDAIRES, PLUS GÉNÉREUX… « Je créerais une facilité d’accès au logement pour les jeunes. Aujourd’hui, c’est quasi impossible de ne pas passer par la case parents après le mariage. » SIHAM, 28 ans, contrôleuse aérienne Si jʼétais au pouvoir... LOUIZAAMMIPOURJ.A. ▲ ▲ ▲148 LE PLUS ALGÉRIE JEUNE AFRIQUE N° 259 8 -259 9 • DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2010 147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 148147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 148 21/10/10 16:41:1521/10/10 16:41:15
- 25. rechignent ensuite à le financer. « L’An- sej propose des aides fiscales très inté- ressantes, raconte Nassim, membre du Centre des jeunes dirigeants (CJD), qui a créé sa société de transport il y a une dizaine d’années. Mais il n’y a pas de suivi, pas de personnel qualifié. Nom- bre des entreprises créées ferment dans l’année qui suit. » Certains Algérois ten- tent alors leur chance ailleurs… FAIRE SA VIE AU PAYS Le phénomène des harraga, ces hom- mes qui « s’embarquent », littéralement, pour l’Europe, est en hausse depuis 2005. L’autre rive de la Méditerranée est toujours perçue comme une terre d’opportunités, notamment pour les jeunes sans formation. Mais ceux qui ont un diplôme envisagent plutôt d’émi- grer dans les règles. « Parfois je pense comme un garçon : j’aimerais partir, confie Nassima, 21 ans, dont la famille accepte difficilement les activités artis- tiques. Mais je le ferai légalement, pour poursuivre mes études au Canada, par exemple. » Dans la classe moyenne, on pense partir se former à l’étranger, mais c’est souvent en Algérie que l’on veut faire sa vie. « Je commence à stagner professionnellement, alors j’irais bien un temps en Europe », confie Djamel, tech- nicien en transmission. « Je ne pourrais partir que temporairement, juge Sarah, 21 ans, future chirurgienne. Ma famille, mes amis et mes repères sont à Alger. » Alors, pour se construire un avenir dans la capitale, les jeunes s’arment de patience, notamment pour s’installer. Mariage et départ du foyer parental vont de pair. Aujourd’hui, Alger compte 800 000 célibataires (sur 3 millions d’habitants), et une femme se marie en moyenne à 30 ans, un homme à 33 ans. « Le logement? Ah! C’est LE “big” pro- blème à Alger », rit Yasmine, 29 ans, res- ponsable marketing. Le loyer d’un petit appartement en banlieue dépasse faci- lement le salaire minimum (150 euros par mois). Tant qu’ils n’ont pas trouvé de logement, beaucoup ne se marient pas – à moins de s’installer un temps chez les parents… « Dans ce cas, c’est difficile d’avoir une vie intime », se navre Kenza, 29 ans, devant les robes qu’elle inspecte pour son mariage, prévu à l’été 2011. Et « vouloir habiter seule à Alger, ça reste délicat », avoue Yasmine. En attendant d’être indépendants, les jeunes ont du temps libre. Et Alger, en dix ans, a retrouvé des couleurs. De nom- breux restaurants ont ouvert – et aussi des salles de billard. Le festival culturel panafricain de 2009 a eu beaucoup de succès. En revanche, la plupart des ciné- mas de la ville sont toujours fermés et les rues ne sont pas très animées après la tombée de la nuit. « On a un peu d’argent à dépenser, mais pas d’endroits pour le faire, se désole Badrou, entrepreneur de 23 ans. Alger manque de parcs d’at- traction ou de centres commerciaux. » Si les cybercafés ont proliféré dans la capitale au début des années 2000, ils sont nombreux désormais à fermer. « Moi, j’ai passé mes trois ans de lycée dans un café internet, avoue Djamel en rigolant. Mais aujourd’hui, une bonne partie a fermé car les gens sont de plus en plus connectés à domicile. » Beau- coup de jeunes font le choix de passer leurs soirées chez eux. « Le soir, je vais chez des amis ou bien je reste en famille, raconte Hassan, un jeune informaticien. Je préfère ne pas aller en ville dans des endroits qui ne sont pas corrects. » Cou- rant 2010, le ministère de la Culture a fait fermer plusieurs boîtes de nuit. Pourtant la musique a une place de choix chez les jeunes. Beaucoup sont branchés sur les chaînes musicales du Les étudiants de l’association Le Souk sensibilisent les jeunes aux problèmes du sida, de la violence contre les femmes, etc. « Je légaliserais les repas en journée pendant le ramadan. » NADIA, 28 ans, chef de projet en agence de communication Si jʼétais au pouvoir... NOVEMBRE 2004 À force de courage et de ténacité, il était devenu la Palestine. Contre vents arabes et marées israéliennes. Sa succession n’en sera que plus difficile. COUVERTURES J.A.50ans JEUNE AFRIQUE N° 259 8 -259 9 • DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2010 147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 149147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 149 21/10/10 16:41:2421/10/10 16:41:24
- 26. satellite. Certains se sont même construit un petit home studio avec leur ordi- nateur. Mais rien ne vaut la scène ! Pour Hakim, du groupe de rock Dzaïr, les jeunes ont plus d’oppor- tunités qu’auparavant. Le ministère de la Culture a ouvert une scène où ils peuvent se produire tous les samedis après-midi. Dzaïr, qui chante notamment en arabe dialectal depuis 1998, a contribué à rapprocher les jeunes de l’administration. « Il y a des initiatives et de l’argent, mais les jeunes ne le savent pas, regrette Hakim. Les autorités ne communiquent pas, ne font pas de travail de terrain. Et si les jeunes font du rock ou une musique non traditionnelle, ils ont du mal à trouver des interlocuteurs. » À Bab el-Oued aussi, quartier populaire de l’ouest de la capitale, on tente d’aider les jeunes musiciens. L’association SOS Culture permet à six groupes de répéter dans son local. « Dans ce quartier, les jeunes artistes n’obtiennent jamais de salle municipale pour se produire », déplore Amine, le coordinateur, dans le sous- sol où joue le groupe Rivergate (« Bab el-Oued » en anglais). « On ne fait pas confiance aux jeunes », conclut-il alors que s’élèvent les premières notes d’un air des Pink Floyd. LASSÉS DE LA POLITIQUE Et c’est la même surdité dans tous les domaines. Malgré des initiatives (construction d’équipements sportifs, octroi de primes aux jeunes chercheurs, journées de sensibilisation sur la dro- gue…), les jeunes n’en perçoivent pas les effets sur leur quotidien. « Peu de personnes interrogées sont conscien- tes qu’il existe une politique de la jeu- nesse », estime le programme Euromed Jeunesse. D’autant que beaucoup de ces projets sont inachevés, détournés de leur fonction initiale, contradictoires les uns avec les autres, méconnus de leurs destinataires ou inaccessibles à cause de la bureaucratie. L’écoute est rare, et les autorités, locales comme nationales, semblent déconnectées du terrain. Entre la galère pour trouver un emploi et la lutte pour l’évolution des mentali- tés, il n’y a pas de place pour la politique 1 JEUNE AFRIQUE: Qu’est-ce qui distingue la jeunesse algéroise? SAÏB MUSETTE: À Alger, la classe moyenne domine, donc chez les jeunes aussi. Plus instruits, plus tournés vers les loisirs, ils sont plus pri- vilégiés qu’ailleurs. La jeunesse dorée, fille des dirigeants politiques, n’est qu’un phénomène ultra-minoritaire qui n’est lié ni au lieu ni à l’époque. Ce qui est marquant à Alger, c’est la mixité sociale. On peut voir ensemble des jeunes étudiants, chômeurs, islamistes, garçons, filles, voilées ou non. C’est la magie de l’urbanité! D’autre part, l’espace social que les jeunes peuvent investir est plus important à Alger qu’ailleurs. Leur liberté et leur visibilité progressent. 2 Qu’a-t-elle de différent des générations précédentes? Dans les années 1980, les « hittistes », ces hommes désœuvrés qui tenaient les murs, étaient les figures symboliques de la jeunesse. Dans les années 1990, ce furent les « trabendistes », les petits trafiquants. Les années 2000 ont vu émerger les harraga qui prenaient la mer au péril de leur vie pour rejoindre l’Europe. Pour la décennie 2010, j’imagine bien les jeunes Algérois comme des entrepreneurs. Formés, ils sont de plus en plus nombreux à monter une affaire dans la capitale. 3 On parle de drogue, de suicide… Les comportements des jeunes sont-ils de plus en plus extrêmes? Ces jeunes étaient enfants pendant la guerre civile. Ils en gardent sûrement d’importants traumatismes, mais ceux-ci ne sont pas visibles. Des cellules « santé jeunesse » existent un peu partout, mais les jeunes ne s’y dirigent guère. Les angoisses liées au chômage ou à l’impossibilité de s’établir peu- vent déclencher un jour des comportements excessifs: devenir très pieux, partir en mer ou se lancer dans un commerce illégal. La consommation de drogue, en revanche, est à mes yeux un phénomène marginal, temporaire, typique d’un certain âge. Je suis globalement optimiste pour les jeunes Algérois, dont la grande majorité ne va pas vers les extrêmes. ■ Propos recueillis par CONSTANCE DESLOIRE 3 QUESTIONS À… SAÏB MUSETTE Sociologue au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread), à Alger « Je donnerais un statut légal aux artistes, qui ne peuvent ni cotiser ni avoir une retraite. » HASSAN, 29 ans, guitariste Si jʼétais au pouvoir... NADIAFERROUKHI 150 LE PLUS ALGÉRIE JEUNE AFRIQUE N° 259 8 -259 9 • DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2010 147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 150147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 150 21/10/10 16:41:3921/10/10 16:41:39
- 27. dans la vie des jeunes. « Ils sont blasés, constate Hichem, pianiste du groupe Dzaïr. Ils n’ont pas l’esprit de contesta- tion, et aucun leader ne les entraîne. » « On a été bien trop politisés pendant une période, regrette Yasmine. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent, tant qu’ils nous laissent faire notre vie! » Les sections jeunesse des partis politiques peinent à recruter. « Ils ne font pas de politi- que car il n’y a pas de vie politique! » estime Nassim. « Moi, je ne veux pas y toucher », confirme Badrou, qui a monté son affaire de restauration. Pourtant, ces jeunes, qui n’appartien- nent pas aux familles dirigeantes large- ment favorisées, pourraient être les élites de demain – si tant est qu’un renouvel- lement soit un jour possible. De plus en plus éduqués et informés, ils supportent de moins en moins de voir leur horizon toujours bouché. « On n’est pas une prio- rité pour l’État, assène le jeune Hamza, étudiant et musicien à Bab el-Oued. Nos pères ont connu le colonialisme; nos grands frères le terrorisme. Et nous, de quoi serons-nous la génération? » ■ CONSTANCE DESLOIRE, envoyée spéciale « IL N’Y A PLUS DE MECS BIEN! » dit-on d’un côté. « Les filles d’aujourd’hui me déçoivent… », entend-on de l’autre. À l’âge où l’on commence à se mettre en couple, chaque sexe a des exigences bien précises. À l’école Beauté Académie, Zina, 26 ans, tempête : « Les garçons veulent profiter du fait qu’on fait des études et qu’on va gagner de l’argent! » « À mon époque, renchérit Amina, 41 ans, on disait des femmes qu’elles étaient hdaidia, qu’elles aimaient l’argent. Aujourd’hui, ce serait plutôt les hommes! » Certains garçons, de leur côté, ne comprennent plus les filles. « Elles ne veulent même plus qu’on leur parle dans la rue », se désole Hakim. Ce à quoi la coquette Ferial, 23 ans, répond: « On subit beaucoup d’agressions verbales à cause de nos tenues, c’est insupportable. » Si le voile est très ré- pandu à Alger, il est désormais coloré et compatible avec un jean et du maquillage. Ce qui semble dérouter une partie de la gent masculine. Lemariagereste pour beaucoup le but d’une relation, mais cela commence à changer. Nombreux sont les jeunes qui cachent leur vie amoureuse à leur famille tant qu’ils ne sont pas fiancés. « Les filles n’ont pas renoncé à une vie sentimentale à cause de la tradition, analyse le socio- logue Saïb Musette. Mais elles ont investi les espaces sociaux où elles sont invisibles, comme internet. » Heba, étudiante de 22 ans, a développé une histoire d’amour sur la Toile avec quelqu’un dont lui ont parlé des amis. Après un an d’échanges, ils doivent se rencontrer pour la première fois, en centre-ville. Viendra ensuite le moment d’envisager une vie sexuelle… Décision surtout difficile pour les filles. « Il y a chez nous une “arnaque à l’hymen”, raconte le longiligne Hamza, étudiant de 23 ans aux fines lunettes. Beaucoup de filles décident de faire l’amour tôt pour être débarrassée et vivre leur jeunesse. Ensuite elles pourront subir une réfection de l’hymen, pour 40000 dinars [environ 380 euros, NDLR]. » Les filles les plus modestes, en revanche, ne pourront pas envisager de tels frais. Et à défaut de diplôme, leur virginité est le « fonds de commerce » qui leur garantira un mari – et une sécurité matérielle. « Les garçons sont souvent contra- dictoires, poursuit Hamza. Ils veulent épouser quelqu’un de vierge, alors qu’eux-mêmes se sont bien amusés. Et ensuite ils se plaignent que leur femme soit inexpérimentée! » Le ta- bou de la sexualité est source de frustration. Les sociologues algériens parlent d’« exclusion sexuelle » des jeunes. Mais c’est parfois par choix que certains garçons n’ont pas de rapport avant le mariage. « Moi, je suis musulman et ro- mantique, raconte Badrou, au volant d’une belle voiture. Je veux que ma nuit de noces soit unique. » Mais s’il changeait d’avis, il n’aurait rien à justifier à personne. D’autant qu’il préférerait, confie-t-il, épouser une Européenne… ■ C.D. Sexe, soupçons et traditionsSexe, soupçons et traditions « Je criminaliserais les agressions verbales des hommes envers les femmes dans la rue. » FERIAL, 23 ans, étudiante en école d’esthétique Si jʼétais au pouvoir... L’École des beaux-arts d’Alger, en 2008. Même quand ils ont un diplôme, les jeunes peinent à trouver un emploi. FÉVRIER 2005 Après la disparition brutale de Gnassingbé Eyadéma, récit exclusif de ses dernières heures et de l’avènement de son successeur à la tête du Togo. COUVERTURES J.A.50ans JEUNE AFRIQUE N° 259 8 -259 9 • DU 24 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2010 147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 151147-151 +algerie Jeunes 2598-99.indd 151 21/10/10 16:41:5321/10/10 16:41:53
- 29. Rûdaw Media Network, future BBC kurde ? Article par CONSTANCE DESLOIRE et DELPHINE DARMENCY • Publié le 12.11.2014 • Mis à jour le 17.12.2014 Symbole à l’étranger d’un Kurdistan irakien sûr et en plein boom économique, le groupe médiatique Rûdaw n’échappe pas aux difficultés que rencontre un État en formation. La majorité des journaux en langue kurde, dont les premiers ont été créés à la fin du XIXe siècle, relèvent surtout de la presse d’opinion jusqu’en 1991 (date de la première autonomie obtenue par les Kurdes d’Irak à la suite de l’intervention militaire américaine). En s’opposant à Saddam Hussein, les États-Unis imposent une frontière au Kurdistan et mettent un coup d’arrêt à la campagne génocidaire du régime baasiste. Ces premières années donnent lieu à un foisonnement de titres de presse, malheureusement interrompu par la guerre civile qui opposa entre 1994 et 1998 les deux principales factions, le PDK (Parti démocratique du Kurdistan, créé en 1946 par la famille Barzani) et l’UPK (l’Union patriotique du Kurdistan, créé en 1975 par la famille Talabani). Depuis quinze ans, le nombre de journaux a explosé (entre septembre 2009 et avril 2010, 280 titres de presse écrite ont vu le jour[+] NoteIraq-Kurdistan Media Sustainability Index, 2010. [1], leur professionnalisme aussi et plusieurs titres comme Hawlati, Awene ou Bas News sont unanimement reconnus pour leur sérieux. Pourtant, « le secteur des médias au Kurdistan n’en est qu’à ses débuts », estime Hewa Othman, directeur de la société audiovisuelle Mediawan et conseiller de Rûdaw lors de son lancement[+] NoteEntretien réalisé à Erbil le 29 juillet 2014. [2]. Les standards professionnels sont longs à acquérir, d’autant qu’il n’existe pas d’école de journalisme, mais seulement un cursus à l’université sur les médias. Surtout, beaucoup d’organes de presse aujourd’hui sont partisans. « Nous aurions besoin de médias d’État, et non pas de groupes attachés à des partis ou des personnes », poursuit-il. C’est dans ce contexte, en avril 2008, qu’est lancé le journal Rûdaw (« Évènement »), disponible dans les deux dialectes kurdes, le sorani et le kurmanji. « Au cours des deux premières années, Rûdaw a
- 30. reçu de l’aide de Press Now[+] NoteUne association née en 1993 en Yougoslavie pour encourager le journalisme, ndlr. [3] et The Independant Media Centre[+] NoteUn réseau de collectifs de journalistes né en 1999, ndlr. [4]», affirme son directeur général Ako Mohammed. Aujourd’hui, sur papier, seul un tirage maximal cumulé de 10 000 exemplaires subsiste pour les deux éditions hebdomadaires du journal, l’édition politique, et l’édition sport et diaspora en Europe. Ces journaux sont bâtis à partir des informations des correspondants installés au Kurdistan irakien (Erbil, Souleymanieh et Duhok, les trois principales villes), à Bagdad, mais aussi au Canada, en Allemagne, aux États-Unis et en Turquie, où se trouvent des communautés kurdes importantes. Aujourd’hui, Rûdaw compte environ 350 employés, remarquablement jeunes. Cette croissance s’explique par la diversification du groupe : après la presse, Rudaw s’est lancé dans la radio et la télévision. Au sein du groupe, la tendance est à la polyvalence. Shadi, employée depuis 2012, explique que « c’est un principe chez Rûdaw : tous les journalistes font de l’écrit, de la radio et de la télé. »[+] NoteEntretien réalisé à Souleymanieh le 7 août 2014. [5] Une chaîne d’info continue qui se rêve en BBC kurde L’idée d’une chaîne de télévision aux très hauts standards professionnels émerge en 2011. Pendant deux ans, Rûdaw bénéficie d’une formation auprès de la BBC. « Oui, d’autres médias internationaux nous ont aidés, mais je n’ai pas le droit de mentionner lesquels », répond Gaziza Bapiri[+] NoteEntretien réalisé à Erbil le 2 août 2014. [6], du département des relations publiques de Rûdaw. En mai 2013, la chaîne est lancée, en même temps qu’une radio. La couverture des événements au Kurdistan par les journalistes de Rûdaw est extrêmement dense. Début août 2014, les équipes de la chaîne sont sur la ligne de front avec l’organisation État islamique – ainsi que d’autres médias. « Rûdaw est un média de qualité, très présent sur le terrain. S’il ne doit y avoir qu’une chaîne présente lors d’un événement, ce sera eux », explique Hewa Othman. Rûdaw a adopté tous les codes de la chaîne d’information continue internationale : jingle musical grave, bandeau défilant, rapidité du montage d’images, incrustation de mentions live, etc. Le spot qui annonce le journal symbolise la vision que Rûdaw TV veut donner d’elle-même : le porte-parole des revendications du simple citoyen. On y voit une série de personnes en colère, hommes et femmes, en manifestation, dans la rue ou sur le lieu d’une catastrophe, parler à un micro tendu au logo orange de Rûdaw. Rûdaw TV, comme ses consœurs internationales, diffuse des programmes variés. À côté d’émissions culturelles ou religieuses, elle propose des programmes sociaux et politiques. Pendant plusieurs mois, Salah Barzinji, un des rédacteurs en chef, a produit Black Box, une émission d’enquêtes qui s’est penchée sur des thèmes comme la drogue. « Le public demande des sujets sociaux nouveaux » confirme Twana Osman, le directeur général de la chaîne NRT TV[+] NoteEntretien réalisé à Souleymanieh le 6 août 2014. [7]. La journaliste Shadi a par exemple enquêté pour Rûdaw sur les nomades, « un sujet dont on ne parlait pas », ou sur des affaires de violences contre les femmes. Les locaux de l’établissement sont situés dans un étroit bâtiment de plusieurs étages dans le quartier Iskan, à Erbil, la capitale du Gouvernement régional du Kurdistan (KRG). Mais le groupe a l’intention de déménager dans un bâtiment neuf en cours de construction, plus grand, signe de son ambition, et probablement encouragée par les premiers succès d’audience. Mais pour l’instant, ses responsables affirment ne pas avoir de données sur l’audimat. À ce jour, Rûdaw TV n’est diffusé qu’en kurde. Mais elle ambitionne d’ici deux ans de lancer une édition en arabe et une en anglais. « Nous voulons devenir l’un des tout premiers choix pour les habitants du Moyen-Orient qui veulent accéder à de l’information » explique son directeur général Ako Mohammed[+] NoteEntretien cité. [8]. Plus tard, peut-être aussi une édition en turc. La BBC est
- 31. définitivement le modèle de Rûdaw, et la mention d’Al Jazeera irrite ses responsables. « Al Jazeera a la plus grande couverture dans la région, mais pas la plus grande qualité », affirme Fazil Najeeb, porte- parole de Rûdaw et directeur des relations publiques[+] NoteEntretien réalisé à Erbil, le 2 août 2014. [9]. Une popularité rapide, et inquiétante ? Le groupe a très vite acquis de la crédibilité à l’international. Il est aussi le concessionnaire pour le Kurdistan du Monde diplomatique depuis 2009. À l’été 2014, en plein conflit entre les combattants kurdes (les « peshmergas ») et l’État islamique, les téléviseurs de diverses institutions du GRK (Gouvernement régional du Kurdistan) ou les halls d’hôtels sont branchés sur la chaîne. Dans les taxis ou les voitures privées, le flash info de Rûdaw est souvent privilégié. « Ils sont très bons avec tout ce qui est nouvelles technologies, Internet », reconnaît Kajaw Jamal Jalal, le rédacteur en chef du journal indépendant Hawlati, basé à Souleymanieh[+] NoteEntretien réalisé à Souleymanieh, le 5 août 2014. [10]. Kanar, jeune diplômée de 25 ans qui travaille dans une société pétrolière, lit Rûdaw en premier lorsqu’elle veut se tenir au courant d’une situation. « Ce sont les plus fiables, même si je sens que je ne suis pas toujours convaincue par leurs articles. Avant, je suivais plutôt Bas News. »[+] NoteEntretien réalisé à Erbil le 2 août 2014. [11] Le 11 août 2014, une vidéo de Rûdaw TV fait le buzz : un journaliste de la chaîne, au milieu d’un pont marquant la ligne de front entre les peshmergas et l’État islamique, interpelle des hommes supposément de l’organisation État Islamique, devant leur drapeau noir. Le journaliste, qui se dit à Myriam Beg, au sud-ouest de Kirkouk, demande aux hommes armés s’ils veulent parler à Rûdaw – sans obtenir de réponse. Sans mentionner nommément Rûdaw, le rédacteur en chef de Hawlati reconnaît que le retard que son journal a pris sur le multimédia leur a fait perdre des lecteurs. « Il y a quelques années, nous étions le premier, avec 250 000 visites par jour. Aujourd’hui nous sommes tombées à 50 000. » Autre concurrent direct, en télévision cette fois-ci, NRT TV. « Rûdaw a beaucoup progressé, c’est un vrai concurrent, estime son directeur général. Il est devant nous pour tout, sauf en crédibilité. C’est le média d’un parti ». Une accusation balayée par Kawa Amin, chef du bureau de Souleymanieh : « Les autres médias font de la propagande contre nous », affirme-t-il sans fournir plus d’explications[+] NoteEntretien réalisé à Souleymanieh le 7 août. [12]. La popularité fulgurante de Rûdaw, due notamment à ses importants moyens, ne lasse pas d’interroger ses concurrents sur les dettes éditoriales qu’a pu contracter le groupe. Une entreprise financée par le Premier ministre C’est avec l’argent du Premier ministre Nerchivan Barzani (PDK) que le lancement de Rûdaw a eu lieu, les responsables de groupe ne s’en cachent pas. Mais à titre privé, précisent-ils. « Au début,
- 32. Rûdaw était une réelle voix, qui a amené du professionnalisme, explique Hewa Othman, qui a conseillé le groupe dès 2008. Mais il est détenu par des proches du PDK. Cela se lit entre les lignes. Même pour les postes de journalistes, le groupe recrute au sein du PDK. La loyauté des journalistes, ici au Kurdistan, va souvent d’abord à des hommes politiques ou des hommes d’affaires. » Selon Kamal Chomani, un journaliste kurde nominé en 2013 aux International Media Awards, Rûdaw est un média fantôme du PDK (« shadow media »)[+] NoteSelon un article de Kamal Chomani paru dans le Kurdistan Tribune le 4 juin 2012. [13]. À côté des organes de presse officiels d’un parti politique, existent selon Chomani, des médias qui se disent privés mais sont en sous-main gérés par un parti. Un ancien rédacteur en chef de Rûdaw, Noreldin Waisy, démissionnaire en 2011, a relaté dans un entretien avec Hawlati que Nechirvan Barzani demandait parfois la parution d’articles favorables au PDK[+] NoteEntretien cité. [14]. Fazil Najeeb, porte-parole de Rûdaw, répond que la chaîne « n’a aucune connexion avec aucun parti, il les critique tous, et son objectif principal est d’être professionnel. Nerchivan Barzani n’interfère pas dans le contenu du groupe. Il donne le budget et c’est tout. Nous avons des critiques d’autres partis mais cela ne nous affecte pas. » Dans les locaux de Hawlati, Kajaw Jamal Jalal décrypte : « Rûdaw a été indépendant au début mais ne l’est plus. Ils critiquent le PDK mais il y a des lignes rouges, comme la famille Barzani ». Un constat partagé par Hewa Othman : « Il y a bien sûr des lignes rouges. Critiquer le PDK en général ou des membres du bas de l’échelle est permis. Mais jamais les plus importants dirigeants ». Le directeur du bureau de Rûdaw à Souleymanieh, Kawa Amin, explique : « Nous n’avons pas de demande éditoriale du PDK. Nous n’avons pas de ligne rouge. – Pas même Barzani ? – Peut-être, répond-il souriant. En ce qui concerne sa personne ». Le Premier ministre Nechirvan Barzani a voulu doter le Kurdistan d’une voix professionnelle aux yeux extérieurs, dans la perspective de devenir un jour indépendant de Bagdad. Mais certains estiment aussi que Rûdaw est un instrument dans la lutte de pouvoir qu’il mène contre son oncle et président du GRK, Massoud Barzani. Le Kurdistan, depuis vingt ans, a développé un système politique qui repose sur des réseaux clientélistes. Comme d’autres industries du secteur privé, Rûdaw n’échappe pas à cette manipulation. Une transparence insuffisante Il n’a pas été possible d’obtenir de la part du groupe ni rapport d’activité indiquant le nombre d’employés ou les résultats d’audience, ni rapport financier. On nous indiquera tout juste que « financièrement, Rûdaw est à l’équilibre ». Officiellement, le Premier ministre contribue au budget mais aucune somme n’est fournie. La participation du GRK est également admise par le porte-parole du groupe, sans fournir de chiffres : « Ils aident un peu mais cela ne suffit pas pour vivre ». Pourtant les importants moyens financiers de Rûdaw sont un secret de Polichinelle. Dans son édition du 24 juillet 2014, l’hebdomadaire Spi, dédié aux médias, fait sa une sur Rûdaw : « Le salaire du directeur de Rûdaw est supérieur à celui du Premier ministre ». Dans son dossier, le journal révèle les salaires comparés des directeurs de Rûdaw (11000 dollars par mois), de NRT TV (2400 dollars) et du journal Awene (600 dollars). Interrogée sur ce qui pourrait être amélioré selon elle dans son emploi, Shadi, jeune journaliste à Rûdaw, confirme : « Le salaire ici, ce n’est pas un problème ». L’opacité sur la provenance et la somme des fonds de Rûdaw permet à chacun de spéculer. « C’est l’argent du pétrole », pensent certains en référence au possible versement des revenus des extractions pétrolières sur le compte de deux banques privées appartenant à la famille Barzani. Ce qu’a officiellement nié le Premier ministre dans une interview au journal Hawlati en 2012. La corruption du GRK est un sujet de moins en moins tabou mais sur lequel filtre encore peu d’informations concrètes.
- 33. Un environnement sur-politisé et dangereux pour les journalistes « Alors que Nechirvan Barzani dépense des millions en publicité dans la presse internationale pour dépeindre le GRK comme « l’autre Irak » et « un espace de démocratie et de liberté de la presse », les journalistes kurdes ne se sentent pas en sécurité dans leur propre maison », se décriait Kamal Chomani dans un article documentant le climat de terreur que connaît la profession. L’orientation autoritaire du GRK commence à être dénoncée. La transition du Kurdistan, persécuté par le régime de Saddam Hussein, vers une région autonome qui a presque tout d’un État, se fait extrêmement rapidement depuis 1991, et surtout depuis la nouvelle Constitution irakienne de 2005. Mais cela ne se fait pas sans heurts. La prégnance du conflit entre les deux principaux partis issus de la guérilla est encore évidente et freine les progrès démocratiques. La vie politique, militaire ou culturelle est encore très marquée par la présence d’un double système parallèle UPK/PDK, qui ont chacun leur zone d’influence sur une partie du territoire. Dans ce contexte de lutte pour la maîtrise des institutions, la presse est un enjeu très important. Le 27 juillet 2014, un jeune journaliste et présentateur de la chaîne Payam TV, proche du parti Groupe Islamiste du Kurdistan, a été grièvement blessé à Dohuk. Depuis 2008, ce sont trois journalistes kurdes irakiens qui ont été assassinés, notamment parce qu’ils enquêtaient sur la corruption au sein du GRK : un indépendant en 2008, un journaliste du quotidien Hawlati en 2010 (« Ils ont prétendu que c’était des groupes islamistes, mais nous savons très bien que c’est le PDK », a commenté le rédacteur en chef), et en 2013, un journaliste de l’hebdomadaire Awene. Twana Osman, directeur général de NRT TV (lancée à Souleymanieh en 2011), relate que ses locaux ont été attaqués à trois reprises : un incendie pour lequel il accuse l’UPK, une grenade lancée sur le toit par des personnes liées au PDK, et une émeute de gens armés. Les causes respectives de ces agressions, selon Twana Osman : la couverture de manifestations pendant le printemps arabe, le juron d’un auditeur contre le leader historique Moustafa Barzani, et un reportage sur un crime d’honneur. Et au cours de l’été 2014, « nos journalistes [n’ont pas été] autorisés à se rendre sur le front contre l’organisation État islamique à Kirkouk par exemple, car nous n’appelons pas « martyrs » les peshmergas tués au combat, comme s’en est vanté un chef de l’État major à la radio », relate encore Twana Osman[+] NoteL’interdiction n’est toujours pas levée à ce jour. [15]. La situation politique inconfortable du Kurdistan autonome peut en partie expliquer les choix du groupe. Bien que professionnel, il ne peut pas se dire indépendant selon les standards internationaux. Mais en cas d’indépendance du Kurdistan – de plus en plus crédible devant le délitement actuel de l’Irak fédéral – Rûdaw sera-t-il capable de se passer des financements du Premier ministre ? Ou de devenir officiellement groupe médiatique public ? -- Crédits photos : Delphine Darmency
- 36. SLATE.FR / Monde Les femmes peshmergas, héroïnes trompeuses de la société kurde Delphine Darmency et Constance Desloire 09.10.2014 - 14 h 30 Soma en démonstration de maniement d’armes dans la caserne de l’unité des femmes peshmergas à Souleymanieh. Photo: Delphine Darmency. Aussi déterminées que leurs frères, les combattantes kurdes irakiennes, actuellement en lutte contre l'organisation État islamique, méritent leur célébrité, mais souffrent toujours d'un statut inférieur. Kurdistan irakien «S’ils ont besoin de moi, j’y vais!» A 65 ans, assise sur le canapé du traditionnel salon de réception oriental de sa maison à Erbil, Bahia, ancienne peshmerga, n’a peur de rien. En août 2014, les combattants ont repris les armes. Depuis 1991, après des décennies de lutte contre leurs bourreaux de Bagdad, les Kurdes d’Irak jouissaient de la paix. Apparus en 1946 dans les montagnes de la frontière Iran/Irak, les «peshmergas», «ceux qui ne craignent pas la mort», se sont battus contre les autorités centrales irakiennes. Aujourd’hui, c’est l’organisation État Islamique (EI) qu’ils affrontent, sur 1.000 km de frontière. Et Bahia s’amuse de se dire prête à y retourner. Depuis son mariage en 1970 avec un important commandant de la résistance, elle est en lutte. Comme l’écrasante majorité des femmes qui se battaient à l’époque, elle ne portait pas d’arme dans cette guerre. Pourtant, elle se sent combattante au même titre que les hommes: «Je suis peshmerga et femme de peshmerga! Une bataille, ça ne se gagne pas qu’avec ceux qui ont un fusil à la main. Il y a besoin de personnes qui soignent, qui nourrissent et qui acheminent les armes.»
- 37. Un haut motif de respectabilité Fille d’un cheikh acquis à la cause nationale, Bahia parcourt les montagnes, ses trois filles sous le bras, au gré des raids de l’armée irakienne et des offensives de l’unité de 50 combattants que dirige son mari. «Elle cousait de l’argent dans les ceintures et cuisinait tous les jours pour deux douzaines d’hommes en arrière du front», raconte sa fille aînée Hiro. «Les autres épouses étaient généralement plus loin de la bataille et je n’en ai jamais vu se battre directement, se souvient Bahia. Je n’ai pas porté les armes moi-même car il y avait les enfants. Mais les hommes doivent se battre, c’est leur devoir! Je me souviens d’un jour où, après une défaite, un homme a déposé son fusil à terre. Je lui ai tendu ma fille que je portais dans les bras, j’ai ramassé l’arme et je lui ai dit: "C’est une honte! Si tu ne te bats pas, occupe-toi d’elle et c’est moi qui vais y aller!"» Aujourd’hui, appartenir à une famille de peshmergas est un très haut motif de respectabilité. «Quand un jeune me croise dans la rue, s’il me connaît, il met sa main sur son cœur», explique Bahia, qui est veuve depuis peu et a vu défiler aux funérailles de son époux tout ce qu’il y avait de notables civils et militaires à Erbil. Pourtant, à la création des institutions régionales kurdes à partir de 2005, après la chute de Saddam Hussein, les femmes n’ont pas pu toucher de pensions d’anciennes combattantes au même titre que les hommes. «Il fallait cinq témoins pour attester qu’un homme était un vrai peshmerga, et cela ouvrait des droits à un salaire du gouvernement, raconte Hiro, 43 ans. Mon père a pu en bénéficier et nous faire vivre. A l’époque, il y avait peut-être 15.000 femmes peshmergas au maximum. Mais au moment de l’identification, 150.000 femmes ont voulu être reconnues. C’est n’importe quoi! Le processus a été interrompu car cela faisait trop! Les élus peuvent faire inscrire qui ils veulent. Ce n’est pas juste de gratifier autant de femmes qui ne se sont pas battues, alors c’est normal que ma mère n’ait rien eu, pour ne pas soutenir la corruption.» Bahia et Hiro, la mère et la fille, dans le salon de Bahia à Erbil. Photo: Delphine Darmency. Bahia, elle, estime qu’elle est associée à la pension de son mari, pour ses actions à elle aussi: «C’est une pension familiale! Et de toute façon, si j’ai besoin de quoi que ce soit, de construire une maison, tout le monde m’aidera et le gouvernement en premier.» Mais comment savoir si les hommages sont rendus à Bahia la peshmerga, ou Bahia l’épouse de peshmerga? Aux hommes, les pensions; aux femmes, seulement des honneurs. Une répartition des choses qui semble convenir à la mère comme à la fille, et esquisse un raisonnement plus fondé sur la complémentarité que sur l’égalité. «Tant pis si je n’ai rien, tant que mon homme a de quoi nous protéger.»
- 38. Deux grandes factions Aujourd’hui, il existe entre 500 et 600 femmes peshmergas. Le Kurdistan n’étant pas encore un Etat, les soldats sont rattachés à l’une ou l’autre des deux anciennes grandes factions, devenues partis politiques. L’un, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) n’a pas de femme combattante mais a des policières. L’autre, l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) a créé en 1996 la première unité féminine. Le colonel Nahida Rashid a participé, au sein d’une toute petite unité mixte, au soulèvement de Souleymanieh, la deuxième ville de la région, en 1991. Devenue diplomate une fois la paix installée, elle a convaincu Jalal Talabani, le président de l’UPK, d’autoriser des femmes à être officiellement peshmergas. Reghin, Soma et Kharman, dans la caserne de l’unité des femmes peshmergas à Souleymanieh. Photo: Delphine Darmency. Dans son bureau au milieu d’une base militaire à la limite du désert, le colonel Rashid explique que toutes les femmes sont les bienvenues. «Nous avons 27 femmes colonels et 47 ont été diplômées de l’Académie d’officiers depuis 2000. Les femmes ont le même goût pour la liberté que les hommes, la même détermination. Beaucoup nous disent vouloir s’engager, surtout en ce moment.» A la question de savoir pourquoi il n’y a que quelques centaines de femmes peshmergas, pour environ 200.000 hommes, la petite femme de 41 ans fait une réponse confuse. Peut-être n’y a-t-il pas tant de femmes kurdes que cela désireuses d’entrer dans l’armée? Certes, le prestige des combattantes est indéniable. Mais être prête au combat, «prête à mourir», est tout de même exceptionnel. Hiro est fière d’être fille de peshmergas; petite, elle nettoyait les munitions de son père. Et à sa manière, elle perpétue l’engagement de ses parents. Alors que les combattants sont partis à Qaraqosh, Kirkouk ou Sinjal repousser l’offensive de l’EI, elle leur cuisine des repas chez elle, le soir après le travail, comme sa mère, trente ou quarante ans plus tôt. Elle le fait en fredonnant une nouvelle chanson patriotique qui est parue début août, et a envahi notamment le téléphone portable de sa fille aînée de 8 ans, Shaikhan. Les paroles comparent le combat des peshmergas à une danse. Hiro ne s’est pas engagée dans l’armée: elle a fait des études, comme l’ont exigé ses parents. «Je serais extrêmement fière si ma fille veut un jour être une peshmerga, assure-t-elle. Je ne lui parle pas du génocide et des combats, mais des Kurdes, et de nos droits.» Le Kurdistan figure à côté d’une poignée de pays dans le monde dont l’armée autorise les femmes à combattre –une liste qui n’inclut qu’Israël au Moyen-Orient. Mais paradoxalement,
- 39. la société kurde est encore très conservatrice. «Je défens ma terre et mon peuple, explique Kusayr, 27 ans, kalashnikov à la main, à la base militaire de Souleymanieh. Je suis triste que nous ayons à nous battre contre l’EI, mais je suis prête.» Mariée à un homme qui a accepté son choix, elle admet: «Certaines filles que je croise lorsque je porte l’uniforme disent qu’elles voudraient me rejoindre, mais que leur famille n’est pas d’accord.» «Les hommes se sentaient plus forts à leurs côtés» Le colonel Nahida Ahmad Rashid dans son bureau de la caserne de l’unité des femmes peshmergas à Souleymanieh. Photo: Delphine Darmency. Les peshmergas nouvelle génération portent du maquillage et ont des téléphones portables. Elles possèdent un vrai équipement mais elles n’ont jamais eu à se battre ces dernières années. En juillet par exemple, au cœur des combats contre l’EI, une vingtaine seulement se sont rendues au front près de Kirkouk. «Les hommes étaient contents qu’elles soient là; ils se sentaient plus forts à leur côtés», précise le colonel Nahida Rashid. L’amour qu’elles portent à leur nation, et aux valeurs kurdes, incompatibles avec l’EI, semble le même que chez les anciennes. «Nous sommes comme nos aînées, explique Soma, engagée de 23 ans, dans la fameuse tenue militaire blanche et marron. On est mieux entraînées, mais elles nous ont tout appris.» «Elles sont inspirées, leur répond symboliquement Bahia, en parlant des jeunes peshmergas. Elles ont la même loyauté, ce sont des reines. Elles ne sont pas mon héritage: elles sont moi!» Les photos de ces combattantes sont très connues à l’étranger et renvoient l’image d’une cause où l’égalité a toute sa place. Dans les montagnes, sous les bombes de Saddam Hussein, ou aujourd’hui, alors que l’éducation leur offre de meilleurs perspectives, chaque génération de femmes affiche les mêmes qualités et valeurs que tous les peshmergas, âmes de la nation kurde irakienne: courage, honneur, et la guerre uniquement en ultime recours. Mais elles restent extrêmement minoritaires dans la société et ne sauraient faire oublier les très fortes inégalités qui persistent, et le véritable fléau national que sont au Kurdistan la violence domestique et les crimes d’honneur. Delphine Darmency et Constance Desloire
- 44. CIRCASSIENS DE JORDANIE ENTRE ASSIMILATION ET REPLI IDENTITAIRE ■ Le 21 mai dernier, devant l’ambassade de Russie à Amman, un millier de Jordaniens, d’origine circassienne, réclament l’annulation des Jeux olympiques d’hiver 2014 et la reconnaissance du «génocide» de leurs ancêtres par l’armée du tsar russe, 150 ans plus tôt, dans une petite ville du Caucase, Sotchi. Mais les J.O. de Sotchi battent leur plein, signifiant l’échec d’une partie des revendications circassiennes. Retour sur une communauté méconnue de Jordanie. REPORTAGE
- 46. CONSTANCE DESLOIRE ET DELPHINE DARMENCY, AMMAN L orsqu’un Jordanien croise un compatriote de peau blanche, mais à l’arabe parfait, il lui faut toujours quelques secondes pour se souvenir de ce petit groupe du Caucase dont l’histoire est trop souvent largement oubliée. C’esten1763quecommencelaluttedupeuple circassien (ou tcherkesse selon l’étymologie arabe), résistant à la fièvre envahissante des troupes tsaristes. Composés de douze tribus, les Tcherkesses s’unissent contre l’ennemi, dans les années 1830, et se dotent d’un drapeau vert à douze étoiles. L’Union extraordinaire des tribus circassiennes est créée en 1861, mais n’est pas reconnue par la communauté internationale. Deux ans plus tard, les Circassiens essaient de négocier, avec le tsar Alexandre II, leur soumission pour ne pas être déportés, mais en vain. Le 21 mai 1864, s’achève la guerre du Caucase dans une dernière bataille qui n’épargne ni femmes ni enfants. Les historiens circassiens parlent de 800 000 morts. Débute alors l’exode d’environ un million de Circassiens vers les différentes régions de l’Empire ottoman. Plus de 200 000 décèdent pendant le voyage. Une majorité s’installe dans ce qui est aujourd’hui la Turquie, les autres dans les différents pays de l’actuel Proche- Orient, notamment en Jordanie où plusieurs milliers de réfugiés arrivent par vagues, à partir de 1878. Après la Première Guerre mondiale, ils deviennent de fidèles sujets du royaume hachémite. Une fidélité qui s’explique par la structure tribale de la société Jordanienne, dont les Circassiens sont l’une des cinquante- six tribus. En temps de crise, le roi rend visite aux dignitaires tcherkesses, comme aux autres. Les Circassiens s’estiment fondateurs de la capitale et protecteurs de la monarchie depuis la fondation du royaume de Transjordanie en 1921. La garde royale de cérémonie, par exemple, est composée exclusivement de Circassiens en tenue traditionnelle. Ils se sont aussi fait remarquer comme officiers. Le père de Ali L’HEBDO MAGAZINE 7 FÉVRIER 2014 | WWW.MAGAZINE.COM.LB46 REPORTAGE Le linguiste Kamal Jalouka présente le drapeau tcherkesse. Une vue de Amman.
- 47. L’HEBDO MAGAZINE 7 FÉVRIER 2014 | WWW.MAGAZINE.COM.LB 47 Maher, personnalité reconnue dans le milieu artistique de Amman, a servi pendant la guerre contre Israël en 1948. «Il a attaqué Moshe Dayan à Jérusalem, nous racontait le sémillant vieil homme, récemment décédé, et qui fut le premier à recevoir la Médaille d’honneur Jordanienne». Aujourd’hui, fiers du rôle qu’ils ont joué dans la construction et la défense d’un pays, né après leur installation, les Circassiens se sententàl’aiseavecleurdoubleappartenance. «Nous sommes Circassiens de nationalité, et Jordaniens de citoyenneté», revendique Tarek, 27 ans, jeune diplômé très investi dans les associations communautaires. De cinquante ans son aîné, le peintre circassien, Mohammad Keituka, clame aussi son amour pour son pays, la Jordanie, en admirant depuis un toit l’immense drapeau national qui flotte sur les hauteurs de la vieille ville. Protéger l’histoire et la culture Bien intégrés à la société et à l’économie en Jordanie, les Circassiens, largement assimilés − représentant environ 1,5% de la population − s’interrogent sur leur identité en observant l’effritement de leur culture et de leur mémoire. Ainsi, le célèbre historien tcherkesse Jordanien, Amjad Jaimoukha, souligne que tous les Tchétchènes, Caucasiens du Nord également, vivant en Jordanie, peuvent retracer leur généalogie sur sept générations, alors que les Circassiens en sont incapables. Au fondement de leur culture, on retrouve la Khabze, la manière de vivre circassienne codifiée à travers les siècles. Selon la coutume, par exemple, à sept ans, les garçons partent s’entraîner à l’art de la chevalerie. D’autre part, les marqueurs culturels circassiens sont très différents de ceux des peuples arabes. La vie du couple tcherkesse est cloisonnée. Lorsqu’une femme est enceinte, il est de rigueur de ne pas en parler ouvertement. Mais ces traditions s’effilochent à l’épreuve du temps et des changements sociétaux. Quant aux croyances religieuses, originellement imprégnées de polythéisme, de paganisme et d’animisme, elles se sont progressivement adaptées aux différentes puissances dominant le Caucase, puis aux divers pays d’accueil des exilés. Les Circassiens sont chrétiens, juifs, ou encore, comme l’ensemble de la communauté de Jordanie aujourd’hui, musulmans. Leur langue, qui s’appuie sur un alphabet cyrillique légèrement modifié, est aussi frappée d’oubli, notamment à cause du manque de reproduction des générations précédentes, qui ont préféré s’intégrer par la langue arabe. Ali Maher s’appelait, en fait, Bermamet. Un nom imprononçable en arabe qu’il a choisi de modifier dans les années 2000. Seuls 10 à 15% des Circassiens de Jordanie ▲ Le peintre circassien Mohammad Keituka.
- 48. pourraient encore parler tcherkesse, selon le linguiste Kamal Jalouka. Cependant, depuis quelques années, certains apprennent la langue circassienne en accéléré, auprès de l’Association circassienne de charité, pour lutter contre l’abandon de la pratique à domicile. «Tous nos pères ne savent pas ce que signifie notre drapeau, alors que nous, oui!, affirme Tarek. Notre génération est plus consciente de notre histoire et de notre identité». Pour garder vivantes les traditions, des militants continuent d’animer les structures de la communauté. Aux clubs al-Jil et al-Ahli, où l’on pratique des activités sportives, l’accent est surtout mis sur le folklore. Des jeunes réapprennent, par exemple, à jouer sur des instruments traditionnels: l’accordéon «pshina» ou le tambour «baraban». Et si les clubs attirent la classe moyenne, la «Tcherkess Kitchen», un traiteur de cuisine traditionnelle, s’est installée en 1999 afin d’offrir un moyen de subsistance à une trentaine de femmes de milieux modestes. L’entreprise, située dans le quartier résidentiel du Septième cercle, vend à midi des pâtisseries à base d’amandes ou de miel aux employés de bureaux. Les cuisinières sont représentatives de la variété des profils des Tcherkesses. On y rencontre Maazez, une Tcherkesse de Syrie mariée à un Jordanien et parlant sa langue originelle; ou Khaoula qui ne parle qu’arabe mais dont le fils a voyagé au Caucase. Malgré tous les efforts de certains, le mode de vie ancestral disparaît, notamment à cause de la dispersion des Circassiens dans L’HEBDO MAGAZINE 7 FÉVRIER 2014 | WWW.MAGAZINE.COM.LB48 Les Circassiens de Jordanie n’ont pas été les seuls à se mobiliser contre les J.O. de Sotchi et pour la reconnaissance de leur massacre. A l’appel du collectif May 21 − qui regroupe une douzaine d’institutions circassiennes dans le monde depuis l’octroi en 2007 des Jeux à la Russie −, des manifestations ont eu lieu, le 21 mai dernier, devant le siège de l’Onu à New York et devant les institutions diplomatiques russes à Berlin et Istanbul. D’autre part, la campagne internationale No Sotchi 2014, à travers son tout dernier slogan kNOwn Sotchi, s’est concentrée sur la sensibilisation. Lors des J.O., 300 kits comprenant de la documentation historique, des autocollants et des bonnets ont été distribués aux athlètes de quarante délégations dans l’espoir que certains acceptent de soutenir leurs revendications. UNE MOBILISATION INTERNATIONALE REPORTAGE▲ Mirna Janbek. La «Tcherkess Kitchen» s’est installée en 1999 afin d’offrir un moyen de subsistance à une trentaine de femmes de milieux modestes.
- 49. plusieurs quartiers de la ville. Certains, comme Wadi Sir, dans les années 1940, étaient presque uniformément tcherkesses. Mais aujourd’hui, autour du Septième cercle, on aperçoit de-ci de-là des tags sur les murs, parfois des avertissements: «Si vous nous frappez, nous vous frapperons». Réflexe d’une minorité en danger. Certains sont d’ailleurs tentés par le repli identitaire. Tarek promet qu’il n’épousera qu’une Circassienne. Pour se rapprocher de ses racines, il s’est même lancé dans un commerce de légumes avec la région de l’ancienne Circassie d’où sa famille est originaire. Mais pour d’autres, la course contre l’assimilation est vaine. Le jugement de l’historien Amjad Jaimoukha est sans appel: «En-dehors du Caucase, être Circassien n’est que nominal. Longtemps, la diaspora a cru que c’était elle qui protégeait la culture. C’est faux, ce sont uniquement les Circassiens du Caucase», qui sont aujourd’hui 700 000. Si le combat pour le maintien de leur culture en Jordanie est probablement déjà perdu, celui pour le «retour» n’est qu’illusion et leur demande de boycott des J.O. un échec. Leur revendication de la reconnaissance du «génocide» de leur peuple n’en est peut-être qu’au commencement, la Géorgie ayant déjà franchi le pas le 21 mai 2011. A suivre… ■ D.D. ET C.D. L’HEBDO MAGAZINE 7 FÉVRIER 2014 | WWW.MAGAZINE.COM.LB 49 «Notre société est très pudique, très fière, donc la danse est notre seule façon d’exprimer des sentiments que nous refoulons en permanence, décrypte Mirna Janbek, professeure de danse circassienne au teint pâle et aux gestes soignés. C’est pour cela que vous verrez parfois des hommes danser uniquement à genoux pendant toute une chorégraphie, pour exprimer la douleur». Plusieurs manifestations annuelles mettent la danse à l’honneur. Parmi elles, la cérémonie de remise des diplômes de la seule école circassienne du Moyen-Orient: la Prince Hamza School. Côté gradins, un millier de personnes sont au rendez-vous, dont le prince Hamza, membre de la famille royale et parrain de l’établissement, unanimement applaudi. Côté scène, les drapeaux Jordaniens et circassiens s’entremêlent. Dans l’obscurité, un épais nuage blanc se dissipe au rythme des accordéons et des percussions. Les montagnes du Caucase se sont invitées à Amman. Dans de magnifiques costumes traditionnels, de jeunes danseurs perpétuent les rituels ancestraux. Guerriers par excellence, les hommes, dague à la ceinture, portent sur la poitrine des flacons de poudre à fusil. Leurs pas, puissants, évoquent ceux des chevaux quand leurs mains, dissimulées dans de très longues manches, rappellent les battements d’ailes de l’aigle. Le mouvement des femmes imite celui des cygnes, délicat et précis. Fières mais timides, elles lèvent la tête en baissant le regard. Deux clubs à Amman pratiquent la danse tcherkesse, mais en amateurs. C’est donc parfois du Caucase même que des troupes professionnelles viennent en Jordanie perpétuer une danse «pure». Les danseurs Jordaniens ont souvent essayé de moder- niser les chorégraphies. «Pourquoi pas, mais c’est de l’art et non plus du folklore, tient à préciser Mirna, soucieuse du patrimoine. Il faut être conscient de la différence». LA DANSE, AU CŒUR DE LA CULTURE D.D. Les Circassiens de Jordanie se sont mobilisés contre les J.O. de Sotchi. Ecriture circassienne.
- 63. Impossible unitéImpossible unité Fondé il y a un demi- siècle, le pays n’a pas connu de répit. Créature et cauchemar des Nations unies, il offre depuis vingt ans des images chocs: guerres, famines, pirates et combats de rue. Au point que l’ONU, échaudée par le fiasco de l’intervention « militaro- humanitaire » de 1992, se garde bien d’y remettre les pieds. Le gouvernement vit retranché à Mogadiscio, et les soldats de l’Union africaine assistent, impuissants, au chaos. U ne étoile blanche orne le drapeau somalien. Cinq branches pour les cinq régions où vit le peu- ple somali : la Somalie britannique, la Somalie italienne, Djibouti, le nord du Kenya et l’Oga- den éthiopien. Mais l’unité perdue avec la conquête européenne des années 1880 n’a jamais été retrou- vée, et l’État somalien, créé en 1960, ne regroupe que l’ancienne Somalie britannique, au nord (actuel Soma- liland, voir encadré), et la Somalie italienne, au sud. Elles se fédèrent en 1960, quelques jours après leurs indépendances res- pectives, et espèrent reconstruire un jour la « Grande Somalie ». Cela n’ar- rivera pas. « Enfant chéri » des Nations unies, le jeune État est d’abord loué, avec excès, comme modèle de démocratie. Dès 1967 et en accord avec les pays voisins, le président Abdirashid Ali Sharmarke et son premier ministre, Mohamed Ibrahim Egal, renoncent à réunir les Somalis. Mais, en octobre 1969, Sharmarke est victime d’un assassinat à la faveur duquel une junte militaire s’empare du pouvoir. À la tête des putschis- tes, le général Siad Barré. Socialiste laïc, il est gagné par le démon pan- somali et engage son pays, en 1977, dans un conflit avec l’Éthiopie, pour prendre le contrôle de l’Ogaden. « Je suis venu au pouvoir pour unifier les Somalis, et rien ne me détournera de ce chemin », déclare-t-il. Lâché par son allié russe, Siad Barré est battu. La République de Somalie, qui avait changé son nom en « République démocratique de Somalie », devient dictature. Les mouvements d’oppo- sition sont écrasés dans la violence. Assistée, la Somalie n’est déjà plus que l’ombre d’elle-même : en 1987, 70 % de son budget provient de l’aide internationale. Début 1991, les insurgés parvien- nent à Mogadiscio. Le 27 janvier, après quatre semaines de combats d’une violence extrême, la ville tombe. Siad Barré prend la fuite. Pas de chance : ce jour-là, le monde a les yeux rivés sur le Koweït. ÉCHEC FLAGRANT « État failli » : tel est, depuis vingt ans, le qualificatif de l’État somalien, qui a contribué à l’émergence d’un concept aujourd’hui enseigné dans les écoles de sciences politiques. Les factions révolutionnaires n’ont pas trouvé d’accord après la chute du dic- tateur, et aucune autorité centrale n’administre plus la Somalie. Pour y remédier, et parce qu’ils sont choqués par les images d’une très dure famine, les États-Unis puis l’ONU débarquent en décembre 1992 : c’est la première intervention « militaro-humanitaire » du XXe siècle. Trois ans, 30 000 hommes et trois opérations de maintien de la paix plus tard, l’échec est flagrant. Les images des corps de marines traînés dans les rues par des pick-up traumatisent les Américains, qui n’ont plus jamais engagé un seul soldat dans un conflit africain. Elle aussi échaudée, l’ONU décide de formaliser et de durcir les critères d’engagement de Casques bleus en zone de guerre. Autant de changements doctrinaux qui ont plus alimenté les manuels de géopolitique que les Somaliens. Depuis 1997, des gouvernements de paille ont été mis en place à la faveur de médiations internationales. En réalité, les seigneurs de guerre, qui s’appuient sur des réseaux claniques et mafieux, se partagent le territoire dans la violence. 12. Somalie Tout au long de l’année, J.A. Voir les vidéos d’archives sur jeuneafrique.com en partenariat avec l’INA Traumatisés, les États-Unis n’ont plus engagé un seul soldat dans un conflit africain. 42 QU’AVEZ-VOUS FAIT DE VOS 50 ANS ? JEUNE AFRIQUE N° 2582 • DU 4 AU 10 JUILLET 2010 042-043 50ans Somalie.indd 42042-043 50ans Somalie.indd 42 1/07/10 22:00:501/07/10 22:00:50
- 64. En 2006, l’Union des tribunaux islamiques (UTI), fondée quelques années plus tôt, s’empare de Moga- discio. Dirigée par des notables, l’UTI rétablit un ordre depuis longtemps disparu, mais n’a pas le temps de se structurer politiquement : Addis- Abeba préfère un voisin affaibli, tan- dis que les États-Unis assimilent, de manière abusive, l’UTI aux cellules terroristes très probablement cachées en Somalie et responsables des atten- tats de 1998 contre leurs ambassades au Kenya et en Tanzanie. L’armée éthiopienne pénètre donc en Somalie, en décembre 2006, et Washington procède à des bombardements ciblés. L’UTI est renversée, et ses membres vont grossir les rangs de groupes bien plus radicaux qui cherchent dans un islam dévoyé une nouvelle identité somalienne. SOUS PERFUSION De tradition soufie modérée, l’is- lam somalien est aujourd’hui devenu caricature. Dernières injonctions des milices islamistes : barbe obligatoire et musique prohibée. Deux princi- paux groupes de miliciens contrôlent, parfois ensemble, parfois l’un contre l’autre, de vastes zones du sud et du centre du pays, et notamment les vil- les de Merka, Kismayo et Baidoa. Les combattants du Hizb al-Islam (Parti de l’islam) et des Shebab (les « jeunes »), qui se sont affiliés à Al-Qaïda en 2007, font également le siège de la minuscule enclave qui abrite, à Mogadiscio, les institutions du gouvernement fédéral de transition (GFT). Réinstallé dans la capitale soma- lienne en 2007, après avoir été hébergé au Kenya puis dans les villes de Jowhar et de Baidoa, le GFT vit aujourd’hui sous perfusion interna- tionale. Depuis dix-huit mois, le pré- sident Cheikh Sharif Cheikh Ahmed, un ancien chef de l’UTI, et son Pre- mier ministre, Omar Abdirashid Shar- marke, le fils de l’ancien président, ne ménagent pas leurs efforts. Mais les pays occidentaux qui les financent s’impliquent surtout dans la lutte contre la piraterie et s’attaquent plus aux symptômes du chaos qu’à ses cau- ses, si complexes. Les 4900 Ougandais de la force de maintien de la paix de l’Union afri- caine (Amisom), arrivés début 2007, n’ont pas les moyens de protéger la population. Alors les Somaliens se débrouillent, en l’absence de servi- ces publics et malgré le couvre-feu, en vigueur après 16 heures chaque après-midi. Sur 10 millions d’habi- tants, 100000 ont fui le pays en 2009. Cinquante ans après la création d’un État tronqué, le drapeau étoilé est interdit par les Shebab. Et la Somalie ne connaît ni la paix ni l’unité. ■ CONSTANCE DESLOIRE Abdirashid Ali Sharmarke (à g.) et Aden Abdullah Osman Daar, le 26 juin 1960, dans la capitale somalienne. Ils deviendront respectivement Premier ministre et président quelques jours plus tard. nnée, J.A. célèbre le demi-siècle de souveraineté des 17 pays ayant accédé à l’indépendance en 1960. SHOULDREAD/AFP LE RÊVE D’UNE « GRANDE SOMALIE » a été enterré par le Somaliland en 1991. Ancienne colonie britanni- que fédérée à la Somalie italienne en 1960 dans l’État de « Somalie », le Somaliland dénonce très tôt une union qui lui est défavorable. Siad Barré, le « Sudiste », ignore ses revendications; les Somalilandais se lan- cent dans une guérilla séparatiste dans les années 1980 et profitent de la chute du régime, en 1991, pour proclamer leur indépendance. Malgré une évidente souveraineté (gouvernement, monnaie, armée…), aucun État au monde n’a reconnu le Somaliland. Alors même, rappellent les autorités, que leur démocratie fonctionne et que l’État soma- lien, lui, n’existe plus. Les Somalilandais étaient appelés aux urnes, le 26 juin 2010, pour élire leur prochain président – le scrutin, prévu en avril 2008, avait été reporté plusieurs fois. La priorité du vainqueur sera la reconnaissance internationale. Chacun des trois candidats espère que le bon déroulement constaté du scrutin constituera un argument de poids. ■ C.D. LE SOMALILAND 43 JEUNE AFRIQUE N° 2582 • DU 4 AU 10 JUILLET 2010 042-043 50ans Somalie.indd 43042-043 50ans Somalie.indd 43 1/07/10 22:01:001/07/10 22:01:00
- 65. Émeutes à Dakhla, le Festival Mer et désert annulé 27/02/2011 à 11h:29 Par Constance Desloire, à Dakhla La fin des festivités a été annulée après des émeutes. © dakhla-festival.com Le festival Mer et désert de Dakhla a tourné à l’émeute, dans la nuit du vendredi 25 février et toute la journée du samedi 26. Les autorités ont décidé l'annulation de la dernière journée - celle du 27 février, également 35e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la République sahrouie. Mis à jour le 28/02/2010 à 09h18 La petite ville de Dakhla, située en plein cœur du Sahara occidental, a été le théâtre d’émeutes entre jeunes Marocains « de l’intérieur » et des populations sahraouies, en marge du festival culturel Mer et désert, dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 février. On déplore 15 blessés et de dégats matériels, selon les autorités marocaines qui ont qualifié ces événements d' « actes de vendalisme ». Le second grand concert, donné vendredi soir place Hassan II, était un moment à la fois familial et tendu. Les slogans « Sahara marocain ! » chantés dans la foule et les nombreux drapeaux du royaume témoignaient de l’importance de l’événement pour les défenseurs d’un Maroc unitaire dans cette région annexée en 1975. Mais pendant la nuit, la revendication a tourné à l’émeute dans le quartier sahraoui d’Oum Tounsi. « Nous avons été attaqués par des civils marocains »,
- 66. racontait, le lendemain, Hassan, un fonctionnaire se présentant comme un militant du droit des Sahraouis. Autour de lui gisaient des carcasses de voitures brûlées à la bombonne de gaz. « Les gens qui rentraient du concert se sont mis à courir devant des agresseurs qui s’en sont ensuite pris à des habitations », confirme un artiste étranger programmé au festival et hébergé dans le quartier. Dans les rues d'Oum Tounsi samedi soir, on recensait bris de verre, façades défoncées et véhicules militaires positionnés. Des affrontements se sont poursuivis le dimanche - jour du 35e anniversaire de la déclaration d'indépendance de la République arabe sahraouie démocratique en 1976 - avant que la situation ne se calme. La présence de l'armée a pour l'instant apaisé des émeutes face auxquelles l'intervention de la police a été tardive. Un commerçant d'Essaouira est décédé sous les roues d'un véhicule dont le conducteur est recherché. Dimanche matin lors d'un point de presse, les autorités ont annoncé officiellement l'arrêt des festivités. « Un groupe de sépartistes [pro-Polisario, NDLR] a exploité ces violences à des fins politiques », a indiqué le wali de Laayoune Khalil Dkhil. Un développement inégal Dans une ville que l’on dit moins politisée que Laayoune - l’autre ville du Sahara marocain où des émeutes avaient fait 13 morts en novembre dernier -, le festival Mer et désert se veut le symbole d’un développement accéléré depuis cinq ans. Compétitions de sport nautique et grands concerts publics attirent des jeunes venus de très loin, dans un cadre idyllique. Événement aux couleurs nationalistes, le festival avait, au cours des quatre éditions précédentes, suscité des troubles mais jamais de cette ampleur. Des investissements massifs ont été réalisés par l’État marocain en termes d’infrastructures pour désenclaver la ville la plus au Sud du pays. Autre objectif : développer la pêche et le tourisme, notamment par le biais du festival. Mais « il y a deux Dakhla », estime Mohamed, 21 ans, un habitant d’Oum Tounsi. « Ici les Sahraouis n’ont pas vu leur quartier se développer et nous sommes tous au chômage parce que l’on est désavantagés. » Par Constance Desloire, envoyée spéciale à Dakhla
- 67. Y oweri Museveni vient de nommer au sein de la com- mission électorale les mêmes membres que pour le scrutin de 2006, pourtant qualifié d’irrégulier par la Cour suprême ougandaise. Pour obtenir le renvoi des commissaires, des opposants politiques et civils manifes- tent déjà – au prix de séjours au com- missariat. Mais sauront-ils profiter du multipartisme, rétabli en 2005, pour s’emparer de la tête de l’exécutif? Le trophée paraît imprenable. Cinq partis se sont rassemblés depuis août 2008 au sein de l’Inter- Party Cooperation (IPC) et doivent choisir un candidat unique le 23 août. Kizza Besigye, champion du Forum for Democratic Change (FDC), a de bon- nes chances d’être désigné. Il a obtenu 28 % à la présidentielle de 2001 – il se présentait à l’époque en indépendant – et 37 % en 2006 pour le FDC. Cet ancien médecin personnel de Museve- ni est devenu le héros de l’opposition en Ouganda, d’autant plus populaire qu’il a été emprisonné pendant deux mois fin 2005. Autre candidat: Olara Otunnu, ex-numéro deux de l’ONU et président de l’Uganda People’s Congress (UPC). Ancien ministre des Affaires étrangères, il avait quitté le pays en 1986 lors de la prise de pou- voir de Museveni et n’y est revenu qu’à l’été 2009. Les autorités le prennent suffisamment au sérieux pour avoir lancé un mandat contre lui, le 4 août, après qu’il eut accusé Museveni de soutenir l’Armée de résistance du Sei- gneur (LRA). Or, sur ce sujet, il ne faut pas chatouiller le président, qui reste par ailleurs très populaire. Dans le domaine de la sécurité, justement, il entretient une image de rempart. Depuis 1986, la LRA, rébellion « chrétienne » utraviolente du nord du pays, permet au régime d’apparaître solide. Et ce alors même qu’il n’a jamais réussi à arrêter son dirigeant, Joseph Kony – au point que certains soupçonnent Museveni de ne pas tout faire pour. La milice soma- lienne des Chabaab, qui a revendiqué les attentats du 11 juillet, pourrait reprendre le rôle de l’épouvantail sécuritaire. Face aux critiques émises par l’opposition sur la participation de l’armée ougandaise à la force de l’Union africaine en Somalie (Ami- som), le conseiller pour les affaires politiques de Museveni, Moses Bya- ruhanga, interroge malicieusement dans la presse: « Quelle est l’opinion du candidat Besigye sur le terroris- me? Peut-on lui faire confiance? » ET LES LÉGISLATIVES? Museveni est de ces hommes d’autant plus populaires qu’ils sont attaqués. Le royaume du Bugan- da, autour de la capitale Kampala, affiche son hostilité au régime. En septembre 2009, des affrontements entre les partisans du roi, le Kabaka Mutebi II, et les fidèles de Museveni avaient fait 30 morts. Aujourd’hui, l’organisation Suubi 2011, fondée par des anciens ministres du royau- me, soutient « un changement très attendu aux prochaines élections ». Mais, selon un sondage du quotidien Daily Monitor, 52 % des Ougandais refusent que les institutions royales se mêlent de politique. En février 2011, Museveni devrait donc encore triompher. Certains ana- lystes, comme Isaack Otieno, direc- teur du programme Corruption et gouvernance de l’Institute for Secu- rity Studies (ISS, basé en Afrique du Sud), estiment que le changement en Ouganda viendra d’abord des légis- latives, qui se tiendront en même temps. Selon lui, « de jeunes leaders vont essayer d’intégrer le National Resistance Movement (NRM), au pouvoir, et de réformer le pays par le Parlement ». Le multipartisme a besoin d’encore un peu de temps pour solidifier la démocratie. ■ CONSTANCE DESLOIRE Des adversairesDes adversaires désarmésdésarmés A priori, personne ne pourra battre Yoweri Museveni en 2011. Malgré le rétablissement du multipartisme en 2005, lʼopposition peine à sʼunir. AFRICA24MEDIA/REUTERS Les soldats de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), éternels opposants, boutés hors d’Ouganda mais qui continuent de faire des ravages dans la région. Le Kabaka Mutebi II, roi du Buganda, affiche son hostilité au régime. 25YOWERI MUSEVENI L’INUSABLE JEUNE AFRIQUE N° 2587 • DU 8 AU 14 AOÛT 2010 020-025 OUGANDA 2587.indd 25020-025 OUGANDA 2587.indd 25 6/08/10 12:20:546/08/10 12:20:54
- 68. N icolas Sarkozy l’atten- dait à Paris pour le défilé du 14 Juillet, des contrats d’équi- pement prêts dans un porte-documents. Mais le roi Abdallah, 86 ans, souve- rain d’Arabie saoudite depuis 2005, a annulé son déplacement sans donner de raison officielle. De quoi relancer les spéculations sur sa santé – et sur sa succession. D’autant que son impres- sionnante longévité n’est pas sans sus- citer l’impatience des quelque deux cents princes de la famille régnante qui pourraient tôt ou tard prétendre au trône. Dans la droite ligne du roi Fayçal (1904-1975), Abdallah a introduit une série de réformes, certes timides, dans un pays réputé pour son conservatisme et son opacité. Et œuvré au renforce- ment de l’influence régionale du royau- me. S’il venait à disparaître, lequel de ses demi-frères lui succéderait? Et que ferait celui-ci de cet héritage? Depuis le décès, en 1953, d’Abdela- ziz Ibn Saoud, qui a unifié le royaume d’Arabie en 1932, la transmission du pouvoir se fait selon le droit d’aînesse – exclusivement masculin. À la mort du souverain, le trône revient au fils le plus âgé d’Ibn Saoud, et ce jusqu’à la disparition de tous les frères. Ce n’est qu’ensuite que la génération des petits-fils du fondateur du royaume pourra accéder au pouvoir. Les fils étant vieillissants, on risque d’assister au cours des prochaines années à une série de règnes de courte durée. Sous d’autres cieux, une suite de couronne- ments d’hommes très âgés, avec le ris- que de devoir destituer un roi impotent, serait de nature à ébranler le système. Mais, en Ara- bie saoudite, aucune succession ne porte en elle un germe de dés- tabilisation. Le pays est parfaitement « encadré » par les servi- ces de sécurité, et le régime wahhabite est suffisamment solide. Il faut donc s’attendre à une passation de pouvoir sereine, selon la coutume. Sont donc en pole position trois demi-frères d’Abdallah : d’abord Sul- tan, 82 ans, l’actuel prince héritier et ministre de la Défense, puis Nayef, 77 ans, ministre de l’Intérieur, promu second vice-président du Conseil des ministres en mars 2009 – un poste toujours attribué au deuxième héritier dans l’ordre de succession –, et, enfin Salman, 74 ans (voir portraits). Tous trois représentent la continuité du pouvoir des Saoud. « Le point commun entre Sultan, Nayef et Salman, selon le chercheur Pascal Ménoret, de la Har- vard Academy for International and Area Studies, c’est qu’ils participent au pouvoir depuis l’arrivée de Fayçal sur le trône, en 1964. Ils partagent la responsabilité du développement ful- gurant du pays après le boom pétrolier de 1973, mais aussi de la progression de la corruption. » Pas de rupture à l’horizon donc avec ce trio. D’autres demi-frères d’Abdallah pourraient aspirer à devenir roi. Sur les 36 enfants mâles qu’a eus Ibn Saoud, 18 sont encore vivants – et ont tous plus de 65 ans. Bandar Ibn Abdelaziz, par exemple, pourtant plus âgé que Sultan et Nayef, a l’in- convénient d’avoir une mère non pas saoudienne, mais marocaine, ce qui le disqualifie. De même que, pour citer les plus influents, Miqrin et Hidhlul, de mères yéménites, et Mishal, Mitab, Talal et Nawaf, de mères arménien- nes. Talal s’est d’ailleurs distingué en s’attirant la désapprobation familiale Dans la droite ligne du roi Fayçal, lʼactuel souverain a introduit quelques réformes timides, mais significatives, dans un royaume réputé pour son conservatisme. Trois hommes sont aujourdʼhui en pole position pour lui succéder. Et assumer ‒ ou renier ‒ cet héritage. CONSTANCE DESLOIRE ARABIE SAOUDITE APRÈSABDALLAH,APRÈSABDALLAH, QUI?QUI? Vu l’âge des prétendants, on risque d’assister à une série de règnes de courte durée. 41MAGHREB & MOYEN-ORIENT JEUNE AFRIQUE N° 259 0 • DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2010 040-043 MMO OUV 2590.indd 41040-043 MMO OUV 2590.indd 41 26/08/10 21:21:5426/08/10 21:21:54
- 69. pour avoir souhaité que le royaume se transforme en monarchie constitu- tionnelle. « Le Coran est notre Consti- tution », avait proclamé le roi Fayçal – et c’est toujours le cas aujourd’hui. En mars 2009, Talal avait aussi exigé d’Abdallah qu’il dise clairement si la promotion de Nayef en faisait le deuxième prince héritier. Il n’a jamais obtenu de réponse. Être d’un âge avancé, avoir une mère saoudienne et être dans les petits papiers de la famille ne suffisent pas pour autant pour être roi. D’autres règles non écrites compliquent la suc- cession, comme l’équilibre entre les différents clans de la dynastie. Le clan des Soudaïri, par exemple, composé des enfants de Hassa Bint Soudaïri, épouse favorite d’Abdelaziz, regroupe aujourd’hui six fils très influents – dont les trois premiers prétendants au trône. Pour prévenir des querelles fratricides, Abdallah a créé, en 2006, un Conseil d’allégeance chargé de désigner le nouveau roi. Composé de trente-cinq membres éminents de la famille royale, celui-ci est censé déci- der par consensus. « Le Conseil n’a pas encore eu l’occasion de se réunir pour la nomination d’un roi. La disparition d’Abdallah servira de test », estime Christopher Boucek, chercheur associé au Carnegie Middle East Center. CONTRADICTION IDÉOLOGIQUE La succession saoudienne pourrait être un plaisant feuilleton royal si l’ave- nir d’une puissance majeure et influen- te du Moyen-Orient n’était en jeu. Avec Abdallah (qui a été, à partir de 1995, le régent informel du roi Fahd, inca- pable de gouverner jusqu’à son décès, en 2005), le pays semble avoir amorcé une ouverture: promotion du dialogue interreligieux, libéralisation économi- que, soutien à l’éducation supérieure des femmes, réforme du système judiciaire… Mais Pascal Ménoret, qui rappelle que le terme de « réforme » a été systématiquement associé à tous les rois depuis Fayçal, préfère parler d’« attentisme prudent, ponctué de déclarations de principe sur l’arabité et l’islamité d’un pays par ailleurs aligné sur la politique de Washington ». De son côté, Neil Partrick, consultant bri- tannique sur le Golfe persique, évoque plutôt des « changements d’environ- nement, modestes aux yeux des stan- dards internationaux, bien que signi- ficatifs pour l’Arabie saoudite. Mais ils ne sont pas suffisamment inscrits dans les institutions pour que leur pérennité soit garantie ». De fait, peu de textes de lois ont réellement été adoptés ou mis en œuvre. Or le royaume, fort de 29 millions d’habitants, 26e puissance mondiale, va devoir faire des choix importants, d’autant que sa jeunesse (60 % de la population ont moins de 25 ans) appelle de ses vœux des réfor- mes, notamment en matière de démo- cratisation. En tant que gardien des lieux saints de l’islam (La Mecque et Médine), Riyad est dans une position délicate, car il ne peut à la fois se poser comme le tenant d’un islam fondamentaliste et faire la chasse aux djihadistes, idéo- logiquement proches du wahhabisme saoudien. Une contradiction embarras- sante pour un pays qui se veut influent et sage, et dont l’acte diplomatique majeur fut l’Initiative de paix arabe de 2002, qui offrait à Israël la reconnais- sance de tous les pays arabes en échan- ge d’un retrait de tous les territoires Sultan Ibn Abdelaziz En sursis Membre du clan Soudaïri, Sultan Ibn Abdelaziz, 82 ans, est ministre de la Défense et de l’Aviation depuis 1962. Atteint d’un cancer du côlon, il a passé, en 2008, de longs mois en convalescence loin du pays, où il n’est rentré qu’en décembre 2009. Son fils Khaled le supplée de facto au ministère. Il est également inspecteur géné- ral du royaume, président du conseil d’administration de la Saudi Arabian Airlines et fondateur de la Commission nationale pour la protection et le développement de la faune et la flore. Officiellement, on se félicite aujourd’hui de sa bonne santé, mais des voix discordantes, mais censurées, sont nettement moins optimistes et laissent clairement entendre que le premier dans l’ordre de la succession risque de disparaître avant le roi Abdallah. Nayef Ibn Abdelaziz Le conservateur Nayef Ibn Abdelaziz, ministre de l’Intérieur et mem- bre également du clan Soudaïri, a été nommé second vice-président du Conseil des ministres en mars 2009. Il est donc bien placé pour monter sur le trône. Depuis sa promotion, il s’est fendu de plusieurs déclarations en contradiction avec la ligne du roi Abdallah. Il a par exemple jugé qu’il n’était pas nécessaire que des fem- mes puissent siéger au Majlis al-Choura, ni que les députés soient élus (ils sont actuellement nommés par le roi). Mais les questions que l’on se pose à son sujet (n’est-il pas trop proche des religieux, des tribus?) sont celles-là mêmes que l’on s’était posées à propos d’Abdallah il y a quinze ans. Il est donc tout à fait possible qu’il infléchisse ses positions pour gouverner de façon médiane, à la manière de l’actuel souverain. Salman Ibn Abdelaziz Le médiateur Autre demi-frère du roi, le Soudaïri Salman Ibn Abde- laziz, 74 ans, est gouverneur de la province de Riyad depuis 1962. Il a une expérience du terrain qui tranche avec la distance que cultivent les princes ministres. Pro- priétaire du journal panarabe Asharq Al-Awsat, il est considéré comme un médiateur au sein de la famille pour avoir été chargé, dans le passé, de l’attribution des rentes aux membres de la dynastie et de la résolution des conflits entre les princes. Un atout majeur dans un système où les décisions se prennent par consensus. Mais le décès précoce de deux de ses fils en raison de problèmes cardiaques fait planer une incertitude sur sa santé. 42 MAGHREB & MOYEN-ORIENT JEUNE AFRIQUE N° 259 0 • DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2010 040-043 MMO OUV 2590.indd 42040-043 MMO OUV 2590.indd 42 26/08/10 20:20:5726/08/10 20:20:57
- 70. occupés – y compris le Golan. Mais l’Arabie saoudite incarne aussi, avec l’Égypte, l’islam sunnite. Son inquié- tude face à la montée en puissance de l’Iran chiite l’a poussée à se rapprocher de la Syrie – alliée de Téhéran – pour renforcer sa position dans la région, comme l’a montré la visite commune d’Abdallah et de Bachar al-Assad à Beyrouth, le 30 juillet. EXIT AL-WALID Il est difficile de dire si les demi-frè- res de l’actuel souverain marcheront dans ses pas sur le terrain des réfor- mes sociales et politiques. Et qu’en sera-t-il des princes de la deuxième génération, celle des petits-fils d’Ibn Saoud, quand arrivera leur tour ? Le roi Fahd avait promulgué, en 1992, une loi ouvrant la succession « aux fils et petits-fils » d’Ibn Saoud, dont il faudrait désigner « le plus apte ». Une procédure de nomination délicate qui n’a jamais été détaillée. Toujours est-il que la génération des petits-fils est désormais sur les rangs. Ayant entre 50 et 60 ans, ils sont pourtant consi- dérés comme trop jeunes. Certains sont cependant assez bien placés pour espérer, à terme, devenir roi : Mitab, 59 ans, fils du roi Abdallah et chef de la garde nationale ; Khaled, 61 ans, fils de Sultan et vice-ministre de la Défense; ou Mohammed, 56 ans, fils de Nayef et responsable des opérations antiterroristes – activité qui lui vaut les faveurs des Occidentaux. Tous trois appartiennent au groupe des « sécu- rocrates » et ont été placés par leurs pères à des postes clés… il y a déjà trente ou quarante ans! Souvent formés en Occident, ils pourraient être favorables à une libéralisation. Dix-neuf d’entre eux siègent au Conseil d’allé- geance et auront leur mot à dire – à condition de respecter l’opinion des fils d’Ibn Saoud. Le passage à la génération suivante interviendra tôt ou tard, mais il n’est pas encore à l’ordre du jour et n’entraînera pas, a priori, de grande révolution. Un personnage comme le libéral Al-Walid Ibn Talal, 55 ans et neveu du roi, sert pour l’instant de repoussoir. La 22e for- tune du monde (en 2009), fils du provo- cateur Talal, n’a pas caché son ambition de monter un jour sur le trône. Mais ses prises de position en faveur d’une émancipation progressive des femmes et ses attaques contre le salafisme l’ont écarté des cercles du pouvoir. RECHERCHE DU CONSENSUS Qui ou quoi, en dehors des Saoud, pourrait influencer la désignation du roi? La famille régnante domine l’Ara- bie depuis deux cent soixante-dix ans. Mais des rivalités intestines lui ont fait perdre le contrôle du pays au XIXe siè- cle. Autre souvenir douloureux : l’as- sassinat, en mars 1975, du roi Fayçal par l’un de ses neveux, qui cherchait visiblement à venger la mort de son frère ultrareligieux tué par la police lors d’une manifestation, dix ans plus tôt. C’est donc aujourd’hui le maintien de l’héritage unificateur du fondateur, gage de stabilité, qui prime. Les Saoud choisiront un souverain à la manière dont ils dirigent le pays: par consen- sus. La famille recueillera l’avis des différents groupes influents, au pre- mier rang desquels le haut clergé. C’est lui qui confirme le choix du roi en le nommant imam. Le contrat tacite est le suivant: tandis que les oulémas ont la haute main sur les questions reli- gieuses et veillent à la pérennité du wahhabisme, le roi s’occupe des affai- res du pays. Les États-Unis ont également leur petite idée: ils ne voient pas d’un œil favorable le couronnement de Sultan ou de Nayef. « Bien que proaméri- cain, explique Simon Henderson, du Washington Institute for Near East Policy, Sultan a la réputation d’être un homme corrompu. » Quant à Nayef, « il a rechigné à renforcer la sécurité après les attaques d’Al-Qaïda contre le royaume en 2003 ». Mais ni l’allié amé- ricain ni même le Majlis al-Choura, le Parlement, n’ont un accès direct aux arcanes de la famille royale. Dans les années à venir, on assistera probable- ment au défilé rapproché de plusieurs têtes couronnées au sommet de l’État – et à peu de changements significatifs. Au royaume des Saoud, la prudence est toujours reine. ■ Les princes de la deuxième génération attendent leur tour avec impatience. Les trois demi-frères d’Abdallah, à Riyad, le 13 décembre 2009. PHOTOS:HONEW/REUTERS 43 JEUNE AFRIQUE N° 259 0 • DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2010 040-043 MMO OUV 2590.indd 43040-043 MMO OUV 2590.indd 43 26/08/10 20:21:0426/08/10 20:21:04