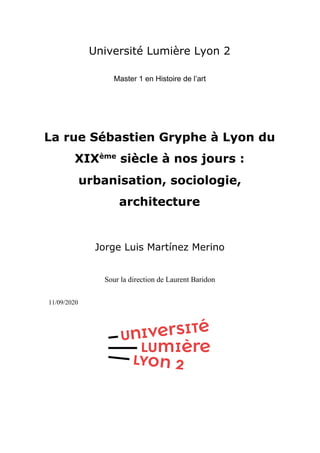
La rue Sébastien Gryphe à Lyon.docx
- 1. Université Lumière Lyon 2 Master 1 en Histoire de l’art La rue Sébastien Gryphe à Lyon du XIXème siècle à nos jours : urbanisation, sociologie, architecture Jorge Luis Martínez Merino Sour la direction de Laurent Baridon 11/09/2020
- 2. Introduction : La rue Sébastien Gryphe du XIXème siècle à nos jours Le développement d’une rue au cours de l’histoire et le langage architectural et urbanistique créé autour d’elle sont déterminés par de nombreux facteurs. Les différentes activités des populations qui y résident sont l’un d’entre eux. Ces activités se refléteront dans une identité particulière des lieux qui, avec le temps, peut devenir un patrimoine historique et architectural. Il présente la particularité d’être éphémère et d’une grande labilité puisque, créé à une certaine époque, il peut complètement être effacé quelques générations plus tard par une population complètement différente, venue peut-être d’ailleurs. Ainsi certains de ces bâtiments ont été reconvertis en logements, d’autres en bars, en atelier, tandis que d’autres étaient détruits. C’est dans ce cadre que nous allons étudier la Rue Sébastien Gryphe à Lyon, située dans le quartier de La Guillotière. Durant des siècles, le pont dit de La Guillotière a été l’unique point d’entrée à l’est de Lyon. Et à son voisinage, petit à petit un faubourg s’est constitué avec notamment des auberges et des commerces, faubourg qui a été définitivement rattaché à Lyon en 1852. Pendant le XIXème siècle, la vitalité de cette rue était due à la présence d’artisans, de petits commerçants et d’ouvriers d’établissements industriels. Ils venaient majoritairement du Dauphiné, de Savoie et du Piémont. Le XXème siècle a vu l’arrivée d’autres étrangers. Les travailleurs immigrés qui s’y installent, en général venus du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et de Chine, s’inscrivent dans l’histoire populaire et cosmopolite de cette rue. Pendant le XXème siècle, de nouveaux commerces sont ainsi apparus. Actuellement, ils contrastent de plus en plus avec des bars ou d’autres lieux occupés par une petite bourgeoisie intellectuelle, notamment à cause de la proximité des universités. Ces transformations successives ont créé des bouleversements dans l’usage de chaque bâtiment mais aussi dans la population et dans les interactions entre ses différentes composantes socio-culturelles : les nouveaux habitants ne se mélangent pas pour autant avec la population immigrée qui y habite de longue date. La place Mazagran témoigne bien de ce phénomène. Ces mutations relativement rapides conduisent à se poser la question de ce qui se trouve en jeu dans ces transformations à la fois urbaines et sociales, comment s’opère le processus de gentrification et quelles sont ses répercussions sur le plan architectural ? L’objet
- 3. de ce mémoire est d’analyser le développement de cette rue pour anticiper son avenir sur le plan urbanistique, social et architectural en étudiant son évolution historique pendant les deux siècles précédents. Pour trouver des réponses possibles à cette problématique, on cherchera des entités sur lesquelles on pourra s’appuyer aux niveaux aussi bien local que régional ou national. En effet, bien que la problématique la plus récente (gentrification) soit au niveau social, dans cette étude, l’accent sera mis sur le développement territorial et la valorisation du patrimoine architectural comme support pour en comprendre le phénomène. On sera donc amené à en étudier les possibles causes, et les initiatives de la ville ou de la Métropole de Lyon pour limiter la ségrégation spatiale et sociale et pour faciliter l’intégration des habitants actuels, voire même des futurs habitants. La question de la valorisation du patrimoine de la rue est relativement peu étudiée et pourrait faire l’objet de multiples controverses au regard des investissements. Dans ce mémoire, on pourrait être amené à prendre position sur cette question. Ce mémoire sera organisé en trois grands chapitres. L’introduction posera la problématique, délimitera la zone d’étude et présentera la méthodologie pour développer ce travail. Le premier chapitre contextualisera la rue en repérant les principaux éléments à analyser, ainsi que les grandes étapes de son histoire. Dans un deuxième temps, on mettra l’accent sur le développement urbanistique et architectural de la rue. Enfin, le troisième chapitre comprendra l’histoire cosmopolite de la rue, qui nous amènera à introduire le phénomène de gentrification et déduire les différents scénarios possibles pour le futur. La conclusion apportera des points de vue critiques sur notre perspective de la problématique à court et long terme. La zone d’étude sur laquelle on développera ce mémoire comprendra la partie nord de la rue ; de son commencement au cours Gambetta en avançant vers le sud jusqu’à son intersection avec la rue de l’université, soit une distance d’à peu près 650m, les voitures circulent dans une ruelle vers le nord. (Figure 1).
- 4. Figure 1. Carte actuelle qui montre la distribution de la partie ouest du quartier de la Guillotière (Saint André), y compris le trajet de la Rue Sébastien Gryphe pour notre étude. Par rapport à la méthodologie, la recherche est fondée sur les sources locales en exploitant les fonds et les bases de données des archives municipales de Lyon, les fonds des archives départementales et métropolitaines du Rhône et la ville de Lyon, ainsi que celles de l’agence d'urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise. D’autre part, notre recherche s’appuie sur une enquête de terrain par des entretiens avec propriétaires de quelques entreprises ou appartements, en analysant l’architecture de chaque bâtiment, son histoire, les activités qu’y se déroulent et leur compatibilité avec celles des autres édifices.
- 5. Chapitre 1 : Contexte historique La partie la plus ancienne de l’histoire de la rue correspond à la partie proche de la Grande Rue de la Guillotière. Elle était habitée sous l’ancien régime mais on ne sait pas la date exacte de son ouverture. Sous le nom de Rue Chabrol (ou Rue de Chabrol), son extension a été tracée progressivement du nord vers le sud à partir du milieu du XIXème siècle. C’est sur un plan de 1839 qu’on peut trouver pour la première fois représenté le tracé de la rue. Avec l’ouverture du cours Gambetta, la rue s’étend aussi au nord. Vers 1841, la Guillotière comptait déjà 25 730 habitants1 , le dynamisme de cette agglomération de la rive gauche du Rhône provient des atouts géographiques, en permettant de développer des axes de circulation essentiels vers l’est et le sud. Ainsi donc, l’urbanisation dans cette région fut à l'époque l’espace intermédiaire entre l’est (Dauphiné, la Savoie et le Piémont en Italie2 ) et la ville de Lyon. Cela est déterminant pour comprendre le développement ultérieur du quartier ; tout le long de son histoire, la Grande Rue de la Guillotière fut le passage d’un commerce très complexe et divers selon la saison : armes de guerre venant d’Italie, objets exotiques venant du Moyen Orient, produits fermiers venant de Provence, etc. C’est justement cette population venant d’ailleurs et leurs différentes façons de commercer qui a établi les activités que se dérouleraient dans le quartier ; premièrement, celles liés à la circulation elle-même (charrons, maréchaux-ferrants), ensuite celles de l’accueil (auberges pour ceux qui avaient d’attendre le matin et la réouverture du pont, fermé la nuit). Cela se traduit par la présence d’activités de santé et de loisirs. 1 GIRAUD Théophile, Histoire de la Guillotière et des Brotteaux depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1846), Lyon, 1846, p.108. 2 A l’époque, la Savoie et le Piémont formaient un seul pays jusqu’à l’Unité italienne en 1861.
- 6. Figure 2. Emplacement de la rue Sébastien Gryphe sur le cadastre napoléonien de 1830 Figure 3. Projet d’ouverture des rues en 1842 avec la prolongation du pont de la Guillotière jusqu’à la place Gabriel Péri, d’oú son ancien nom « Place du Pont (le nord étant à gauche sur cette carte). L’existence de nombreux bras du Rhône nous donne une idée de l’incertitude de ce fleuve et de l’impact d’une crue sur le quartier. Tracée en grisé, la position de la rue Sébastien Gryphe, encore inexistante à l’époque. Pour comprendre l’évolution et le contexte de cette époque, je m'appuierai à titre d’illustration, sur les planches de Joachim Martin3 , un document tout à fait exceptionnel et inédit qui nous raconte comment était la vie au XIXème siècle dans le sud-est de France, et ce qui est inhabituel, du point de vue d’un artisan et paysan modeste. Il témoigne de la distance qui existait entre les classes sociales à l’époque. Il évoque de façon très positive le début de la République, surtout à cause de ses politiques de laïcité. Grâce à ses textes, on sait qu’il n’y avait pas de xénophobie envers les nouveaux ouvriers piémontais, mais il raconte que le peuple ressentait cette nouvelle présence comme une concurrence pour l’approvisionnement. Il était conscient qu’avec l’industrie en plein essor, il habitait dans un monde qui changeait rapidement et dans lequel il y avait de plus en plus de mouvements de population. 3 Jacques-Olivier BOUDON, Le plancher de Joachim : l'histoire retrouvée d'un village français, Paris : Belin, DL 2017.
- 7. Dans ce contexte, la rue de Chabrol (son nom à l’époque) est ouverte vers 1820 dans le cadre du lotissement du clos Félissent. En 1824, son premier tracé s’étend de la Grande Rue de la Guillotière à la rue Montesquieu, sur le document préparatoire au plan d’alignement Scève4 . Sur le Plan des propriétés des Hospices civils de Lyon en 1839, la rue est prolongée jusqu'à la rue des Trois-Pierres (actuellement rue Salomon Reinach). La section suivante, de la rue des Trois-Pierres à la rue Croix-Jordan, est ouverte spontanément par les lotisseurs du Prado à partir de 1842, en respectant le plan d'alignement municipal5 . Figure 4 : Plan de 1855, le premier tracé de la rue Sébastien Gryphe apparaît déjà sur le plan mais sous le nom de Rue de Chabrol (le nord étant à gauche sur cette carte) ; dans cette carte on observe aussi le tracé du cours de Brosses (Gambetta) à ouvrir. C’est en 1879 que la rue est rebaptisée du nom de Sébastien Gryphe, au début de la Troisième République, en hommage à l'illustre imprimeur humaniste de la Renaissance lyonnaise. Car on verra que tout le long du XIXème siècle, la rue témoigne de l’épanouissement d’une puissante industrie principalement liée à l’imprimerie. La proximité du fleuve concourt au développement de l’industrie, qui petit à petit prenait une place dominante dans le quartier ; le Rhône permettait de transporter et aussi d’extraire la matière première, tandis que l’industrie en revanche permettait de planifier un meilleur système de dragage pour le fleuve. Cependant, cette relation n’a pas été toujours aussi avantageuse qu’il paraît au premier abord . Le fleuve engendrait aussi des problèmes à cause de son instabilité et de ses ramifications qui, en période de pluie, provoquaient des inondations, les plus remarquables étant celles de 1840 et 1856. 4 AD Rhône 3 Pl 91. 5 AC Lyon, 321 WP 179/1.
- 8. C’est dans ce contexte que sur la rue Sébastien Gryphe se trouvait l’un de plus beaux ateliers d’imprimerie de toute la France, la fabrique de papiers peints Graillet. Fondée dans le 2ème quart du XIXème siècle, les locaux de l’ancien atelier ont été entièrement ruinés par une inondation en 1840. Mais, après une implantation temporaire, ils ont été remplacés par une usine modèle inaugurée le 2 août 1842, souvent considérée comme l’un des plus beaux ateliers de papiers peints qui existait en France6 . Du XIXème au XXIème siècle, la rue a témoigné du passage de différentes formes de gouvernement en France, soit neuf en total7 . Dans chaque régime, des événements se sont produits, quelques-uns plus marquants que d’autres. De ce fait, à Lyon, on peut constater un avant et un après lors du Second Empire. L'historien Maurice Agulhon note que « l’histoire économique et culturelle » du Second Empire se caractérise par « une période prospère et brillante » 8 . En effet, le style du second empire s’est répandu dans tout le pays en provoquant des changements irréversibles dans le langage urbain et architectural des cités. Avant de passer au deuxième chapitre pour analyser proprement ces éléments, on va repérer quelques facteurs importants pour comprendre le contexte historique de cette période. D’abord, pour la première fois, il existait une conscience de la ville comme entité de production industrielle (production en série dans les usines dont la production se caractérisait par l’emploi de machines), dont l’urbanisme jouait un rôle important. Par conséquent, l’agriculture voit aussi une mécanisation naissante qui augmentait la productivité, ce qui provoquait un exode rural vers des grandes villes qui voient exploser leur population. En autre, les échanges s’accéléraient, avec le développement du chemin de fer, l’ouverture de la ligne Paris-Lyon-Marseille en 1857 permettait un dynamisme commercial qu’on n’avait jamais expérimenté à Lyon, et du même favorisait l’arrivée de migrants, qui par les conditions géographiques, trouvaient dans la Guillotière le repère parfait pour l’agrandissement industriel de la ville. La même année, des côtés est et sud-est, il s’est passé un évènement important ; le roi d’Italie Victor Emmanuel II de Savoie, ordonnait le début des travaux du percement du Mont Cenis 6 GIRAUD Théophile, Histoire de la Guillotière et des Brotteaux depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1846), Lyon : J. Giraud, 1846. 7 1er Empire (1804-1815), restauration de la monarchie (1815- 1830), Monarchie de Juillet (1830- 1848), deuxième République (1848- 1852), 2nd empire (1852-1870), troisième République (1870-1941), Régime de Vichy (1941-1944), Quatrième République (1944-1958), Cinquième République (1958-présent). 8 Maurice Agulhon, Décembre 1851 dans l'Histoire de France, 1851.
- 9. pour la construction d’un tunnel ferroviaire, qui sera finalement inauguré en 1871. Etant le plus long tunnel ferroviaire au monde à son époque, celui-ci permit l’accélération de l’arrivée des migrants Italiens dans la région, mais aussi d’un flux commercial qui bénéficiait à tout le continent et qui contribuait au développement de celle-ci lors du siècle précédente9 . Figure 5 : Gare de Modane, Les Émigrants Italiens. Enfin, une transformation sociale profonde aboutit au triomphe de la bourgeoisie et du libéralisme. Ce facteur social favorise le développement de la production industrielle, la circulation des hommes et des marchandises, et confère un rôle majeur aux entrepreneurs tout en réduisant la place de l’État. Ainsi, une nouvelle élite s’imposait dans les villes ; la haute bourgeoisie, qui investissait et réussissait dans les secteurs en pointe, et qui profitait de cette réussite pour asseoir une position sociale que toute la population commençait à voir comme un modèle. 9 LAPADU-HARGUES Matthieu, « Histoire de la gare de Modane : le tunnel ferroviaire du Fréjus », sur archivchemindefer.free.fr (consulté le 8 septembre 2020).
- 10. Figure 6 : Panorama des quais du Rhône, 1856 Figure 7 : Place du Pont, avant 1909
- 11. Chapitre 2 : Architecture et urbanisme 2.1 Saint André L’orientation du trajet de la rue Sébastien Gryphe permet de contextualiser son développement sur deux pôles d’urbanisation : d’abord, celui proche de la Grande Rue de la Guillotière (zone 1 et zone 2), ensuite, le reste du trajet, y compris la zone qui ne fait partie de notre étude. Toute cette extension faisait partie de la conception du quartier Saint André, qui s’étendait jusqu’au Rhône par l’avenue Berthelot et au sud progressivement le tissu urbain gagnait du terrain sur celui des champs. En effet, c’est de ces espaces vierges qu’est née la tendance à concevoir des constructions en série de façades homogènes, sauf quelques exceptions, qui structurent des ambiances urbaines très contrastées. Ces espaces peuvent être perçus comme autant de résistance à l’harmonisation ou aux projets de modernisation abandonnés. Dans la perception du langage urbain de la rue, on ne peut pas nier le riche héritage historique dont témoignent les immeubles néoclassiques construits pendant le Second Empire et la Troisième République, avec des influences de styles régionalistes comme celui provenant du Dauphiné. Donc, la richesse architecturale de la Guillotière réside dans ses racines. On constate, grâce aux archives, que pendant le deuxième tiers du XIXème siècle, les conseillers municipaux commençaient à prévoir le remblaiement des terrains au vu de l’expansion démographique10 . A partir de 1847, des plans dressés par Laurent Dignoscyo (1795-1876), architecte, urbaniste, cartographe et inspecteur des domaines, et son fils, Claude Dignoscyo, répondaient à ces commandes de la ville de Lyon. Sans détruire ou déformer les anciens tracés, on verra que tous les deux traduisent cette volonté de la ville de mettre en œuvre un plan régularisé avec la proposition de nouveaux projets, qui amèneront une nouvelle ambiance dans le quartier au siècle suivant. Cette planification urbaine variée et progressive a donné le jour à un patrimoine bâti riche et diversifié. Le quartier Saint-André appartient aux plus anciens quartiers de la Guillotière, c’est pour cette raison qu’il renferme diverses typologies du patrimoine urbain et architectural 10 Crépet, 1845, p.24.
- 12. liées à son histoire : les îlots des quais avec les universités, l’hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph (voir le chapitre 3), les tissus urbains plus anciens de la Rue Sébastien Gryphe et de la Grande Rue de la Guillotière (qui créent les principaux axes du quartier), marquent les traces des anciens faubourgs historiques11 . Les îlots qui constituent la rue sont composés d'immeubles à dominante habitat dont la hauteur moyenne est de trois étages (soit environ 10 à 12 mètres). L'archétype de maison est celle en pierre appareillée en limite qui possède une desserte collective centrale. Ils se regroupent de façon homogène autour de la rue. Ces îlots présentent une ambiance urbaine très dense dont les activités économiques situées aux rez-de-chaussée sont très variées. Si bien ces activités sont en constant mouvement, les façades de la plupart d’immeubles ont été peu entretenues. Figure 8. Analyse typomorphologique de tissus ; Orange- Tissus compacts de centralité multifonctionnelle : tissus développés en ilot couronne, Bleu- Tissus mixtes à formes compactes à caractère résidentielle marqué- tissus composites, Jaune : Pièces urbaines de grande emprise et d’intérêt collectif- tissus monofonctionnels utilitaires. 11 Grand Lyon et l’Agence d’Urbanisme de la métropole lyonnaise, Plan local d’urbanisme et de l’habitat : Lyon 7ème arrondissement, 2019.
- 13. Afin que l’analyse architecturale soit exhaustive, nous diviserons le parcours de la rue en quatre zones de même ampleur allant du nord au sud. Figure 9. Division de l’étude de la Rue Sébastien Gryphe par zones. On verra que dans l’ensemble de zones la presque totalité des édifices sont des immeubles qui comprennent une typologie mixte, dont le rez-de-chaussée accueille une activité commerciale ou administrative (privée ou publique) et les étages supérieurs des fonctions résidentielles. Notre première étude sera donc de repérer les principales activités dans les rez-de-chaussée ; pour cela le point de vue social mettra l’accent sur le profil des gens ou potentiels clients dans ces locaux, tandis que le point de vue architectural analysera la façon d’interagir et de vivre ces espaces. Ensuite, on fera une même étude sociale et architecturale pour la typologie résidentielle des étages. C’est en faisant ces analyses qu’on s’appuiera sur des enquêtes de terrain et, grâce à celles-ci, on aura une idée claire et organisée dans le chapitre suivant de la compatibilité entre les commerces et la population qu’y réside.
- 14. 2.2 Zone 1 Figure 10. Zone 1, en couleur orange, les bâtiments qui datent du XXIème siècle, en bleu, celles du XXème siècle, en vert, celles du XIXème siècle et en rose, celles du XIIIème siècle. Cette zone comprend 14 bâtiments dont la plupart ont été construits pendant la seconde moitié du XIXème siècle. Les plus grands styles développés pendant cette période se reflètent dans l’architecture, qui aussi témoigne d’un évident éclectisme : dans les façades (pour cette zone avec une élévation moyenne à 5 étages), la hiérarchie et les divisions pour chaque étage, les encadrements de fenêtre, des travées sont la norme dans la presque totalité des immeubles. Sur le trottoir droit, la file de bâtiments 3 à 9 partagent les mêmes caractéristiques et la même élévation ; un balcon dans l'étage de comble porté par des consoles, brisis en ardoise et une élévation de 5 étages, le 13 vient rompre avec ce modèle en arrivant au coin avec la Grande Rue de la Guillotière. Ce bâtiment est le plus ancien dans toutes les zones avec des traces qui
- 15. datent du XVIIIème siècle12 . Du côté gauche, on trouve un contraste beaucoup plus marquant ; du nord au sud, l’édifice 44, 4 et 6 datent de 2003, c’est donc la construction la plus récente ainsi que celle avec plus d’élévation (12 étages). Ensuite, l’édifice 12b date de 1904, ici, dès cette date jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, se trouvait la société de bienfaisance « La Goutte de lait »13 . Cet édifice, sous la charge de l’architecte Pierre Martinon (1869-1918), témoigne d’interventions qui reflètent des changements technologiques dans la manière d’habiter au cours des derniers siècles : un ascenseur étroit est implanté juste au centre du passage cocher. Ayant obstrué le passage de voitures à la cour, les anciens garages au fond de celle-ci ont été transformés en logements. Figure 11. Edifice 12B ; à gauche, le passage cocher avec l’ascenseur au milieu, à droite, les anciens garages de la cour transformés en logements. En continuant avec l’hétérogénéité du trottoir gauche, les édifices 14 et 14b, ont des élévations et des extensions très variées ; depuis 1901, au 14b l’entreprise Tardy fabrique des échelles en tous genres, d’où l’élévation à un seul étage vu la fonction industrielle de l’édifice à l’origine. Le 14 est proprement une maison de trois étages et c’est l’édifice le plus étroit dans cette zone. Ces deux édifices datent de 1901. En continuant avec l’hétérogénéité du trottoir gauche, les édifices 14 et 14b, ont des élévations et des extensions très variées ; depuis 1901, au 14b l’entreprise Tardy fabrique des 12 Archives d’Auvergne Rhône Alpes, à consulter sur https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/immeuble/caccffa6-2c2b-4cae-a411-f06c53852b8d. 13 Rive gauche, n° 27, p. 24.
- 16. échelles en tous genres, d’où l’élévation à un seul étage vu la fonction industrielle de l’édifice à l’origine. Cet édifice fait partie du patrimoine industriel du 7ème arrondissement de la ville de Lyon. La société Pillon Veuve, dont Madame Veuve Pillon était la représentante, était la précédente à l’entreprise Hardy, c’est Madame Veuve Pillon qui en 1907 avait déposé une demande de permis de construire au 14b pour une maison de trois étages. La même année, Madame Titéna, propriétaire du 14, déposait une demande de permis de construire pour une maison (conçue par l’architecte P. Martinon) ; dont un local était prévu en rez-de-chaussée pour l'œuvre de la Goutte de lait au 12b. Cette maison de trois étages est l’édifice le plus étroit de cette zone. Ainsi, une demande de bâtir pour un entrepôt au 14b (par Mme Veuve Pillon) est autorisé, entrepôt construit par l'entrepreneur Pageot 14 . En 2002, le bâtiment a été modifié pour transformer les locaux commerciaux en deux logements. Figure 12. À gauche, comparaison d’élévations et façades des édifices 12b, 14 et 14b, à droite, plan du rez-de-chaussée du 14. 14 Demande de PC par Mme Vve Pillon au 14 bis rue Sébastien Gryphe, plan du rez-de-chaussée, coupe élévation / calque, encre. 1 : 50. 64 x 89. 1907 (AC Lyon, 1097 WP 509)
- 17. Les typologies commerciales dans cette zone comprennent 21 établissements dont 15 sont des magasins de cosmétiques et/ou coiffures orientés vers les populations africaines, soit 67%. D’autres usages contrastent avec cette activité prédominante sont représentés par une librairie, « La Gryphe » au 5 et une imprimerie « Dactylo print » au 9. Notre enquête montre que dans la presque totalité de commerces il ne s’agit pas de magasins locaux vu qu’un grand nombre de leur clientèle vient d’autres quartiers de la ville. 2.3 Zone 2 Figure 13. Zone 2, en couleur orange, les bâtiments qui datent du XXIème siècle, en bleu, celles du XXème siècle et en vert, celles du XIXème siècle. La plupart d’édifices dans cette zone ont été construits pendant la deuxième moitié du XIXème siècle. Avec une élévation moyenne de 4 étages, cette zone, bien que peu étendue, est remplie de contrastes, surtout dans les usages commerciaux des rez-de-chaussée. Dans la zone 1, on trouvait une ambiance commerciale marquée par des boutiques de cosmétiques et de coiffeurs
- 18. africains. Mais ici, au contraire, on trouve une variété de typologies qui paraîtrait tendre vers l’uniformité. Des 15 magasins qui opèrent actuellement sur ce tronçon, on en trouve 4 qui offrent un service très spécifique, voire exclusif. A l’exception de la Trollune au 25 (magasin de l’imaginaire), et la Pure au 59 (magasin de vêtements), ils semblent être moins fréquentés pendant le jour et son concept semble plus difficile à saisir si on regarde leur enseigne en passant par la rue. Ce premier groupe typologique se confronte avec un deuxième de tradition populaire sur la rue : deux boucheries ‘Halal’, un restaurant et un coiffeur africain, gardent la cohérence par rapport à la zone 1 et assurent l’ambiance cosmopolite, même si celle-ci devient notoirement hétérogène. On pourrait citer un troisième groupe « neutre » qui comprend une boulangerie, une laverie, et tout le trottoir gauche du trajet entre la Grand Rue de la Guillotière et la Rue Montesquieu. Celui-ci est un ensemble d’immeubles de location pour étudiants. On constate aussi la présence d’une mosquée à l’intérieur. En effet, cela pourrait expliquer le grand nombre d’Africains sur l’entrée de l’immeuble, et leur activité dans la zone est très questionnée ; une des interrogations de l’enquête était de savoir comment la rue était perçue par les gens ? Les réponses nous laissent voir que grand nombre d’habitants locaux, voire les clients qui n’habitent pas forcément le quartier, perçoivent cette présence comme négative et croient qu’il s’agisse de dealers de drogue, tandis qu’une minorité pense qu’ils donnent plus de vitalité et d’ambiance à la rue. Celle-ci est également la zone avec plus de locaux à l’abandon, on en compte 4.
- 19. Figure 14. Zone 2 depuis la zone 3, on peut voir une station de vélo à droite et la façade de l’immeuble du 59 (l’immeuble le plus récent) qui contraste avec le patron qui suit le trajet. Figure 15. Entré du 24, côté Rue Sébastien Gryphe, ici on trouve habituellement une forte présence d’Africains (photo prise pendant le confinement).
- 20. 2.4 Zone 3 Figure 16. Zone 3 : en vert, les bâtiments qui datent du XIXème siècle, en orange, les bâtiments et œuvres publiques du XXIème siècle. Dans l’ensemble de cette zone, deux parties peuvent être distinguées : d’abord, le pâté de maisons où se trouve la Place Mazagran (46), ensuite celle entre la rue Sébastien Reinach et Rue Jangot. Le bâtiment du 50, situé angle Rue Jangot, fut construit pendant la deuxième moitié du XIXème siècle sous le nom de « château » du Prado. Cet immeuble est un exemple inhabituel d’une nouvelle façon de réemploi à l’époque. L’écrivain et poète Alexis Rousset (1799-1885), fut pionnier dans cet exceptionnel intérêt pour le réemploi ; il accumulait de fragments de bâtisses en démolition dans des anciens quartiers pour après faire construire d’immeubles dits « châteaux », dont il faisait intégrer ces réemplois de pierre, bois ou ferronnerie. Donc, le château du Prado a été construit à partir d’éléments architecturaux de tout venant : les portes palières, en bois de chêne, sont tirées d’un noble hôtel de Bellecour, les poutres, d’un ancien grenier à sel, tandis que les garde-corps en fer forgé et les
- 21. encadrements de fenêtres sont tirés d’un vieux bâtiment du quartier St Antoine, alors que le percement de la rue Constantine progressait. A l’intérieur, un escalier en vis à creux est exceptionnel en comparaison aux escaliers des édifices aux alentours, qui principalement sont tournants. L’immeuble à cinq étages avec cave est distribué en trois corps de bâtiments en U, répartis autour d'une petite courette. Chaque élément conserve sa propre nature en apportant une valeur esthétique, mais d’autre part, ils parviennent à s’intégrer dans l’ensemble pour composer un riche langage ornemental produit du réemploi. Ainsi, petit à petit, ces activités de réemploi devinrent nombreuses dans tout le quartier. Fig. 17 : Le château du Prado pendant le XIX siècle, à droite l’image actuelle de l’édifice. Les façades nord et ouest, à l’époque mitoyennes, sont de nos jours l'objet d'interventions artistiques contemporaines dès l'ouverture de la place Mazagran (46 et 42) ; vu qu’ils sont entièrement aveugles, ils permettent la conception de fresques murales. Le fait d’avoir seulement un bâtiment dans tout l'îlot est dû à l’intérêt du maire Edouard Herriot pour créer un boulevard routier qui aurait fait la jonction entre l’avenue Félix Faure et le naissant Pont de l’Université. Dès 1923, ce projet avait causé la démolition de la plupart des immeubles dans tout le trajet de la jonction, y compris une grande partie de ce pâté de maison. Cependant, le projet ne fut pas jamais concrétisé (on abordera plus sur ce sujet dans le chapitre suivant). Avant la mise en œuvre de l’immeuble, on constatait l’existence d’un autre projet dans le terrain dont Rousset était déjà propriétaire, attesté grâce aux archives, une intention parallèle d’innover et s’étendre dans la rue ; d’une part, d’un profil artistique comme Rousset (qui bien aurait pu appartenir à la haute bourgeoisie aussi) et de l’autre, d’un entrepreneur comme
- 22. Pierre Graillet, qui industrialise une activité également artistique comme la conception de papiers peints (54 et 56). Tous les deux se disputaient chaque extrémité de la Rue Jangot15 . Le bâtiment de la fabrique de papier peints de M. Graillet, toujours en bon état de conservation, est l’un des meilleurs exemples de nos jours de l'architecture qu'on pouvait trouver sur la rue pendant le XIXème siècle ; des murs de calcaire moellon enduit, un bâtiment à deux étages maximum et des arcs en plein cercle sur les entrées étaient des éléments qui constituaient le langage architectural de l'époque. Actuellement l’édifice abrite une auberge de jeunesse appelé « Le flâneur ». Pour revenir à la Place Mazagran, c’est pendant la première décennie du XXIème siècle que des espaces verts commencent à se développer dans ces dents creuses, qui viennent changer donc l’image urbaine de la rue en apportant un nouveau centre de rencontre et d’interaction pour la population locale. En 2004, une série d’interventions auxquelles les habitants du quartier ont participé créent une serre sur le terrain, qui avait été utilisée comme parking. Sous la direction de l’artiste Emmanuel Louisgrand, le projet est nommé « l’îlot des Amarantes », et s’est développé par étapes d’agrandissement jusqu’à 2008. C’est en 2007 que des interventions pour reverdir le reste de l’îlot commencent de la part de l’association Brin d’Guill’, à nouveau avec la participation du quartier. Cependant, en 2011, le Grand Lyon prend en charge l’aménagement de la place et dès celle année-là, a généré des rénovations et des interventions assez discutées16 . Ce dernier changement d’administration pourra nous donner des pistes pour en comprendre la remarquable gentrification qui se déroule à présent sur la place. 15 AC Lyon, 315 WP 016/3. 16 Mathieu PERISSE, (2020, 14 janvier). A la Guillotière, l’îlot Mazagran, laboratoire d’une autre ville possible. Consulté sur https://www.mediacites.fr/enquete/lyon/2020/01/14/a-la-guillotiere-lilot-mazagran-laboratoire-dune-autre-ville-p ossible/
- 23. Fig. 18, la Place Mazagran : à gauche, avant sa construction en 2004, à droite, lors d’un évènement musical « Nuits Sonores », après les rénovations de part du Grand Lyon en 2015. 2.5 Zone 4 Fig. 19, Zone 4. Dans cette dernière zone, l’ambiance sociale et architecturale changent à cause des typologies de certains édifices ; le 75 est le seul bâtiment avec briques en façade, il correspond aussi à la seule pièce urbaine dans la rue de grande emprise et d’intérêt collectif qui appartient à l’association et l’église du Prado, présents dans presque tout cet îlot. Sur le trottoir gauche, se trouvent des petits immeubles à maximum 2 étages en arrivant à la rue de l’université, elle est également la zone qui compte le plus de typologies d’associations consacrées principalement à l'accueil, l'hébergement et l'insertion de personnes sans abri ou en grande difficulté sociale. La présence du Foyer de Notre-Dame des sans-abris se trouve au 76 et 83, l’édifice du 76 compte plusieurs fresques murales réalisées par Cité Création.
- 24. Fig. 20, Trottoir gauche de la Zone 4, on voit des élévations moins hautes. Fig. 21, Fresque mural sur le mur du Foyer Notre Dame des Sans Abris.
- 25. Avec l’étude de chaque zone, on a montré que, dans sa presque totalité, la Rue Sébastien Gryphe constitue un patrimoine urbain et architectural bâti, riche et diversifié, qui fait partie d’un tissu urbain, marqueur de l’histoire de la Guillotière. Les bâtiments avec des usages mixtes, dont 72% d’eux ont été construits pendant le XIXème siècle, partagent des typologies qui, bien que pouvant varier, donnent un langage uniforme à l’image de la rue, qui contraste avec quelques édifices qui datent du XXIème siècle. Chapitre 3 : L’histoire cosmopolite de la rue Dans le premier chapitre, on a déjà abordé de façon générale les premières vagues d’immigration à Lyon, pour indiquer que celles-ci venaient principalement de la région sud-est (Dauphiné, Piémont et la Savoie), et que ces processus de migration ont explosé lors du développement de l’industrie tout le long du XIXème siècle. Cependant, ces déplacements de populations vers Lyon, qui ont conduit au cosmopolitisme actuel de la rue et à une naissante gentrification dans tout le quartier, sont beaucoup plus complexes. Donc, dans ce chapitre, on va mettre l’accent sur l’historiographie migratoire tout en faisant une étude en parallèle de la planification urbaine de la ville. Il est indispensable pour notre analyse de découvrir quel était le rôle de la mairie au sein d’un quartier dont la population croissait au rythme du développement de l’industrie et plus récemment de la globalisation, voire des soubresauts politiques et économiques. On étudiera également le développement irrégulier dû à la population locale. Il convient pour commencer de s’intéresser au rôle historique de la Place du Pont. L’auteur Pétrus Sambardier17 l’a ainsi décrite en 1932 : « carrefour animé, souvent grouillant, où se parlaient toutes les langues d’Europe, d’Afrique et du Dauphiné, où l’on a rencontré tous les costumes, qui avait l’air à la fois de quelque quartier populaire de Paris, d’un vieux faubourg lyonnais et d’un port méditerranéen ». Comment cet espace est-il devenu si cosmopolite en quelques décennies ? Au cours de la fin du XIXème siècle, un déplacement des zones à urbaniser s’opérait vers le sud et le sud-est, sur des territoires presque vierges de toutes constructions. 17 Pétrus Sambardier, La vie lyonnaise, 12 mars 1932.
- 26. Fig. 22, Place du Pont, avant 1909 Avant son rattachement à Lyon en 1852, le faubourg était déjà le point de destination d’une forte présence étrangère, paysans et artisans principalement. A cette époque, il s’agissait rarement des migrations familiales, les hommes venaient seuls, et certains d’entre eux ont ouvert de petits commerces ou des entreprises dont quelques-uns ont prospéré. A la fin du siècle, le premier groupe migratoire en nombre étaient les Italiens : nombre d’entre eux venus du Piémont, notamment du Canavese18 , mais une partie originaire aussi des communes de l’actuelle province de Frosinone, au sud de Rome. Un événement peut expliquer ce phénomène, en prenant en compte aussi la proximité géographique, c’est qu’à partir de 1880, les grandes usines commencent à recruter des « gamins » italiens, qui étaient une main d’œuvre moins chère et qui acceptaient de vivre dans des conditions pénibles vu qui venaient de familles extrêmement pauvres19 . Si les Italiens sont le premier grand groupe migratoire à Lyon, ils sont aussi les premiers à connaître des réactions de rejet et de xénophobie, surtout après 1894, année où le président Sadi Carnot fut assassiné par un anarchiste italien. Ces tensions ont changé au début du 18 Région au nord de Turin. 19 Raniero Paulicci di Calboli, Larmes et sourires de l’émigration italienne, Paris, librairie Félix Juven, 1905, pp. 190-210 ; Mariella Colin, « L’émigration des enfants italiens en France aux XIXe et XIXe siècles : entre la littérature et l’histoire », in Gli Italiani all’estero : autres passages…, 1990, pp. 17-25.
- 27. nouveau siècle, en 1912 le trafic d’enfants italiens prend fin, cependant le flux migratoire des familles entières augmente, surtout lors du début de la Grande Guerre en 1914. C’est la guerre d’ailleurs qui a conduit à une nouvelle diversification des populations migrantes. Le pays fut l’appel à une main d’œuvre « coloniale » et étrangère pour travailler dans les usines du quartier, environ 1500 Algériens, venus surtout de Kabylie, et des centaines de Chinois viennent s’intégrer à la population étrangère. A la fin de la guerre, certains Algériens réussirent à rester à Lyon constituant ainsi le premier noyau maghrébin20 , désormais le groupe migratoire mal perçu par de nombreux métropolitains, cependant, les motifs étaient complètement différents de ceux des groupes Italiens dans le siècle précédent. Il y a, dans l’esprit français de l’époque, un sentiment de supériorité envers les populations issues des régions colonisées, l’exposition coloniale de 1914 dans la nouvelle halle construite par Tony Garnier témoigne bien de ce sentiment. La conjoncture politique et économique tourmentée de l’après-guerre avait provoqué l’arrivée d’autres populations : des Arméniens par exemple, qui fuyaient le génocide turc, mais aussi de Grecs, de Serbes, des Espagnols de la région de Murcia et de Russes. Fig. 23, Exposition de 1914, Installation du Village Noir 20 Gilbert Meynier, L’Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Genève : Droz, 1981, p. 463.
- 28. Après la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale, des accords sont signés par rapport à la reprise de la migration, accords qui favorisent à des pays latins comme l’Espagne, l’Italie et le Portugal, ces populations bénéficient de la dynamique des Trente Glorieuses et progressent socialement dans le quartier, mais ensuite, ces accords se tournent vers les Algériens, surtout lors de la Guerre d’Algérie en 195421 . En 1975, les pays latins (Italie principalement) constituent encore près de 40% de la population migrante, suivis par les Maghrébins, qui représentent un peu plus d’un tiers22 . À cette population s’ajoute une minorité des réfugiés cambodgiens qui fuirent les crimes du régime Khmer Rouge. Cette historique migratoire devient plus complexe dans les années 1980-2000, marquées par une politisation croissante de la question de l’immigration à l’échelle nationale. A partir de 1991, arrivent des populations de l’ex-Yougoslavie, mais aussi des pays de tout l’est de l’Europe après la dissolution de l’Union Soviétique. En même temps, l’Afrique noire commence à prendre une place notoire dans le quartier, ce sont ces derniers qui trouvent dans la rue Sébastien Gryphe l’espace idéal pour s’installer, surtout dans la partie proche de la Grande Rue de la Guillotière. Toutes ces populations migratoires ont fini par donner une riche ambiance cosmopolite au quartier. Cependant, tandis que ce groupe issu de la migration prospérait, une nouvelle population croissait aussi depuis la dernière décennie du XIXème siècle. Cette population, est principalement issue de la conception de deux projets : d’abord, l’hôpital privé Saint-Luc et l’hôpital Saint-Joseph, ensuite, sous la supervision d’Abraham Hirsch (1828-1913), les édifices des universités. Ces réalisations tant privées que publiques, seront conçues après l’assèchement définitive des lônes Bechevelin et de la Vitriolerie en 187123 . Depuis la première moitié du XXème siècle, l’activité économique dans le quartier avait baissé considérablement, ce qui avait provoqué sa paupérisation, mais aussi des greffes malencontreuses des années 1980-1990. Cependant, avec une nouvelle dynamique urbaine de la part de la municipalité, l’intention avec ces écoles et hôpitaux était de reprendre l’activité économique dans le quartier tout en donnant vie et embellissement à la rive gauche du Rhône. 21 Geneviève Massard-Guilbaud, Des Algériens à Lyon : de la Grande guerre au Front populaire, Paris : CIEMI, L’Harmattan , 1995, 536 p. 112. 22 Andrée Chazalette, Habitat des immigrés à Lyon, Lyon : G.S.U. 1979, P. 2 tableau 1 23 Halitim-Dubois Nadine, Lyon, de la Guillotière à Gerland : le 7e arrondissement 1912-2012 / sous la direction de Dominique Bertin, Lyon : Ed. Lyonnaises d'art et d'histoire, 2012 (p. 95).
- 29. Cette nouvelle activité économique serait assurée avec une population non issue de l’immigration. Entre 1877 et 1879, le long de l’avenue des Ponts (Berthelot) sont construits les édifices des universités. Ces édifices post-haussmanniens donnaient une nouvelle image de ce quartier visible depuis les quartiers bourgeois de la presqu’île, tout en assurant cohérence et lisibilité à la ligne de quai jusqu’à l’avenue Berthelot. C’est sous la supervision de Hirsch que seront construits les plus importants groupes scolaires de Lyon (environ une douzaine) ; boulevard Croix-Rousse, avenue Berthelot, rue Jarente, rue Bousset, cours Charlemagne, rue Pierre-Corneille et rue Chavant. Fig. 24, Quai Claude Bernard vers 1900. Au début du XXIème siècle, cette nouvelle population, dont étudiants et professionnels est nombreuse dans le quartier… de telle sorte que la population à des origines de plus en plus variées, surtout dans le secteur éducatif. De nos jours, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est l’institution publique qui accueille le plus d’étudiants étrangers à Lyon, soit 18,68% de ses étudiants, qui comptent en moyenne 27 000 par année scolaire24 . Cependant, la présence d’étudiants dans le quartier n’est pas une question récente, si actuellement on la considère dans son ensemble avec d’autre nouvelle population comme un 24 Infographie de 2020, consulter sur le site. https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/quelle-universite-francaise-accueille-le-plus-d-etudiants-etrangers.ht ml
- 30. fait négatif par rapport au développement du quartier (en favorisant le développement de la gentrification), cela est dû au fait qu’en si peu de temps ils viennent acquérir une place de plus en plus dominante. Avec leur arrivée, ils amènent aussi des nouvelles façons d’habiter l’espace, de se confronter et d’interagir en fonction d’activités et habitudes culturelles. Ce besoin d’espaces plus adaptés à leur style de vie a généré la conception de toute une gamme des lieux alternatifs qui mettent en péril la tradition cosmopolite de la rue. C’est notamment le cas avec l’ouverture de bars, mais aussi de ‘concept stores’25 , dont on peut citer dans la rue la « Trollune » au 25, qui est une boutique de ‘l’imaginaire’. Donc, le quartier petit à petit a été redéfini par ces habitants, on parle ainsi d’une évolution. La question qu’on doit se poser avec tous ces changements sociaux, c’est comment traverser cette évolution tout en gardant l’identité cosmopolite du quartier ? De l’autre côté, on ne peut pas nier l’existence de poches de pauvreté bien contrastantes ; l’histoire solidaire du quartier, qui compte nombre d’associations de soutiens aux migrants, mais aussi aux sans-abri ou SDF (sans domicile fixe) (sur la rue on peut citer le foyer de Notre Dame des Sans abri au 74 et l’Association Culturelle de musulmans de France au 15) vient se confronter avec d’autres réalités qui cohabitent la rue mais sans se mélanger les unes avec les autres. Ce phénomène reste difficilement saisissable, car complexe et mouvant. Le récent succès en termes économiques du quartier a une autre conséquence ; le prix de l’immobilier, y devient clairement déraisonnable et les loyers également. Cette hausse pour la demande d’immobilier met en risque non seulement le patrimoine social, mais aussi architectural, vu qu’on a peu construit récemment et par conséquent des projets de rénovation gagnent de la place. Des zones généralement défavorisées attirent de nouveaux investisseurs, qui vont éventuellement attirer des personnes différentes : il y aura donc beaucoup de nouveaux commerces, de nouveaux résidents, qui sont prêts à payer un prix élevé pour habiter le quartier. Un exemple significatif de ces zones défavorisées se trouve à côté de la rue : l’Ilot Mazagran. Depuis longtemps, cet îlot attire le regard d’investisseurs dans une zone où il n’y a guère d’espace pour construire. Du point de vue du Grand Lyon, cet îlot représente un fort potentiel pour la recomposition de ce quartier dense. La perception du quartier, aux yeux de pouvoirs publics, suggère que son avenir, dans beaucoup de situations, peut devenir un choix politique ; « Ces périmètres bâtis sont peu restaurés et participent à une image de 25 Notion marketing décrivant un commerce de détail thématique
- 31. paupérisation du quartier » 26 . Comme on l’a déjà vu dans la zone 3 du Chapitre 2, cet îlot se situait sur la ligne du projet inachevé de prolongement de l’avenue Félix Faure. « Le Nord de l’arrondissement (7ème ) est le lieu privilégié des populations arrivant dans l’agglomération, certains secteurs ayant gardé un caractère populaire et cosmopolite. Une offre de logements plus diversifiée à destination des familles, des personnes âgées et des étudiants sera à développer, tout en renforçant l’offre en logements sociaux étudiants »27 . Après la publication en 2011 d’un plan de concertation préalable pour développer des projets dans tout cet axe28 , la mairie du 7ème arrondissement et les habitants du quartier n’arrivent pas à se mettre d’accord pour planifier le meilleur avenir du quartier. Devant ces désaccords, on doit examiner d’abord ce qui est en jeu quand la rue cesse d’être un lieu de réunion pour tous les groupes de la société car les espaces publics et les logements doivent être pensés pour diverses personnes avec des budgets variés. Si, dans les prochaines décennies, la rue est occupée par un seul profil de population, il n’y aura plus de désaccords, mais il n’y aura plus de partage d’opinions et de connaissances. Le quartier deviendra socialement homogène. Le processus de gentrification peut signifier aussi la fin des mélanges de population. Grâce à l’enquête faite sur terrain et à l’étude de cas analogues dans d’autres villes, on peut avoir une idée de ce qui les attend la plupart de commerçants sur la rue : si la hausse de loyer continue, ils ne seront plus en mesure de payer les prix élevés et devront partir pour les banlieues. Le creuset qui attire tant de monde est donc temporaire. 26 Le Grand Lyon, Lyon 7ème - Mazagran-Depéret, Concertation préalable, 2011. 27 Grand Lyon et l’Agence d’Urbanisme de la métropole lyonnaise, Plan local d’urbanisme et de l’habitat : Lyon 7ème arrondissement, 2019. 28 La concertation préalable est une phase qui permet d’informer et d’associer, pendant toute la phase d’élaboration du projet, les riverains, les associations locales et toutes les personnes concernées par le projet. La concertation préalable permet également d’ouvrir un espace d’information et de dialogue, en amont des études de conception (art. L300-2 du Code de l’Urbanisme).
- 32. Conclusion Dans ce travail de recherche sur la Rue Sébastien Gryphe, on a constaté une évolution importante depuis deux siècles : on est passé successivement d’un quartier d’artisans, avec la révolution industrielle à des habitants provenant de l’exode rural proche de Lyon, puis de plus loin, Savoie et Piémont, puis Italie du sud. Ensuite, sont venus des Maghrébins, et des personnes d’Afrique sub-saharienne, donnant un caractère très cosmopolite à cette rue. Toutes ces populations ont amené avec elles, leurs habitudes et leurs manières de vivre avec toutes les conséquences sur la morphologie du quartier. À Amsterdam, dans le quartier de Zeeburg29 , il existe un exemple d’évolution qui a su conserver l’identité culturelle et historique d’un quartier ; bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, on considère que cet exemple pourrait être applicable à la rue Sébastien Gryphe. En effet, Zeeburg est le quartier cosmopolite de la région, on trouve dans la rue Javastraat une ambiance multiculturelle avec des commerçants de diverses origines. En 2018, avec le soutien financier de la ville, la chroniqueuse, économiste et urbaniste Najah Aouaki a lancé un projet pour aider les commerçants à mieux s’adapter aux nouveaux habitants. Elle a mis en évidence le caractère particulier des commerçants et de leurs produits. Ce faisant, elle rend chaque magasin plus attrayant et différencié. Elle essaye de développer les points forts des commerçants et de renforcer le lien entre les commerçants et les habitants. Ainsi, son but est aussi d’associer l’image avec la qualité offerte dans le magasin et donner une plus grande diffusion, cela a été réussi avec la création d’un site web30 . Elle a constaté qu’il y avait de nombreux magasins du Pakistan, de Turquie et de l’Inde qui au premier regard semblaient n’avoir aucune différence entre eux. Cependant, en entrant dans chaque magasin et ayant connu les produits qu’offrait chaque établissement, elle a trouvé que chacun avait vraiment quelque chose d’unique à offrir et se distinguait par un service ou un produit en particulier. Ainsi, elle a vu l’importance de concevoir une image plus juste pour faire connaître ces produits et montrer aussi que, dans la rue, chaque établissement avait sa 29 SAKIZLIOĞLU Bahar, LEES Loretta, Commercial Gentrification, Ethnicity, and Social Mixedness: The Case of Javastraat, Indische Buurt, Amsterdam, City and community, 2019. 30 A consulter sur http://javakwartier.nl/about/
- 33. place importante pour le langage cosmopolite du quartier, et qu’il était important de les préserver et les faire connaître aux nouvelles populations. Dans la Rue Sébastien Gryphe se trouvent aussi, d’origines très variées, beaucoup de magasins qui partagent la même typologie, et de manière similaire à la Rue Javastraat. Mais les limites entre chaque zone de ces typologies sont beaucoup plus marquées. Par exemple, dans l’ensemble de la zone 1, on ne peut nier que la présence dominante de commerces sont les magasins de produits cosmétiques et de coiffures dont la principale clientèle et l’ambiance en général qui vitalisent cette zone, sont des Africains noirs. On en compte 14 au total. Grâce aux enquêtes sur terrain, j’ai eu l’occasion de pouvoir connaître l’intérieur de quelques espaces, d’expérimenter la façon de découvrir chaque magasin et aussi d’apercevoir quel était le profil dominant des clients dans chaque lieu. Il est vrai que, du dehors, on a l’impression qu’il s’agit du même concept dans chaque établissement, et c’est là qu’on pourrait encourager une image plus orientée à ce qui fait la différence et le point fort entre chaque commerce. Mais il sera aussi question de voir comment le quartier est perçu par les propriétaires et clients fréquentant ces magasins ; en effet une des questions dans notre enquête était de savoir s’ils avaient considéré l’option d’une rénovation, et la plupart de réponses étaient négatives. Quand on avance plus au sud vers les autres zones, la présence africaine dans les établissements commence à diminuer pour donner plus de place à des magasins maghrébins dont le mécanisme est presque le même. Bien sûr, on ne peut pas créer des lieux attrayants pour toute la population, et sans parler seulement de commerces, mais on peut essayer d’exclure le moins de groupes possible. Un des moyens serait de prendre en compte tous ces groupes quand on fait des plans pour la ville. Il faudrait donc changer la politique pour encourager les promoteurs et investisseurs à construire des maisons pour le segment de type classe moyenne. Quand on met l’accent du côté inférieur ou du côté supérieur de la société, cette option finirait par devenir un choix politique. Si on s’intéresse principalement aux populations venues d’ailleurs, cette rue avec plus de deux siècles d’histoire perdrait beaucoup avec une uniformisation : l’idéal serait une rue qui reçoit et qui donne, qui apporte quelque chose à l’ambiance du quartier, et qui reçoive pour pouvoir vivre. Cependant, actuellement on y trouve un déséquilibre, l’accent est mis sur l’uniformité, dans laquelle les habitants traditionnels du quartier n’iront plus donner vie à la rue, en la rendant de plus en plus uniforme, sans avoir plus de liens avec elle, alors qu’elle a beaucoup à offrir.
- 34. Bibliographie BEAUFORT Jacques, L'architecture à Lyon 02: Lyon et le grand Lyon de 1800 à 2000, Ed. J.-P. Huguet, 2001 (42-Saint-Julien-Molin-Molette). CLERUAL Anne, Paris sans le peuple, Editions la découverte, Paris, 2013. CONDON STEPHAINE, Les courants migratoires italiens vers la Guillotière dans la première moitié du XXème siècle, Bulletin du Centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale, vol.1, 1992. DE OCHANDIANO Jean-Luc, Lyon à l'italienne : deux siècles de présence italienne dans l'agglomération lyonnaise, Lyon : Lieux dits, 2013, octobre 2016. DI CALBOLI Raniero Paulicci, Larmes et sourires de l’émigration italienne, Paris, libraire Félix Juven, 1905, pp. 190-210 ; Mariella Colin, « L’émigration des enfants italiens en France aux XIXème et XIXème siècles : entre la littérature et l’histoire », in Gli Italiani all’estero : autres passages…, 1990, pp. 17-25. GIRAUD Théophile, Histoire de la Guillotière et des Brotteaux depuis sa fondation jusqu'à nos jours (1846), Lyon : J. Giraud, 1846. HALITIM-DUBOIS Nadie, Histoire industrielle du quartier de la Guillotière, Zoom Rive Gauche, Mairie de Lyon, 2003. HALITIM-DUBOIS Nadine, Lyon, de la Guillotière à Gerland: le 7e arrondissement 1912-2012 / sous la direction de Dominique Bertin, Lyon : Ed. lyonnaises d'art et d'histoire, 2012. JAMBON Yannick, Les faubourgs des villes modernes en France (XVIe siècle – debut XIXé siècle), Etude historique et géographique, Lyon : Presses universitaires de Lyon, DL 2017. LAPADU-HARGUES Matthieu, « Histoire de la gare de Modane : le tunnel ferroviaire du Fréjus », sur archivchemindefer.free.fr (consulté le 8 septembre 2020). MASSARD-GUILBAUD Geneviève, Des Algériens à Lyon : de la Grande guerre au Front populaire, Paris : CIEMI, L’Harmattan, 1995. MEYNIER Gilbert, L’Algérie révélée : la guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXe siècle, Genève : Droz, 1981. MEIFRED F., Histoire de la Guillotière et des Brotteaux, depuis sa fondation jusqu’à nos jours (1846), Lyon, 1846.
- 35. SAKIZLIOGLU Bahar, LEES Loretta, Commercial Gentrification, Ethnicity, and Social Mixedness: The Case of Javastraat, Indische Buurt, Amsterdam, Wiley online library, novembre 2019. VANARIO Maurice, Les rues de Lyon à travers les siècles: XIVe au XXe siècle, Lyon, Ed. LUGD, 1990.
- 36. Annexes
