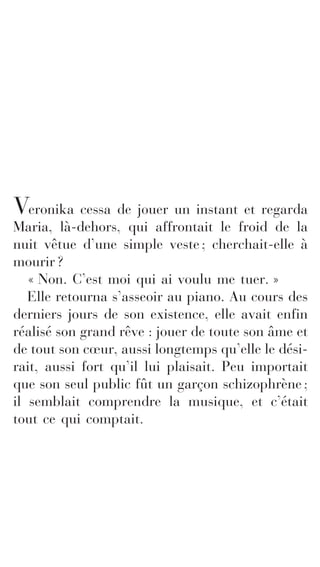Veronika, une jeune femme, décide de se suicider après avoir mené une vie qu'elle juge monotone et dénuée de sens. Dans ses derniers instants, alors qu'elle s'apprête à mourir, elle se retrouve plongée dans des réflexions sur la vie, la mort et l'identité de la Slovénie, la question de sa nationalité se mêlant à sa quête de sens. Finalement, au lieu de se laisser aller à la mort, elle écrit une lettre pour défendre son pays, ce qui l'amène à remettre en question sa décision de mettre fin à ses jours.