Ce rapport de stage détaille l'aménagement des berges de Fontan suite à la tempête Alex de 2020, dans le cadre d'un projet de protection hydraulique. L'objectif est de concevoir des ouvrages pour protéger le village contre les crues torrentielles, en s'appuyant sur des études hydrauliques et environnementales. La mission inclut la préparation d'une procédure d'urgence à caractère civil afin de faciliter les travaux de reconstruction nécessaires.


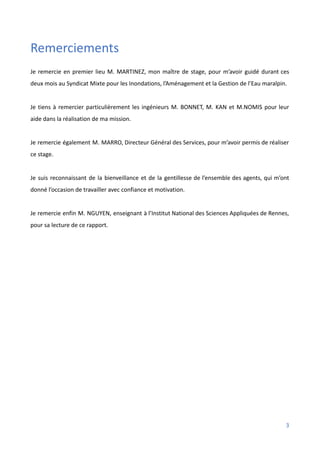





![Au niveau de la traversée du village, la tempête Alex a provoqué des dommages importants sur les
bâtiments en plus de l’érosion des berges et des modifications morphologiques du cours d’eau. Le
projet vise une protection des berges sur un linéaire de 600 mètres. Le choix des ouvrages de
protection hydraulique est pensé de façon à [1] [3] :
○ Conserver les bâtiments existants en rive droite et de les protéger contre l’aléa torrentiel ;
○ Ne pas réduire la section hydraulique de la Roya ;
○ Assurer une insertion qualitative des ouvrages dans le paysage et dans le patrimoine local
de la commune.
D’un point de vue réglementaire, les travaux de reconstruction projetés nécessitent une
déclaration dans le cadre de la Loi sur l’Eau (DLE). Mais les procédures DLE sont longues et ne
permettent pas de répondre aux situations d’urgence et aux besoins des sinistrés.
Pour que les travaux de protection puissent démarrer rapidement, de nouveaux outils
réglementaires ont été instaurés. Au lendemain de la tempête Alex par exemple, des arrêtés
préfectoraux permettent de déroger aux procédures de marchés publics. Ceci pour rechenaliser les
cours d’eau, pour enlever les embâcles, pour instaurer des voies de circulation provisoires… En
2021, des Porter à la Connaissance du Préfet (PAC) sont utilisés et laissent place depuis 2022 aux
Procédures d’urgence à caractère civile (PUC). Les procédures PUC reprennent les rubriques d’un
dossier Loi sur l’Eau mais les simplifient. Parmi les simplifications, citons la dématérialisation de
l’enquête publique ou encore le passage régulier d’un écologue en substitution de l’inventaire
écologique sur quatre saisons. Mon stage prépare ainsi la mise en œuvre d’une procédure PUC
pour le projet de reconstruction des berges de Fontan.
Le linéaire du projet a été séquencé en une trentaine de profils, chacun d’eux espacés de 20
mètres. Tout au long de ce rapport de stage, plusieurs indications seront référencées à partir de la
numérotation de ces profils. Ces derniers sont donnés à la page suivante, sur des images satellites
acquises les jours suivants la tempête Alex. On y remarque l’important dépôt d’alluvions et
l’érosion des berges. Ce sont des caractéristiques d’une crue morphogène.
9](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-9-320.jpg)

![2.2 Les acteurs du projet
Plusieurs acteurs interagissent pour élaborer le projet de protection hydraulique au niveau de la
traversée de Fontan. Parmi les principaux acteurs :
○ La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF), qui intègre la commune
de Fontan. La CARF est responsable de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) mais a délégué cette compétence au SMIAGE.
○ Le SMIAGE, qui est maître d'œuvre et maître d’ouvrage du projet.
○ Les habitants sinistrés qui se sont regroupés en un syndic. À l’heure de l’écriture de ce
rapport de stage, certains habitants n’ont toujours pas retrouvé leur domicile. Les ouvrages
de protection hydraulique projetés pourraient empiéter sur leurs propriétés. La maîtrise
foncière sera traitée différemment en phase travaux et en phase d’exploitation. Pour
l’exploitation, la CARF envisage la maîtrise foncière soit par l’acquisition (procédure à
l’amiable ou procédure d’expropriation) soit par le biais d’une gestion contractuelle
(convention de gestion, servitude conventionnelle).
○ La Préfecture, qui représente l’autorité de l’État.
○ La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes Maritimes (DDTM 06).
C’est cette direction qui sera chargée de l’instruction de la Procédure d’urgence à caractère
civil.
○ Les sociétés d’assurances, qui sont susceptibles de participer au financement de la
consolidation des avoisinants à proximité des futurs ouvrages de protection (ces derniers
sont à la charge du SMIAGE).
2.3 La temporalité du projet
Plusieurs maisons au niveau de la traversée de Fontan sont fortement endommagées par la
tempête [4] [5]. Les opérations de terrassement par le SMIAGE pour mettre en œuvre ses
ouvrages risqueraient de provoquer des effondrements. Pour se prémunir d’un tel risque, une
reprise au préalable des bâtiments fragilisés est à la charge des assureurs. Mais ces reprises sont
complexes et nécessitent des études approfondies. C’est pourquoi les travaux du SMIAGE ne
commenceront pas avant la fin de l’année 2022, soit plus de deux années après la tempête.
11](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-11-320.jpg)


![Partie II : Étude hydraulique de la Roya à
Fontan
Préalablement à la présentation des études réalisées lors de ce stage, il convient de faire un bref
rappel théorique concernant les crues torrentielles et les phénomènes d’incision et
d’exhaussement du lit d’un cours d’eau.
1. Les crues torrentielles
On distingue les crues torrentielles (“éclairs”) des crues fluviales (“de plaines”). Il existe différentes
façons de définir une crue torrentielle. Nous nous appuyons ici sur la définition du rapport de
l’IRSTEA1
[20], à savoir “une crue ayant une activité morphologique notable” avec un “transport
sédimentaire important par des phénomènes de charriage ou de lave torrentielles2
". Les crues
torrentielles se manifestent également comme des crues rapides et violentes. Le bassin versant
montagneux de la Roya draine rapidement les eaux de ruissellement vers les cours d’eau, avec une
mise en charge importante lors de précipitations intenses.
Figure : Types de crues. Source : Les risques naturels en montagne, D.RICHARD, F.NAIM, L.BESSON
2
Méthodes d’aide à la décision pour les plans d’action et et de prévention, Analyse comparative des méthodes dites “multicritères” dans le contexte
du risque torrentiel, Mars 2018, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement (IRSTEA), PITON Guillaume,
PHILIPPE Félix, RICHARD Didier, TACNET Jean-Marc. Page 6.
1
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
14](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-14-320.jpg)

![2. Évolution du fond du lit
Pour définir la profondeur d’ancrage des ouvrages de protection hydraulique, il convient de
connaître au préalable le niveau des plus basses eaux connues (PBEC) et le niveau d’affouillement
potentiel. Ces paramètres sont présentés dans les paragraphes suivants.
Positionnement des plus basses eaux connues (PBEC)
Un cours d’eau possède deux sources d’énergie principales : sa pente et son débit liquide. Quand
ces deux paramètres augmentent, la rivière accroît sa capacité à déplacer des matériaux solides
(alluvions, blocs rocheux…). Il existe ainsi une interaction entre les débits liquide et solide
𝑄(𝑡)
, illustrée par la balance de Lane et de Borland (1955).
𝑄𝑠
(𝑡)
Figure : La balance de Lane-Borland (1955)
Un cours d’eau cherche naturellement à avoir un état d’équilibre énergétique. Quand le débit
liquide est plus grand que le débit solide disponible, l’énergie en excès est dissipée par incision du
lit. À l’inverse, quand le débit solide devient plus grand (avec un apport de matériaux suite à un
glissement de terrain par exemple), on observe une tendance au dépôt. On parle d’équilibre quand
le potentiel de transport est satisfait par la fourniture sédimentaire : dans ce cas il n’y a
𝑄(𝑡) 𝑄𝑠
(𝑡)
théoriquement plus d’érosion ou de dépôt. Cependant, d’après l’ingénieur G. Degoutte [23] :
“même la rivière la plus paisible n’est jamais dans un vrai équilibre, du fait de la force tractrice (...).
Tout au plus nous pouvons dire que pour un régime permanent donné, la charge solide sortante est
égale à la charge entrante. C’est donc d’équilibre dynamique qu’il faut parler. L’équilibre dynamique
16](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-16-320.jpg)
![est un ajustement permanent autour d’une géométrie moyenne, aussi appelé respiration4
”. À titre
d’exemple, pour le projet de Fontan, le SMIAGE considère une respiration de l’ordre de 50
centimètres.
Une pente d’équilibre correspond ainsi à un lit fait d’alluvions tel que pour toute crue non
morphogène, l’écoulement trouve les matériaux solides nécessaires pour assurer son équilibre
entre la puissance hydraulique et la charge sédimentaire. La pente d’équilibre (équilibre
dynamique) peut être estimée en superposant les profils en long d’un cours d’eau à différentes
époques, en reliant des points de singularités (contrôles amont et aval : seuils, barrages, zones
pavées, exutoire…).
Figure : Ajustement de la pente d’un lit alluvionnaire (source : ETRM)
La profondeur d’un cours d’eau évolue ainsi au cours du temps, en s’abaissant (incision) ou en
s'élevant (exhaussement). Au cours de son Histoire, le lit de la Roya à Fontan a donc logiquement
connu un niveau “le plus bas” et un niveau “le plus haut”. Concernant le projet de Fontan, le
niveau des plus basses eaux connues (PBEC) a été initialement établi sur un relevé lidar fait en
2018. Un “lidar” (light detection and ranging) est un procédé de télédétection laser, qui permet de
prendre des mesures altimétriques à distance, depuis un vol en avion par exemple. Un autre relevé
lidar suite à la tempête Alex (2021) montre un exhaussement de 2,5 à 3,5 mètres par rapport au
lidar 2018 (niveau supposé des PBEC). Cette tendance à l’exhaussement est confirmé par un
consensus hydrologique publié par le CEREMA5
[12], sans pour autant donner de valeurs précises
pour la traversée de Fontan.
5
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement et l’aménagement
4
Hydraulique et dynamique fluviale, Novembre 2001, cours universitaire du DEA hydrologie, hydrogéologie, géostatistique et géochimie, ENGREF,
DEGOUTTE Gérard. Page 59.
17](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-17-320.jpg)

![Autres paramètres influençant l’évolution du fond du lit
1. Le débit
Comme expliqué précédemment lors du repositionnement des PBEC, le débit liquide est une
𝑄
variable de contrôle pour l’évolution morphologique de la rivière. Ce paramètre conditionne ainsi
le projet à Fontan. La Préfecture des Alpes Maritimes fixe comme débit de référence
au niveau de la traversée de Fontan [9]. Le débit de projet retenu est quant à
𝑄𝐴𝑙𝑒𝑥
= 1000 𝑚
3
/𝑠
lui estimé à . Il correspond au débit de la base de données SHYREG. Le
𝑄𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡
= 693 𝑚
3
/𝑠 𝑄100
débit est régulièrement employé comme référence de projet par le SMIAGE.
𝑄100
2. La largeur des faisceaux
Pour la traversée de Fontan, le RTM6
recommande une largeur de faisceau de 60 mètres. On
appelle “faisceau” la largeur du lit selon une section transversale au cours d’eau. La largeur idéale
du RTM ne peut pas être respectée au niveau de la traversée de Fontan à cause du contexte
environnant ; le faisceau est par exemple réduit à 22 mètres à proximité du profil P19 ou à 34
mètres au niveau du pont de la Tourette (P25). Le faisceau est également restreint au droit du
boulodrome (P15 à P21). Lorsque la largeur du faisceau est en-dessous de la valeur recommandée,
le lit de la rivière tend à inciser et à affouiller les fondations des ouvrages. Pour la traversée de
Fontan, il s’avère donc pertinent d’élargir le faisceau lorsque cela est possible. La suppression du
boulodrome (P15 à P21) pour agrandir le lit de la Roya s’est ainsi posée.
Pour étudier le gain hydraulique en supprimant le boulodrome, j’ai estimé la hauteur d’eau et la
vitesse d’écoulement avec et sans cet équipement. Cette estimation s’est faite avec la méthode de
calculs présentée dans la partie II.3 Calculs de l’affouillement potentiel. Finalement, la suppression
du boulodrome s’est avérée bénéfique pour deux raisons : d’une part un abaissement de la
hauteur d’eau de près d’un mètre et, d’autre part, une réduction de la vitesse d’écoulement. La loi
interdisant le prélèvement de matériaux en rivière, les déblais générés par la suppression du
boulodrome seront remis dans la Roya le temps d’être naturellement emportés vers l’aval.
6
Service de Restauration des Terrains de Montagne, appartenant à l’Office National des Forêts (ONF)
19](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-19-320.jpg)
![3. Calcul de l’affouillement potentiel
Définition
L’affouillement est la tendance du courant à éroder le lit de la rivière, engendrant une baisse
progressive du fond du lit. Plusieurs formes d’affouillement existent [25] :
○ Affouillement général (érosion naturelle)
○ Affouillement de contraction (augmentation de la vitesse d’écoulement et des forces
abrasives au niveau des rétrécissements du cours d’eau)
○ Affouillement local (au niveau des piles ou des culées)
Dans le cadre du projet de Fontan, on ne considère que l’affouillement général. Plusieurs formules
sont recensées pour calculer cette profondeur d’affouillement général [27].
Formule de Hayni et Simons (1968)
𝑑90
< 6 𝑚𝑚
𝐹 = 0, 48𝑄
0,36
−
𝑆
𝐵
Formule de Kellerhals (1967)
𝑑90
> 6 𝑚𝑚 𝐹 = 0, 248
𝑄
𝐵
( )
−0,8
* 𝑑90
−0,12
−
𝑆
𝐵
Formule de Ramette (1981)
Fonds sableux (0, 05 − 2𝑚𝑚)
[15] [27]
𝐹 = 0, 73
𝑄
𝐵
( )
2/3
* 𝑑50
−1/6
Avec :
la section mouillée correspondant aux plus hautes eaux (PHE)
𝑆
la largeur du lit mineur
𝐵
le débit de projet
𝑄
le diamètre du tamis telle que 50% de l'échantillon passe au travers
𝑑50
le diamètre du tamis telle que 90% de l'échantillon passe au travers
𝑑90
Pour le présent projet, la profondeur d’affouillement est calculée avec la Formule de Ramette
𝐸
(1981) [15]. Cette formule a été établie par M.Ramette sur la base des travaux d’Izard et Bradley
(1958). Le SMIAGE utilise habituellement cette formule pour ses estimations hydrauliques, car elle
est rapide à mettre en œuvre et tient compte à la fois de la géométrie de la section d'écoulement
et de la rugosité des matériaux. L’utilisation de cette formule est cependant critiquable, pour des
20](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-20-320.jpg)


![L’introduction du coefficient de Manning-Strickler permet d’obtenir (5) à partir de (4). Le
𝐾 =
𝐶
𝑅
1/6
coefficient de Manning-Strickler est tabulé selon la rugosité considérée pour le cours d’eau.
𝐾
(5)
𝑄(ℎ) = 𝐾𝑆𝑅ℎ
2/3
𝐼
Pour rappel, l’équation de Manning-Strickler n’est valable que pour le régime
permanent/stationnaire ( constant) et uniforme ( constant), où la pente du lit est parallèle à la
𝑄 ℎ 𝐼
pente d’énergie . Peut-on alors réellement utiliser cette expression dans le cadre du projet de
𝐽
Fontan, sachant que le régime n’y est pas permanent et uniforme (RPU) ? Selon une formation
donnée par le RTM [21], il existe deux conditions pour appliquer l’expression de Manning-Strickler.
La première condition est basée sur les expériences de Smart et Jaeggi en 1983 : “au-delà d’une
pente de 6 à 10%, la phase solide perturbe suffisamment l'écoulement liquide pour que cette
équation perde toute validité7
”. La deuxième condition condition est basée sur les travaux de
Rickenmann et Recking en 2011 : “la loi de Manning-Strickler donne des résultats corrects pour des
profondeurs relatives (définies par le ratio supérieures à 7 environ8
”. Où est le rayon
𝑅ℎ
/𝐷84
𝑅ℎ
hydraulique et signifie que 84% des sédiments ont des diamètres inférieurs à cette valeur. À
𝐷84
titre d’information, les résultats de ces expériences historiques sont donnés en annexe 1 et 2. Ces
deux conditions sont vérifiées dans le cadre du projet de Fontan. Nous allons ainsi appliquer
l’expression (5), en acceptant que les résultats obtenus ne donnent qu’un ordre de grandeur et pas
de valeurs précises.
8
Ibid
7
3-Hydraulique torrentielle, support de présentation de la formation ONF/RTM à Barcelonnette, Juin 2019, QUEFFÉLÉAN Yann, KUSS Damien.
Diapositive 13.
23](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-23-320.jpg)


![chantier), un dispositif anti-affouillement doit être mis au niveau des PBEC (sabot parafouille, par
exemple). Dans le cas où les profondeurs d’affouillement sont trop importantes, une solution
pourrait être de repaver le lit de la rivière. Le pavage d’une rivière correspond au matriçage en
fond de lit de granulats et de blocs rocheux qui ne peuvent être déplacés que par des crues
morphogènes (donc avec des grandes périodes de retour). Pour le projet de Fontan, si cette
solution est techniquement faisable elle n’est pas admissible du point de vue écologique car elle
impacterait de façon trop significative la faune et la flore locale.
4. Force tractrice
Le courant génère une force tractrice (ou d’arrachement) notée sur le fond du lit et sur les
𝐹
berges. Cette force tractrice augmente avec la sinuosité du cours d’eau et avec de faibles rapports
. Afin d’estimer la contrainte tractrice , on définit le volume de contrôle d’un écoulement
𝐿
ℎ
τ0
uniforme avec sa longueur , son périmètre mouillé et sa section mouillée . On a ainsi [15] :
𝑑𝑠 𝑃 𝐴
(6)
𝑑𝐹 = τ0
𝑃𝑑𝑆
Figure : Définition d’un volume de contrôle pour déduire l’’expression des forces tractrices
26](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-26-320.jpg)

![En ce qui concerne l’arrachement sur des berges inclinées de par rapport à l’horizontal, on
τβ
β
miore avec l’angle de frottement du sol :
τ0
ϕ
(8)
τβ
= τ0
* 1 −
𝑠𝑖𝑛²β
𝑠𝑖𝑛²ϕ
Contrainte sur berge
de P26 0 P31
pente des berges β (rad) 0,588
angle de frottement
interne
φ (°) 38
φ (rad) 0,663
coefficient 1 −
𝑠𝑖𝑛²β
𝑠𝑖𝑛²ϕ
0,434
Contrainte tractrice
en fond de lit
τβ (Pa) 177
La connaissance des forces tractrices s’avère utile pour choisir les techniques de génie végétal
adaptées pour les berges, lorsque les conditions hydrauliques le permettent (c’est-à-dire quand les
vitesses de courant n’excèdent pas les ). À titre d’exemple, les résultats numériques calculés
2 𝑚/𝑠
dans les tableaux précédents sont repris dans la partie III.3.1 afin de choisir les solutions en génie
végétal possibles.
Connaître les forces tractrices permet également d’estimer la contrainte critique de charriage des
grains en fond de lit [22].
28](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-28-320.jpg)
![5. Critique des méthodes employées
Critiques sur l’utilisation de la formule de Manning-Strickler
Les valeurs obtenues (affouillement, vitesse, hauteur d’eau…) ont été comparées avec des
modélisations HEC-RAS9
faites par l’hydraulicien du SMIAGE. La comparaison montre des résultats
cohérents avec un même ordre de grandeur.
L’utilisation de la formule de Manning-Strickler implique le choix d’hypothèses simplificatrices, qui
imposent un écart avec la réalité. Cet écart peut être la raison des différences observées avec le
logiciel de modélisation hydraulique HEC-RAS. Parmis les approximations :
- La section hydraulique est considéré comme homogène en géométrie et en rugosité entre
deux profils consécutifs (soit une distance de 20 mètres)
- Le choix de la rugosité (coefficient ) est complexe à estimer pour un cours d’eau. Dans
𝐾
notre cas, il a été adopté une démarche sécuritaire en prenant le plus grand coefficient 𝐾
de l’intervalle possible
- Il a également été considéré que , c’est-à-dire que la pente du fond du lit est parallèle
𝐼 = 𝐽
à la ligne d’énergie. Il est à noter que peut être déterminé en analysant les laisses de
𝐽
crues et en faisant tourner plusieurs modélisations hydrauliques, ce qui n’a pas été fait pour
le projet.
D’autres formules existent pour estimer la vitesse moyenne et la hauteur d’eau pour des cours
d’eau en montagne, comme la relation de Ferguson (2007) :
(9)
𝑢 =
2,5𝑔
0,5
𝑅ℎ
1,5
𝐽
0,5
𝐷84
Il aurait été intéressant d’appliquer cette formule au projet et d’en mesurer l’écart entre avec les
résultats issus de l’application de Maning-Strickler.
Critiques sur l’utilisation de la formule de Ramette
D’après un guide méthodologique du CEREMA [26], les résultats de la formulation de Ramette
pour estimer l’affouillement général sont “à considérer comme premier ordre de grandeur
9
HEC-RAS (Hydrologic Engineering Centers River Analysis System) est un logiciel de modélisation des cours d’eau développé par l’armée américaine
29](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-29-320.jpg)
![sécuritaire10
”. Un rapport d’avant projet du RTM [28] argumente aussi que “les valeurs obtenues
par cette approche sont souvent très importantes et que cette méthode convient surtout pour les
rivières à fond sableux et pour les affouillements provoqués par les tourbillons et localisés au droit
des culées des piles centrales de pont11
”.
Critique sur les tableurs réalisés
Une critique est aussi à apporter sur les tableurs réalisés : ceux-ci ont été construits sans
programmation en VBA, ce qui peut s’avérer très contraignant si l’on souhaite changer le débit de
projet ou la géométrie des sections hydrauliques.
6. Conclusion intermédiaire
Lors des estimations hydrauliques, j’ai appris à “sortir” des cas d’école où les paramètres initiaux
sont clairement énoncés. À l’inverse, j’ai dû choisir avec autonomie certains paramètres initiaux,
tels que le choix de la rugosité, la granulométrie médiane du lit de la Roya… Des choix différents
peuvent entraîner des écarts significatifs dans les résultats, tel que la profondeur d’affouillement
potentiel par exemple. Les hypothèses se font ainsi en considérant les cas les plus défavorables, de
façon à surdimensionner les futurs ouvrages plutôt que les sous-dimensionner (approche
sécuritaire). Les estimations hydrauliques menées jusqu’à présent n’aboutissent donc qu’à des
ordres de grandeur. L’ingénieur doit avoir conscience de ces approximations et doit être capable
d’en définir les origines.
11
Confortement de la digue de la Durance dans la traversée de bourge en rive droite et protection contre l’affouillement, Commune de l’Argentière la
Bessée, Rapport d’avant-projet, Janvier 2001, RTM. Page 31.
10
Analyse de risque des ponts en site affouillable, Février 2019, Guide méthodologique, CEREMA. Page 48.
30](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-30-320.jpg)

![1.1 Vérification de la stabilité du mur poids
Un défaut de stabilité se manifeste de différentes façons pour un mur poids [18], comme cela est
illustré ci-dessous :
Figure : Les ruptures possibles pour un mur poids (source : www.groupe-sma.fr)
Dans le cadre de mon stage, j’ai cherché à vérifier la stabilité au renversement et au glissement du
mur poids REDI-ROCK en amont du profil P15 (c’est-à-dire hors des zones d’interaction avec
l’ouvrage à la charge des assureurs).
Le renversement est vérifié quand le rapport des moments est le suivant :
𝐹𝑅
=
𝑀 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡
𝑀 𝑟𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
> 1, 5
Le glissement est vérifié quand le rapport des forces est le suivant :
𝐹𝐺
=
Σ 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠
Σ 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠 𝑑é𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠
> 1, 5
Afin de faire les vérifications, j’ai choisi les hypothèses les plus défavorables en considérant que :
○ l'ouvrage est affouillé (la butée n'est pas prise en compte)
○ la cohésion du sol est nulle (sol essentiellement composé d’alluvions)
○ il n’y a pas de chaînage entre la semelle et le mur poids
○ la terre armée n’est pas prise en compte dans les vérifications
○ la hauteur d’eau correspond à celle d’une crue de faible période de retour
○ le niveau de l’eau en amont de l’ouvrage est le même que le niveau de la Roya (les
pressions hydrostatiques se compensent)
32](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-32-320.jpg)

![Sur le schéma précédent, les forces représentées sont les suivantes :
la poussée des terres
𝑃
le poids de l’ouvrage
𝑊
la traction dans un lit de terre armée
𝑇
la pression hydrostatique
𝑃𝑊
la surcharge sur le sol
𝑞𝐸𝑑
Le schéma montre que le mur REDI-ROCK prend appui sur le niveau d’affouillement potentiel, au
droit d’une semelle en béton. Il n’y a donc pas de sabot parafouille en enrochement libre prévu
dans ce cas. En effet, par retour d’expérience il est recommandé de conserver un ensemble rigide
(REDI-ROCK + semelle) plutôt qu’un ensemble mêlant rigidité du mur poids avec la souplesse des
enrochements libres.
La cohésion nulle du sol permet de ne pas passer par la théorie des états correspondants. D’après
l’expression littérale des forces, les facteurs de sécurité peuvent se ramener sous la forme [19] :
(10)
𝐹𝑅
=
𝑃𝑉
*𝑑𝑉
+𝑊*𝑑𝑊
𝑃𝐻
*𝑑𝐻
(11)
𝐹𝐺
=
𝑐𝑏+𝑊𝑡𝑎𝑛φ
𝑃𝑊
+𝑃𝑐𝑜𝑠δ
Avec :
, et les bras de levier relatifs aux forces projetées dans le repère orthogonal
𝑑𝑉
𝑑𝐻
𝑑𝑊
la cohésion (ici celle du béton de fondation, assise du mur poids)
𝑐
la largeur de la fondation
𝑏
l’angle de frottement interne du sol
φ
l’angle de frottement béton-terrain naturel
δ
Le tableur a été construit de façon à ce que l’utilisateur ait accès aux sollicitations et aux facteurs
de sécurité en ne saisissant que les données relatives au terrain et aux dimensions géométriques
du mur. Les résultats affichés par le tableur ont été comparés avec ceux du logiciel TALREN pour
quelques cas simples, afin de vérifier leur cohérence.
34](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-34-320.jpg)

![2.1 Diamètre médian
Les enrochements sont dimensionnés à partir du diamètre médian défini selon la formule
𝐷𝑟𝑒𝑓
d’Isbach [17]. Cette formule est applicable pour des enrochements reposant sur un talus et pour
un écoulement faiblement turbulent.
(12)
𝐷𝑟𝑒𝑓
=
(β𝑣)²
2𝑚𝑔α∆
Avec :
la vitesse moyenne
𝑣
un coefficient qui caractérise la courbure du cours d’eau. (1 à 1,25 pour un lit rectiligne)
β
la densité déjaugée :
∆ ∆ =
γ𝑠
−γ𝑤
γ𝑤
le coefficient de Lane, avec la pente du talus
α α = 1 −
𝑠𝑖𝑛²η
𝑠𝑖𝑛²ϕ
η
le coefficient d’Isbach (1,20 pour des enrochements appareillés et 0,86 pour des
𝑚
enrochements en vrac)
Comme pour le prédimensionnement des murs REDI-ROCK, j’ai réalisé un tableur afin de pouvoir
obtenir rapidement un ordre de grandeur de la dimension des enrochements à mettre en place.
Enfin, l'approvisionnement en enrochement se base sur un fuseau, dans lequel 80% des blocs mis
en œuvre doivent s’y retrouver. Ce fuseau est délimité par les bornes .
0, 9𝐷𝑟𝑒𝑓
; 1, 4𝐷𝑟𝑒𝑓
[ ]
2.2 Coupe type
Les enrochements sont soumis au risque d’affouillement, au même titre que les fondations de
murs REDI-ROCK. Pour s’assurer de la pérennité des ouvrages vis-à-vis de l’affouillement, ceux-ci
peuvent s’ancrer sur le niveau d’affouillement potentiel ou peuvent s’équiper en pied d’un “sabot
parafouille” qui repose sur le niveau des PBEC. Le sabot est constitué de blocs libres qui viennent
s’insérer sous l’ouvrage au fur et à mesure que le lit s’incise. Ci-dessous est donné une coupe type
du profil P19, au stade avant-projet de l’étude.
36](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-36-320.jpg)
![Figure : Coupe type du profil P19 en stade avant-projet
La coupe schématique précédente montre deux ouvrages au-devant du bâtiment : un mur
REDI-ROCK (en orange, à la charge du SMIAGE) et une paroi pieux sécants et jet-grouting (en rose,
à la charge des assureurs). Parmi les propositions d’aménagement figurait un unique ouvrage, mais
cela n’était pas viable en termes de jurisprudence et de responsabilité respective du SMIAGE et
des assureurs [14]. La paroi mise en œuvre par les assureurs permet aussi au SMIAGE de terrasser
dans le lit de la Roya, sans menace d'effondrement des avoisinants ou de glissement de terrain.
37](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-37-320.jpg)



![Bibliographie
Données propres à Fontan et à la vallée de la Roya
[1] Quelques éléments de discussion sur les principes d’aménagement, Support de présentation de
la réunion du 15 avril 2021, SMIAGE
[2] Vallée de la Roya - Commune de Fontan, Préservation des habitations du cœur de village,
Support de présentation de la réunion du 13 juin 2022, SMIAGE
[3] Vallée de la Roya - Fontan, Projet de reconstruction des berges de la Roya dans la traversée de
Fontan, Support de présentation de la réunion du 23 Novembre 2021, SMIAGE
[4] Compte-rendu de visite, Sécurisation du bâti existant, Commune de Fontan, Avril 2021, CSTB
[5] Intervention sur les parcelles N424 & N448, Commune de Fontan sur Roya Village, Étude
structure, Janvier 2021, SEFAB
[6] Commune de Fontan (06) Berges de la Roya, Restauration des protections de berge en rive
droite, Étude géotechnique de conception, Phase avant-projet, Octobre 2022, Géolithe
[7] Diagnostic écologique, Bon de commande n°2-21, Juin 2022, SEGED
[8] Études des cours d’eau des Alpes-Maritimes visant la restauration du fonctionnement
hydromorphologique et la prévention des risques d’inondation - Phase 1 - État des lieux du
fonctionnement du bassin versant de la Roya, 16 mars 2021, GeoPeka, Egis
[9] Tempête Alex – Retour d’expérience technique – Données hydrométéorologique, 29 octobre
2021, Préfecture des Alpes Maritimes
[10] Demande d’agrément fourniture – Blocs REDI-ROCK, Septembre 2021, Razel-Bec (entreprise
mandataire)
[11] Note de calculs hydraulique – Blocs REDI-ROCK, Décembre 2021, Première édition, Razel Bec
(entreprise mandataire)
[12] RETEX technique ALEX, Inondations des 2 et 3 octobre 2020, Consensus hydrologique,
Septembre 2021, V1, CEREMA
[13] Plans de projet et de récolement de l’usine EDF de Fontan, 1912 et dates inconnues, EDF
[14] Réduction de la vulnérabilité du bâti – Étude programmatique, Projet MIRAPI, Juillet 2022,
GOURE Fabien (architecte), SEFAB (BET Structure et géotechnique)
41](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-41-320.jpg)
![Données théoriques
[15] Hydraulique et dynamique fluviale, Novembre 2001, ENGREF, DEGOUTTE Gérard. Disponible à
l’adresse Internet suivante :
<https://www.ancientportsantiques.com/wp-content/uploads/Documents/ENGINEERING/Fluvial/
Degoutte2001-HydrauliqueFluviale.pdf>
[16] Auscultation géotechnique, Techniques de l’Ingénieur, C229 V1, Janvier 2016, BRIANCON
Laurent, CAZEAUDUMEC Benoit, PINCENT Bernard
[17] Table ronde enrochement, Support de présentation, Avril 2014, SABATIER David, RTM et ONF.
Disponible à l’adresse Internet suivante :
<https://www.cerema.fr/system/files/documents/2017/11/04_AG_table_ronde_enrochement_Da
vid_Sabatier_RTM_cle595893(1).pdf>
[18] Pathologies des murs de soutènement, Techniques de l’Ingénieur, C7201 V1, Mai 2013,
DELEFOSSE Jean
[19] Méthode de vérification de l’entreprise Fine, accessible à l’adresse Internet suivante :
<https://www.finesoftware.fr/aide-contextuelle/geo5/fr/verification-coefficient-de-securite-01/>
[20] Méthodes d’aide à la décision pour les plans d’action et et de prévention, Analyse comparative
des méthodes dites “multicritères” dans le contexte du risque torrentiel, Mars 2018, Institut
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement (IRSTEA), PITON
Guillaume, PHILIPPE Félix, RICHARD Didier, TACNET Jean-Marc. Disponible à l’adresse Internet
suivante : < https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02132339/document>
[21] 3-Hydraulique torrentielle, support de présentation de la formation ONF/RTM à
Barcelonnette, Juin 2019, QUEFFÉLÉAN Yann, KUSS Damien
[22] 4-Transport solide par charriage, support de présentation de la formation ONF/RTM à
Barcelonnette, Juin 2019, QUEFFÉLÉAN Yann, KUSS Damien
[23] Hydraulique et dynamique fluviale, Novembre 2001, cours universitaire du DEA hydrologie,
hydrogéologie, géostatistique et géochimie, ENGREF, DEGOUTTE Gérard
[24] 0-Introduction générale à l’hydraulique en contexte torrentiel, support de présentation de la
formation ONF/RTM à Barcelonnette, Juin 2019, QUEFFÉLÉAN Yann, KUSS Damien
[25] Vulnérabilité des ouvrages d’art au risque d’affouillement des fondations, Vibrations
[physics.class-ph], Université Paris Est, 2018, BOUJIA Nissrine. Disponible à l’adresse Internet
suivante : <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01949884v1>
[26] Analyse de risque des ponts en site affouillable, Février 2019, Guide méthodologique, CEREMA
Disponible à l’adresse Internet suivante :
<https://piles.cerema.fr/IMG/pdf/guide_analyse_risque_des_ponts_en_site_affouillable_cle6e982
e.pdf>
42](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-42-320.jpg)
![[27] Les Risques en génie civil, Mars 2004, Ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche
scientifique et de la technologie, République Tunisienne. Disponible à l’adresse Internet suivante :
file:///C:/Users/f.thomasset/Downloads/B37-Aff-Mongi-Risque-2004.pdf>
[28] Confortement de la digue de la Durance dans la traversée de bourge en rive droite et
protection contre l’affouillement, Commune de l’Argentière la Bessée, Rapport d’avant-projet,
Janvier 2001, RTM. Disponible à l’adresse Internet suivante :
<https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/f09321p0035_avp.pdf>
43](https://image.slidesharecdn.com/rapportdestage-220831205312-74421d2d/85/Rapport-de-stage-pdf-43-320.jpg)
