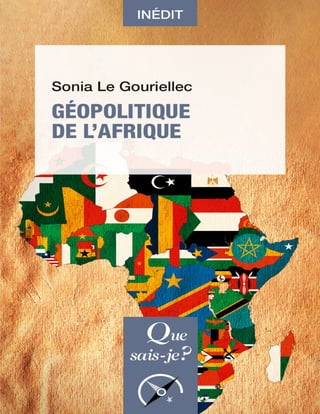
Géopolitique-de-l_Afrique-Gouriellec_-Sonia-le-2022-Que-sais-je-_.pdf
- 4. À lire également en Que sais-je ? COLLECTION FONDÉE PAR PAUL ANGOULVENT Alexandre Defay, La Géopolitique, no 3718. Pascal Gauchon, Jean-Marc Huissoud, Les 100 mots de la géopolitique, no 3829. Bouchra Rahmouni, Younes Slaoui, Géopolitique de la Méditerranée, no 3975. Anne-Clémentine Larroque, Géopolitique des islamismes, no 4014. Mathieu Duchâtel, Géopolitique de la Chine, no 4072. Jean-Sylvestre Mongrenier, Géopolitique de l’Europe, no 4177.
- 5. ISBN 978-2-7154-1020-6 ISSN 0768-0066 Dépôt légal – 1re édition : 2022, avril © Que sais-je ? / Humensis, 2022 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris Ce document numérique a été réalisé par Nord Compo.
- 6. « Penser l’Afrique dans le cours du monde est le meilleur moyen de penser l’Afrique elle-même. Et le cours du monde ne se pensera pas sans le rôle que l’Afrique y a joué et y joue encore. Bref, l’Afrique ne se comprend pas sinon réfléchie et analysée dans le cours de notre monde. » Souleymane Bachir Diagne « Cela tient à l’histoire de notre continent et à la manière dont elle est racontée. Certains, y compris parmi nous, s’imaginent que les Africains ne font pas vraiment partie du monde. Tout se passe comme si, lors d’un banquet, nous nous installions non pas autour de la table avec les autres, mais plutôt dans un coin, en suivant des règles différentes. […] Les Africains n’habitent pas le monde différemment des autres. » Chimamanda Ngozi Adichie
- 9. Introduction 1 L’Afrique, avec plus d’un milliard d’habitants, berceau de civilisations multiples, est constituée de 54 États chargés chacun d’une histoire propre et représente à elle seule un continent-monde. Trop souvent considéré comme un tout homogène, ce continent doit se penser dans toute sa diversité et sa profondeur. Aussi, il est de plus en plus courant d’évoquer « les Afriques » plutôt que « l’Afrique », terme unidimensionnel qui a le défaut de maintenir cet immense territoire géographique dans une vision monolithique réductrice. Longtemps décrits comme étant en marge du système international, ses acteurs y ont été souvent perçus comme passifs et dépendants du reste du monde. C’est une tout autre représentation que nous allons aborder dans cet ouvrage. Celle, au contraire, d’un continent ouvert sur le monde. Tout au long de l’histoire mondiale, les Afriques ont participé aux échanges et aux équilibres politiques, commerciaux et intellectuels. Aujourd’hui, elles sont intégrées à la mondialisation et aux dynamiques du système international. Notre objectif sera donc d’analyser dans le détail les États africains en tenant compte de la complexité de leurs trajectoires historiques, sociologiques ou politiques. Cela nous permettra de comprendre les dynamiques actuelles et, dans le même temps, de nous donner la possibilité de mieux comprendre les différentes questions qui viennent articuler l’ensemble des relations entre les acteurs africains et le reste du monde.
- 10. Le livre est découpé en six chapitres retraçant les grandes étapes historiques des différentes entités politiques de ce continent, notamment les relations de dépendance et d’interdépendance avec l’extérieur, mais aussi les acteurs des dynamiques internationales en Afrique (les puissances extérieures, les diasporas…). Nous verrons que des trajectoires peuvent être communes à bien des régions ou pays, et la colonisation peut expliquer de nombreuses spécificités dans le développement des États africains. Toutefois, « similaire » n’a jamais voulu dire « identique ». L’Afrique est plurielle, et nous nous sommes tenus autant que possible tout au long de l’ouvrage à ne pas étudier toutes les dynamiques internationales en prenant le continent africain comme un bloc homogène. Au contraire, nous nous sommes efforcés de diversifier à la fois les régions étudiées et les points de vue, en décentrant toujours le regard. Nous allons donc étudier la place et le rôle des Afriques dans le système international contemporain. Nous verrons qu’elles sont l’illustration parfaite qu’il ne faut pas oublier les contingences locales et l’agencéité2 des acteurs dits « périphériques ».
- 11. CHAPITRE PREMIER Les Afriques dans le monde : proto-États et histoire de la colonisation (jusqu’en 1950) L’histoire du monde ne peut être écrite en faisant abstraction du continent africain, et l’histoire de l’Afrique ne peut être écrite comme un récit entièrement isolé du monde. Nous connaissons aujourd’hui de mieux en mieux cette histoire. Pourtant, en Europe elle ne nous est trop souvent parvenue que de façon fragmentée, ce qui ouvre la porte à de nombreuses perceptions et interprétations faussées. Ainsi, les histoires égyptienne et romaine ont souvent été enseignées de façon déconnectée du reste du continent. L’histoire de l’Afrique du Nord a également été perçue presque toujours de façon indépendante, ce qui a pour effet de créer une rupture encore perceptible aujourd’hui entre cette région (le Maghreb et la partie africaine du Machrek) et le reste du continent. Cette histoire d’un continent pourtant si important est donc souvent méconnue, et le mythe encore vivace d’un immense « pays » sans histoire, auquel l’Europe aurait apporté la civilisation, n’est jamais très loin. Un mythe qui fut répandu par de grands intellectuels, tel Victor Hugo, et qui
- 12. nous poursuit toujours. Dans son Discours sur l’Afrique, celui-ci écrivait : « Quelle terre que cette Afrique ! L’Asie a son histoire, l’Amérique a son histoire, l’Australie elle-même a son histoire. […] l’Afrique n’a pas d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe1 . » C’est justement parce que l’histoire de l’Afrique n’était alors pas écrite que ces intellectuels ont pu penser qu’elle n’en avait pas. De même, c’est parce que l’on a longtemps considéré les Afriques sans culture et sans civilisation que la colonisation a pu être justifiée. Du fait d’une quasi-absence dans les manuels scolaires, l’enseignement de l’histoire du continent débute souvent par la question de l’esclavage et de la traite atlantique (XV-XIX e siècle). L’écriture de l’histoire de l’Afrique est donc relativement récente et elle s’est constituée à partir de sources qui sont orales, archéologiques, anthropologiques ou géographiques. Que nous révèle cette histoire sur la place du continent dans le monde et sur les relations internationales ? Le chercheur William E. B. Du Bois a contribué à lancer cette réflexion il y a à peu près un siècle, grâce à son célèbre The World and Africa, mais ce n’est que récemment que la dynamique semble véritablement avoir été lancée2 . I. – Un continent intégré au reste du monde La représentation du continent conçoit l’histoire, notamment économique, comme accusant un retard permanent par rapport aux autres3 . Or, l’Afrique a connu à certaines périodes de son histoire des épisodes de croissances économiques majeures. En effet, le continent africain participait aux échanges commerciaux mondiaux dès le Moyen Âge4 . Ainsi, l’empereur Mansa Moussa (1312-1337) était à la tête d’un empire riche en or. Le « Seigneur des mines », comme il se faisait appeler, s’est ainsi rendu en 1324 à La Mecque, et a distribué tellement d’or au Caire qu’il a
- 13. provoqué une véritable crise financière. Dès l’époque de l’Égypte ancienne (3150-331 avant J.-C.), certaines entités politiques africaines furent intégrées à l’économie mondiale, grâce au commerce avec le Moyen-Orient et l’océan Indien. Au cours du siècle qui a suivi la mort du prophète Mahomet, en 632 après J.-C., ces réseaux commerciaux ont largement facilité la diffusion de l’islam, contribuant à étendre son foyer de la péninsule arabique jusqu’à l’Afrique du Nord. Les Afriques précoloniales communiquaient bien avec le reste du monde, ne serait-ce que par la religion. Dès le IV e siècle, la Libye et l’Éthiopie se trouvaient en contact avec Alexandrie, et l’Éthiopie est d’ailleurs l’un des plus anciens royaumes chrétiens. L’empire d’Axoum, né vers le IV e siècle avant J.-C., s’appuyait sur d’importants réseaux commerciaux. Son fameux port Adulis, sur la mer Rouge, est mentionné dans Le Périple de la mer Érythrée5 . Du IX e au XI e siècle, l’islam se diffuse par le biais du commerce et des conquêtes dans la Corne de l’Afrique, mais aussi sur la côte est et à travers le Sahara, jusqu’en Afrique de l’Ouest. Ainsi, l’empire du Ghana ouvre la période impériale en Afrique occidentale, en basant son pouvoir sur le contrôle des routes transsahariennes et le commerce de l’or, du sel et des esclaves avec le monde arabe6 . Aujourd’hui encore, de nombreuses langues de ces régions utilisent des mots dérivés de l’arabe pour désigner des concepts commerciaux et mathématiques. Ces réseaux marchands ont fini par relier les Africains à des peuples aussi éloignés que ceux d’Asie de l’Est. En témoignent, notamment, les artefacts chinois du XV e siècle qui ont été découverts sur la côte nord du Kenya et qui révèlent l’existence d’échanges et de contacts entre les deux régions, et ce bien avant l’arrivée des Européens. L’esclavage faisait partie du commerce de l’océan Indien, même s’il différait de son équivalent transatlantique sur des points importants. Le manque d’archives détaillées et l’accent mis sur la traite atlantique ont
- 14. ralenti les recherches sur la traite islamique. Des estimations suggèrent que la traite des esclaves dans l’océan Indien a pu augmenter dans les années 1800, avec, au cours de ce siècle, plus d’un million d’esclaves partis des ports d’Afrique de l’Est. Il est toutefois intéressant de noter que ce commerce extérieur était essentiellement un « sous-produit » d’un commerce intracontinental en plein essor, avec des millions d’autres esclaves capturés et vendus en Afrique de l’Est7 . L’histoire africaine est une part de l’histoire de l’Europe. « Il n’y a aucune partie du monde dont l’histoire ne recèle quelque part une dimension africaine, tout comme il n’y a d’histoire africaine qu’en tant que partie intégrante de l’histoire du monde », écrivait le philosophe camerounais Achille Mbembe. Le continent n’était pas à part ou marginalisé, comme a pu le laisser penser une historiographie ancienne et eurocentrée. Entre le XII e et le XVI e siècle, le continent vit réellement une grande période d’essor culturel aussi bien qu’économique. II. – Le paysage politique précolonial L’étude des relations internationales consiste, traditionnellement, à examiner les interactions entre chacune des unités qui constituent le système international. Les États souverains sont un de ces acteurs de référence. Aujourd’hui, le continent africain est composé de 54 États souverains (55 à l’Union africaine avec la République arabe sahraouie démocratique). Comment s’est constitué le système étatique actuel ? Nous allons essayer ici de comprendre comment, en deux siècles, le continent est passé d’entités politiques diverses telles que des royaumes à des États souverains, qui représentent aujourd’hui plus du quart des membres de l’Organisation des Nations unies.
- 15. Avant la colonisation, le continent africain est dans l’ensemble sous- peuplé. La partie subsaharienne est une région de forêts très inhospitalière et le paysage politique de l’Afrique est très diversifié. Les institutions politiques varient alors considérablement, en termes de taille et d’organisation. Les guerres entre royaumes, empires et communautés y sont régulières. Dans certaines régions du continent, de grands États sont apparus et ont alors conquis de vastes territoires ; d’autres régions se trouvent dominées par des sociétés sans État et des groupes nomades n’ayant que des liens politiques distendus. Certaines sociétés se voient gouvernées de manière relativement consensuelle, les aînés (elders) prenant collectivement les décisions, tandis que d’autres ont des dirigeants autoritaires et sont dotées d’institutions hiérarchiques, voire militaires. Les empires peuvent être très puissants, notamment en Afrique de l’Ouest où, à partir du IX e siècle, les empires du Ghana, du Mali et des Songhaïs ont successivement dominé une partie des pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique saharienne. En Afrique du Nord-Est se trouvaient l’Égypte ancienne et le royaume d’Axoum (IV e siècle avant J.-C.-IX e après J.-C). L’Afrique australe était en partie administrée par l’empire du Grand Zimbabwe du XI e au XIV e siècle. Les historiens, anthropologues et archéologues ont fourni de nombreuses informations sur les organisations politiques alors en place. À cette époque, on trouvait rarement une ligne claire délimitant les zones de contrôle d’un dirigeant de celles d’un autre. Les frontières géographiques des entités politiques précoloniales étaient particulièrement fluides. Les centres de contrôle politique étaient éparpillés, entrecoupés de vastes zones de moindre contrôle, voire d’absence totale de contrôle. Les frontières n’étaient donc pas des lignes fixes sur une carte, elles étaient flexibles et se chevauchaient en fonction de la capacité des dirigeants à étendre leur influence. Les guerres visaient alors davantage à contrôler les personnes (y compris les esclaves capturés) et les ressources (y compris le
- 16. bétail) qu’elles n’avaient pour tâche de contrôler des territoires8 . Néanmoins, ce serait une idée reçue que de croire que les limites politiques étaient complètement ignorées, et cela participe du mythe de l’absence de politique sur le continent. Ainsi, les limites (kurotia) du royaume asante précolonial (situé dans l’actuel Ghana) sont précises. De même, en 1890 et 1891, le negusse negest – « roi des rois », équivalent d’empereur – éthiopien Ménélik II envoya une série de lettres dites « circulaires » à tous les dirigeants occidentaux, dans lesquelles il réaffirmait l’indépendance de son territoire et les limites de celui-ci. Sur tout le continent, des tentatives de conquêtes ou d’intégration furent menées par des dirigeants politiques qui créèrent alors de nouvelles frontières associant un système de marches et de lignes visibles de séparation9 . C’est ce que fit, de 1804 à 1810, Ousman Dan Fodio (1752- 1817) dans le Nord de l’actuel Nigéria. Avec le soutien des musulmans et des peuls animistes, il proclama la guerre sainte contre le sarkin (roi) Yunfa et fit la conquête des divers États haoussas, ainsi que celle du Nupe et de l’Adamaoua. Il créa ainsi l’empire de Sokoto. De la même façon, El Hadj Omar Tall (1797-1864), conquérant ayant mené une lutte contre l’entreprise coloniale, parvint à étendre, à partir de 1850, son empire théocratique (comprenant les actuels Sénégal, Mauritanie, Guinée et Mali). Les sociétés étaient organisées autour de réseaux de clans et de lignages qui formaient à leur tour des communautés plus larges. Le mariage était parfois assimilé à un outil politique permettant de créer des alliances entre les entités politiques, comme c’était le cas pour les familles royales en Europe. Néanmoins, ces identités se trouvaient généralement assez mouvantes, voire floues. Il pouvait y avoir de multiples identités collectives qui se chevauchaient et se déplaçaient en fonction des nécessités. La parenté et l’ethnicité étaient constamment négociées et renégociées10 . On constatera ici que le terme d’« ethnie » est souvent utilisé pour ces contrées, quand le terme de « nation » est plutôt employé en ce qui concerne
- 17. l’Europe. La colonisation a apporté une rigidité des classifications auxquelles les acteurs locaux ont adhéré, en fonction des intérêts politiques du moment. Les Européens, notamment les Portugais, sont arrivés sur les côtes africaines au XV e siècle. Ils échangeaient des marchandises et des biens avec les habitants, « christianisaient » les populations et capturaient des esclaves. Au fil du temps, à mesure que leurs capacités navales augmentaient, d’autres puissances européennes sont également arrivées. Les Britanniques ont commencé à établir des comptoirs commerciaux en Afrique dans les années 1530, ont atteint le cap de Bonne-Espérance en 1581 et créé la Compagnie des Indes orientales en 1600. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales a été créée deux ans plus tard, et les Français se sont également lancés dans l’aventure, en établissant chacun leurs propres avant- postes le long de la côte. Richelieu avait déjà créé la première compagnie coloniale française en 1626, au Sénégal11 . Au fur et à mesure, leur attention s’est portée sur l’exploitation du capital humain de l’Afrique. Des maisons d’esclaves telles que le fort d’Elmina dans l’actuel Ghana, et l’île de Gorée dans l’actuel Sénégal, ont été établies. La traite des esclaves a entraîné une énorme perte de capacités humaines dans de nombreuses parties du continent. Du début des années 1500 à la fin des années 1800, 12,8 millions de personnes ont été réduites en esclavage. Pour l’océan Indien, les estimations, sont de 11,5 millions de personnes. Dans certaines régions comme le Bénin actuel, par exemple, on estime que 3 % de la population était exportée en tant qu’esclaves chaque année. Même si le commerce transatlantique des esclaves a décliné au début du XIX e siècle, notamment avec la loi de 1807 abolissant le commerce des esclaves dans l’Empire britannique – et non l’esclavage lui-même –, l’intérêt européen pour les territoires africains n’a pas diminué.
- 18. Dans les années 1870-1880, les explorateurs étaient avant tout en quête de richesses (diamants, or, cuivre, etc.). Ils ont alors commencé à pénétrer plus profondément sur le continent africain. Henry Morton Stanley, Richard Burton et John Hanning Speke sont devenus des célébrités en Europe en cherchant la source de divers fleuves, notamment le mythique Nil, et en donnant des noms européens aux lacs et aux montagnes de l’intérieur. David Livingstone a exploré le bassin du Congo. Tous ont laissé rapidement leur place dans les années 1880 à des explorateurs plus militarisés, afin de relier les territoires, créant ainsi des rivalités entre les puissances coloniales. III. – La colonisation et la création des États souverains modernes La plus grande partie du continent est longtemps restée indépendante, même pendant la période de la traite atlantique. C’est seulement à partir de la fin du XIX e siècle que la presque totalité du continent est colonisée par des puissances extra-continentales (Allemagne, Belgique, France, Royaume- Uni, etc.) ou par d’autres peuples du continent. Seuls l’Éthiopie et le Libéria demeurent indépendants. Le revers infligé par les troupes de Ménélik II aux Italiens, en 1896, à Adoua, reste d’ailleurs célèbre et est encore commémoré par les Éthiopiens. Alors que les Européens intensifiaient leur exploration de l’Afrique, ils se retrouvèrent en concurrence entre eux pour le contrôle de territoires. En 1867, les Anglais arrivèrent en effet à percer le canal de Suez pour remonter ainsi plus facilement vers l’Europe. Cecil Rhodes (qui donne son nom à la Rhodésie, l’actuel Zimbabwe) rêvait de construire un chemin de fer allant du Nord au Sud de l’Afrique. Mais la résistance des Boers en Afrique du Sud déboucha sur la guerre des Boers (celle-ci correspond à
- 19. deux guerres qui ont eu lieu en 1880-1881 et 1899-1902) que l’État libre d’Orange et la République sud-africaine du Transvaal perdent, avant d’être rattachés à l’Empire britannique jusqu’en 1910. Dans les années 1880, les Britanniques s’installèrent également dans un petit pays, la Gambie, qui devint l’un des symboles de la rivalité franco-anglaise. Lorsque des tensions apparurent entre le Portugal et la Belgique, à l’embouchure du fleuve Congo, le chancelier allemand Otto von Bismarck eut l’idée d’inviter les représentants de douze pays européens à négocier une approche commune. Lors de la conférence de Berlin de 1884-1885, les dirigeants européens revendiquèrent ainsi chacun leurs sphères d’influence respectives. Cet événement, largement surévalué, est fréquemment cité comme étant le « partage de l’Afrique ». Pourtant, il existe une différence de taille entre ce qui s’est décidé à Berlin et la mise en œuvre de ces décisions12 . Certains dirigeants africains ont rejeté les propositions européennes, tandis que la plupart les ont acceptées en les interprétant selon leurs intérêts propres. Ainsi, à la fin du XIX e siècle, la rébellion de Samory Touré montre comment on pouvait avoir des divergences d’interprétation même quand les traités étaient signés. Ce processus a parfois pris des décennies à se mettre en place, du fait de la résistance des Africains, notamment les Ibos, les Ashantis, les Mandikas, les Hereros, les Zoulous, les Shonas et les Éthiopiens. La Grande-Bretagne et la France obtinrent les plus grandes emprises. La couronne britannique colonisa de grandes parties de l’Afrique orientale et australe ainsi que certaines parties de l’Afrique occidentale. La France prit le contrôle de zones de l’Afrique occidentale et centrale, ainsi que celui de Madagascar. Les Portugais réussirent à maintenir leur présence en Afrique australe et en Afrique de l’Ouest (Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert). Le roi belge obtint une colonie en Afrique centrale (Congo), devenue par la suite bien personnel du roi belge, lorsque le Parlement s’opposa à la colonisation du territoire. L’Espagne acquit de son côté des
- 20. droits sur la Guinée équatoriale et le Sahara occidental. L’Allemagne avait quant à elle une présence coloniale en Afrique de l’Est, en Afrique du Sud- Ouest, au Cameroun, en Tanganyika (partie de l’actuelle Tanzanie), en Namibie et au Togo, jusqu’à ce qu’elle soit contrainte d’abandonner ces territoires après avoir perdu la Première Guerre mondiale. Les Italiens ont acquis des colonies en Somalie, dans le Nord de l’Éthiopie (actuelle Érythrée) et en Libye. Néanmoins, comme l’Allemagne, ils ont perdu toutes leurs possessions après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1910, les puissances européennes avaient donc colonisé presque toute l’Afrique subsaharienne, à trois exceptions près : l’Afrique du Sud, qui est devenue indépendante de la Grande-Bretagne en 1910 mais est restée sous un gouvernement minoritaire blanc jusqu’en 1994 ; le Libéria, qui avait été créé dans les années 1820 pour accueillir d’anciens esclaves américains, est resté indépendant par la suite avec une relation étroite avec les États-Unis ; et l’Éthiopie qui n’a jamais été colonisée, malgré l’occupation italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Une question se pose néanmoins. Pourquoi les puissances européennes ont-elles colonisé l’Afrique à partir de 1885 ? Plusieurs hypothèses existent et se complètent : les États européens étaient puissants, contrairement à leurs homologues africains, et la colonisation de l’Afrique a été stimulée par une forte concurrence entre ces puissances européennes. La colonisation européenne de l’Afrique a également été influencée par les idéologies qui prévalaient à la fin du XIX e siècle, notamment celle de la supériorité culturelle et raciale des Européens. L’Europe devait « civiliser les races inférieures » d’Afrique, pour reprendre le célèbre discours de Jules Ferry prononcé en 188513 . Par ailleurs, une approche marxiste voit dans la colonisation la conséquence d’un besoin de matières premières pour les industries européennes et de nouveaux marchés pour leur production.
- 21. IV. – Vers l’africanisation de la gouvernance Quelles que soient leurs motivations à la colonisation, les Européens ont adopté des gestions administratives différentes de ces territoires et les ont laissés ensuite en héritage aux nouveaux États devenus indépendants. Les Britanniques appliquaient un système de contrôle indirect dans lequel ils exerçaient leur autorité par l’intermédiaire de chefs traditionnels locaux. Au Soudan, par exemple, l’encadrement du Sud était assez minimaliste et assuré par les seuls administrateurs locaux. La France, quant à elle, a gouverné ses colonies de manière plus directe, en déployant un grand nombre d’administrateurs coloniaux dans l’ensemble de ses territoires africains tout en s’appuyant également sur des chefs locaux. L’administration des colonies portugaises et belges impliquait un degré encore plus élevé de coercition et de force militaire. Ainsi, dans l’État indépendant du Congo (actuelle République démocratique du Congo), et sous le règne du roi Léopold II de Belgique de 1885 à 1908, les fonctionnaires coloniaux ont exploité les ressources naturelles par le biais d’un système brutal de travail forcé, qui incluait la mutilation comme punition en cas de non-respect des quotas de production14 . Dans de tels contextes, on imagine bien que peu d’efforts furent faits pour mettre en place et développer des services sociaux ou bien former les Africains à des postes gouvernementaux. Ces différences entre les administrations coloniales ont contribué à expliquer certaines différences dans la gouvernance des pays africains après l’indépendance. Les gouvernements coloniaux ont presque tous réussi à restreindre le champ politique et à étouffer tout débat public. Ils sont intervenus au contraire massivement dans l’économie extractive, avec des effets à long terme sur le développement politique et économique du continent. La Première Guerre mondiale et l’entre-deux-guerres ont contribué à créer un nouveau climat. D’une part, les tirailleurs sénégalais ont été
- 22. mobilisés sur le front : ils pensaient obtenir des droits en retour de la défense de la France. Pourtant, aucun changement sur leur situation ne s’est produit après le conflit. D’autre part, une classe ouvrière a commencé à se constituer dans les colonies avec la création de syndicats dans les années 1930. Cela a eu aussitôt un effet non négligeable sur le contexte politique : les liens entretenus entre les syndicats africains et leurs homologues européens, dans un moment de développement des idéologies socialistes internationalistes, bouleversaient l’ordre colonial. Les revendications sociales devinrent alors des revendications nationalistes15 . À titre d’exemple, Sekou Touré était, avant de devenir le premier président de Guinée, un syndicaliste actif. Après la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes ont introduit quelques changements dans l’administration de leurs colonies africaines. Ainsi, en Afrique francophone, en février 1944, la Conférence de Brazzaville permit la création des partis politiques. En 1956, la loi dite « loi-cadre Defferre », modifiant les institutions de l’Union française et le mode électoral, fut une étape importante dans le processus de démocratisation. Elle modifia les pratiques électorales et amorça l’africanisation de la gouvernance. Des assemblées territoriales ont ainsi été créées, avec des représentants élus par les colonisés. Le suffrage a été étendu afin d’inclure davantage de populations. Grâce à une série de changements constitutionnels, la France a également autorisé la représentation des Africains au sein de sa propre Assemblée nationale. Plusieurs futurs dirigeants des États africains indépendants ont ainsi été élus au Parlement français à cette époque, notamment Léopold Sédar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)16 . Dans ce contexte, les mouvements nationalistes ont pris de l’ampleur dans toute l’Afrique. Nombre de ces mouvements étaient jusqu’alors organisés au niveau national, tandis que d’autres avaient une orientation plus panafricaine (chapitre IV). Les processus de décolonisation ont varié en
- 23. fonction des territoires. Après avoir perdu l’Inde en 1947 et avoir brutalement réprimé l’insurrection des Mau Mau au Kenya dans les années 1950, le Royaume-Uni a finalement accepté la fin de sa période coloniale. En 1957, le Ghana (anciennement la Côte de l’Or) est devenu le premier pays d’Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance grâce à l’élan de Kwame Nkrumah (1909-1972). À l’exception du Kenya et du Zimbabwe, la décolonisation a été relativement pacifique dans les autres colonies britanniques. Parmi les territoires français, la décolonisation a pu être violente. On peut citer par exemple l’insurrection malgache (1947- 1948), la guerre camerounaise (1955-1962) ou encore la guerre d’indépendance algérienne débutée en 1954 et qui a eu d’énormes répercussions sur la politique intérieure de la métropole en participant à l’effondrement de la IVe République. En 1958, afin d’éviter des soulèvements similaires, la France a organisé un référendum constitutionnel portant sur l’Union Française et l’adoption de la nouvelle Constitution de la Ve République. Ce référendum donnait aux colonies africaines le choix entre une autonomie limitée au sein de la communauté française ou une indépendance totale. Dirigée par le charismatique Sékou Touré (1922- 1984), la Guinée est la seule à voter pour l’indépendance et est durement sanctionnée lorsque la France lui coupe toute aide. Le pays se tourne alors vers le bloc communiste. La Côte française des Somalis (actuel Djibouti) est un cas particulier. Le territoire ne devient indépendant qu’en 1977. Dès 1958, cependant, s’étaient ouverts les débats sur l’éventuelle décolonisation, qui auront donc duré près de vingt ans. De son côté, la Belgique est confrontée à des émeutes au Congo et à une révolution de la majorité hutue au Rwanda à la fin des années 1950. Le Portugal est la seule puissance coloniale à s’être battue pour conserver ses territoires africains dans les années 1960. Des guerres anticoloniales ont été menées en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau. Ce n’est qu’en 1974 qu’un coup d’État contre le gouvernement autoritaire d’António
- 24. Salazar a ouvert la voie à l’indépendance de ces colonies africaines. En 1980, la quasi-totalité de l’Afrique était indépendante. Le nombre important d’États qui accèdent à l’indépendance dans les années 1960 a une conséquence indirecte sur le système international et en particulier sur l’ONU. En effet, entre 1960 et 1975, 61 nouveaux États ont intégré l’Organisation. Si leur vote, en pleine guerre froide, fut convoité par les grandes puissances, leur comportement interne et à l’international fut alors scruté avec une attention toute particulière. En 150 ans, le panorama politique et économique africain a donc considérablement évolué. Le colonialisme européen a imposé aux Afriques un modèle d’États souverains, modifiant ainsi la carte du continent et laissant en héritage des institutions politiques hybrides ainsi qu’une marginalisation économique mondiale de ces nouvelles entités. Que serait-il advenu si l’Afrique n’avait connu ni les traites ni la colonisation ? Si l’Afrique soudanaise des grands empires (Ghana, Mali, Songhaï)17 ou encore le Kongo avaient poursuivi leur développement étatique ? Il est difficile de répondre à cette question sans tomber dans un raisonnement contrefactuel, mais il convient de le conserver en mémoire quand on étudie la formation des États et les difficultés rencontrées par les entités africaines.
- 25. CHAPITRE II Formation des États et naissance des big men (1950-1970) Après la colonisation, le paysage politique du continent africain est composé d’États souverains et indépendants. Cependant, ces nouveaux États africains ont des spécificités dues à la superposition de structures institutionnelles de style européen (wébérien) à des systèmes d’organisation politique et économique préexistants. En effet, le colonialisme n’a pas totalement détruit les modèles politiques précoloniaux. Bien que relativement bref dans la longue histoire de l’Afrique, le colonialisme a transformé le continent à bien des égards et a eu des effets durables qui continuent de façonner la politique africaine d’aujourd’hui. L’un des héritages du projet colonial européen est l’enracinement faible et parfois le manque de légitimité de certaines institutions politiques. Créées par des puissances coloniales, celles-ci se trouvent en manque de soutien populaire : les institutions dont ont hérité les dirigeants africains postcoloniaux étaient considérées comme étrangères pour la plupart des populations. Dans ce contexte, certains dirigeants ont préféré prélever des ressources étatiques, afin de s’assurer, par clientélisme, le soutien d’une partie de la population. La compétition pour le contrôle des institutions
- 26. étatiques était parfois et même souvent violente. Cette conception patrimoniale de l’État a eu d’importantes conséquences nationales et internationales. Comme le rappelle l’historienne française Catherine Coquery-Vidrovitch : « Les drames africains actuels sont trop fréquents, trop répétitifs pour relever du hasard1 ». I. – Des États considérés comme faibles Aujourd’hui, c’est devenu un lieu commun de dire que l’État en Afrique est fragile, voire faible. Évoquer « l’État en Afrique » invite à penser cette organisation de la société comme un objet singulier sur le continent. Pour penser cela, il faudrait créer des outils conceptuels inédits et originaux. Du fait de leurs trajectoires historiques, de la faiblesse de leur développement institutionnel et de leur profil économique, le cadre théorique d’étude des États africains renvoie effectivement couramment aux concepts de « force » et de « faiblesse » de l’État2 . La définition d’un État, en relations internationales, comprend généralement plusieurs critères : le contrôle d’un territoire donné, y compris le monopole de la contrainte physique considérée comme légitime ; un certain degré de légitimité accordée par la population, de sorte que les règles de cet État sont observées ; et la reconnaissance internationale de son droit d’exister. En Afrique, et dans d’autres régions du monde, nombreux sont ceux qui n’exercent pas une autorité effective sur l’ensemble de leur territoire (que ce soit en raison de rébellions ou bien d’autres menaces), et ils manquent alors de légitimité auprès de la population locale. Le chercheur Robert Jackson a développé le concept de « souveraineté négative », pour définir de tels États3 . Cette souveraineté négative prend sa source elle aussi dans le processus de décolonisation : la liberté est octroyée aux anciennes colonies et formellement reconnue internationalement par les autres États. Ainsi, leur
- 27. existence en tant qu’États est principalement due à la reconnaissance internationale de leurs frontières, tant par les voisins que par les autres États. L’État est assez peu institutionnalisé dans de nombreuses régions d’Afrique, il y est même au contraire marqué de clientélisme. Or l’institutionnalisation se manifeste par la distinction entre la personnalité physique des gouvernants et la puissance publique. La distinction qui est faite entre la fonction exercée par les gouvernants et la personne qui exerce cette fonction permettrait pourtant de concevoir une forme de continuité de l’État. Ce n’est pas le cas dans la période postcoloniale et se développe alors la notion d’État patrimonial ou néopatrimonial. Ces types d’États seraient des États pas ou peu institutionnalisés. Par exemple, en ce qui concerne les transitions politiques, quand un État est fort et donc institutionnalisé, les structures doivent disposer d’une certaine autonomie et doivent exister indépendamment des forces sociales qui ont préexisté à leur formation. Ainsi, les dirigeants doivent et peuvent être permutables, sans qu’il y ait d’incidence sur les institutions qui, elles, restent stables. Dans les années 1980 et 1990, la littérature scientifique étudie principalement l’échec de l’État en Afrique. Les sociétés traditionnelles se moderniseraient-elles par un développement politique, régulier et par étapes, ou bien la vision européenne de l’État se serait-elle imposée, conduisant à une « occidentalisation de l’ordre politique4 » ? L’« État africain » demeure ainsi toujours étudié sous le prisme de l’État importé, celui hérité de la colonisation et inadapté. De fait, il existerait un idéal type d’État, dont tous les États devraient se rapprocher. Cela nie les singularités et spécificités propres à chacune des formations politiques. Le concept d’« État failli » traduit très bien cette idée, en voulant évaluer pour chaque État les compétences de celui-ci5 . Ainsi, l’État, sur le modèle européen, serait à analyser comme le stade final d’évolution de toute société. Il en est
- 28. fait un modèle dont la diffusion est universelle bien qu’il ne soit pas accueilli de la même façon par toutes les nations. Néanmoins, cette approche empêche de penser l’État différemment et de laisser place à d’autres formes d’organisation de la société. Jean-François Bayart considère qu’il y aurait bien une « sédimentation historique » liée à une appropriation par les populations. Il convient ici de parler d’« hybridation ». En effet, les facteurs exogènes ne sont pas les seuls à avoir permis l’émergence de l’État, et la décolonisation ne serait pas le point de départ des États africains6 . Le chercheur va même plus loin et explique que la « politique du ventre » serait, dans cette perspective, une forme de gouvernementalité africaine, et il fait du caractère néopatrimonial de l’État la cause même de son échec7 . II. – Néopatrimonialisme et naissance des big men Le concept de néopatrimonialisme définit les pays dans lesquels les dirigeants considèrent l’État comme leur bien personnel. L’accaparement est donc à la base de l’État patrimonial. Cela est rendu possible par l’existence de facteurs propres aux sociétés en développement, comme la faible mobilisation sociale par exemple, ou l’alliance étroite qui existe entre le dirigeant et sa bureaucratie, sans réel contre-pouvoir. De plus, l’absence de véritables élections et donc de contre-pouvoir politique et d’une opposition tangible ne permettent pas de contenir le prince et la bureaucratie. Ce concept de néopatrimonialisme a été mis en place afin de pouvoir donner une interprétation de l’État en Afrique en reprenant Weber. Jean-François Médard8 utilisera en premier la notion de néopatrimonialisme. Il en a repris le concept et l’a fait évoluer pour mettre en évidence les situations où la « logique patrimoniale s’applique à un système politique qui n’est pas traditionnel ». Le chercheur avance l’idée
- 29. que « le néopatrimonialisme se moule dans une apparence institutionnelle qui lui est étrangère, car, si la distinction entre le public et le privé est mise en avant, officiellement, c’est seulement au niveau du vécu qu’elle est niée et vidée de son contenu9 ». Les notions de patrimonialisme et de néopatrimonialisme renvoient toutes deux à l’appropriation privative des charges et des richesses publiques par leurs détenteurs. Cependant, une distinction doit être faite pour les États postcoloniaux : les dirigeants, s’ils s’approprient effectivement les ressources publiques, instaurent cette appropriation dans le cadre d’un État doté de structures légales et modernes. La distinction entre public et privé existe donc, mais de manière purement formelle. C’est précisément à l’intérieur de ce cadre théorique que l’on observe que de nombreux États postcoloniaux du continent ont l’apparence d’États bureaucratiques, alors que cette organisation a été imposée par le colonisateur. En réalité, les dirigeants ont recours à des formes de domination patrimoniale (contrôle des ressources, népotisme, clientélisme, et bien d’autres moyens). Il existe donc à la fois une situation de bureaucratisation et de patrimonialisation. La confusion est clairement perceptible, notamment entre les domaines politiques et économiques10 . Jean-François Médard fait également le portrait du big man11 quand celui-ci est guidé par une stratégie d’accumulation financière afin de s’assurer une clientèle qui lui soit dépendante. La réussite du big man proviendrait dans cette analyse d’un chevauchement entre les domaines économique et politique. Vues de la sorte, les élites dirigeantes sont ainsi bien plus des entrepreneurs économiques que des responsables politiques, et ils sont conduits à vivre de la politique et non pour elle, comme l’avait déjà souligné Max Weber12 . Le néopatrimonialisme est-il une cause, une conséquence ou l’explication même des problèmes de gouvernance et de développement rencontrés sur le continent africain ? Ce concept est mobilisé à de nombreuses occasions, que ce soit pour l’analyse du développement
- 30. économique, des stratégies de prises de pouvoir, de la corruption ou d’un certain nombre de conflits… Le néopatrimonialisme est ainsi devenu un concept « fourre-tout » qui n’est réellement applicable que pour un échantillon de pays. Jean-François Médard propose donc une classification, à la fin des années 1990, qui opère en fonction de l’intensité et des modes de régulation des pratiques du néopatrimonialisme13 . De même, Daniel Bach distingue le « néopatrimonialisme prédateur » caractérisé par un échec de l’institutionnalisation, et donc de l’État, d’un « néopatrimonialisme régulé » qui serait « les deux extrémités d’un continuum marqué par une grande diversité de configurations empiriques. La dissolution de la frontière entre espace public et intérêts privés du chef de l’État tend à devenir totale dans le cas d’un néopatrimonialisme prédateur, tandis que celui dit régulé conserve une certaine capacité à produire des politiques publiques. Le néopatrimonialisme dans l’État doit être distingué des situations marquées par sa patrimonialisation intégrale14 ». L’État en Afrique est donc le fruit de plusieurs composantes, qui sont à la fois historiques (précoloniales, coloniales et postcoloniales), religieuses et traditionnelles, comme le pouvoir lignager ou royal. Comme partout ailleurs, l’État est la résultante d’un processus extrêmement long de sédimentation (Bayart). En effet, l’État, en Afrique comme ailleurs, n’est pas une réalité figée ou immuable, mais une institution toujours en évolution et en voie de transformation. Il est donc le fruit d’un constant processus d’institutionnalisation. Plusieurs facteurs participent à la construction d’un État. Le facteur militaire est celui qui va nous intéresser plus particulièrement dans le chapitre suivant. Le sociologue Charles Tilly y a consacré une partie de ses recherches. Selon lui, « la structure de l’État apparaît essentiellement comme un produit secondaire des efforts des gouvernants pour acquérir les moyens de la guerre15 ». En effet, l’auteur estime que la relation entre les États et la guerre (et même la préparation elle-même de la guerre) doit être
- 31. placée au centre de l’analyse sur la formation de l’État. Norbert Elias, avant lui, allait dans le même sens en pensant que la guerre est au cœur du processus de monopolisation du pouvoir politique16 . Georges Simmel ajoutera que la centralisation d’un État dépend avant tout de l’importance des conflits armés. Les conflits permettent donc à l’État de se structurer, la formation et construction de l’État impliquant un degré plus ou moins élevé de conflits. Conséquence de cette thèse, les États africains sont dits faibles également parce qu’ils n’auraient pas connu l’expérience de la guerre qui leur aurait permis de se densifier en tant que territoires et de se structurer17 .
- 32. CHAPITRE III Un continent marqué par les conflits armés (1960-2021) Le continent africain est généralement connu pour être celui des conflits armés. Sur la dernière décennie, le nombre de conflits y a été estimé à environ quarante. Pourtant, il convient de ne pas surinterpréter ces chiffres et de ne pas voir en ce décompte le seul trait d’une anarchie généralisée. En effet, si les informations qui nous parviennent font souvent écho de tragédies, n’oublions pas que de nombreux États connaissent aussi une paix relative (Sénégal, Zambie, Ghana, Botswana1 ). De même, des pays peuvent connaître l’instabilité sur une partie de leur territoire, quand le reste est épargné (RDC, Nigéria, Somalie). D’autres encore ont connu des succès remarquables après des périodes troublées (Angola, Rwanda). Malgré tout, il est un fait incontournable que la majorité des conflits dans le monde se déroule encore en Afrique. Les guerres interétatiques demeurent assez peu nombreuses2 et on observe majoritairement des guerres internes dites insurrectionnelles3 . Plus de 30 pays africains ont connu au moins un conflit non sécessionniste depuis 1960 avec plus ou moins de succès. Au fil du temps, de nombreuses théories ont été proposées afin d’expliquer les causes des conflits en Afrique. Paul D. Williams les explique en faisant référence à
- 33. une métaphore culinaire évoquant l’implication de différents ingrédients qui peuvent être combinés de diverses manières4 . Dans cette partie, nous nous proposons d’étudier l’évolution des conflits sur le continent africain sur trois périodes : la guerre froide, la décennie 1990, et la séquence ouverte par les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Nous verrons également quels sont les principaux « ingrédients » tels qu’ils ont été identifiés par les spécialistes des conflits africains, afin d’en expliquer l’origine et la nature. I. – La guerre froide : les Afriques dans les jeux d’influence La guerre froide a exercé une influence considérable sur les relations internationales en Afrique et l’existence de potentiels conflits. Bien que la plupart des États africains aient rejoint le Mouvement des non-alignés5 au moment des indépendances, dans la pratique, plusieurs d’entre eux entretenaient encore des relations avec l’une ou l’autre des deux superpuissances. Les élites africaines étaient partagées quant à celui des deux blocs à rejoindre. Certains, comme Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), voulaient continuer à coopérer pleinement avec leurs anciens colonisateurs dans l’idée de continuer d’assurer la stabilité et le développement du nouvel État. D’autres, comme le Premier ministre ghanéen, Kwame Nkrumah, étaient plus enclins à la construction de l’unité africaine et adoptèrent une position résolument anti-impérialiste envers les anciennes puissances coloniales et envers l’Occident en général. Les politiques des deux puissances globales à l’égard du continent africain étaient quant à elles guidées par des considérations politiques liées à l’opposition entre les deux blocs. L’Est et l’Ouest allaient ainsi soutenir
- 34. des régimes du continent afin de s’assurer le maintien de leur sphère d’influence. On peut dégager quatre grandes périodes pendant la guerre froide et noter que les conflits qui se sont déroulés ont certes été déterminés par l’évolution et en fonction du contexte global, mais pas seulement : la première période s’étend jusqu’à 1956 ; puis de 1956 à 1965, de 1965 à 1974, puis jusqu’à la fin de la guerre froide. Ainsi, dans les années 1950- 1956, les luttes anticoloniales avant les indépendances comme celle des Mau Mau au Kenya (1952-1956), l’Union des Populations du Cameroun (1955-1960) ou encore les rébellions du Kwilu (1963-1965) et du Simba au Congo (1961-1964) n’ont pas reçu de soutien de la part des grandes puissances. Au niveau global, la période de 1956 à 1965 a été plutôt marquée par l’escalade de la compétition entre les superpuissances. Celle-ci a culminé avec la crise du Congo en 1960 et s’est achevée avec la prise de pouvoir d’un allié des États-Unis, Mobutu Sese Seko. La crise de Suez, en 1956, a nettement marqué l’impuissance de la Grande-Bretagne et de la France ainsi que « le début de la fin » du colonialisme britannique et français sur le continent. Paradoxalement, cette crise a également amorcé la concurrence entre les superpuissances en Afrique. Les conflits sécessionnistes commencèrent en effet de se développer sur cette période mais avec assez peu de succès (Kassai et Katanga au Congo, Biafra au Nigéria, Sahara occidental au Maroc). Cela s’explique par l’intangibilité des frontières issues de la colonisation qui s’imposa comme principe6 . Seuls l’Érythrée et le Somaliland accéderont à ces demandes de sécession, mais uniquement après la guerre froide (et l’indépendance du Somaliland n’est toujours pas reconnue). Dans la période suivante, qui s’étend de 1965 à 1974, la compétition entre les superpuissances apparaît beaucoup plus faible. Pendant huit ans, les États-Unis ont été accaparés par la guerre au Vietnam. Durant cette décennie, l’Union soviétique fut également très occupée par des problèmes
- 35. internes. Une nouvelle période de compétition soviéto-américaine commence alors en 1975. L’Angola ainsi que les autres anciennes colonies portugaises (Guinée-Bissau et Mozambique) gagnent leur indépendance et instaurent des régimes marxistes. De nouveaux dirigeants prennent le pouvoir après des coups d’État : au Congo-Brazzaville (1968), en Somalie (1969), au Bénin (1972) et en Éthiopie (1974), et se déclarent alors marxistes. Les dirigeants américains commencent à redouter une diffusion plus importante du communisme en Afrique. Le contexte global va donc influer sur l’ensemble des conflits qui ont lieu sur le continent africain : les deux superpuissances vont se livrer à des guerres par procuration dans le conflit qui se déroule entre l’Éthiopie et la Somalie, pour le contrôle du territoire de l’Ogaden, à l’Est de l’Éthiopie. En 1981, après l’investiture du président Ronald Reagan, les États-Unis adopteront une nouvelle doctrine et fourniront une aide conséquente aux groupes rebelles en lutte contre les régimes marxistes. Dans le même temps, l’Union soviétique va entrer dans une période politique tumultueuse à la suite du décès de Brejnev, en 1982. Son successeur, Mikhaïl Gorbatchev, va favoriser une politique de désescalade. L’attrait idéologique manifeste jusque-là pour l’Union soviétique commence alors à s’estomper sur le continent africain, et ce retrait annonce une crise économique de taille. Ainsi, la guerre froide aura façonné les relations internationales du continent pendant près de trois décennies. Certains des dirigeants du continent furent maintenus au pouvoir parce qu’ils avaient une fonction spécifique dans cette lutte globale, en tant que pare-feu face au communisme notamment, et le plus célèbre d’entre eux fut Mobutu, au Zaïre. Les interventions des superpuissances devinrent plus intenses en trois endroits, et à trois moments différents : lors de la crise du Congo, entre 1960 et 1962 ; lors de la guerre civile en Angola, de 1974 à 1975 ; et lors de la guerre entre l’Éthiopie et la Somalie, en 1977-1978. Des interventions de moindre importance ou unilatérales eurent lieu également
- 36. lors des invasions du Shaba, province du sud-ouest du Zaïre (1977 et 1978) ; ainsi qu’à un moment des plus critique de la guerre civile tchadienne, dans le courant des années 1970. Ajoutons celles s’étant déroulées en Afrique australe, durant les luttes acharnées pour le pouvoir qui ont eu lieu. Dans les trois cas, les deux superpuissances sont intervenues dans des camps opposés et leur ont envoyé un grand nombre d’aides logistiques, d’armes et de conseillers. D’autres grandes puissances extérieures avaient également quelques intérêts en Afrique, notamment la France, la République populaire de Chine, le Portugal, l’Inde et Cuba. Des États comme la Tanzanie ou la Zambie ont adopté le socialisme africain et se sont alignés sur la Chine, plus que sur l’Union soviétique. Dans les colonies portugaises et en Rhodésie, les Chinois concurrencèrent les Soviétiques en parrainant des groupes de libération rivaux. De son côté, la France n’avait pas renoncé à ses ambitions de maintenir le rôle qui serait le sien en Afrique, et cela en se tenant en dehors des logiques de blocs. Il est d’ailleurs à noter qu’aucune des grandes crises entre superpuissances sur le continent pendant la guerre froide n’a eu lieu à l’intérieur des frontières d’une ancienne colonie française. Le Portugal, quant à lui, s’est battu pour maintenir son empire colonial jusqu’en 1975 ; l’Inde et d’autres pays non alignés ont poursuivi des intérêts économiques et politiques propres ; Cuba a soutenu le Congrès national africain (ANC) en Afrique du Sud et d’autres groupes de libération, cette fois non pas en tant que pion de l’Union soviétique mais selon des motivations plus spécifiques. Il est important de rappeler que les acteurs africains eux-mêmes ont conservé un pouvoir d’action considérable au cours de ces décennies. Le contexte de la guerre froide n’a en effet pas toujours déterminé les relations intra-africaines. Ainsi, dans les années 1970, le Bénin était officiellement marxiste-léniniste, tandis que le Togo voisin se trouvait plutôt aligné sur la France et le bloc occidental. Il n’y avait cependant pas de différends
- 37. majeurs entre eux. De même, le Congo-Brazzaville « marxiste » s’entendait assez bien avec le Cameroun, le Gabon et le Zaïre « pro-occidentaux ». En somme, bien que la guerre froide ait été la toile de fond des relations internationales du continent de 1956 à 1989, elle n’a pas déterminé toutes les interactions des États africains entre eux ni même avec le reste du monde. Avec la fin de la guerre froide, la plupart des observateurs pouvaient se plaire à penser que les conflits allaient diminuer en Afrique, comme ailleurs et partout dans le monde. Au lieu de cela, la violence n’a fait qu’augmenter. II. – Les années 1990 : « une décennie de désespoir » C’est ainsi que le regrettait l’Organisation des Nations unies. De nombreux États africains sont ressortis de ces dix années plus pauvres qu’en y entrant7 . Le nombre moyen de conflits armés qui ont éclaté chaque année en Afrique dans les années 1990 a été deux fois supérieur à celui de la décennie précédente8 . Alors comment expliquer cette situation ? Avec la fin de la guerre froide, les Afriques ont perdu de leur valeur stratégique. Le chercheur Samuel Decalo considère même que « les États africains passèrent alors de pions stratégiques qu’ils étaient pendant la guerre froide, à l’état de “confettis sans intérêt”9 ». Petit à petit, les États- Unis et ce qu’il restait de l’Union soviétique se désengagèrent du continent africain. Les premiers réduisirent ou interrompirent totalement leur aide militaire aux alliés les plus anciens, comme le Kenya, le Libéria, la Somalie, le Tchad ou encore le Zaïre. Les missions humanitaires américaines fermèrent et les personnels furent redirigés vers de nouvelles zones prioritaires, notamment en Europe de l’Est. De ce fait, les États qui survivaient en partie grâce à ces soutiens extérieurs devinrent beaucoup
- 38. plus vulnérables aux insurrections populaires et aux guerres civiles. Ils n’eurent plus, comme auparavant, le statut de clients dans un monde bipolaire. Cette perte de la rente stratégique coïncida parfois avec une crise économique et des pressions de plus en plus fortes pour démocratiser le fonctionnement de l’État. Les principaux donateurs redirigèrent donc leurs aides en fonction des efforts faits en termes de gouvernance. L’aide au développement chuta de 21 % entre 1990 et 1996. En conséquence, les réseaux de clientélisme s’effondrèrent, tout comme certaines coalitions au pouvoir en proie aux divisions internes. En Sierra Leone, une guerre civile éclata en 1991 et ne s’acheva qu’en 2002. Au Libéria voisin, Charles Taylor fit régner la terreur et entre 800 000 et un million de personnes moururent au cours du génocide des Tutsis au Rwanda. La Somalie fut également rongée par une guerre civile sans fin entre seigneurs de guerre. III. – Les causes des conflits Les conflits en Afrique ont souvent été analysés de façon simpliste en les réduisant à une cause unique principale, qui pourrait être, au choix : le colonialisme, les élites postcoloniales, l’ethnicité ou encore l’avidité des criminels. La première, le colonialisme, est souvent perçue comme la cause principale des conflits. Le colonialisme ayant favorisé certains groupes sociaux par rapport à d’autres et tracé des frontières arbitraires, obligeant tantôt des peuples différents à vivre ensemble, tantôt à séparer des populations homogènes – voir le chapitre premier. Le colonialisme aurait ainsi créé les conditions propices à des conflits futurs. Certes, le colonialisme apparaît comme étant « une des pièces du puzzle », mais il n’est pas pour autant la cause unique ou première du déclenchement d’un conflit. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, il existait plutôt des colonialismes, avec des pratiques et des héritages bien différents. Cela
- 39. ne nous permet donc pas d’expliquer pourquoi le continent a connu une recrudescence des conflits dans les années 1990 ou au début des années 2010. De plus, l’agencéité des Africains était alors totalement diluée. La deuxième explication avancée pour analyser cette recrudescence porte également la responsabilité des conflits sur les seules élites postcoloniales. Il est vrai que, pendant longtemps, une partie des États du continent était aux mains d’une élite politique – les « big men » – bénéficiant d’un pouvoir quasi absolu (chapitre 2). Quelle que soit l’origine de la faiblesse de l’État africain, elle contribua de manière importante à l’apparition de nombreux conflits armés. Lorsque les institutions étatiques ne s’avérèrent plus être des instruments de pouvoir suffisamment efficaces, de nouvelles opportunités s’offrirent, à la fois à chaque fonctionnaire et à d’autres big men, dont les intérêts allaient souvent à l’encontre de ceux du dirigeant. Enfin, lorsque l’État se rétrécit au point que la concurrence politique ne peut plus être gérée par les canaux légaux et légitimes, des conflits armés éclatent dans le but d’en prendre le contrôle. Mêlés à cela, les systèmes politiques commencent à subir des pressions extérieures : la bonne gouvernance, la démocratisation, la participation de la société civile, le multipartisme, les élections libres et compétitrices, l’alternance, le constitutionnalisme et la lutte contre la corruption deviennent les principaux critères d’évaluation de ces systèmes par les bailleurs de fonds internationaux. La lutte pour le pouvoir et la richesse qui en découle ont provoqué de nombreux conflits et crises à cette époque. Bien que cette perspective ait donné plus de place à l’agencéité des acteurs africains, elle n’a pas tenu compte des réalités locales qui ont souvent servi à minimiser les forces et les structures internationales (par exemple concernant les échanges inégaux au sein de la mondialisation, les différentes politiques des institutions financières internationales, etc.).
- 40. Les institutions financières internationales : une implication controversée dans les économies On distingue trois grandes périodes économiques sur le continent africain10 . D’abord, les premières années qui suivirent les indépendances, où l’on observe une croissance faible et de graves difficultés pour un certain nombre de pays. Puis, des années 1980 jusqu’à la fin des années 1990, le continent fut touché par une crise de croissance et de solvabilité, avec une forte récession économique, suivie d’une reprise lente et hésitante. Cette période est également marquée par une restriction du champ politique. Enfin, au début des années 2000, la plupart des économies africaines ont affiché une croissance économique positive malgré l’effondrement de l’économie mondiale en 2008-2009 qui les a également touchées. Depuis leur indépendance, les pays africains entretiennent des relations parfois difficiles avec les institutions financières internationales (IFI). En peu de temps, ils se sont tournés vers la Banque mondiale pour obtenir des crédits afin de financer d’importants projets d’investissement et vers le Fonds monétaire international pour résoudre les problèmes de balance des paiements. Dans le même temps, ils n’ont pas cessé de critiquer l’ingérence de ces institutions, dans les dynamiques politiques internes notamment via les programmes d’ajustement structurel (PAS) mandatés par le FMI et la Banque mondiale. Ceux-ci ont été imposés à de nombreuses économies africaines comme condition, entre autres, d’un meilleur accès aux marchés financiers internationaux. Les pays africains ont dû sévèrement négocier avec les institutions financières multilatérales, sur les plans à la fois politiques et économiques. Ils se sont vus fortement incités – voire contraints – d’accepter des programmes de rigueur économique qu’ils ne pouvaient pas suivre et des « recettes » de libéralisation économique, afin de négocier ensuite le désendettement. Le troisième facteur causal avancé s’apparente à une forme de « culturalisme essentialiste » : selon cette conception, en effet, l’ethnie tuerait. Les conflits en Afrique seraient d’après cette approche réduits à la seule compétition entre groupes ethniques ou tribaux. Or, une fois les différences ethniques retenues, cela n’explique pourtant pas pour quelle(s)
- 41. raison(s) un groupe de personnes donné peut prendre les armes alors qu’un autre reste pacifique. Les faits vont donc à l’encontre de cette théorie, puisque les pays les plus diversifiés sur le plan ethnique sont bien souvent les plus paisibles (Tanzanie), alors que ceux dont la population est constituée de groupes homogènes (Somalie, Rwanda) sont ceux qui ont connu les guerres les plus sanglantes. De plus, cette approche oublie le fait que ce sont les colonisateurs eux-mêmes qui, sur le continent africain, ont le plus souvent imposé ou cristallisé l’existence de catégories de peuples à caractère tribal. Ces identités peuvent avoir existé auparavant et contenir en elles-mêmes un sens politique, comme ce fut le cas pour les Ashanti du Ghana et les Baganda d’Ouganda. Toutefois, les identités peuvent aussi s’être constituées dans l’ordre du symbolique, sans avoir un sens politique particulier qui se rattache à elles. Dans certains cas, les groupes ethniques ont même été créés purement et simplement, comme ce fut le cas pour les Ngala, au Congo11 . Ces créations ethniques ont entraîné des conséquences notables dans la mesure où elles ont contribué à rigidifier les groupes sociaux, là où prédominait auparavant la fluidité. Ce fut le cas pour les identités Hutu et Tutsi, qui ont été comme réifiées et rigidifiées durant la colonisation. Quelle que soit la nature de l’identité ethnique, il n’est pas déraisonnable d’avancer l’idée qu’elle peut produire des divergences sociales qui sont bien réelles, et par la suite être instrumentalisées par des entrepreneurs politiques qui perçoivent ces groupes identitaires comme une coalition politique comme une autre. De cette façon, l’institutionnalisation des identités durant la période coloniale a accru l’importance politique de l’identité ethnique. En revanche, les mobilisations identitaires se sont assez peu répandues dans un pays comme le Sénégal où les politiciens ont pu user d’intermédiaires tels que les marabouts locaux et les chefs traditionnels, contrairement à des pays comme le Bénin, le Kenya et la Guinée, pour lesquels un certain nombre de calculs politiques ont rendu la mobilisation ethnique beaucoup plus
- 42. importante. D’autres pays ont également tenté d’encadrer institutionnellement ces différences ethniques (Ouganda, Éthiopie, Nigéria, RDC) ou bien les ont combattues dans le but de se constituer une identité nationale qui leur soit propre (la Tanzanie, sous Julius Nyerere). À cela il faut ajouter que l’approche essentialiste tend également le plus souvent à nier l’importance de l’identité nationale dans de nombreux pays du continent. Nous en trouvons les signes dans une enquête d’Afrobarometers, menée dans seize pays africains en 2009. Concernant l’importance de l’identité ethnique et de l’identité nationale, nous apprenons que 32 % des sondés ressentaient alors n’avoir qu’une seule identité nationale (88 % en Tanzanie, mais 17 % au Nigéria) ; 35 % considéraient être au centre d’une double appartenance, et seuls 9 % firent prévaloir leur identité ethnique cadrée sur celle identifiée comme étant nationale. Ces chiffres remettent donc en question la perception des loyautés ethniques versus nationales sur le continent. La dernière tendance est une forme de réductionnisme économique dans lequel les conflits sont vus comme étant dus principalement à un opportunisme économique et des décisions rationnelles12 . Dans cette optique, les problèmes économiques des Afriques ont pu conduire à une crise du patronage politique (clientélisme), et cela avant même la fin de la guerre froide. Selon le chercheur William Reno, cette crise du patronage a donné naissance à de nouveaux types de chefs rebelles : les « seigneurs de la guerre »13 . Ces acteurs seraient animés non pas par des motifs idéologiques, comme pendant la guerre froide, mais par la cupidité économique et les griefs ethno-régionaux. De nombreuses analyses sont venues critiquer ces approches : si les ressources naturelles peuvent contribuer à financer des conflits, cela ne veut pas dire pour autant que le contrôle ou l’acquisition de ces ressources en soit la cause originelle. Les conflits, généralement, ont des causes multidimensionnelles. En Sierra Leone, par exemple, ce sont les diamants qui ont fait perdurer le conflit,
- 43. mais les causes profondes étaient plus complexes. Une fois la question des diamants réglée, le conflit ne s’est pas arrêté pour autant14 . Dans ce cas précis, le conflit était en partie lié à une révolte contre les structures agricoles oppressives. Beaucoup de jeunes y avaient participé précisément pour échapper à ces structures qui les auraient placés dans des conditions de quasi-esclavage vis-à-vis de propriétaires terriens. Ces derniers les contraignaient, par exemple, à ne pas se marier. Des motivations analogues ont poussé les jeunes hommes à participer à la guerre de libération au Zimbabwe (1972-1979). Séverine Autesserre a ainsi montré que les questions de l’accès à la terre, aux ressources et au pouvoir local se sont combinées entre elles et sont devenues, une fois réunies, essentielles à la constitution d’un conflit durable15 . C’est donc plus compliqué qu’une simple « nouvelle guerre16 » comportant uniquement des impératifs et des objectifs économiques. Des chercheurs comme P. D. Williams offrent quant à eux une perspective quelque peu différente. Celui-ci a étudié les interactions entre cinq variables : la gouvernance, les ressources, la souveraineté, l’ethnicité et enfin la religion. C’est selon lui la somme de ces éléments pris dans leur globalité et en interaction les uns avec les autres qui permet de comprendre la complexité des conflits, sans les réduire à un seul « ingrédient ». Quoi qu’il en soit, bon nombre de ces conflits de l’après-guerre froide se sont également « régionalisés » par l’intervention d’États voisins. Pour autant, cela ne veut pas dire que les conflits régionalisés soient un phénomène entièrement nouveau en Afrique. En effet, la longue guerre civile angolaise, qui a duré de 1975 à 1991, a attiré bien des acteurs extérieurs venant à la fois d’Afrique (Zaïre et Afrique du Sud) que d’ailleurs (surtout Cuba, avec le soutien soviétique). La lutte contre l’apartheid, en Afrique du Sud, a également généré un conflit qui fut régional, dans l’Afrique australe. Cependant, il faut noter que ces conflits étaient principalement liés aux toutes dernières étapes de la décolonisation.
- 44. En dehors de l’Afrique australe, l’intervention militaire directe de leurs voisins dans les guerres civiles des États africains (comme ce fut le cas au Tchad) fut un phénomène assez rare, bien que le soutien symbolique ou matériel aux rebelles des pays voisins n’ait pas été chose inhabituelle (comme lors de la première guerre civile du Soudan, en 1955-1972). Depuis la fin de la guerre froide, cependant, le continent est resté en proie à un nombre croissant de conflits régionalisés. Durant toute la période de la guerre froide, les pays voisins craignaient d’avoir à intervenir directement sur les territoires alliés aux superpuissances, dans la crainte de voir l’un des camps prendre la défense de leurs alliés respectifs. La fin de la guerre froide a vu disparaître de tels freins17 . IV. – Les évolutions du panorama sécuritaire au XXI e siècle En 2020, sur trente-quatre conflits dans le monde, quinze se déroulaient en Afrique18 . La plupart des conflits sur le continent sont nouveaux et impliquent l’État islamique (EI) ou Al-Qaïda. Entre 1995 et 2011, peu de nouveaux conflits ont éclaté. Après cette période, on observe une remontée des violences politiques organisées, notamment du fait des guerres en Libye, au Mali, au Soudan du Sud et en RCA. La conflictualité augmente également avec une recrudescence des violences au Nigéria, en Somalie, au Soudan et en Éthiopie par exemple. Après les attaques du 11 septembre 2001 et le lancement de la « guerre globale contre la terreur » par les États-Unis, les Afriques sont devenues un véritable enjeu sécuritaire dans les discours politiques occidentaux. La justification de ce nouvel investissement américain repose sur les travaux concernant les ungoverned spaces et les failed states, susceptibles de servir de refuges pour les terroristes. Dès lors, l’Afghanistan devient un parangon
- 45. largement invoqué pour analyser la situation dans d’autres régions du monde touchées par le développement de foyers terroristes. Il est question ainsi du « Sahelistan » ou même du « Bokostan »… Les États faibles ou faillis constitueraient un terreau favorable au développement de groupes terroristes et représenteraient même une menace directe pour les États occidentaux dans un contexte de globalisation. Ce changement révèle un renversement de perspective : la guerre ne naîtrait plus de la puissance des États, mais de leur faiblesse. Ainsi, catégoriser les États sur une échelle de fragilité paraît être une façon de décrire et de penser les relations internationales d’après l’efficience des fonctions de cet État (chapitre II)19 . Après la guerre froide, l’augmentation des violences religieuses et du terrorisme a marqué un changement significatif du panorama sécuritaire en Afrique20 . Durant toute la période de guerre froide, qui a coïncidé avec l’époque des premières décennies des indépendances, la religion fut rarement un facteur de mobilisation sociétale. La présence accrue de la religion dans la sphère publique marque l’une des évolutions sociopolitiques les plus spectaculaires en Afrique, depuis la vague de démocratisation et les efforts de libéralisation économique des années 1990. Les Églises évangéliques et pentecôtistes se sont alors multipliées. Entre 1970 et 2010, par exemple, la proportion de chrétiens est passée de 37 % à 57 %21 . Dans le même temps, l’islam semble relativement stable (les musulmans représentaient 28 % de la population africaine en 1970, contre 31 % en 2010). La montée du christianisme s’est accompagnée d’une érosion significative de l’animisme (de 50 à 35 %)22 . Si l’islam n’a pas connu un fort développement depuis les années 1970, la montée récente de l’intégrisme islamique sur une partie du continent a introduit un élément de déséquilibre dans de nombreux États africains. Depuis le début des années 2010 en effet, les groupes djihadistes s’étendent sur le continent africain. On le voit avec le groupe Al-Shabaab en Somalie, Boko Haram au Nigéria, AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) et tous
- 46. les autres groupes opérant dans le Sahel. L’insurrection de 2012 au Mali laisse également penser que les violences fondamentalistes se sont ensuite diffusées sur tout le continent. Or, Marc-Antoine Pérouse de Montclos a pu clairement montrer la dimension historique du djihad sur le continent23 . Dans le Sahel, ces groupes sont parvenus à créer une coalition qui leur a permis d’augmenter l’intensité de leurs actions opérationnelles communes. Plus à l’est, le groupe somalien Al-Shabaab – qui a prêté allégeance à Al- Qaïda – conteste le pouvoir central soutenu par les institutions internationales et les grandes puissances. En parallèle, l’État islamique (EI) paraît étendre son influence. Après l’allégeance d’une faction du groupe nigérian Boko Haram, l’EI s’est fortement implanté en Libye afin de créer une plateforme pour s’étendre sur le reste du continent. En Ouganda, on a pu voir le groupe se rapprocher des rébellions locales : le ralliement de rébellions locales au terrorisme international constitue une évolution inquiétante dans ce pays. Le phénomène a également été observé au Sahel, en Somalie puis au Mozambique. Il est à noter cependant que les liens entre toutes ces filiales locales et les groupes internationaux sont souvent difficiles à établir. Pour des gouvernements contestés, la tentation est grande de requalifier une rébellion nationale en filiale d’un groupe terroriste. Cela leur permet d’obtenir le soutien de puissances extérieures et de légitimer leur pouvoir. Cette expansion du terrorisme sur le continent se combine donc régulièrement à des violences strictement locales, comme l’illustre parfaitement la situation au Sahel. C’est peu dire que les blocages politiques persistent : pire, nous pouvons observer que les violences semblent bien s’étendre sur tout le pays. Celles-ci sont attribuées aux actions de groupes armés, mais aussi aux tensions entre communautés sur la base de rivalités historiques, de disputes autour des ressources naturelles sur fond d’absence de l’État et de prolifération des armes légères et de petit calibre. En plus de ces développements nationaux, il faut remarquer la multiplication des conflits dits « locaux », qui opposent des communautés, éleveurs et
- 47. agriculteurs, sur fond d’instrumentalisation par les groupes armés terroristes. D’autres événements peuvent également expliquer la conflictualité renouvelée depuis 2011. Scott Straus a ainsi mis en évidence la fréquence accrue des violences lors des consultations électorales24 . En effet, la compétition politique peut accroître la tendance à vouloir mobiliser sur des bases ethniques. Si la majorité des élections se déroulent dans le calme, il existe en effet des contre-exemples. L’élection kényane de 2007 a montré à quel point le chaos pouvait régner lors d’un scrutin (1 000 morts, 350 000 déplacés). De même, des violences ont accompagné les élections au Zimbabwe (2018), en Côte d’Ivoire (2020), au Burundi (2020), et au Ghana (2020). Il faut ajouter à cela que la durée ou le renouvellement des mandats présidentiels constitue une des raisons de la forte mobilisation des populations dans de nombreux pays, comme à Djibouti où le Président est au pouvoir depuis 1999 et a modifié la Constitution en 2010, en Ouganda où le Président est le même depuis 1986 ou encore en Côte d’Ivoire où Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat dans un contexte constitutionnel controversé. Par ailleurs, le continent africain apparaît comme étant celui où le plus grand nombre de coups d’État ont eu lieu. La perception de l’Afrique comme étant un continent en proie à l’intervention des militaires dans le champ politique n’est pas dénuée de tout fondement. En effet, les Afriques ont connu près de quatre coups d’État annuels en quarante ans, de 1960 à 2000 ! Dans de nombreux cas, ces coups d’État ont été perpétrés contre des régimes incapables de mettre en place des gouvernements réellement efficaces, et donc de créer une cohésion populaire suffisamment solide. Dans ce contexte, les militaires ont alors compris qu’ils pouvaient s’affirmer en tant que force politique tout en se présentant comme « un moindre mal » par rapport au gouvernement défaillant.
- 48. Le nombre moyen de coups d’État par an en Afrique a diminué de moitié après la réintroduction du multipartisme, au début des années 1990. Pourtant, cette pratique semble être de retour depuis quelques années, comme ce fut le cas au Zimbabwe en 2017, puis, en 2021, au Tchad, au Mali, en Guinée, ainsi qu’au Niger où un coup d’État a également été évité de justesse. En 2022, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau ont également été la cible de coups d’État25 . Comment expliquer une telle recrudescence ? Quatre facteurs paraissent importants à retenir : le contexte national accompagné, dans la plupart des cas, de l’impopularité du président ; une recrudescence visible de l’instabilité régionale, avec l’effet d’« entraînement » que peut provoquer, pour un État voisin, un coup d’État ; et, pour finir, l’organisation précipitée d’élections en période de « post-conflit », ou en période « post-coup », comme ce fut le cas au Mali. Il est toutefois important de noter que de nombreux États africains n’ont jamais connu de coup d’État. De plus, ceux qui en ont subi récemment représentent moins de 10 % de l’ensemble des États africains et – à l’exception notable du Zimbabwe – ce sont justement ceux qui en avaient déjà connu auparavant. Pendant la guerre froide, pour les organisations régionales africaines, les coups d’État étaient souvent acceptés étant donné que cela représentait un mode d’accès au pouvoir. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, les États-Unis ont voulu mettre l’accent plutôt sur la promotion de la démocratie conformément à ce que réclamaient aussi les opinions publiques. Aussi, la Déclaration de Lomé de 2000 et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de 2007, ont fermement condamné les prises de pouvoir anticonstitutionnelles. Cela a pu alors ouvrir la voie pour une mise à l’écart des régimes putschistes, et, depuis, la plupart des coups d’État sont toujours très fortement dénoncés par les institutions continentales.
- 49. CHAPITRE IV La quête de l’unité ou le déploiement du régionalisme dans les Afriques La quête d’unité se trouve au centre des relations internationales africaines. Cette quête a un nom : le panafricanisme. Est-ce un mouvement politique ou philosophique, une idéologie, ou bien une doctrine de l’unité politique ? Peut-être tout cela à la fois. On peut d’ores et déjà avancer que le panafricanisme a pour but initial de promouvoir l’indépendance du continent africain et qu’il encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d’ascendance africaine, et ce où qu’ils soient dans le monde. En ce sens, le panafricanisme se trouve au cœur des relations internationales du continent. Il s’est constitué par l’histoire du continent et a pu faire écho aux luttes qu’ont menées les peuples noirs, notamment celles contre l’esclavage, l’impérialisme ou le colonialisme. Néanmoins, Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni s’étonne : « Ce qui est surprenant, c’est que dans les approches classiques des relations internationales, le panafricanisme n’est pas considéré comme une vision du monde pertinente1 ». Alors, en quoi le panafricanisme apparaît-il comme « une autre conception du monde », où trouve-t-il ses racines et de quelle manière est-il venu nourrir les relations internationales entre les acteurs africains,
- 50. notamment après les indépendances, quand la question de l’unité politique du continent africain se posait ? I. – Le panafricanisme Afin de comprendre l’avènement lui-même du panafricanisme, il nous faut faire un petit rappel historique. Les traites négrières ont été une véritable rupture dans l’histoire du continent. Les afro-descendants faisaient alors face à la nécessité d’appréhender la condition noire. C’est à partir de cette période qu’est apparu le mouvement du panafricanisme. Les premiers écrits sur le sujet sont largement autobiographiques, comme The Interesting narrative of the life of Olaudah Equianoor Gustavus Vassa, The African, qui fut publié en 1789. Ce livre a été très lu et est devenu une arme importante pour les mouvements abolitionnistes. Son auteur, Equiano, fut le premier à créer une véritable identité panafricaine ou continentale. Le panafricanisme est donc particulièrement influencé par les mouvements noirs aux États-Unis et aux Caraïbes. Des personnalités telles qu’Edward Blyden ou William E. B. Du Bois ont encouragé à bien des égards une prise de conscience de la « race nègre »2 . Marcus Garvey, le « Moïse noir », défend ainsi l’idée d’un retour en Afrique. En effet, regrettant de ne pouvoir s’intégrer au sein de la nation américaine, les émigrationnistes prêchent alors le « retour vers les terres africaines ». Ainsi, bien que le panafricanisme eût pour objet principal l’Afrique, c’est la diaspora afro- descendante qui lança ce mouvement3 . La première conférence panafricaine à Londres en 1900 réunit d’ailleurs 32 participants, dont seulement 4 Africains. Très tôt, des divisions apparaissent cependant au sein du mouvement. Dès le départ, deux courants émergent : celui de William Du Bois, en faveur de l’intégration, et celui de Marcus Garvey, qui penche lui pour un
- 51. séparatisme radical et une absence de relations avec les colonisateurs. Celui-ci considère en effet que ce n’est qu’en procédant de cette manière que pourrait se développer la condition noire. Il va donc rendre populaire le slogan : « l’Afrique aux africains ». Une nouvelle scission voit le jour au Congrès panafricain du 19 au 21 février 1919 qui se tient à Paris. Ces divisions opposent William Du Bois et le député français Blaise Diagne. Ce dernier défend, outre la politique coloniale de la France, une tendance nettement assimilationniste. Des différences d’ordre plus spécifiquement géographique émergent également et entraînent alors une scission avec d’un côté les colonies françaises et de l’autre les colonies britanniques. II. – Vers une Organisation de l’unité africaine Les différents rêves d’unir les populations africaines, portés par les nouvelles élites qui partageaient des visions différentes, ont donc conduit à la formation de trois groupes. Comme indiqué précédemment, certains dirigeants africains ont dû lutter militairement pour obtenir l’indépendance de leur pays : Kwame Nkrumah (Ghana), Mobido Keita (Mali) et Sékou Touré (Guinée) ont notamment défié les métropoles coloniales. Par la suite, ces nouveaux dirigeants ont voulu rassembler les États africains indépendants dans une union politique commune, bien que de nombreuses autres colonies aient obtenu leur indépendance de façon relativement pacifique. En décembre 1960, un groupe de douze anciennes colonies françaises s’est réuni à Brazzaville afin de discuter de la constitution d’une confédération souple et d’une coopération complète avec la France. En janvier 1961, le Maroc a organisé de son côté une réunion à Casablanca des États africains les plus radicaux (Égypte, Ghana, Guinée, Libye et Mali, ainsi que le gouvernement provisoire d’Algérie). Lors de cette réunion, les représentants de ces États ont adopté une ligne anti-impérialiste exigeant
- 52. l’indépendance de l’Algérie, le rétablissement au Congo de Patrice Lumumba et l’unification rapide des États indépendants d’Afrique. Ce groupe préconisait par exemple de développer en commun une planification économique générale, une politique étrangère et une armée continentale. En mai 1961, d’autres États africains comme l’Éthiopie, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone se joignirent également au bloc de Brazzaville, à Monrovia (Libéria), formant ainsi le « Groupe de Monrovia » militant, lui, plutôt pour une intégration par étapes. Ainsi, le contraste entre le Groupe de Casablanca et le Groupe de Monrovia allait être le reflet des divisions entre l’Est et l’Ouest : le premier groupe exigeait une libération immédiate ; le second privilégiait la patience, la coopération avec les anciens colonisateurs et toute une série de réformes sociales graduelles. Finalement, les blocs de Monrovia et de Casablanca sont parvenus à surmonter leurs différends. Ce furent donc 32 États qui se rassemblèrent en 1963, à Addis-Abeba pour créer l’Organisation de l’unité africaine. Malgré les plaidoyers du président ghanéen Kwame Nkrumah qui se déclarait en faveur d’une union plus forte, l’OUA fut créée en tant qu’organisation intergouvernementale respectant la souveraineté de chaque membre. Par conséquent, celle-ci allait disposer d’assez peu de marge de manœuvre, vu l’état de relative faiblesse dont elle allait pâtir. L’illustration en est la rhétorique autour des frontières, qui a évolué très rapidement : en 1963, l’Organisation de l’unité africaine nouvellement créée fait figurer dans son chapitre III le respect de la souveraineté et l’intégrité territoriale de chaque nouvel État, et affirme le principe de non-ingérence. La résolution du Caire de 1964 ira plus loin encore, en adoptant la résolution AGH/Res16, dite de l’« intangibilité des frontières coloniales ». De manière étonnante, les nouveaux dirigeants africains donnent un caractère immuable aux frontières coloniales et garantissent à leurs citoyens que la carte du continent restera pratiquement inchangée. Comment expliquer qu’il puisse
- 53. exister une telle contradiction dans les courants unionistes du panafricanisme ? L’objectif d’une telle position pour les nouvelles élites dirigeantes est de protéger les intérêts de leur propre régime. Les chefs d’États cherchaient également à s’assurer qu’ils seraient protégés des attaques frontalières de leurs voisins. Après l’expérience du colonialisme, les dirigeants africains avaient intégré les normes internationales de souveraineté4 et de non- intervention. Pour le chercheur Jeffrey Herbst, le maintien des frontières issues de la colonisation était donc un moyen peu coûteux pour les nouveaux dirigeants africains de créer et de maintenir des frontières sans faire la guerre et sans avoir à établir une forte présence politique sur l’ensemble de leurs territoires. Tout comme les puissances coloniales avaient cherché à limiter les conflits entre elles et n’avaient pas voulu investir dans la construction d’un État, il en allait de même pour les nouveaux dirigeants africains (chapitre premier). En ce sens, on a pu constater que la carte de l’Afrique a été très peu modifiée depuis. Quelques changements marginaux ont été apportés aux frontières, en 1963 entre le Mali et la Mauritanie et entre le Sénégal et la Gambie en 1975. Dans les deux cas, cela fut fait par un accord conjoint entre les pays concernés. Dans les quelques cas où la carte politique africaine a été modifiée de manière plus significative, ce le fut afin de revenir aux anciens tracés coloniaux. Il en fut ainsi pour l’Érythrée, le Soudan du Sud et le Somaliland (qui lui n’a pas obtenu la reconnaissance internationale).
- 54. L’Organisation des Nations unies : la voix du continent africain sur la scène internationale ? Les États africains représentent plus du quart des membres des Nations Unies. En 2022, 54 sièges sur 193 sont occupés par des États africains. Pourtant, lors de la conférence fondatrice de l’Organisation des Nations unies en 1945, seuls quatre pays africains (Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Libéria) étaient présents pour 50 participants. Les politiques étrangères des pays du continent africain siégeant à l’ONU sont en grande partie tournées vers cette organisation parce qu’elle leur offre une plateforme pour exercer leur influence diplomatique. En raison de leur nombre actuel, les États africains, associés aux autres pays en développement, sont ainsi souvent en mesure de fixer l’ordre du jour de l’Assemblée générale et d’influencer les décisions. À ce titre, l’ONU a été une tribune importante pour que ces États puissent défendre diverses causes, notamment à l’époque de la décolonisation. L’arrivée au sein de l’Organisation dans les années 1960 de nombreux États africains nouvellement indépendants a renforcé le groupe afro-asiatique puis le mouvement des non-alignés, et celui du « groupe des 77 » dans le domaine économique. Ces groupes ont permis la création de nombreux programmes et fonds spécifiques aux problèmes des pays en voie de développement5 . Il est également important de mettre en avant le fait que les États africains forgent des alliances de politique étrangère au sein des organisations internationales (OI) elles-mêmes, et ce par le biais des OI africaines. Par exemple, la position des États africains en vue de réformer le Conseil de sécurité des Nations unies se manifeste sous la forme du Consensus d’Ezulwini6 mené par l’UA. Via cette coalition, ils demandent pour l’Afrique deux nouveaux sièges permanents avec droit de veto et deux sièges non-permanents. Si l’Assemblée générale offre aux États africains un lieu de socialisation diplomatique, le pouvoir réel réside néanmoins au sein du Conseil de sécurité, où les cinq membres permanents disposent d’un droit de veto et où dix non permanents sont élus pour un mandat de deux ans dans des blocs régionaux. Le bloc africain élit ainsi trois de ses membres pour représenter le continent. Cette représentation a permis au continent d’exercer une influence et de faire entendre sa voix. Toutefois, il est souvent reproché aux cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) de jouir d’un pouvoir asymétrique en raison de leur utilisation exclusive du droit de veto. En conséquence, des tentatives répétées ont été faites pour réformer le Conseil de sécurité afin de mieux représenter les pays en développement. Les prétendants les plus
- 55. probables à un éventuel siège permanent africain (l’Égypte, le Nigéria et l’Afrique du Sud) ont chacun lancé des initiatives diplomatiques afin de soutenir une telle réforme. L’ONU joue par ailleurs un rôle important sur le continent à la fois en matière de coordination de l’aide, de promotion des institutions démocratiques, des droits de l’homme ou encore à travers l’appui au développement économique et social. Il faut ajouter à cela qu’un aspect notable de la relation ONU-Afrique concerne le rôle du maintien de la paix. Sur les 70 missions déployées sous mandat onusien depuis 1948, 30 l’ont été en effet sur le continent africain7 . Le continent africain occupe donc une place centrale dans l’ordre du jour de l’ONU. III. – L’Organisation de l’unité africaine : un bilan mitigé En 1963, lorsque les nouveaux États indépendants ont créé l’Organisation de l’unité africaine, celle-ci avait deux objectifs principaux. Le premier était de mettre fin au colonialisme et à la domination de la minorité blanche sur le continent. L’OUA et ses États membres apportèrent en ce sens un soutien financier et diplomatique aux luttes de libération dans toute l’Afrique, reconnaissant généralement un seul mouvement nationaliste dans chacune des colonies. Au fil du temps, les pays devinrent les uns après les autres indépendants, rejoignant eux-mêmes l’OUA. Le second objectif déclaré de l’OUA depuis sa fondation était de résoudre de façon collective les différents conflits et de poursuivre par la même occasion le développement économique. Dans ces deux domaines, les progrès ont été assez faibles au cours des trois décennies qui ont suivi la création de l’organisation. Aujourd’hui encore, une grande partie des pays africains se situent en matière de développement économique tout en bas de la liste des pays les plus performants. L’Afrique reste donc la région du monde la plus dépendante de l’aide, et les efforts d’intégration économique décrits plus loin n’ont pas réussi à contrer cette marginalité. En ce qui concerne la
- 56. résolution des conflits, le bilan montre bien que l’OUA n’a guère été à la hauteur de ses promesses. En effet, tout au long des années 1980, à l’exception d’une brève mission de maintien de la paix dirigée au Tchad par le Nigéria, l’organisation n’a pas été un acteur majeur dans la résolution de la grande majorité des conflits qui se sont déroulés sur le continent : Mozambique, Angola, Burundi, Ouganda, Ghana, Nigéria… Même après la création, en 1992, du mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, les guerres en Somalie, au Rwanda, au Soudan, au Libéria et en Sierra Leone se sont poursuivies, mettant clairement en évidence l’impuissance de l’OUA dans ce domaine. L’une des principales raisons de l’incapacité de l’OUA à atteindre ses objectifs politiques, notamment dans le domaine de la résolution des conflits, est avant tout la priorité qu’elle accorde, depuis son origine, au principe de non-ingérence. L’OUA était donc une organisation composée d’États souverains, qui n’agissaient collectivement que dans les rares occasions où leurs intérêts propres n’étaient pas menacés. Dans les années 1990, face à l’incapacité de l’organisation à répondre aux crises successives, certains dirigeants ont commencé de réclamer des réformes. Cette volonté de réformer l’OUA, et, finalement, de la transformer en « Union africaine », est due en grande partie aux dirigeants de trois puissances régionales : Thabo Mbeki en Afrique du Sud, Olusegun Obasanjo au Nigéria et Mouammar Kadhafi en Libye8 . Le président Mbeki avait été vice-président sous Nelson Mandela et rêvait d’une « renaissance africaine » dans laquelle son pays, nouvellement libéré, jouerait un rôle de premier plan. En plus de promouvoir les intérêts commerciaux de l’Afrique du Sud dans le reste de l’Afrique, il chercha également à transformer l’image de l’OUA, qui restait pour lui celle d’un « club de dictateurs ». Obasanjo, officier à la retraite, fut élu président du Nigéria en 1999, lors des seules élections multipartites en près de deux décennies. Il espérait également que l’Afrique tournerait définitivement une page de son passé.
- 57. Quant à Kadhafi, qui était au pouvoir depuis 1969 et s’était fréquemment immiscé dans les affaires subsahariennes – notamment au Libéria et au Tchad après la dégradation de ses relations avec les États arabes à la fin des années 1990 –, il paraît de plus en plus vouloir investir en Afrique. En 1999, lors d’un sommet extraordinaire qui s’est tenu à Syrte (Libye), il a surpris les dirigeants africains en proposant la création des « États-Unis d’Afrique », se plaçant ainsi en concurrence par rapport aux propositions de Mbeki et Obasanjo. L’ensemble des délégués présents préférèrent voter en faveur de la création d’une nouvelle institution qui remplacerait l’OUA. IV. – La transition vers l’Union africaine L’Acte constitutif de l’Union africaine, signé en l’an 2000, à Lomé (Togo), s’inspire donc assez largement des idées de Mbeki et d’Obasanjo, tout en rejetant l’ambitieux projet d’États-Unis d’Afrique de Kadhafi. Afin de promouvoir la paix, la sécurité et le développement par la coopération et l’intégration, l’UA a mis en place une série de nouvelles institutions que sont le Parlement panafricain, désormais basé en Afrique du Sud, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) composé de quinze membres, tous issus de chacune des cinq régions géographiques de l’Afrique9 , la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, basée en Tanzanie, et la Commission de l’UA, basée, elle, en Éthiopie. L’UA prévoit également la création d’une Banque centrale africaine qui, à terme, réglementerait une monnaie commune pour l’ensemble du continent. En résumé, le changement le plus important dans la transition de l’OUA à l’UA a peut-être été l’abandon du principe de non-intervention. C’est l’article « 4 (h) » de son acte constitutif qui donne à l’UA le droit d’intervenir dans un État membre « sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide
