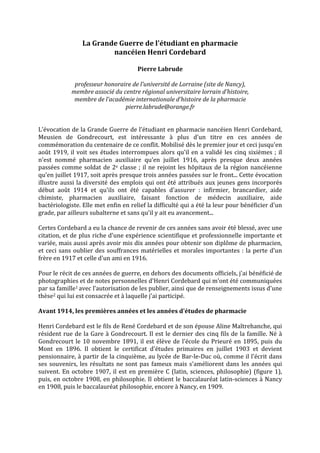
La Grande Guerre de l'étudiant en pharmacie nancéien Henri Cordebard.
- 1. La Grande Guerre de l'étudiant en pharmacie nancéien Henri Cordebard Pierre Labrude professeur honoraire de l’université de Lorraine (site de Nancy), membre associé du centre régional universitaire lorrain d’histoire, membre de l’académie internationale d’histoire de la pharmacie pierre.labrude@orange.fr L'évocation de la Grande Guerre de l'étudiant en pharmacie nancéien Henri Cordebard, Meusien de Gondrecourt, est intéressante à plus d'un titre en ces années de commémoration du centenaire de ce conflit. Mobilisé dès le premier jour et ceci jusqu'en août 1919, il voit ses études interrompues alors qu'il en a validé les cinq sixièmes ; il n'est nommé pharmacien auxiliaire qu'en juillet 1916, après presque deux années passées comme soldat de 2e classe ; il ne rejoint les hôpitaux de la région nancéienne qu'en juillet 1917, soit après presque trois années passées sur le front... Cette évocation illustre aussi la diversité des emplois qui ont été attribués aux jeunes gens incorporés début août 1914 et qu'ils ont été capables d'assurer : infirmier, brancardier, aide chimiste, pharmacien auxiliaire, faisant fonction de médecin auxiliaire, aide bactériologiste. Elle met enfin en relief la difficulté qui a été la leur pour bénéficier d'un grade, par ailleurs subalterne et sans qu'il y ait eu avancement... Certes Cordebard a eu la chance de revenir de ces années sans avoir été blessé, avec une citation, et de plus riche d'une expérience scientifique et professionnelle importante et variée, mais aussi après avoir mis dix années pour obtenir son diplôme de pharmacien, et ceci sans oublier des souffrances matérielles et morales importantes : la perte d'un frère en 1917 et celle d'un ami en 1916. Pour le récit de ces années de guerre, en dehors des documents officiels, j'ai bénéficié de photographies et de notes personnelles d'Henri Cordebard qui m'ont été communiquées par sa famille1 avec l’autorisation de les publier, ainsi que de renseignements issus d'une thèse2 qui lui est consacrée et à laquelle j'ai participé. Avant 1914, les premières années et les années d'études de pharmacie Henri Cordebard est le fils de René Cordebard et de son épouse Aline Maîtrehanche, qui résident rue de la Gare à Gondrecourt. Il est le dernier des cinq fils de la famille. Né à Gondrecourt le 10 novembre 1891, il est élève de l'école du Prieuré en 1895, puis du Mont en 1896. Il obtient le certificat d'études primaires en juillet 1903 et devient pensionnaire, à partir de la cinquième, au lycée de Bar-le-Duc où, comme il l'écrit dans ses souvenirs, les résultats ne sont pas fameux mais s'améliorent dans les années qui suivent. En octobre 1907, il est en première C (latin, sciences, philosophie) (figure 1), puis, en octobre 1908, en philosophie. Il obtient le baccalauréat latin-sciences à Nancy en 1908, puis le baccalauréat philosophie, encore à Nancy, en 1909.
- 2. Figure 1 : l'équipe de football du lycée de Bar-le-Duc en 1908 (archives de Madame Deray*) Paul Cordebard et Henri Presson (cité plus loin) sont debout, respectivement en troisième et quatrième position, tandis que Henri Cordebard est le premier assis à gauche. Se destinant à la pharmacie, il commence aussitôt son stage en optant pour le régime ancien des études3 : trois années de stage et trois années d'études dans une école supérieure comme celle de Nancy. Sa première année de stage a lieu à la pharmacie Florance de Joinville (Haute-Marne), du 20 juillet 1909 au 20 juillet 1910. Il n'en conserve pas un excellent souvenir comme il l'indique dans ses notes intimes. Les deux années qui suivent se passent à la pharmacie de M. Fageot, boulevard de La Rochelle à Bar-le-Duc (Meuse). Ce sont des amis de la famille et le stage est très agréable, d'autant plus qu'il en sait beaucoup plus que l'année précédente. Avant lui le stagiaire a été Henri Presson, originaire de Biencourt à une dizaine de kilomètres de Gondrecourt. Il est même prévu qu'Henri reprendra l'officine au terme de ses études et qu'il épousera une demoiselle de la ville... Cordebard entre donc en première année à l'Ecole supérieure de pharmacie de Nancy à l'automne 1912. Presson est délégué préparateur dans le laboratoire du professeur de chimie, Georges Favrel, et il propose son ami Cordebard comme préparateur bénévole au laboratoire de pharmacie chimique dont est responsable Auguste Sartory, chargé du cours. En seconde année (1913-1914), Henri est nommé préparateur délégué (ou suppléant) le 29 novembre 1913, en remplacement de Presson, ce qui lui assure un petit traitement4. Il obtient la médaille d'argent au prix de chimie en 19134. Puis, à l'occasion du premier concours de l'internat en pharmacie des Hospices civils de Nancy, qui a lieu le 8 décembre 19134, il est reçu troisième et devient ainsi interne provisoire à l'hôpital civil, l'actuel hôpital central. Les deux premiers, nommés internes titulaires, sont Henri Presson et Jean Duclerget. En juillet 1914, une herborisation collective a lieu en Alsace. A son retour, le 2 juillet, il a un malaise, de la fièvre, et le médecin diagnostique une menace de pneumonie qui le maintient à la chambre du 2 au 15. Il subit de ce fait le 18 juillet un examen de fin d'année spécial et individuel, puis il revient à Gondrecourt en observation médicale. La mobilisation
- 3. La situation internationale conduit le gouvernement à décider l'envoi de l'ordre de couverture aux troupes concernées le 31 juillet avec sa mise en application ce même jour à 21 heures. Le déploiement partiel des troupes des cinq corps d'armée de couverture (2e d’Amiens, 6e de Châlons, 7e de Besançon, 20e de Nancy et 21e d’Epinal), destinés à permettre à la mobilisation de s'effectuer en sécurité, conduit au départ de Paul Cordebard, l'un des frères d'Henri. La mobilisation générale est décrétée le samedi 1er août à 15 h 45 et les affiches bien connues comportant la phrase complétée à la main : « Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914 », commencent presqu'aussitôt à être placardées. Le 3 août, à 18 h 40, le gouvernement allemand déclare la guerre à la France. Les détails de la mobilisation d'Henri Cordebard sont connus avec précision par ses notes. Comme ils sont rarement exposés, je les indique ici. Cordebard, qui n'a pas encore effectué son service militaire et qui est sursitaire de la classe 1911, reçoit son fascicule de mobilisation du modèle A, le dimanche 2 août, et il quitte Gondrecourt aussitôt que possible par le train pour rejoindre le camp de Châlons5 où il est affecté à la 6e section d'infirmiers militaires6 qui y est en garnison. Il y arrive vers minuit, dans le noir et sous la pluie, et trouve une place dans une petite tente de toile, pleine de dormeurs en civil installés tête-bêche. Le lundi 3, vers cinq heures du matin, parti en reconnaissance, il croise son ami et confrère Emile Frache, qui est de Vaucouleurs, arrivé la veille, qui est déjà en tenue militaire et qui connaît un sergent à qui il a offert à boire..., puis Presson, qui a été récemment reçu pharmacien de 1e classe, arrivé lui aussi la veille et en plein jour. Ils prennent la décision de ne pas se quitter autant que faire se pourra ! Frache s'arrange pour les faire nommer à l'ambulance où il est lui-même affecté. A sept heures du matin, chacun prend son petit déjeuner avec café et pain, puis a lieu l'habillement par groupes de trente hommes, qui sont appelés par quatre de taille identique. On ne différencie que des moyens, des grands et des petits... Chacun reçoit à « vue de nez » : un pantalon, une veste, un ceinturon, une capote, un képi, des chaussures, un caleçon, deux chemises, un sac d'infanterie avec une gamelle et un quart, une cuiller et une fourchette, enfin une couverture de laine à rouler sur le sac. Une heure est accordée pour s'habiller et se présenter en tenue. L'affectation est enregistrée par un sergent-major, sur le conseil de Frache et en accord avec le sergent précité, dans la même ambulance 14/6 du 6e corps d'armée. Cette affectation est vite faite et elle concerne deux sergents, quatre caporaux, vingt-quatre appelés réservistes infirmiers, douze de visite et douze d'exploitation, ce qui est la distinction classique. L'infirmier de visite est plus qualifié que son collègue dit « d'exploitation ». Le premier participe aux soins cependant que le second s'occupe de toutes les besognes de base de la formation sanitaire. En dehors des infirmiers en cours de service militaire et qui ont été formés à cette tâche, les étudiants en médecine et en pharmacie sont fréquemment désignés pour cette activité. Vers 10 heures, six officiers parmi lesquels figurent un capitaine, un pharmacien et deux officiers d'administration font appeler et réunir tout le personnel. L'ambulance s'organise et son départ a lieu le lendemain. Henri Cordebard va rester dans cette formation jusqu'au 21 septembre 1915, soit un peu moins de quatorze mois. Bien qu'ayant validé les cinq sixièmes de ses études de pharmacie, mais n'ayant pas effectué
- 4. son service militaire et n'ayant donc pas passé l'examen d'aptitude qui permet l'accession au grade de pharmacien aide-major, Cordebard est mobilisé comme simple soldat. Il est néanmoins dans le Service de santé, alors que d'autres sont mobilisés dans les armes... Les ambulances sont des formations sanitaires de campagne dont le second numéro, ici 6, correspond au corps d'armée auquel elles appartiennent. Elles sont rattachées directement à ce corps qui peut en attribuer aux divisions dont il est constitué. Au moment où débute la mobilisation, le 6e corps7 est commandé par le général Sarrail, qui est remplacé le 30 août par le général Verraux lorsque Sarrail prend le commandement de la IIIe armée en remplacement du général Ruffey. Il part au combat fort de deux divisions d'infanterie : la 12e de Reims et la 40e de Saint-Mihiel, auxquelles s'ajoutent différents éléments organiques dont la 6e section d'infirmiers avec les ambulances qu'elle a mises sur pied ; il est rattaché à la IIIe armée. Pour sa part, une ambulance, commandée par un médecin-major (capitaine), a alors pour effectif et moyens : six médecins en comptant son chef, un pharmacien, deux officiers d'administration, trente- huit infirmiers, dix conducteurs pour les six voitures à deux chevaux et vingt brancards8. A partir de la fin de l'année 1915, deux, voire trois ambulances sont attribuées à la division en fonction de son action et des pertes envisagées. Le service de santé divisionnaire comprend aussi une section d'hospitalisation et un groupe de brancardiers divisionnaire ou G.B.D. qui comporte entre autres et initialement cent-trente-deux brancardiers. On part pour une guerre courte et des pertes restreintes, surtout dues aux balles et non aux éclats d’obus, perspectives que les évènements vont très rapidement infirmer... La guerre sur le front meusien La IIIe armée se déploie dans la Woëvre pour surveiller Metz et Thionville. Du 3 au 14 août, transporté dans sa partie méridionale, le 6e corps d'armée participe aux opérations de couverture puis se concentre jusqu'au 21 dans la région de Fresnes-en-Woêvre et d'Etain. Henri Cordebard participe avec son ambulance aux mouvements et combats du corps d'armée. Dans ses souvenirs, il écrit qu'avec l'ambulance 14/69, il est dans la Région fortifiée de Verdun pendant la bataille de la Marne, puis à Dugny (sur-Meuse) dans l'hôpital pour « éclopés et récupérables ». Le séjour s'y prolonge au cours de l'année 1915 où il parle « d'inaction du front local et de la stagnation des ambulances » dont le personnel effectue des travaux d'assainissement : enlèvement des fumiers et nettoyage des granges. Ce sont fréquemment les pharmaciens qui supervisent ces besognes. Dans un extrait de lettre qui figure dans la thèse d'Hèlène Freund10, il écrit : « du 2 août 1914 au 21 septembre 1915, j'appartenais à l'ambulance divisionnaire 14/6, dans la Meuse, en contact permanent avec les régiments d'infanterie dont nous avons ramassé et évacué les blessés pendant la bataille de la Marne autour de Verdun, puis soigné les malades et petits blessés à Dugny, Génicourt (sur-Meuse), Villers-sur-Meuse, etc., villages fréquemment bombardés, jusqu'au 20 septembre 1915 »11. Dans son ambulance, il s'intéresse à l'organisation du Service de santé en campagne, et c'est ainsi qu'il est le co-auteur, avec le pharmacien aide-major Loison, qui est sans doute lui aussi affecté à cette ambulance, d'une publication sur ce sujet, qui paraît au
- 5. début de l'année 1915 dans le Bulletin des sciences pharmacologiques12. Il s'y trouve une photographie, de mauvaise qualité malheureusement, qui a peut-être été prise par lui dans l'église de Dugny, transformée en ambulance (figure 2). Cette publication est l'occasion de consacrer plusieurs pages à l'organisation et au fonctionnement de la formation, au rôle des différents personnels, et de faire des propositions sur les dotations en matériels, accessoires et surtout médicaments qui pourraient être utiles et permettraient de mieux utiliser le pharmacien aide-major et les éventuels étudiants employés comme infirmiers. La croyance en une guerre courte ne conduisait pas à cette réflexion, mais le désastre sanitaire de 1914 amène le gouvernement à des décisions qui vont dans ce sens, mais que le commandement répugne longtemps à admettre et à mettre en oeuvre. Figure 2 : une église, sans doute celle de Dugny, transformée en ambulance (Bulletin des sciences pharmacologiques, référence n° 12, p. 17) La lecture des carnets de guerre du médecin-major Beyne13 apporte un éclairage sur ce qui se passe jour après jour pendant toute la guerre sur le front et dans les lieux où se trouve aussi Cordebard : la ligne des contacts et le relevage des blessés, les premiers soins, les déplacements des unités, les villages, les camps, etc. En effet, Beyne est mobilisé avec la 67e division de réserve que Cordebard rejoint en septembre 1915. En août 1915, alors que le corps d'armée est retiré du front et mis au repos près de Vavincourt, à quelques kilomètres de Bar-le-Duc, et que lui-même est à Domrémy, il fait une demande directe à « Monsieur le Médecin inspecteur général », écrit-il sans le nommer14, en vue de recevoir « une affectation technique plus rationnelle ». Il a la chance d'être désigné quelques jours plus tard pour le laboratoire de toxicologie de la 67e division d'infanterie. Les laboratoires de toxicologie ont commencé à fonctionner en juillet. L'affectation à la 67e division d'infanterie La 67e D.I.15 est une division de réserve qui a été mise sur pied à la mobilisation en 17e région militaire (Toulouse) avec six régiments d'infanterie de réserve, l'équivalent d'un régiment d'artillerie et des éléments de cavalerie et du génie. Son rattachement varie beaucoup au cours du conflit. Isolée et à la disposition du ministre au moment de la mobilisation, elle fait ensuite partie du 3e groupe de divisions de réserve qui est rattaché à la IIIe armée d'août à novembre 1914, puis au 6e corps d'armée de janvier à septembre 1915. Elle est ensuite, selon les moments, isolée ou attachée à un corps d'armée. Enfin, du 10 août 1915 au 25 février 1916, son rattachement est la Région fortifiée de Verdun.
- 6. Au moment où, le 22 septembre 1915, Cordebard est affecté au laboratoire de toxicologie, la division appartient au 17e corps d'armée et est commandée par le général de brigade Aimé. Cordebard va rester affecté au laboratoire jusqu'au 22 juillet 1917. Cette structure de deux personnes est rattachée au G.B.D. et donc directement au médecin-chef divisionnaire, Suivons la division pendant que Cordebard y est présent. Au moment où il y arrive, elle occupe un secteur meusien qu'il a déjà fréquenté : entre Seuzey et Koeur-la-Grande face au saillant de Saint-Mihiel, et, à partir du 27 juillet, depuis Vaux-lès-Palameix. Au repos et à l'instruction du 16 janvier au 10 février 1916, la division occupe alors un secteur entre la Meuse et Béthincourt au nord-ouest de Verdun et elle se trouve engagée lors de l'attaque allemande du 21 février. Cordebard cite les noms d'Amians (un lieu-dit ?) et Chattancourt à propos de ce jour d'attaque et il note la période du 21 au 28 février où la division est engagée. Début mars, les combats ont lieu au bois des Corbeaux (au nord de Cumières), à Béthincourt, Forges (sur-Meuse) et au Mort-Homme. Retirée du front le 12 mars, elle est transportée en Champagne vers Bétheny et La Neuvillette, au nord de Reims, où elle séjourne jusqu'au 22 août. Après quelques jours de repos vers Revigny-sur-Ornain, elle repart en direction de Verdun : Belrupt (en-Verdunois) et Deuxnouds-devant-Beauzée, puis le bois de Vaux- Chapitre (entre Fleury-devant-Douaumont et le fort de Vaux) et Thiaumont (au sud- ouest de Douaumont) jusqu'au 22 septembre. Après un bref moment de repos, elle est transportée dans la région de Toul où elle prend en charge le secteur compris entre Limey (aujourd'hui Limey-Remenauville) et la Moselle, c'est-à-dire le côté de Pont-à- Mousson du célèbre saillant de Saint-Mihiel. Le laboratoire de toxicologie est installé à Bois-le-Prêtre selon les notes de Cordebard. La division reste là jusqu'au 30 juin 1917, jour où elle est transportée au camp de Saffais (entre Saint-Nicolas-de-Port et Bayon, dans le Vermois), pour repos et instruction. Enfin, à partir du 18 juillet, elle est acheminée dans la région de Villers-Cotterêts (Aisne). Son mouvement s'achève le 19 août au moment où Cordebard est muté dans la région de Nancy. Le responsable du laboratoire est le pharmacien aide-major de 1e classe (lieutenant) Henry Pénau16 qui raconte l'arrivée de son nouvel adjoint17 : « C'était par un bel après- midi d'été (...) dans ce petit village de Courouvre que je connaissais depuis longtemps déjà, pour y avoir maintes fois cantonné ; je vis arriver vers moi un grand jeune homme élancé, qui se présentait comme adjoint au pharmacien aide-major que j'étais moi- même ». Les laboratoires de toxicologie18 ont été créés à l'échelon de chaque division en vue de l'analyse chimique et toxicologique des eaux de boisson et de la surveillance de l'hygiène des cantonnements. Comme la guerre de position s'est imposée, le but de cette structure a évolué, et il est maintenant aussi d'analyser les produits dont la qualité préoccupe le commandement, en particulier les aliments et les boissons vendus par les commerçants installés près du front. L'apparition de la guerre chimique avec des produits mortels, c'est-à-dire autres que lacrymogènes ou sternutatoires, le 22 avril 1915 dans la région d'Ypres avec le (di)chlore, conduit ces laboratoires à s'occuper de ce qui touche à ces toxiques au niveau du front, en association bien sûr avec les laboratoires des échelons plus élevés. Leur responsabilité est confiée aux pharmaciens, en choisissant les plus expérimentés, parmi lesquels les réservistes compétents, majoritairement de
- 7. l'université, des hôpitaux et de l'industrie. Henri Pénau est un exemple parfait du pharmacien à désigner pour cet emploi. L'adjoint du responsable, qualifié d'aide chimiste, est le plus fréquemment un étudiant en pharmacie dont les études sont suffisamment avancées. Cordebard est aussi un candidat de choix puisque ses études sont presque terminées, qu'il est préparateur délégué de pharmacie chimique et interne provisoire des hôpitaux. Le médecin-major Beyne, de l'armée active, commande le G.B.D. du 19 décembre 1916 au 27 septembre 191713. Il est donc certain que Cordebard le côtoie. Le laboratoire dispose d'un matériel limité et doit recourir à l'emprunt et au système D. Il se transporte dans une charrette et son chef a droit à un cheval pour ses déplacements en vue des prélèvements de projectiles, de liquides, de toxiques, d'objets souillés ou contaminés, de terre provenant des lieux d'explosion des obus, voire de matériels ennemis. Il s'installe comme il le peut en suivant le G.B.D., autant que possible dans des bâtiments en dur qui permettent plus aisément la pratique des opérations de chimie. Ultérieurement et à la suite de notes émises les 26 juillet et 22 août 1915, le laboratoire participe à l'instruction des soldats sur les questions de guerre chimique, sur le port des moyens de protection, en leur faisant faire des exercices en chambre infectée par du chlore et en leur donnant confiance en leurs équipements. Le laboratoire intervient enfin dans la réfection, la modification et la ré-imprégnation des appareils protecteurs, en créant des ateliers qui utilisent les brancardiers du G.B.D. comme main d'oeuvre. Pénau écrit19 : « Et ainsi pendant de longs mois, jusqu'en février 1916, nous avons arpenté dans une petite voiture de blessés, toutes les routes de la Meuse, à la recherche des points d'eau. Que nous les connaissions bien ces petits villages : Courouvre, Dugny, Pierrefitte (c'est là qu'est prise en octobre 1915 la photographie du laboratoire - figure 3 - et de ses deux responsables), Nicey, qui hébergeaient notre laboratoire improvisé, tandis que celui-ci s'enrichissait peu à peu des balances et d'un matériel de fortune, mais si utile, encore qu'il n'eût rien de réglementaire... ». Une liste minimale figure dans la circulaire du 18 juin 1915 mais ceci est insuffisant. Je dispose de la liste établie le 31 août 191520 pour le laboratoire de la 65e division, rédigé par son chef, un pharmacien major de 2e classe, à Manonville (entre Toul et Pont-à-Mousson dans le secteur de Bois- le-Prêtre) : quatre caisses de matériels de laboratoire, quinze appareils respiratoires à oxylithe, lunettes, sachets, liquide pour pulvérisateur, glycérine, eau distillée, alcool, pétrole, 200 kilogrammes d'hyposulfite et de carbonate de sodium pour préparer la solution neutralisante contre le chlore, planches, caisses et matériels divers, ce qui représente environ neuf cents kilogrammes. A cette date doit arriver un stock des deux produits chimiques précédents et du matériel pour prélèvements de gaz, représentant approximativement la même masse, soit au total un peu plus de mille-huit-cent kilogrammes, ce qui nécessite une voiture hippomobile21.
- 8. Figure 3 : le laboratoire de toxicologie à Pierrefitte-sur-Aire en octobre 1915. Cordebard est à droite, et son chef Henri Pénau, à gauche (archives de Madame Deray) De septembre 1915 à janvier 1916, le laboratoire procède à des analyses systématiques de potabilité des eaux de consommation, à des analyses toxicologiques puis « à tous les essais pour la lutte contre les gaz asphyxiants, le chlore en particulier, avec des masques ». Le 10 février 1016, la division est envoyée en avant de Verdun, sur la rive gauche de la Meuse, pour y creuser des tranchées et des boyaux. Dans les notes qui m'ont été confiées, des noms apparaissent : les côtes de Meuse, Troyon, Lahaymeix, Pierrefitte, Marre le 15 février 1916. Cordebard écrit que c'est à Marre qu'ils sont devenus, Pénau et lui, « brancardiers releveurs de blessé »22. L'attaque allemande du 21 février23 est moins brutale, écrit-il, à l’endroit où se trouve la division, que sur l'autre rive. L'artillerie cause de lourdes pertes, ce qui fait que « tous sont employés nuit et jour, à la relève des blessés, aux pansements, aux transports et aux évacuations, sous un bombardement permanent jour et nuit ». Il évoque une citation obtenue par la division : « troupe très belle et très brave ». A ce propos Pénau écrit : « Cette épreuve, nous l'avons connue plus tard, en février 1916, au Morthomme, (sic) lors de la première grande offensive allemande. Il ne s'agissait plus alors de points d'eau ; il fallait aller à la relève des blessés, passer au travers des rafales d'artillerie, en connaître la périodicité et savoir doubler les zones non défilées. (...) là et plus tard au fort de Souville et au tunnel de Tavannes, de sinistre mémoire, l'ardeur de Cordebard était la même, (...) »24. De mars à septembre, la division est progressivement reconstituée en Champagne, et en particulier à Reims « où nous analysons et surveillons la potabilité des eaux de la ville ». Nommé au grade de pharmacien auxiliaire25, le 12 juillet 191626, Cordebard conserve la même affectation. Ce grade correspond à celui d'adjudant et permet à ceux qui ne sont pas titulaires du diplôme de pharmacien ou qui n'ont pas passé l'examen d'aptitude au grade de pharmacien aide-major (sous-lieutenant), d'être employés en qualité de pharmacien, dans un grade convenable et avec une certaine autorité. Il avait existé auparavant, avait été supprimé, et les circonstances l'ont fait rétablir par une circulaire du 30 septembre 1915 du sous-secrétariat d'Etat du Service de santé27. Compte tenu des secteurs où se trouve sa division, Cordebard est au coeur des combats où l'arme chimique est employée, et confronté aux difficultés qu'évoque le docteur Paul
- 9. Voivenel28 dans ses ouvrages et en particulier le célèbre « Avec la 67e division de réserve » : l'entassement des blessés et l'encombrement des locaux, le sol couvert de vêtements rougis, l'odeur du sang, et par ailleurs les difficultés et les moyens alors limités dont disposent les médecins pour le traitement des soldats atteints d'oedème pulmonaire dû aux toxiques chimiques : l'ipéca pour faire vomir, la saignée et l'oxygène29. En effet, d'après ses notes, Cordebard fait fonction de médecin auxiliaire30 depuis sa nomination au grade de pharmacien auxiliaire et, sur la demande expresse du médecin-chef du G.B.D. et du médecin-chef divisionnaire, il conserve son affectation dans cette unité. Cette activité médicale d'un pharmacien trouve son origine dans l'épineuse question de la répartition du personnel entre la zone des armées afin d'y garantir le fonctionnement du Service de santé, et la zone de l'intérieur qui doit assurer en continu l'accueil et le traitement des blessés et malades qui lui sont envoyés par les armées. Aussi des réductions d'effectifs ont-elles lieu à l'avant au profit de l'arrière. Le 4 septembre 1916, la division remonte à Verdun, sur la rive droite, dans le secteur Souville-Tavannes. Dans ses notes, Cordebard indique qu'au moment où le G.B.D. arrive à Dugny, un ordre du médecin inspecteur de Verdun demande qu'une section de trente brancardiers se rende immédiatement au tunnel de Tavannes31 où la division qui occupe le secteur manque de ces personnels. Il appartient à ce détachement qui se trouve à 21 heures au lieu dénommé « Cabaret rouge » et, à 21 h 15, en vue de l'entrée du tunnel qui explose sous les yeux de la section. Cordebard a pour ami Marcel Royer, d'une promotion antérieure à la sienne et qui a été reçu pharmacien le 14 janvier 1916 à Nancy. Pharmacien auxiliaire lui aussi, il appartient au G.B.D. de la 73e division qui, en septembre 1916, se trouve dans le secteur de Verdun comme la 67e division. Le G.B.D. 73 s'est mis à l'abri dans le tunnel. Royer doit partir en permission mais, comme Cordebard lui a annoncé sa visite pour la soirée du 4 septembre, il reste là... Malheureusement, quand il arrive, la catastrophe vient de trouver son épilogue et Royer a péri dans l'incendie et les explosions. Cette disparition est très vivement ressentie par Cordebard qui écrit : « Je lui avais fait donner rendez- vous au cours d'une arrivée éventuelle prévue pour ce jour-là. Le tunnel, miné par les Allemands, explosa quelques instants avant mon arrivée. Il y était... et je n'y arrivais qu'une heure après son explosion. Je ne pense pas que l'on ait identifié son corps par la suite sous l'effondrement de sa voûte d'entrée ». Cordebard se trompe, l'explosion n'est pas due aux Allemands mais à l'incendie de bidons d'essence qui entraîne l'explosion de munitions stockées sous la voûte, l'incendie et la mort de plus de cinq cent personnes semble t-il, dont le commandant d'une brigade, et beaucoup des personnels du G.B.D. 73. La confiance que ses chefs lui manifestent se retrouve dans le texte de la citation à l'ordre de la division dont Cordebard fait l'objet le 29 septembre 1916 : « remplit les fonctions de médecin auxiliaire avec la plus grande autorité et le plus grand dévouement. Volontaire pour toutes les missions périlleuses, a assuré par lui-même, pendant soixante heures consécutives, la relève et le transport de nombreux blessés, dans un secteur particulièrement bombardé ». Il est donc décoré de la croix de guerre avec une étoile d'argent. Il s'est vraisemblablement illustré à Tavannes et à Souville pendant la bataille de Verdun, où il a été volontaire pour participer à la relève des blessés. Pénau l'a indiqué dans son discours en 193732 et les notes personnelles de Cordebard mentionnent ces deux lieux. Peut-être s'agit-il des attaques allemandes des 11 et 12 juillet 1916 où les lance-flammes et les obus chimiques ont été employés. Du 4
- 10. au 25 septembre, la bataille est encore active, comme il l'écrit : « Nous y connaissons des jours difficiles au cours desquels nous perdons notre général divisionnaire Aimé en avant au fort de Souville et où personnellement, j'ai la grande joie de recevoir la croix de guerre ». Henri Cordebard se livre à des essais personnels de tolérance aux toxiques de guerre. Par ses témoignages, nous savons qu'il s'enferme dans une sorte de poulailler où il laisse se dégager du chlore et, à partir de 1917, de l'ypérite, jusqu'à une concentration constante. Il déclenche alors un chronomètre pour définir pendant quelle durée il supporte cette atmosphère... Il sort quand il ne peut plus respirer et calcule des effets de doses. Mais quelquefois il est dans un état tel qu'il faut aller le chercher ! Il fait aussi, mais sans succès semble t-il, des essais sur des animaux. C'est à la suite de telles expériences qu'il devient, au moins en partie, anosmique33, ce qui est une conséquence classique de ces expositions. La bataille de Verdun prenant fin, la division est déplacée à Bois-le-Prêtre, dans le secteur de Pont-à-Mousson, qui est plus calme, mais où l'hiver est particulièrement rude. En avril 1917, le chef du laboratoire, Pénau, au front depuis le début de la guerre et père de quatre enfants, est muté à Paris dans un service affecté à la lutte contre les gaz. Peu après, en juin, Cordebard est envoyé à l'Institut Pasteur à Paris pour y suivre un stage de formation d'une durée d'un mois consacré à la lutte contre les bactéries anaérobies susceptible de contaminer les plaies de guerre. Les affectations moins exposées et la fin de la guerre Le 23 juillet 1917, à son retour de stage et selon ses Titres et travaux, Cordebard est affecté au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, à une douzaine de kilomètres au sud de Nancy. La fiche qui lui est consacrée au Service historique de la défense34 ne fournit aucune autre précision. Il s'agit très vraisemblablement de l'hôpital militaire complémentaire n° 1435 qui s'est installé dans le quartier Félix-Douay qui constituait avant la guerre la garnison du 4e bataillon de chasseurs à pied36. Selon ses notes, il y exerce en qualité d'aide bactériologiste jusqu'en novembre 1918, ce que contredit sa fiche militaire. A t-il oublié l'affectation qui suit ? Est-ce une erreur de l'administration militaire ? Cette fiche poursuit donc en indiquant que, le 11 janvier 1918, il passe au centre hospitalier « de Kléber », précisément à l'ambulance 1/59, où il demeure jusqu'au début du mois de novembre 1918. Il s'agit, selon toute vraisemblance, de la caserne Kléber d'Essey-les-Nancy, érigée peu avant le conflit pour accueillir le 79e régiment d'infanterie appartenant à la 11e division de Nancy. Selon certaines sources, cette caserne abrite aussi à ce moment l'hôpital d'armée n° 137. Dans cette ou ces affectations, Cordebard nous précise que les praticiens « eurent à soigner un grand nombre de malades, dont beaucoup moururent de la grippe espagnole ». Le 6 novembre 1918, il est affecté à l'hôpital militaire Sédillot de Nancy. Ses notes indiquent que, toujours pharmacien auxiliaire, il officie au laboratoire d'analyses de la 20e région militaire (Nancy) où il reste jusqu'à sa mise en congé illimité, le 20 août 1919 selon son exposé de titres, le 28 selon sa fiche. Tout ceci est un peu confus car, dans son discours de remerciement à l'occasion de la remise de sa Légion d'honneur38, Cordebard
- 11. indique : « Au début de novembre 1918, je fus retenu par le pharmacien major Bruntz, à l'occasion d'un examen probatoire, pour organiser à l'Ecole un laboratoire militaire de préparations galéniques ». Or il se trouve que Bruntz est le directeur du laboratoire de bactériologie de la 20e région en même temps que le directeur de l'école supérieure de pharmacie, et que ce laboratoire, qui devrait se trouver à l'hôpital Sédillot, a été placé à l'école quand l'établissement hospitalier a été dissous le 2 mars 1916. Bien que l'hôpital soit ré-ouvert le 1er octobre 1918, le laboratoire n'y est pas transféré. Dans son rapport au recteur relatif à l'année universitaire 1918-191939, Bruntz indique : « récemment, le laboratoire de pharmacie industrielle et le laboratoire de chimie des étudiants ont été utilisés pour fabriquer, sous la direction de M. Bruntz, pharmacien-major de 1e classe, les médicaments demandés par deux armées ». Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le laboratoire d'enseignement de pharmacie industrielle (figure 4) est employé pour les besoins militaires. Figure 4 : le laboratoire de pharmacie industrielle de Nancy (collection P. Labrude) De son côté, Bruntz connaît Cordebard puisqu'il est l'un des préparateurs de l'école qu'il dirige40. Aussi, profitant d'un examen que ce dernier subit, au titre des mesures prises pour permettre aux étudiants mobilisés de terminer au plus vite et au mieux leurs études41, il lui propose cette activité de pharmacien que celui-ci accepte. Bruntz demande alors l'affectation d'Henri Cordebard dans son laboratoire militaire. Ceci est cohérent avec son activité précédente d'aide bactériologiste. Mais Bruntz, au lieu de l'employer dans cette tâche, lui confie la direction de la préparation de médicaments galéniques dont il a la responsabilité. En sa qualité de préparateur, Henri Cordebard (figure 5) participe à l'enseignement à partir du 1er novembre 1918 et jusqu'à sa démobilisation en août 1919, tout en terminant ses études de pharmacie et en poursuivant sa mission militaire. A la fin de l'année 1918, il organise des séances de travaux pratiques au profit d'étudiants américains et luxembourgeois mobilisés42.
- 12. Figure 5 : Henri Cordebard en uniforme en 1919 (archives de Madame Deray) La suite est plus simple. Cordebard reste dans cette affectation jusqu'à sa démobilisation le 20 août 1919 et il termine entre temps ses études. Ayant journellement côtoyé le professeur Bruntz et lui ayant vraisemblablement donné satisfaction, ce dernier, à qui incombe la reconstitution des cadres de l'école, lui fait une proposition d'emploi. Cordebard écrit qu'il a reçu la mission de ré-organiser le service des travaux pratiques de chimie alors qu'il a encore lui-même des examens à passer... En 1938, à l'occasion de la remise de sa Légion d'honneur43 et en présence de Bruntz devenu recteur, Cordebard précise : « A ma démobilisation, M le Doyen Bruntz me proposa la direction des travaux pratiques de chimie. J'acceptais provisoirement en attendant le jour d'une installation que j'avais toujours considérée comme certaine, n'ayant jusqu'alors jamais songé à la carrière universitaire ». Comme déjà indiqué, Cordebard est démobilisé en août 191944 après avoir été reçu pharmacien de 1e classe le 12 juillet45. Il est nommé chef de travaux pratiques d'analyse chimique et toxicologie par un arrêté ministériel du 26 novembre 191946 après qu'un autre arrêté, du 15 de ce même mois, l'a chargé de remplacer le chef de travaux titulaire, M. Girardet, en congé pour raison de santé, du 1er septembre au 30 novembre. L'après-guerre Cordebard ne quitte pas l'école, devenue faculté en mai 1920, contrairement à ce qu'il pensait puisqu'il devait reprendre la pharmacie de Bar-le-Duc où il avait effectué la seconde partie de son stage. Différentes raisons, dues à la situation de l'après-guerre, l'en empêchent. Il reste chef de travaux pratiques jusqu'au 31 décembre 1941. A partir du 10 février 1927 et jusqu'à cette même année 1941, il est aussi chargé du cours complémentaire d'analyse chimique. Il est ensuite chargé du service de la chaire de chimie analytique et toxicologie à compter du 1er janvier 194246. Son titulaire a été révoqué par le gouvernement de Vichy. Conclusion
- 13. Telle est, brièvement racontée, au travers de documents officiels, mais aussi de notes et de témoignages, les années de guerre de l'étudiant Henri Cordebard, presque pharmacien, préparateur délégué et interne provisoire en juillet 1914. Un peu plus de cinq années plus tard, en août 1919, lorsqu'il est placé en « congé illimité », il a été trois années au front, dont deux comme soldat et une comme sous-officier supérieur. Il a ensuite passé une année dans les hôpitaux, à Saint-Nicolas-de-Port, sans doute à Essey- les-Nancy, et il a terminé la guerre dans un emploi purement pharmaceutique à Nancy. S'il n'a pas été démobilisé rapidement, il a cependant pu terminer ses études et obtenir son diplôme, avoir une activité pharmaceutique puis trouver un travail qu'il ne recherchait pas et auquel il n'avait pas songé... Cette guerre a bouleversé sa vie puisqu'il n'est pas devenu officinal mais universitaire, qu'il ne s'est pas marié, qu'il ne s'est pas installé à Bar-le-Duc et qu'il n'a pas quitté Nancy. Déjà quelque peu chimiste en juillet 1914, il l'était plus encore en 1919, et il l'est resté. La méthode de dosage de l'alcool éthylique qu'il a mise au point en porte témoignage. Henri Cordebard sort sans nul doute de cette épreuve enrichi d'un grand nombre de connaissances scientifiques nouvelles et d'une expérience humaine que n'a pas d'habitude un jeune adulte de son âge. Mais ayant été deux fois à Verdun et deux fois en Champagne, il est sûr aussi que cette guerre l'a très profondément marqué, comme l'ont indiqué ceux qui l'ont approché. Une vie marquée, mais aussi une famille marquée... En effet, les quatre frères Cordebard sont partis au combat en 1914. Si Henry en revient sans avoir été blessé, André est tué au plateau de Craonne le 26 mai 1917 et Georges meurt en 1927, vraisemblablement des suites de son intoxication par un gaz de combat à Verdun en 1916. On ne s'étonne donc pas qu'après tout cela, beaucoup des combattants n'ont plus voulu évoquer ce qu'ils avaient vécu, et qu'ils ont souhaité, avec leurs familles, que cela ne se reproduise pas. Bibliographie et notes 1. La plupart des paragraphes ont été rédigés à partir de notes personnelles d'Henri Cordebard : carnet, feuille sur la mobilisation, feuilles sur la famille, titres et travaux, photographies, mis à la disposition de l'auteur par Madame Anne-Marie Deray, petite- nièce d'Henri Cordebard. 2. Freund (Hélène), Henri Cordebard, un pharmacien célèbre. Vie, oeuvre, dosage de l'alcool dans le sang, thèse de diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, Nancy, 1991, 137 p. 3. Les études sont réorganisées par le décret du 26 juillet 1909. Elles comportent désormais une année de stage suivie de quatre années d'études. Si Cordebard avait opté pour ce nouveau régime, il aurait été diplômé au moment de la mobilisation et il aurait pu être nommé aide-major. 4. « La vie universitaire », Bulletin de l'Association des anciens élèves de l'Ecole supérieure de pharmacie de Nancy, 1914-1920, n° 8, p. 47-48. 5. Aujourd'hui ce camp est connu sous le nom de « camp de Mourmelon ». 6. Les sections d'infirmiers militaires administrent les personnels du Service de santé non titulaires d'un grade d'officier. Sauf quelques cas particuliers, il en existe une par corps d'armée et qui en porte le numéro. 7. 6e corps d'armée, http://fr.wikipedia.org/wiki/6e_corps_d'armée_(France), consulté le 30 avril 2017.
- 14. 8. Une division d'infanterie en 1914 : c'est quoi ? http://chtimiste.com/regiments/divisioncestquoi.htm, consulté le 30 avril 2017. 9. Le journal des marches et opérations (J.M.O.) de l'ambulance 14/6 est conservé aux archives du Service de santé au musée du Val-de-Grâce à Paris. L'auteur n'a pas pu le consulter en raison des conditions de fonctionnement du service. 10. Freund (Hélène), op. cit., p. 10. 11. Fallon (Léon), La Meuse et les guerres, volume III : La Grande Guerre 1914-1918, Dossiers documentaires meusiens n° 42, Office central de coopération à l'école, Bar-le- Duc, 1986, 68 p. 12. Loison (Jean) et Cordebard (Henri), « Le service de santé en campagne », Bulletin des sciences pharmacologiques, 1915, vol. 17, n° 1, p. 11-24. 13. Beyne (Ouvrage collectif de la famille de Jules Beyne), Carnets de guerre 1914-1918 du médecin major Jules Beyne, Les éditions du Net, Puteaux, 2012, 324 p. 14. Ce doit être le chef supérieur du Service de santé du corps d'armée, qui est généralement du grade de médecin inspecteur, c'est-à-dire de rang assimilé à celui de général de brigade. 15. 67e division de réserve. http://fr.wikipedia.org/wiki/67e_division_d'infanterie_(France), consulté le 30 avril 2017. 16. Vigneron (Maurice), « Henry Pénau (1884-1970) », Annales pharmaceutiques françaises, 1973, vol. 31, p. 786-790. 17. Discours prononcés le 27 octobre 1938 à l'occasion de la promotion de Henri Cordebard, pharmacien, dans l'Ordre de la Légion d'honneur, Berger-Levrault, Nancy- Paris-Strasbourg, 1939, 21 p., photographies, ici p. 9. 18. Maucolot (Régis), Les pharmaciens dans la guerre des gaz (1914-1918). Généralités - Saillant de Saint-Mihiel, thèse de diplôme d'Etat de docteur en pharmacie (sous la direction de P. Labrude), Nancy, 1996, vol. 2, p. 205-221 (les laboratoires de toxicologie divisionnaires). 19. Penau (Henri), Discours prononcés le 27 octobre 1938..., op. cit., p. 9. 20. Maucolot (Régis), op. cit., volume 3, document n° 43. 21. Latour (Jean-Claude) et Vauvillier (François), « Les voitures du service de santé », Histoire de guerre, blindés & matériel, 2015, n° 112, p. 9-19, et n° 114, p. 9-16. 22. Au sujet des brancardiers, on pourra consulter : Boucard B., Brancardiers ! Des soldats de la Grande Guerre, Ysec Editions, Lisieux, 2015, 199 p. 23. Au sujet de la bataille, on pourra consulter : Turbergue (Jean-Pierre) (sous la direction de), Les 300 jours de Verdun, Editions italiques, Paris, 2013, 550 p. La bataille est étudiée jour après jour. 24. Discours prononcés le 27 octobre 1938..., op. cit., p. 10. 25. Circulaire du 30 septembre 1915 du sous-secrétariat d'Etat du Service de santé prescrivant la nomination, à titre définitif d'emblée, de pharmaciens auxiliaires, Répertoire de pharmacie, 1915, vol. 27, p. 316. Les étudiants candidats à ce grade doivent au moins être titulaires de huit inscriptions, soit deux années d'études, et, en plus, soit posséder un titre universitaire (licence) ou hospitalier (interne), soit avoir fait fonction de pharmacien avec zèle et compétence pendant six mois ou avoir été cités. Les auxiliaires peuvent être employés dans de nombreuses formations dont les laboratoires de toxicologie. 26. Cordebard (Henri), Exposé des titres et des travaux scientifiques..., Société d'impressions typographiques, Nancy, 1944, 22 p., ici p. 7.
- 15. 27. Toraude (Louis Georges), « La défense sanitaire des troupes combattantes. La nomination des pharmaciens auxiliaires », Bulletin des sciences pharmacologiques, 1915, vol. 22, p. 97-100 (annexes). 28. Voivenel (Paul), Avec la 67e Division de Réserve, Librairie des Champs-Elysées, Paris, 1933-1938, 4 volumes. Egalement : A Verdun avec la 67e division de réserve, notes d'un médecin major, de Paul Voivenel, préface de Gérard Canini, Presses universitaires de Nancy, Nancy, 1991, 186 p. 29. Lestrade (Cécile), Un médecin et son époque : vie et oeuvre du docteur Paul Voivenel (1880-1975), thèse de doctorat en médecine, Toulouse, 1998, 115 p., ici p. 56-69 : la Grande Guerre. Cette thèse est disponible en ligne. 30. Le remplacement de deux médecins auxiliaires par des pharmaciens auxiliaires dans les G.B.D. est cité dans le Répertoire de pharmacie, 1916, vol. 28, p. 178. 31. Le tunnel de la voie ferrée Verdun-Etain, long d'un peu plus d'un kilomètres et large d'environ cinq mètres, sert d'abri à des états-majors et à des troupes, et de lieu de stockage de matériels et de munitions. De nos jours, l'origine de la catastrophe reste encore en partie incomprise. 32. Discours prononcés le 27 octobre 1938..., op. cit., p. 10. 33. Freund (Hélène), op. cit., p. 8-10. 34. Service historique de la Défense (S.H.D.), fiche de renseignements sur la carrière militaire d'Henri Cordebard. Certaines dates et affectations ne concordent pas avec ce qu'écrit ou raconte Henri Cordebard. 35. Olier (François) et Quénéc'hdu (Jean-Luc), Hôpitaux militaires dans la guerre 1914- 1918, Ysec Editions, Lisieux, 2016, vol. 5, p. 213. 36. Le quartier Félix-Douay a servi à l'armée jusqu'en 1939. Il a été presque entièrement démoli et il n'en subsiste que quelques bâtiments à un étage. 37. La caserne Kléber a servi à l'armée jusqu'à ces dernières années, en particulier à l'aviation légère de l'armée de Terre et à un centre mobilisateur. Elle a été en partie démolie en 2014-2015 et les bâtiments conservés ont été réhabilités en vue de nouveaux usages. L’ouvrage cité dans la référence précédente ne connaît aucun centre hospitalier dans cette caserne au cours du conflit. 38. Discours prononcés le 27 octobre 1938..., op. cit., p. 19. 39. Bruntz (Louis), dans : Rapport annuel du conseil de l'université et comptes rendus des facultés et école, années 1917-1918 et 1918-1919, Coubé, Nancy, 1920, p. 146. 40. Les membres du corps enseignant, mobilisés sur place ou non, quelque soit leur rang, conservent leur fonction pendant toute la durée de la guerre. C'est ainsi que Cordebard est renouvelé en qualité de préparateur délégué le 25 novembre 1914, le 17 octobre 1915, le 19 janvier 1916, le 3 novembre 1917 et encore le 31 octobre 1918. Archives de la faculté de pharmacie de Nancy, registre des décrets et arrêtés de nomination, de janvier 1904 à septembre 1950. 41. Lafferre (Louis), Instruction pour les étudiants en pharmacie des classes antérieures à la classe 1918, qui ont été sous les drapeaux pendant la guerre, Bulletin des sciences pharmacologiques, 1919, vol. 24 , p. 18. 42. Archives de la faculté de pharmacie de Nancy, dossier Henri Cordebard. 43. Discours prononcés le 27 octobre 1938..., op. cit., p. 19. 44. Au sujet de la démobilisation, on pourra consulter : Cabanes B., La victoire endeuillée La sortie de guerre des soldats français 1918-1920, Points Histoire (H 498), Editions du Seuil, Paris, 2014, 614 p. 45. Archives de la faculté de pharmacie de Nancy, service de la scolarité, fiche de doctorat d'université d'Henri Cordebard.
- 16. 46. « La vie universitaire », Bulletin de l'Association des anciens élèves de l'Ecole supérieure..., op. cit., p. 47-48. *L'auteur remercie Madame Anne-Marie Deray, petite nièce du professeur Henri Cordebard, pour les photographies et les documents familiaux qu'elle lui a aimablement confiés.