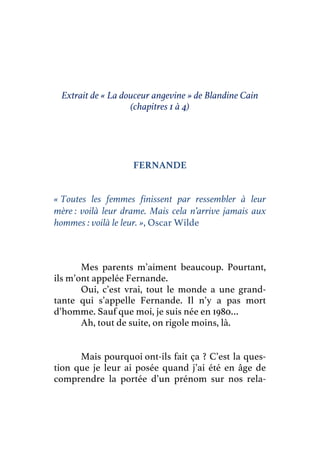
Extrait de La douceur angevine, roman de Blandine Cain : chapitres 1 à 4
- 1. Extrait de « La douceur angevine » de Blandine Cain (chapitres 1 à 4) FERNANDE « Toutes les femmes finissent par ressembler à leur mère : voilà leur drame. Mais cela n’arrive jamais aux hommes : voilà le leur. », Oscar Wilde Mes parents m’aiment beaucoup. Pourtant, ils m’ont appelée Fernande. Oui, c’est vrai, tout le monde a une grand- tante qui s’appelle Fernande. Il n’y a pas mort d’homme. Sauf que moi, je suis née en 1980… Ah, tout de suite, on rigole moins, là. Mais pourquoi ont-ils fait ça ? C’est la ques- tion que je leur ai posée quand j’ai été en âge de comprendre la portée d’un prénom sur nos rela-
- 2. tions sociales. Ma mère m’a répondu qu’elle ne voulait surtout pas d’un prénom à la mode, Caro- line, Stéphanie… « Il ne manquerait plus que ça fasse Famille de Monaco ! ». Dans mon cas, « Fer- nande » étant associé au nom de famille « Galo- pin », on n’aurait pas nécessairement frôlé l’amalgame. C’est sûr que lorsque j’aidais ma mère à la caisse de la boucherie familiale, ça ne choquait personne. Même chose aux Trois Brasseurs, où j’ai passé mes fins d’après-midi durant une bonne partie de mon enfance pour y faire mes devoirs puis pour participer aux discussions de comptoir, pendant que mes parents finissaient leur journée derrière la vitrine, sur le trottoir d’en face. Mon prénom aurait eu toute sa place dans un roman de Pagnol, La Gloire de mon Père, Le Châ- teau de ma Mère… On entend les cigales et ça sent bon le Pastis. Pourtant, je ne suis pas née en Pro- vence, mais à Angers. Mes parents n’étaient pas à une incohérence près. Un nom pareil, ça a quelques vagues avan- tages. Par exemple, Fernande Galopin, ça respire l’honnêteté, ça force le respect… Du moins, au téléphone, quand on me dit : « Vous avez une voix jeune ! ».
- 3. Normal, vu mon âge. Sauf que ça, j’évite de le dire. Parce qu’alors, ça devient franchement suspect. À l’ANPE, ils ont inspecté ma carte d’identité sous tous les angles pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un faux, usurpation d’identité post-mortem ou je-ne-sais-trop-quoi. Et côté séduction, j’ai quand même eu plu- sieurs fois l’impression que ça ne jouait pas en ma faveur : — Salut les gars ! Je vous présente la copine qui passe les vacances avec moi : elle s’appelle Fer- nande. — …, grand silence accompagné de regards fuyants et de sourires furtifs. — Oui, je sais. Elle sait. Allez, faites un effort, merde ! — Bonjoooour Fernaaaaande ! en chœur, en mode Alcooliques Anonymes. On dit que la société a tendance à coller des étiquettes aux gamins dès le plus jeune âge. Eh bien moi, mes parents s’en sont chargés dès la ma- ternité. Au moins, aucun doute : j’aurais eu besoin d’un pseudo si j’avais décidé de faire carrière dans le porno. Sauf si j’avais voulu me spécialiser dans la tranche d’âge +60, à qui on a rebattu les oreilles
- 4. avec la très poétique chanson : « Quand je pense à Fernande… ». Toutes les bonnes fées ne peuvent pas se pencher sur le même berceau, il en faut pour tout le monde. En me donnant un prénom bien moche, mes parents se sont peut-être dit que ça pousserait le monde de l’invisible à faire son maximum pour compenser. Et heureusement, c’est vrai, j’ai d’autres atouts à mettre en avant pour faire oublier mon prénom anachronique. Mes longs cheveux bruns, souples et bouclés, mes yeux clairs – de la couleur d’un lac en Croatie, dixit un de mes ex –, mon teint mat, m’ont valu d’avoir plus de petits copains que d’amies à l’école. Jusqu’à encore assez récemment, je faisais 1m75 et ma silhouette était élancée. Ce que je préfère chez moi, ce sont mes poignets graciles et la petite fossette derrière chacune de mes épaules. Je ne suis pas sûre que ce soit ce que les autres remarquent en premier. En tout cas, c’est vrai qu’hormis ma propre aversion pour mon prénom, je n’ai pas eu à subir beaucoup de moqueries : on pardonne tout aux gens beaux. J’ai un côté rebelle. J’ai été vite attirée par ce qui était interdit ou peu recommandable : l’alcool, le sexe, les drogues… Je me serais bien fait tatouer aussi, mais je me suis tout de suite imaginée à
- 5. quatre-vingt-dix balais, alors qu’un jeune aide- soignant musclé me ferait ma toilette et reluquerait la tête de mort sur mon bras ou le triskell sur le bas de mon dos, avec un sourire condescendant. Alors je ne l’ai pas fait. Comme quoi, on peut s’interdire des trucs en anticipant des situations qui n’arriveront peut-être jamais. Parce qu’honnêtement, ça m’étonnerait carrément que j’atteigne l’âge canonique de quatre-vingt-dix ans. Côté prénom, je n’ai finalement pas opté pour un pseudo. J’ai tout simplement relégué Fer- nande aux oubliettes, au profit de mon deuxième prénom officiel, Olivia : heureusement, mes pa- rents s’étaient vu imposer ce second prénom par ma marraine, bien mieux inspirée qu’eux ce jour- là. À part au lycée, où les profs n’en ont pas démor- du, sadiques qu’ils étaient, mon entourage s’est très bien fait à ce changement. Cela a presque suscité un soulagement collectif, de ne plus avoir à m’appeler par ce prénom d’arrière-grand-mère en faisant semblant de ne se rendre compte de rien. Après le lycée, ma passion pour les histoires m’a fait hésiter entre deux orientations : la fac de lettres et l’école de journalisme. Pragmatiques, mes parents m’ont conseillée de suivre la direction qui
- 6. m’offrirait un métier rémunéré plus tard. Et puisque je n’avais pas la vocation de devenir prof – je ne voyais pas bien ce que j’aurais pu faire d’autre après une fac de lettres, à l’époque –, j’ai donc rete- nu l’école de journalisme, quittant ainsi ma cam- pagne angevine pour mener ma vie étudiante à Lille. Avec grand plaisir d’ailleurs, car les occasions de découvrir de nouveaux univers, des personnages énigmatiques ou encore de décrypter l’actualité étaient nombreuses. En quelques années, durant cette expatriation lilloise, j’ai ainsi décuplé ma culture générale et surtout ma curiosité. Je me suis prise de passion pour le monde celte et ses contes et légendes, à force de côtoyer là-bas d’autres déraci- nés, souvent d’origine bretonne ou galloise, allez savoir pourquoi. En troisième année, juste avant de rentrer dans la vie active pour de vrai, j’ai réalisé mes pre- mières piges pour une feuille de chou locale, cou- vrant notamment l’ouverture de la Grande Brade- rie ou rédigeant un article sur la météo pourrie de la saison précédente – pas de grande nouveauté pour les Lillois. Il fallait bien commencer par quelque chose. Dès le départ, j’ai signé mes articles « Olivia Galopin ».
- 7. SYLVESTRE « Il y a des adultes qui jamais n'ont été des enfants », Jacques Prévert Je suis né neuf mois après la mort de Jacques Prévert, jour pour jour. Heureux hasard, réincarna- tion…? Je n’aurais pas cette prétention. Mais j’avoue que ça ne me déplaît pas de m’imaginer un lien filial avec ce poète. Prévert fait partie de ces artistes que je comprends, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Je déteste les phrases alambi- quées, les figures de style… Tout cela me fait la même impression que les jargons utilisés dans certains métiers, comme pour exclure ceux qui n’auraient pas été élus puis initiés. Je préfère de loin les phrases coupées à la serpe, qui vous re- muent les tripes et vous font dresser les poils. Car il faut bien l’avouer, je suis quelqu’un de simple et de très ordinaire. Si je devais citer mes trois princi-
- 8. pales qualités, ce serait certainement la détermina- tion, la droiture et la loyauté. Quand j’y repense, mon enfance ressemble à un séjour dans un petit panier d’osier rempli d’ouate, comme ceux dans lesquels on mettait les oisillons tombés du nid qu’on recueillait au prin- temps, au pied des vénérables chênes de notre propriété familiale, située juste en-dessous de Chaudefonds-sur-Layon. Oui, j’ai grandi dans un hameau en pleine campagne, à une demi-heure au Sud d’Angers. Pour l’enfant que j’étais alors, c’était un petit paradis. Pour l’ado que j’allais devenir, cet endroit deviendrait un trou où je me sentirais en- terré vivant. Comme quoi, tout est une question de point de vue. Je me souviens de ma mère, toujours dans la cuisine, à mitonner des petits plats pour ses quatre hommes, à chantonner comme si rien ne pouvait jamais la mettre de mauvaise humeur. Elle a passé notre enfance à nous répéter que nous étions faits dans le même moule, avec nos yeux bleus et nos cheveux blonds. Dans son dos, tout le monde l’appelait la Mère Denis – quand on s’appelle Ca- therine Denis et qu’on a trois enfants, difficile d’y échapper –, mais il ne fallait pas se faire prendre, car c’est à peu près la seule circonstance dans la- quelle elle était capable de se mettre en rogne pour
- 9. de bon, à cause de la pub pour la machine à laver Vedette. Mon père, toujours au boulot, notaire de son état. Maître Michel Denis. Jamais un mot plus haut que l’autre, le regard scrutateur derrière ses lu- nettes cerclées de métal doré. Il savait endosser naturellement le costume de père de famille mora- lisateur quand il fallait expliquer à l’un de ses trois fils quelle route il devrait emprunter plus tard. Mes deux frères aînés, Bertrand et Gaël, l’un bientôt devenu responsable commercial dans l’automobile de luxe et l’autre, enseignant- chercheur en faculté de sciences, comme le leur avait fermement suggéré tout à tour mon cher père. De bons petits soldats. Nous avons tous sauté une classe durant notre primaire. À croire que mes parents ont été très convaincants auprès du corps enseignant. Par la suite, j’ai pris des chemins moins glo- rieux que mes frères. Autant dire qu’avec mes notes en dents de scie durant mon collège, et encore plus au lycée – sans parler de la suite –, je n’ai vite plus été celui qu’on exhibait lors des soirées mondaines, durant lesquelles les exploits de sa progéniture se disputaient la vedette avec le montant des impôts payés cette année et le dernier handicap au golf. Ce contexte familial m’a amené à prendre rapidement
- 10. mes distances avec l’ensemble de ses membres, sans pour autant faire une véritable crise d’adolescence. Tout juste des signaux faibles qui se traduisaient par une colle le samedi ou un zéro en histoire-géo. Au lycée privé catholique où mes parents m’avaient envoyé, je me suis trouvé une bande de copains beaucoup plus émancipés que moi. Avec le recul, j’ai fini par en conclure que plus la famille est stricte et militaire, plus les enfants se dévergondent. Je me suis mis à fumer en cachette, à piquer quelques pièces dans le porte-monnaie de ma mère pour m’acheter un paquet de temps à autre et sur- tout, pour rester avec les copains après les cours et faire un petit baby avec un Monaco à la main, au troquet du coin. Rien de bien méchant. Mes co- pains, eux, avaient tout essayé : les joints évidem- ment – moi aussi –, mais également le pollen, la résine de cannabis, les champignons hallucino- gènes, la cocaïne… Je ne voulais pas commencer, par peur d’aimer ça et de ne plus savoir m’arrêter. J’ai toujours été d’un tempérament raisonnable. Durant mon année de Terminale S, je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Alors j’ai suivi les copains, et on s’est tous inscrits pour passer le concours de ma future école de commerce. Ça tombait bien, l’école se trouvait à Angers, et je n’avais donc pas besoin de déménager pour y aller. Mes parents ont poussé un soupir de
- 11. soulagement. Ils s’attendaient à ce que je leur parle d’une obscure orientation sans aucun débouché. Je ne me rendais pas compte du plaisir que je leur faisais. Encore fallait-il que je sois accepté, et en ef- fet il s’en est fallu de peu : le séjour sur liste d’attente m’a semblé interminable après mes résul- tats du bac, décroché au rattrapage. La bonne nou- velle, c’est que nous étions trois copains de lycée à y débarquer ensemble. Nous avons donc fait notre rentrée fanfarons, et plus sûrs de nous que jamais. Les années suivantes ont été une vraie révé- lation pour moi : de jeune garçon effacé et plutôt mal dans ma peau, j’ai appris à me mettre en avant, à oser, à exposer mon point de vue… J’ai donc en- tamé ma mue, devenant un jeune homme serein, abusant jusqu’à la lie du pouvoir de mes yeux bleus, de mes cheveux clairs savamment maintenus légèrement trop longs – tout comme ma barbe de trois jours – et de mes épaules de rugbyman sur la gente féminine, tout en conservant au fond de moi ce syndrome de l’imposteur. Mon élection, en troi- sième année, comme Président du bureau des sports, a eu raison de mes derniers complexes, et je suis tombé dans l’extrême inverse : homme à femmes, peu respectueux, finissant ivre-mort à la fin de chaque soirée, oubliant le prénom de ma
- 12. dernière conquête avant même d’être reparti de chez elle le lendemain matin. Une période que je préfère oublier, car je n’en suis plus très fier au- jourd’hui. Les années passant, la fin de mon cursus étudiant approchait. Six mois avant que je n’obtienne mon diplôme, mon père m’annonce qu’il m’a trouvé un poste de consultant dans un cabinet de conseil à Nantes, pour la rentrée sui- vante. Je suis soufflé. Je vais bientôt avoir vingt-et- un ans, et mon père croit encore que j’ai besoin de lui pour gérer ma vie, alors que je viens d’enchaîner plusieurs stages que j’ai trouvés tout seul… Certes dans des univers qui déplaisent for- tement à mes parents : une salle de concert – com- prenez des rock-stars anarchistes en puissance – et un domaine viticole – comprenez des alcooliques en devenir. Je me mure dans un mutisme buté. Je passe l’été à faire la fête avec mes amis, je rentre sporadi- quement chez mes parents pour y abandonner mon linge sale et grignoter rapidement quelque chose, avant de repartir. Je termine l’été comme un zom- bie. Je passe aussi beaucoup de temps claquemuré dans ma chambre, sous la couette, les stores mi- clos, un livre à la main.
- 13. Cet été-là, je lis Un été dans l’ouest de Philippe Labro. Ça me donne envie, évidemment, cet ail- leurs, ce rite initiatique moderne, cet été passé à besogner dans un univers totalement exotique. Je suis passé à côté d’un séjour à l’étranger l’année précédente, je n’étais pas prêt. Le moment est venu. Et je ne veux pas faire le plaisir à mon père d’accepter ce poste, de rentrer dans les clous de son petit agenda étriqué. Je prends une décision radi- cale : je vais partir un an en Irlande en tant que barman, pour voir du pays, et surtout prendre mes distances avec mes parents et me donner le temps de réfléchir à la suite. Le 1er septembre 2000, me voilà dans l’avion pour Dublin. Mes parents ont été très clairs : c’est mon choix, c’est ma vie, mais dans ce cas, j’assume et je me débrouille. Je ne recevrai pas un sou de leur part durant cette année à venir. Ils seront là, en revanche, si j’ai besoin d’être rapatrié en cas de coup dur et si je veux finalement accepter ce poste de consultant. Dès mon arrivée, installé dans une auberge de jeunesse, je me construis un petit réseau de quartier, constitué de back packers – ces voyageurs qui se déplacent avec pour seul bagage, un sac-à- dos –, de commerçants, d’étudiants… et de tenan- ciers de pubs. Très vite, l’un d’entre eux me parle
- 14. d’un poste de barman qui se libère, dans un club after two niché comme beaucoup d’autres dans les caves de la ville. Ces établissements prennent le relais des pubs, contraints de fermer avant 2 heures du matin, et accueillent les derniers noceurs de fin de soirée. Je comprends que c’est une belle oppor- tunité de me dégager du temps en journée, et de travailler en décalé. Ma jeunesse et ma motivation m’aideront à tenir le rythme. Je trouve dans la foulée une chambre chez l’habitant dans le charmant quartier de Saint Ste- phen’s Green, juste en face de l’immense parc épo- nyme. Je prends l’habitude d’y flâner chaque jour avant d’aller travailler, observant les cygnes et les canards qui s’ébattent sur le lac et viennent qué- mander du pain auprès des passants. J’apprends à me planquer, comme le font les locaux, dès que le ciel se voile, pour laisser passer l’averse qui s’abat alors d’un coup durant quelques minutes intenses. Je suis émerveillé par la lumière à la fois vive et noire, irréelle, qui annonce le retour du soleil. J’ai envie de me mettre à la photo rien que pour im- mortaliser ces moments. Contre toute attente, j’adore ce climat. En fait, j’aime tout de l’Irlande. J’appréhendais des crises de mélancolie, loin des miens. Je ressens au contraire des bouffées de joie intense. J’ai l’impression de naître pour la seconde fois.
- 15. OLIVIA « Comme cul et chemise » : très liées ou complices, pour des personnes. Lorsque j’étais petite, je me souviens que chaque été, nous passions presque toutes les va- cances à la maison, parce que mes parents ne pou- vaient pas se permettre de fermer la boucherie très longtemps et qu’ils ne disposaient pas de pied-à- terre où que ce soit. Mes grands-parents étaient morts jeunes, je ne les avais même pas connus. Alors sans grands-parents, sans frères et sœurs, je m’ennuyais ferme à Chemillé. J’étais pourtant réveillée dès le lever du jour, tirée de mon sommeil par le chant des oiseaux, qui se relayaient ensuite jusqu’au soir sur les branches du tilleul situé juste devant la fenêtre de ma chambre. Après les cris aigus des petits moineaux du matin, celui des tourterelles prenait le relais,
- 16. pour battre la mesure de ces longs après-midis écrasants de chaleur, de leur lente mélopée. Je me souviens de m’être beaucoup, beau- coup ennuyée. Le reste de l’année non plus, mon quotidien n’avait rien de palpitant. Les sorties étaient rares, les amis comptés. Mes parents faisaient ce qu’ils pouvaient. J’étais au cœur de leurs préoccupations. Ils étaient juste très pris par leur commerce. Je me rends compte que j’étais vraiment très seule. J’ai regardé Téléchat pendant plusieurs années : je me souviens d’un chat et d’une autruche, présentant le journal télévisé et discutant avec divers objets ani- més… et je crois me rappeler d’un épisode durant lequel ils évoluaient dans une barque au milieu de nulle part. Mais j’ai peut-être tout inventé. Lorsque je regardais ce programme, je partageais le canapé avec mon grand frère imaginaire, qui m’expliquait cet univers absurde auquel je ne comprenais rien. Il s’appelait Marcel, parce que je me suis dit que c’était cohérent avec l’univers sémantique familial. Mon premier souvenir remonte à ce moment suspendu de l’année, ces quelques jours avant les grandes vacances, alors que les journées commen-
- 17. çaient à s’étirer en de belles soirées d’été. Cette année-là, je m’apprêtais à fêter mes cinq ans – peut- être six – avec mes parents. Ma mère avait préparé un superbe gâteau d’anniversaire. J’ai soufflé mes bougies, ravie. J’ai ouvert mes cadeaux : j’ai découvert émerveillée un Polly Pocket super chouette, des petits poneys, des livres, une mappemonde qui s’allume… Et puis, une enve- loppe, accrochée sur une boîte à chaussures. J’ai ouvert l’enveloppe : j’en ai sorti des billets avec la tête de mon idole imprimée dessus, Chantal Goya. Mes parents avaient acheté des billets pour que nous allions voir son spectacle à Paris-Bercy ! Et dans la boîte à chaussures, une paire de ballerines en cuir rose avec des petits talons. Le bonheur total. Je crois que j’ai dû les porter au moins trois mois d’affilée, après le concert évidemment, pour ne pas les abîmer avant le jour J. Je me souviens aussi avoir apporté une rose à Chantal Goya sur scène à la fin du concert, jouant des coudes au milieu des autres petites filles hystériques. C’est la première et la dernière fois que j’ai vraiment été fan d’une célébrité. C’est aussi la pre- mière fois que j’ai mis les pieds à Paris. J’ai surtout trouvé la ville angoissante, sale et peu accueillante. Je ne me suis pas tout à fait départie de cette pre- mière impression depuis.
- 18. Dès que j’ai été assez grande pour rester seule à la maison, vers onze ou douze ans, j’ai arrêté de traîner aux Trois Brasseurs des journées entières pendant l’été. Au programme : grasse matinée, brunch pantagruélique, bain de deux heures, lec- ture, balades, appels téléphoniques sans fin avec des copines qui me racontaient leurs vacances, les garçons trop mignons, les cousins super chiants ou au contraire trop sympas, les parents casse- bonbons… Moi, je n’avais pas grand-chose à racon- ter. J’étais livrée à moi-même. Heureusement qu’il y avait les livres, que j’ingurgitais par dizaines pendant ces périodes. Ma mère pestait régulièrement, parce que je lui de- mandais de retourner à la bibliothèque d’Angers pour en emprunter de nouveaux tous les trois jours. Parmi les livres les plus marquants de ces étés, je me souviens de Malevil de Robert Merle. J’étais suffisamment solitaire durant ces longues semaines pour m’imaginer faire partie de ces quelques rescapés d’une catastrophe nucléaire. J’organisais ma survie dans ma tête, je réfléchissais à qui je ferais confiance ou non parmi mes connais- sances. La liste n’était pas très longue. Durant mes balades, j’ai fini par aller de plus en plus loin. Et par croiser de temps en temps un garçon de mon âge, que je ne connaissais pas. Pas un gamin de notre petit village de la campagne
- 19. angevine, je l’aurais su. Un grand échalas, seul lui aussi, visiblement renfermé et pas vraiment ave- nant. Une fois, je lui ai adressé un pseudo-signe – assez discret il est vrai –, auquel il n’a pas répondu. Je n’ai pas recommencé. J’ai continué à le croiser, toujours du côté des grandes prairies à l’est du bourg. Et puis un jour, mes parents m’annoncent que nous sommes invités à dîner chez les Langlois. A la Trinité. Une vaste exploitation de vaches à viande, qui fournit la boutique de mes parents depuis toujours. Des viandes IGP Bœuf de Vendée et Bœuf du Maine, évidemment. Hors de question d’élever, de vendre ou de manger autre chose, chez nous comme chez eux, j’imagine. Je les ai croisés un nombre incalculable de fois à la boutique lors de leurs livraisons, puisqu’ils équarrissaient à l’époque leur viande eux-mêmes. À l’ancienne. Je n’avais jamais été chez eux jusque-là. Ils habitent pourtant à seulement quelques kilomètres de chez nous. Dès l’entrée, je suis hyper impressionnée par cette allée centenaire de peupliers qui entoure le chemin d’accès à la vaste maison de maître. Pay- sans oui, mais alors avec du style et de la classe. Les
- 20. locaux de l’exploitation agricole sont séparés de la maison par un petit bois sur la droite, composé de chênes, de hêtres et de saules pleureurs, devant lequel brillent les eaux d’une mare, où barbotent oies et canards. En s’approchant, on aperçoit quelques grenouilles plonger. Ce lieu est un véri- table coup de cœur pour moi ce jour-là. En contre- bas, on entend en arrière-plan les eaux de l’Hyrôme, qui poursuivent calmement leur chemin sinueux pour rejoindre la Loire. Quelle beauté, quelle harmonie ! Par rapport, la maison de mes parents ressemble à une masure. Même si je l’aime beaucoup, évidemment. Une maison d’enfance reste irremplaçable. Les prés environnants sont très bien entretenus. Les vaches paissent tranquille- ment, derrière les barrières en bois qui entourent la maison de toute part. L’odeur de ferme me plaît. Arrivée sur le perron de cette magnifique bâ- tisse en pierres blanches et au toit d’ardoise, je suis totalement désarçonnée quand la porte s’ouvre sur ce jeune homme, croisé pendant mes balades. Il l’est encore plus que moi et je trouve alors son comportement très puéril : quand il m’aperçoit, il se détourne et file à l’étage sans demander son reste. Nous échangeons des regards interloqués avec mes parents. La maîtresse de maison nous a entendus elle aussi et vient à notre rencontre. Quand elle voit nos mines, elle nous annonce tout de go : « Ah, vous avez dû croiser Constantin, notre
- 21. petit-fils. Le fils de Camille. Vous allez vous habi- tuer ! Il est un peu étrange, mais c’est un bon gar- çon. Il nous aide beaucoup à la ferme, quand il passe ses vacances avec nous ! ». C’était donc le petit-fils de Monsieur et Madame Langlois. Cons- tantin. Nous traversons le splendide salon, séparé de la salle à manger par un impressionnant escalier de pierres qui conduit vraisemblablement aux chambres, pour nous installer dehors, sur la ter- rasse à l’arrière de la maison. Nous profitons ainsi du paysage composé de prairies et de vignes, à perte de vue. Le soleil se couche derrière nous, à l’ouest, et se prête à un jeu d’ombres chinoises, faisant grandir les silhouettes mouvantes des vaches du troupeau des Langlois. L’apéritif passe, le dîner aussi. Nous profi- tons de la douceur de l’été. Constantin a été placé en face de moi, mais il ne me parle pas. Il ne parle pas du tout, en fait. Il me regarde quelques se- condes avec des yeux légèrement exorbités avant de se détourner à nouveau, sans oser visiblement aller plus loin. Il me met mal à l’aise. Une fois le repas terminé, Madame Langlois nous propose d’aller « jouer » dans la chambre de Constantin, pendant que les adultes parlent affaires à l’heure du café-cognac. J’envoie des signaux de détresse à mes parents, qui ne voient rien, trop absorbés par leur conversation animée. Je dois
- 22. avoir treize ans, je suis évidemment très vexée d’être traitée comme une enfant, mais je m’exécute de mauvaise grâce. Et là, deuxième choc en décou- vrant la chambre de Constantin, après avoir em- prunté le gigantesque escalier de pierres dans un silence gêné : son univers est fabuleux. Il a littéra- lement recouvert les murs et le plafond d’étoiles et de corps célestes qui brillent dans le noir. La pièce doit bien faire trois mètres de haut, c’est très beau. Il m’explique, avec un bégaiement très pro- noncé, et une voix cassée, en pleine mue, qu’il vou- drait être astronaute plus tard. Mais qu’il sait bien qu’il n’y arrivera pas. Alors il le fait pour de faux, à défaut de le réaliser pour de vrai. Je suis émue. Et je comprends pourquoi il avait tant de mal à m’adresser la parole. Assumer son bégaiement à treize ans, c’est impossible, je crois. Il me raconte sa vie au collège, à Nantes, ses camarades de classe, en particulier Nathan et Cora- lie, qui passent leur temps à se moquer de lui, à lui claquer la porte au nez, à l’enfermer dans les toi- lettes, à l’appeler Con-Con. Pourquoi me fait-il confiance ce soir-là ? En tout cas, ses confidences ne tombent pas dans l’oreille d’une sourde. Je dé- teste l’injustice. Je décide de devenir son amie et de parler du harcèlement dont il est victime à ses grands-parents avant qu’il ne reparte à la fin des vacances, pour trouver une solution. Pour l’aider.
- 23. En redescendant l’allée de leur propriété ce soir-là pour rentrer chez nous, alors que les cloches de l’église viennent de sonner onze fois, je découvre émerveillée une vision de Chemillé que je ne con- naissais pas. Malgré le sommeil qui me gagne, je lutte pour garder les yeux ouverts et contemple les quelques maisons encore allumées, qui brillent telles de frêles lucioles autour du solide clocher pointant vers les étoiles. Je me souviens très claire- ment m’être dit à ce moment précis, que ce jour serait certainement un jour important de ma vie. Dès la semaine suivante, je passe mes jour- nées avec Constantin. Nous aidons à la ferme le matin, mangeons un repas préparé par Madame Langlois le midi, qui me traite très vite comme sa propre petite-fille. L’après-midi, nous flânons dans les environs, en quête d’un cours d’eau pour se rafraîchir les pieds ou d’un arbre propice à la cons- truction d’une cabane. Nous sommes censés être trop vieux pour ce genre de loisirs, mais on s’en fiche. On passe des moments fabuleux ensemble. Je finis par prendre mon courage à deux mains et je profite que Constantin est parti acheter des œufs dans la ferme voisine pour expliquer ses problèmes à Madame Langlois. Au départ, elle ne comprend pas la gravité de la situation. Elle me dit qu’il faut que jeunesse se passe, qu’on a tous connu
- 24. ça à l’école, que ça forge le caractère. J’évoque le bégaiement de Constantin. Je lui demande s’il a toujours été comme ça. Elle me dit que non, que c’est venu quand ses parents se sont séparés, il y a trois ans. Elle se met à pleurer, touchée au cœur, presque coupable. Je lui donne des exemples précis de situations humiliantes que Constantin a subi de ses camarades. Elle me promet d’en parler à son fils. Dès le lendemain, Camille, le père de Cons- tantin, débarque. Il prend son fils à part. J’ai très peur que mon nouveau copain ne se sente trahi, de savoir que j’ai partagé ses confidences dans son dos. Ils reviennent tous deux la mine grave. Bras dessus, bras dessous. Le père de Constantin s’éloigne avec sa mère, après m’avoir gratifié d’une pression de la main sur l’épaule. Je me retrouve seule avec Constantin. Il me regarde, longuement. Il me prend dans ses bras. Il me souffle au creux de l’oreille : « Merci » et se met à sangloter. Quelques semaines plus tard, j’apprends que Constantin va venir habiter chez ses grands- parents pendant toute l’année scolaire à venir. Son père a pris la décision de l’éloigner de son collège et de l’inscrire dans un lieu où il aurait une alliée de poids : moi. Je suis aux anges.
- 25. Pendant les quatre années suivantes, nous ne nous sommes plus quittés et nous avons fait quasiment toutes nos premières expériences en- semble. Un an après son arrivée, son bégaiement avait totalement disparu. La Trinité est devenue ma seconde maison et ma seconde famille. Constantin est devenu mon frère de cœur. Jusqu’à ce que je parte à Lille faire mes études et que nos chemins se séparent.
- 26. SYLVESTRE « Une madeleine de Proust » : micro-évènement qui fait ressurgir des souvenirs de jeunesse, acte mi- neur porteur d'une forte charge émotionnelle. Chaque été de mon enfance, nous partions en famille dans la maison de mes grands-parents à Oléron, où je retrouvais tous mes cousins, oncles et tantes. Au total, nous étions une quinzaine à parta- ger notre mois d’août entre le marché, la plage et les grandes tablées dans le jardin ombragé par une tonnelle. Parmi cette vaste tribu, j’étais le plus jeune, avec Pénélope, d’un an mon aînée. La petite der- nière de la sœur de mon père. Elle était rousse, maigrelette, avec une voix particulièrement grave pour une fillette de son âge et de sa corpulence. Chaque été, elle amenait les cassettes des tubes les plus en vogue du moment. Nous les écoutions en boucle. Je me souviens qu’on était restés bloqués
- 27. sur la chanson de Bibie, qui me résonne encore dans la tête : « Tout simplement ». Mes frères nous avaient surpris en train de l’écouter un après-midi, planqués dans une grange de la propriété, et s’étaient copieusement foutus de ma gueule en me disant que c’étaient des chansons de gonzesses. Je l’avais déjà pressenti, mais j’ai pris conscience à ce moment précis qu’on était vraiment différents. Je m’en fichais, j’avais Pénélope, un mois par an. C’était mieux que rien. Et le reste de l’année, je réécoutais nos bandes-son de l’été quand j’avais des coups de blues. Il se trouve que Bibie et Pénélope avaient presque la même tessiture vocale et j’avais un peu l’impression de l’avoir auprès de moi lorsque j’écoutais la cassette qu’elle m’avait laissée à la fin des vacances. Quelques années plus tard, on avait fait une fixette sur les sketchs et les chansons paro- diques des Inconnus. Ils nous faisaient hurler de rire. Les plus grands nous regardaient une fois encore avec mépris. Je m’en fichais toujours, je passais de supers vacances. Une année, Pénélope est arrivée avec une énorme valise, remplie en bonne partie de gros livres, tous d’Anne Rice : les sorcières, les vampires, les géants… Elle a méthodiquement commencé son premier livre le premier jour des vacances, a lu au
- 28. moins six heures durant, a fait la même chose le deuxième jour, en est venu à bout après quelques jours, a enchaîné avec le second, et ainsi de suite. Je crois qu’elle a dû décrocher trois mots durant tout le séjour. Je suis revenu affreusement déçu et en colère à la fin de l’été, cette année-là. Je m’étais ennuyé comme jamais, tenu à l’écart par Pénélope, par nos aînés, par les adultes. J’avais l’impression qu’on m’avait volé mes va- cances. Au détour d’un dîner avec mes parents, j’ai compris ce qui s’était passé : mon oncle et ma tante s’étaient émus quelques semaines avant le départ en vacances du fait que leur fille ne lisait pas suffi- samment à leurs yeux : mais qu’est-ce qu’ils allaient faire d’elle, blablabla, la culture, c’est important, et l’imaginaire, l’imaginaire, tu en fais quoi…? Ni une, ni deux, Pénélope avait décidé de leur montrer qu’elle pouvait très bien lire, et même passer son temps à ne faire que ça. Ses parents avaient fini par la supplier d’arrêter de se couper du monde ainsi. Elle avait refermé le dernier livre en cours et n’avait plus retouché à aucun livre pendant plusieurs mois ensuite, avant de malgré tout s’avouer à elle-même que la modération avait parfois du bon. Mais pas toujours, d’après elle. Je l’avais retrouvée fidèle à elle-même l’année suivante et nos épopées avaient repris de plus belle.
- 29. Pénélope avait toujours des idées farfelues, qui ont pris de l’envergure avec l’âge. À l’adolescence, je me souviens que ça consistait à aller se baigner à poil au clair de lune, ou encore à ouvrir une bouteille de rosé en cachette et de la boire au goulot, planqués derrière le garage. Avec elle, j’ai découvert à quel point il était bon de trans- gresser les règles. Je me suis aussi pris mes plus belles roustes au retour de nos escapades. Les adultes et même nos frères et sœurs nous ont rapi- dement surnommés « Les inséparables ». Avant même d’avoir atteint l’âge de raison, Pénélope a développé une conscience écologique aigüe et m’a embarqué dans des combats par les- quels je ne me sentais pas vraiment concerné, mais c’était tellement excitant… Une fois, nous devions avoir une quinzaine d’années, nous nous sommes embarqués dans une opération commando. Nous avions appris qu’un cirque s’installait pour une semaine pas très loin de la maison. Vers une heure du matin, Pénélope est venue me réveil- ler dans mon lit, dans la chambre que je partageais avec mes deux frères. Elle m’a attiré jusqu’au jar- din, et m’a expliqué son plan, en chuchotant, une pince coupante à la main. Elle voulait aller dans le cirque libérer tous les animaux. J’ai réussi à lui faire entendre raison pour les lions et les tigres, ça me paraissait un peu dangereux quand même. Par
- 30. contre, elle n’a rien voulu savoir pour l’éléphant, les zèbres et les singes. J’avais une peur bleue de me faire pincer, et en même temps je ressentais une grande jubilation à faire un truc pareil. Quand j’y repense… Je ne vous dis pas le bazar les jours qui ont suivi ! On a fait la une des journaux locaux pendant le reste des vacances. Chaque animal a été retrouvé, au bout du compte. Personne n’a même imaginé nous soup- çonner. Plus c’est gros, plus ça passe. Encore main- tenant, je n’oserais pour rien au monde l’avouer à mes parents. Des étés comme celui-là, il y en a eu dix-sept, exactement. Et puis, alors que je venais d’avoir dix- huit ans, mon grand-père est mort brutalement. Ça a été un choc pour tout le monde. En fait, c’étaient lui et ma grand-mère, qui étaient les vrais insépa- rables. Après l’enterrement, ma grand-mère a rapi- dement dépéri. Elle est morte quelques mois après lui, à tout juste soixante-dix ans… La maison d’Oléron a été vendue. Je n’ai pas revu Pénélope, qui a arrêté ses études avant même d’avoir fini sa première année de médecine et est partie bourlinguer aux quatre coins du monde. Elle a rejoint Greenpeace. Elle m’envoie encore des cartes postales qui arrivent chez mes parents. La
- 31. dernière était postée de Jakarta, une histoire d’orangs-outans si j’ai bien tout suivi.
- 32. Vous avez envie de découvrir la suite ? Écrivez-moi à contact@blandinecain.fr : je vous donnerai accès à deux chapitres supplémentaires gratuitement !
