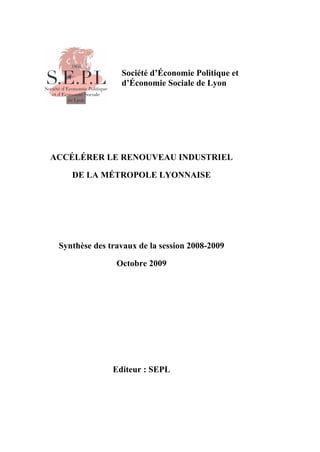
Synthèse des travaux SEPL 2008-2009
- 1. ACCÉLÉRER LE RENOUVEAU INDUSTRIEL DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE Synthèse des travaux de la session 2008-2009 Octobre 2009 Editeur : SEPL Société d’Économie Politique et d’Économie Sociale de Lyon
- 3. - 3 - SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE POLITIQUE ET D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LYON Sommaire 1 –Note de synthèse des travaux de l’année 2008-2009....... 5 2 – Comptes-rendus des conférences de l’année 2008-2009 21 Alain PERROY et Nicolas MILLET « Avenir des industries chimiques à Lyon dans le contexte des évolutions européennes et mondiales » ..... 23 Jean FLUCHÈRE et Michel SIMON « Prospective énergétique à l’horizon 2030 et perspectives pour la métropole lyonnaise » .............. 31 Bruno LACROIX « Avenir des industries métallurgiques dans la métropole lyonnaise » .............. 37 Philippe ARCHINARD et Nicolas LETERRIER « Bio et nanotechnologies- Des pôles d’excellence emblématiques de la région ? Une fertilisation croisée en Rhône-Alpes ? »....................... 43
- 4. - 4 - Yves BAYON de NOYER et Bernard GAUD « Enjeux et perspectives de l’industrie agroalimentaire française dans la compétition européenne et internationale. Les atouts de Rhône-Alpes et de Lyon Métropole. Quels développements ? » .................. 51 Hôte d’Honneur : Jean-Pierre RAFFARIN « Politique économique et attractivité des territoires »....... 59 3) Annexes ............................................................................... 105 Contacts : Robert PARIS, Président de la SEPL e.mail : paris_robert@yahoo.fr Bernard CONSTANTIN, Vice-Président de la SEPL e.mail : beconstantin@aol.com Marc BONNET, past Président de la SEPL e.mail : bonnet@iseor.com Renée JIMBERT, Secrétaire Générale de la SEPL e.mail : renee.jimbert@lcl.fr
- 5. - 5 - « Accélérer le renouveau industriel de la métropole lyonnaise dans un contexte de crise et de mondialisation » Avis et propositions de la Société d’Économie Politique et d’Économie Sociale de Lyon INTRODUCTION Dans le prolongement de ses travaux de l’année 2007-2008 sur le développement de la métropole de la Région Urbaine de Lyon1 , la SEPL a souhaité réfléchir en 2008-2009 à l’avenir de l’industrie dans notre métropole, qui a en effet fondé sa prospérité sur les activités industrielles2 en entraînant le développement des autres secteurs économiques. Une caractéristique importante de l’histoire de cette industrie est la fertilisation croisée entre secteurs industriels. Par exemple, le secteur pharmaceutique a été implanté à Lyon grâce à la soie et la mécanique s’est développée en grande partie au travers d’interactions avec le textile. Aujourd’hui, on constate une interaction entre la chimie, la pharmacie et les bio- technologies. Une autre caractéristique de la métropole lyonnaise a été la vitalité de ses réseaux commerciaux internationaux. L’hypothèse à la base de ces travaux est que nos activités industrielles, entendues au sens large, correspondent à la vocation 1. Voir SEPL (2008) « Construire Lyon-Métropole : Renforcer le travail en équipe entre Lyon et les agglomérations environnantes pour créer une métropole multi-polaire ». 168p. 2. Voir notamment Michel Laferrère (1963) « Lyon, ville industrielle ».
- 6. - 6 - de notre territoire et que leur développement est vital non seulement pour l’époque actuelle, mais aussi pour les jeunes générations. Ces dernières ne pourront pas trouver de réelles perspectives d’emploi sur notre territoire si notre industrie venait à décliner. Or, les processus de mondialisation actuels, accentués par la crise financière de 2008, menacent les fondements de notre prospérité. Il s’agit par conséquent de mobiliser tous nos atouts et de prendre en mains notre destin pour initier une nouvelle phase de développement durable de nos activités économiques. Cela nécessite de bâtir en équipe un véritable projet stratégique de notre métropole, avec une composante industrielle forte, tout en accentuant l’avance de notre industrie dans le domaine de la sécurité et du respect de l’environnement. Les travaux de la SEPL ont ainsi consisté à apporter un prolongement, une réflexion complémentaire, aux propositions présentées dans le « Livre blanc pour une nouvelle ambition industrielle dans la Région Urbaine de Lyon » publié par la CCI Lyon en mars 2009 sous la présidence de Guy Mathiolon. Cet ouvrage mettait l’accent sur la nécessité d’un travail en équipe pour sauvegarder et rénover les activités industrielles de la région. L’objectif de la SEPL n’était pas de reprendre le travail présenté dans ce document très clair et pertinent, mais d’insister sur les potentiels de la mise en réseau des acteurs impliqués par le développement industriel. 3 . Nos travaux ont ainsi consisté à réfléchir à un projet de méthode pour apporter une mise en œuvre effective et concrète de la proposition n°1 du livre blanc « Une nouvelle gouvernance territoriale », consistant à « travailler dans un nouvel espace regroupant plus de trois millions de personnes 3. CCI Lyon (2009) « Livre blanc pour une nouvelle ambition industrielle dans la Région Urbaine de Lyon. Les 20 propositions sont les suivantes : 1) une nouvelle gouvernance territoriale. 2) Choisir les spécialisations, professionnaliser l’animation et obtenir des financements publics sur 5 ans. 3) Créer un centre de prospective et d’innovation industrielle. 4) Passer du brevet défensif au brevet offensif. 5) Créer des centres de ressources en développement commercial. 6) Soutenir la mise en place de la première organisation commerciale. 7) Créer un lanceur d’entreprises à vocation mondiale. 8) Mettre en place une force commerciale du territoire. 10 Re-sourcer une partie des activités. 11) Faciliter les opérations de reprise. 12) Créer une place de marché pour els capitaux de proximité. 13) Créer un fonds de ré-industrialisation 14) Soutenir l’investissement industriel par des mesures fiscales adaptées. 15) Rendre cohérents DTA, SCOT et PLU. 16) Aménager et animer des parcs d’activité industriels modernes et attractifs. 17) Mailler les zones entre elles par des infrastructures performantes. 18) Développer l’inter-modalité. 19) Développer les connexions lointaines. 20) Lancer l’enquête industrie.
- 7. - 7 - dans l’agglomération lyonnaise élargie », et à « élaborer une gouvernance souple associant les acteurs économiques concernés pour définir un schéma de développement industriel ambitieux et novateur ». En effet, la mise en œuvre de cette proposition conditionne à notre avis la qualité de réalisation des 19 autres propositions. 1)IMPORTANCE DU SUJET La conviction de la SEPL pour le choix de notre sujet sur le renouveau industriel a été renforcée par de nombreux avis de personnalités extérieures à notre métropole. Nous pouvons en particulier citer Bruno Bonduelle4 , Président de la CCI de Lille métropole, et par ailleurs responsable d’une entreprise disposant d’un établissement industriel à Lyon. Il avait en effet déclaré à la SEPL, peu de temps avant la crise de mi 2008, que la cohésion des acteurs de Lyon et de sa région autour des enjeux de renouveau économique et de développement de l’emploi est loin d’être aussi forte dans notre région de Lyon que dans la région métropole lilloise : « Je pense que cela a été plus facile d’élaborer un projet pour nous à Lille que ça ne l’est pour vous à Lyon pour la bonne raison que c’est plus facile de rebondir quand on est au fond de la piscine. J’ai toujours considéré que vous étiez riches, prospères…. Il peut très bien vous arriver ce qui nous est arrivé dans les années 60 et je pense que vous devez vous convaincre que l’union entre vous, entre chefs d’entreprise, monde consulaire, milieu politique, est indispensable pour imaginer les solutions du vingt-et-unième siècle car nous abordons un monde dangereux qui sera tout à fait différent de celui que nous avons connu au vingtième siècle. » Les témoignages d’industriels entendus au cours des travaux de cette session 2008-2009 de la SEPL confirment cette nécessité de faire davantage équipe dans un contexte d’hyper-compétition pour 4. Voir le texte de la conférence du 24 janvier 2008 in SEPL, ibid, p. 67.
- 8. - 8 - les industries de notre métropole pour les raisons invoquées suivantes : - Les secteurs traditionnels de notre industrie (chimie, mécanique- métallurgie, etc.) subissent un effritement de notre compétitivité lié à un certain vieillissement de nos équipements et à un renouvellement insuffisamment rapide : une grande part de nos investissements sont davantage liés à des actions défensives et de renouvellement qu’à des projets d’innovation. - La plupart des secteurs industriels déplorent le développement de nombreuses pratiques de concurrence déloyale dans le domaine des conditions d’emploi et de respect de la propriété intellectuelle observables de la part de nos concurrents dans certains pays émergents. Certains rachats d’entreprise sont aussi perçus comme des chevaux de Troie, permettant d’accéder à bon compte à nos patrimoines technologiques. Face à ces phénomènes, ils constatent une difficulté de la France et de l’Europe à protéger notre patrimoine de savoir-faire dans le cadre des règles du commerce mondial. - Les organismes professionnels observent la taille insuffisante de nos PMI pour agir seules dans les stratégies d’innovation et d’internationalisation. En outre, de nombreuses PMI sont handicapées par des difficultés de management et de transmission, ce qui menace leur compétitivité, et la diffusion de méthodes innovantes de management est lente. - Des organismes d’études économiques s’inquiètent des risques systémiques liés au fait que de nombreuses activités de service de la métropole dépendent directement ou indirectement des activités industrielles (par exemple, un emploi dans la chimie en induit trois autres dans la métropole). L’effritement ou la diminution de nos activités industrielles se traduirait inéluctablement par une régression de l’emploi, sans que cela puisse être compensé par des créations équivalentes d’emplois publics, ni par des arrivées de populations à hauts revenus provenant de la région parisienne ou de régions riches de l’Europe. - Des banquiers constatent que la volatilité des capitaux internationaux en recherche de placement ne favorise pas des investissements importants dans la Région Urbaine de Lyon. En
- 9. - 9 - revanche, ces mouvements de capitaux peuvent s’orienter en priorité vers des pôles de développement industriels concurrents situés majoritairement en Asie et en Amérique du Nord. - Des responsables d’établissements d’enseignement supérieur disent ne pouvoir assister que passivement à la fuite des talents : les jeunes les plus brillants issus de la région et de nos meilleures écoles ou universités sont captés en premier lieu par les pôles de niveau mondial, puis par la région parisienne. Il ne reste à Lyon qu’une petite minorité de jeunes à « haut potentiel ». En outre, les entreprises de l’agglomération lyonnaise captent la plupart des talents de la métropole qui restent, au détriment des autres agglomérations, ce qui crée des processus pervers et préjudiciables à terme pour l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, il a été jugé nécessaire d’approfondir la réflexion relative à la cohésion des parties prenantes de notre territoire pour sauvegarder et rénover nos activités industrielles. Nous pensons en effet que la nécessité de bâtir un projet ambitieux n’est pas encore mûre à la fois dans l’esprit des acteurs économiques et dans celui des responsables politiques et des citoyens. Pour trouver des pistes de solutions, la SEPL a notamment fait intervenir des grands témoins dans cinq domaines-clés de l’industrie de notre métropole : la chimie, la mécanique-métal- lurgie, les industries de production d’énergie, les bio-technologies en lien avec les nano-technologies, et l’agroalimentaire. En marge de ces conférences, de nombreuses rencontres ont eu lieu, et des séances de travail et de créativité ont consisté à élaborer des propositions. Les paragraphes suivants proposent une synthèse des interrogations soulevées au cours des débats, ainsi que des pistes de solutions proposées. 2)INTERROGATIONS SUR L’AVENIR ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL DE LA MÉTROPOLE LYONNAISE Les exposés présentés lors des conférences de la Société d’Economie Politique et d’Economie Sociale de Lyon ont conduit à
- 10. - 10 - poser les questions suivantes que l’on peut regrouper autour des six thèmes : a)Manque de prise de conscience des menaces pour notre développement industriel durable - L’attractivité de notre métropole et l’emploi de ses habitants actuels et futurs ne se joue t’il pas actuellement sans que les différents acteurs en aient pris suffisamment conscience ? - Faut-il abandonner à leur sort les secteurs traditionnels comme la mécanique, la métallurgie, la chimie et le textile ; industries aujourd’hui menacées par la concurrence mondiale ? - Faut-il laisser à moyen terme se terminer l’aventure de notre chimie, avec des effets de chute de « dominos » si nous perdions un jour le vapo-crackeur de la raffinerie de Feyzin ? - Faut-il prendre acte du manque de taille critique de nos PMI par rapport aux entreprises allemandes en renonçant à leur faire jouer un rôle d’innovation technologique et de développement international ? - Faut-il renoncer à élaborer une stratégie ambitieuse sous prétexte que les centres de décision des grandes entreprises industrielles créées sur notre territoire migrent vers Paris, et de plus en plus vers l’étranger ? - A-t-on bien pris la mesure des risques d’espionnage industriel et de pillage de nos savoir-faire et mis en place des procédures de protection et des dispositifs permettant de travailler en confiance entre PMI, ainsi qu’entre PMI et grandes entreprises, même lorsqu’elles sont en partie concurrentes ? - Y a-t-il une prise de conscience par les acteurs politiques, de droite comme de gauche, de l’urgence à agir, ou bien cela relève t’il d’initiatives ponctuelles et locales, comme dans le cas du conseil de développement industriel du Sud-Est lyonnais tel qu’il a été expérimenté à Vénissieux ?
- 11. - 11 - - A l’heure où l’on s’inquiète pour la survie des nanotechnologies à Grenoble compte tenu de la montée en puissance de pôles identiques en Asie, peut-on se contenter de mettre tous nos espoirs dans les bio-technologies dans notre région urbaine de Lyon qui doit faire vivre plus de 3 millions d’habitants ? b)Insuffisance de mobilisation de nos atouts - Faut-il avoir honte de nos atouts dans le domaine de l’industrie de construction de centrales nucléaires civiles, où notre région est la seule au monde à disposer de tous les savoir-faire en matière de recherche, d’ingéniérie de construction et de sécurité dans un espace géographique restreint ? - Avons-nous conscience des atouts industriels de notre territoire dans le domaine de la diversité et de la fiabilité des productions d’énergie ? - Mettons-nous assez de conviction dans nos atouts pour le développement de l’agro-alimentaire, ou bien voulons-nous jouer dans de nombreux domaines en « deuxième division » en restant principalement des bons industriels régionaux ? - Avons-nous bien exploité toutes les possibilités de renouveau du textile et de l’habillement, comme dans l’exemple d’Hexcel, ou bien ce secteur est-il condamné à rétrécir comme peau de chagrin, malgré l’existence du pôle de compétitivité du textile « Techtera » ? - Pouvons nous davantage bénéficier des écoles et universités implantées sur notre territoire pour fertiliser nos industries, ou bien faut-il laisser partir à l’extérieur de notre région 80 % des étudiants les mieux formés sous prétexte que nos entreprises ne leur offrent pas des conditions assez attractives ? c)Insuffisance de coopération au sein des filières industrielles - L’action remarquable des branches professionnelles dans de nombreux domaines industriels et du BTP est elle suffisante pour développer notre compétitivité ou bien faut-il compléter leur action
- 12. - 12 - pour permettre une plus forte synergie, en particulier entre secteurs industriels ? - Faut-il mener des actions volontaristes pour que les industries de sous-traitance de capacité puissent diversifier leurs activités et allonger leurs chaînes de valeur pour accéder aussi aux clients finaux ? - Fait-on suffisamment équipe pour aider le développement commercial et international de nos PMI, ou bien les efforts sont-ils trop dispersés ? d)Nécessité de mettre davantage en synergie nos pôles de compétitivité 5 - Mettons-nous assez d’énergie pour faire de Lyon et de sa région une capitale européenne dans le domaine des bio-technologies, en lien avec les nano-technologies de Grenoble ? - Avons-nous suffisamment exploité les synergies entre les points forts et les pôles de compétitivité de notre territoire : au sein de chaque secteur industriel ou de chaque filière ? Entre secteurs industriels ? Entre les établissements de formation et de recherche et l’industrie ? Entre la métropole lyonnaise et les autres grandes agglomérations de la région Rhône-Alpes et des régions voisines (Grenoble-sillon alpin et métropole valdo-franco-genevoise), ainsi qu’au niveau national et européen ? - Faut-il coordonner les dispositifs de financement existants (Siparex ? etc) pour donner aux agglomérations de la métropole lyonnaise des moyens supplémentaires pour financer le renouveau industriel et pas seulement les créations de petites entreprises ou l’accompagnement des restructurations ? 5. Voir en particulier les travaux de « Grand Lyon, l’Esprit d’ Entreprise » qui propose une refonte de la plateforme stratégique en concentrant les efforts sur trois principaux secteurs : les sciences du vivant, les technologies propres et les secteurs émergents. Les moyens proposés pour atteindre ces objectifs consistent à accompagner la dynamique des pôles de compétitivité, continuer à développer l’Université de Lyon, confirmer notre politique en faveur de l’entrepreneuriat, amplifier le marketing territorial et approfondir notre connaissance de l’économie du territoire et de ses évolutions.
- 13. - 13 - e)Insuffisance de coopération entre agglomérations de la Région Urbaine de Lyon et de la Région Rhône-Alpes pour créer une synergie entre secteurs industriels - Peut-on imaginer un renouveau industriel multi-forme, fondé comme par le passé sur des fertilisations croisées entre nos industries et les services associés ? - Le caractère diversifié de nos industries et services dans les différentes agglomérations de la métropole est-il suffisant pour assurer un développement équilibré et durable de notre territoire, ou bien cette diversité est-elle un point faible si nous n’avons pas de « taille critique » dans de nombreux domaines ? Ne faut-il pas rechercher la taille critique en jouant en équipe d’agglomérations ? - Le développement de l’Agrapôle a-t-il besoin d’être relayé au niveau des diverses agglomérations de la métropole pour permettre une plus grande synergie de notre secteur agro-alimentaire encore trop émietté, ainsi qu’entre l’agroalimentaire, la mécanique pour les industries agroalimentaires et la logistique pour le transport des produits finis ? - Le niveau régional est-il suffisant pour tenter de stimuler la politique industrielle de Lyon et de sa région urbaine, ou faut-il un dispositif complémentaire au niveau de chaque agglomération de la métropole ? - L’agglomération lyonnaise peut-elle faire cavalier seul, en utilisant des dispositifs de concertation tels que « Grand Lyon Esprit d’Entreprendre », ou bien faut-il faire équipe avec les agglomérations voisines au sein de la RUL et de la région pour faire jouer les synergies avec une taille permettant le maintien dans notre territoire de services à haute valeur ajoutée pour l’industrie ? A toutes ces interrogations, la SEPL répond par une autre question, celle de la qualité du travail en réseau au sein de notre métropole :
- 14. - 14 - « Le rythme actuel d’apprentissage du travail en équipe et réseau au sein de notre métropole est-il vraiment suffisant compte tenu de l’accélération des processus de compétition au plan mondial ? » En réponse à cette question, notre conviction se différencie de l’idée communément admise d’une compétitivité obtenue sans une forte mobilisation de tous. L’idée d’une compétitivité industrielle durable en se contentant des pôles de compétitivité de notre métropole était sans doute pertinente jusqu’à maintenant et elle a permis des avancées, mais elle doit maintenant être complétée par un projet plus global sur notre territoire. En effet, les opinions les plus répandues ou telles que nous les avons perçues peuvent être résumées par le scénario A suivant, auquel la SEPL réplique par la proposition du scénario B : -Scénario A : Les agglomérations de la métropole lyonnaise ne doivent pas trop se soucier de leur prospérité économique malgré la crise et le renforcement de la compétition mondiale, grâce à la diversité des industries et à un développement des activités de services ou de tourisme. Au pire, l’agglomération lyonnaise tirera son épingle du jeu en concentrant les activités à forte valeur ajoutée et les nouvelles implantations d’entreprises, grâce à sa situation géographique privilégiée, à un statut de capitale régionale, et à l’existence de pôles de compétitivité jugés de classe mondiale ou nationale. Les financements devraient être concentrés sur quelques pôles de compétitivité et non saupoudrés pour faire plaisir à tous les secteurs, car l’Etat n’a pas les moyens de disperser ses efforts financiers. Le Nord-Isère bénéficiera de sa position géographique pour les activités liées à la logistique tandis que les autres agglomérations de la métropole, comme Saint-Etienne, Bourg en Bresse, Roanne ou Vienne auront un simple rôle de satellite ou de complément à l’agglomération lyonnaise et abandonneront une grande partie de leur industrie, leurs habitants survivant grâce à des transferts sociaux et à des activités à faible valeur ajoutée. Le rôle des responsables administratifs et politiques devrait rester davantage centré sur le bien être des habitants, la culture et la gestion des grands
- 15. - 15 - équipements en essayant de faire au mieux dans un contexte de raréfaction de l’argent public. Le monde politique et le monde économique peuvent continuer à élaborer des projets en grande partie spécifiques en s’occupant chacun de domaines différents. La SEPL récuse ainsi ce consensus mou, certes confortable pour les retraités, pour les détenteurs d’emplois protégés et même pour de nombreux électeurs, mais dangereux pour les salariés actuels, voire catastrophique pour l’emploi et les conditions de vie des générations montantes et pour le développement durable de notre métropole. Il s’agit en effet de prendre davantage conscience des menaces et opportunités de notre territoire à un moment de crise qui accélère les transformations économiques dans le monde et exige une stratégie ambitieuse. - Scénario B (proposé par la SEPL) : L’hypothèse est que notre territoire de la Région Urbaine de Lyon, en lien avec les autres territoires de Rhône-Alpes, a potentiellement toutes les ressources disponibles, grâce à ses complémentarités, pour construire et mettre en œuvre un projet ambitieux de grande métropole économique et industrielle. Il ne manque pour réussir qu’une volonté et une vision partagée par tous. La réussite de cette ambition nécessite un travail d’équipe de tous les acteurs de la métropole, avec un niveau de consensus entre acteurs qui devrait être comparable à la cohésion observée par exemple à Barcelone, à Manchester ou à Singapour, ce qui est encore très loin d’être le cas. Face à ces menaces, la SEPL affirme le besoin de renforcer les pôles de compétitivité existants, en particulier celui des bio-technologies de Lyon en lien avec celui des nanotechnologies de Grenoble, mais elle juge que cela ne suffira pas pour notre survie. Notre région a en effet la possibilité de tirer ensemble tous les secteurs pour les rénover en les rendant davantage complémentaires et parvenir ainsi à une compétitivité durable de niveau européen et mondial de notre région urbaine.
- 16. - 16 - Les pôles de compétitivité actuels constituent un des éléments de réponse, mais leurs impacts sont encore trop limités à quelques secteurs et ils sont encore insuffisamment matures pour favoriser une coopération de l’ensemble des parties prenantes dans la confiance, avec des règles du jeu bien acceptées par tous. Les dispositifs doivent par conséquent être amplifiés et complétés pour surmonter les défis actuels de la compétition industrielle mondiale, accentuée par la crise. La proposition de la SEPL ne consiste pas à choisir entre tel ou tel pôle de compétitivité, mais à faire en sorte que notre territoire devienne lui-même un pôle de compétitivité globale et durable grâce à une fertilisation croisée6 et à la qualité des coopérations de ses acteurs politiques, économiques et de recherche et enseignement travaillant en équipe et en réseau dans la confiance. Bâtir un projet en réseau est ainsi jugé par la SEPL comme urgent et vital compte tenu des enjeux pour notre territoire, pour la sauvegarde des emplois actuels et pour la prospérité future. Cela suppose non seulement de prendre conscience des menaces pour provoquer un sursaut, mais de bâtir un projet volontariste pour renforcer les coopérations de toutes natures : partenariats public- privé, développement de l’alternance dans les établissements d’enseignement et de recherche, pilotage de projets par filières, etc. 3)NECESSITE D’UN PROJET GLOBAL POUR PASSER À UNE VITESSE SUPÉRIEURE La SEPL engage les responsables politiques, économiques et du monde de la recherche à passer à une vitesse supérieure pour les actions de renouveau de notre tissu industriel, au moyen de méthodes plus interventionnistes de management et de gouvernance de notre territoire aujourd’hui menacé. Elle souhaite que des méthodes de projets territoriaux soient mises en 6. La fertilisation croisée consiste à créer un apprentissage collectif en réseau pour stimuler l’innovation. Voir notamment les travaux du Center for Governance and Leadership, Civil Service College, Singapour. (par exemple Gwee J ; (2009)”Innovation and the creative industries cluster” in Innovation, Management, Policy and Practice, Vol 11 issue 2.
- 17. - 17 - œuvre pour réfléchir à la prospective territoriale7 de notre métropole La SEPL propose de bâtir un projet au niveau métropolitain (territoire de la Région Urbaine de Lyon), dans l’esprit d’autres expériences métropolitaines telles que la Cité des Echanges de la métropole lilloise, ou encore la démarche de projet de Manchester. Parmi les méthodologies envisageables, il est possible de citer celle qui a été créée à Lyon par le Professeur Savall et qui a été présentée lors de sa conférence à la SEPL du 28 avril 20088 : Elle s’appuie sur le concept de « potentiel caché » facilement mobilisable au travers d’un investissement minimal dans le cadre d’un groupe de projet socio-économique9 . La mise en place d’un groupe de projet chargé de préparer un plan stratégique de la métropole fait travailler en synergie les acteurs politiques et économiques des diverses agglomérations de la métropole. Le groupe de projet comprend trois instances : 1)Le groupe de pilotage : il comprend les acteurs politiques et économiques de chacune des agglomérations de la métropole (Bourg en Bresse, Grand Lyon, Nord-Isère, Roanne, Saint-Etienne, Villefranche sur Saône, Vienne), ainsi que les représentants de l’Etat de la Région Rhône- Alpes. Le groupe de pilotage fait la synthèse des travaux des groupes de travail par agglomération et par domaine économique et industriel sur la base des scénarios proposés ainsi que des balances économiques (coûts et performances visibles et cachés de chaque scénario de projet). Le groupe de pilotage est présidé en premier lieu par un tandem Président du Grand Lyon- Président de la CCI de Lyon, 7. Voir par exemple la conférence de Vincent Pacini à la SEPL le 15 octobre 2007 sur « La prospective territoriale, de l’impertinence à la pertinence : exemple de Lyon et de sa région ». 8. SEPL « Constuire Lyon-Métropole », op.cit, voir en particulier le schéma p. 97. 9. Voir les travaux de l’ISEOR sur le management socio-économique des territoires. Voir également la méthode de projet présentée in Savall H. et Zardet V. « Maîtriser les coûts et performances cachés ». Economica 1987-2005 (également publié aux Etats-Unis sous le titre Mastering Hidden Costs and Performance, IAP, 2007), ainsi que Savall, H., Zardet, V. et Bonnet, M. (2000-2008) « Libérer les performances cachés par un management socio-économique ». Iseor et Bit, Genève. (Traductions en anglais et espagnol).
- 18. - 18 - puis par une présidence tournante avec des tandems de présidents d’agglomération. 2)Des groupes de travail par agglomération : L’objectif est de compléter le travail des conseils de développement en y ajoutant un volet industriel qui est actuellement très insuffisant. Ils explicitent notamment les domaines dans lesquels chacune des agglomérations propose à la métropole de jouer un rôle de pilote. 3)Des groupes de travail innovateurs par domaine industriel : chimie, pharmacie, mécanique-métallurgie, équipements électriques et électroniques, filières indus- trielles de l’énergie, textile-habillement, agroalimentaire, logistique, etc. Ces groupes de travail qui font participer les professions partent de l’évaluation des actions en cours, en particulier en ce qui concerne les clusters. Ils recensent aussi les dysfonctionnements observés et les opportunités non saisies qui appellent des actions. Il s’agit aussi de procéder à un bilan des actions déjà réalisées (par exemple avec ERAI, l’ADERLY et les autres agences de développement) et de faire des propositions pour faciliter la mise en synergie des différents secteurs industriels entre eux, en particulier en matière de développement com- mercial, de protection industrielle, d’ingéniérie financière, et de cohérence territoriale, etc. Ainsi constitué, le groupe de projet recense toutes les actions au cours de séances bimestrielles planifiées sur un an et propose une mise en forme cohérente en formalisant des axes tels que les suivants : a) Plan d’actions à mener au sein des secteurs industriels des diverses agglomérations de la métropole eux-mêmes, dans le but d’allonger les chaînes de valeur et de ne pas se limiter par exemple à des activités de sous-traitance, b) Plan d’actions à mettre en œuvre entre les secteurs industriels de la métropole, pour régénérer des secteurs industriels menacés au moyen de fertilisations croisées,
- 19. - 19 - c) Plan d’actions à réaliser entre les acteurs industriels de la métropole et les autres acteurs économiques, politiques et sociaux de la métropole, afin de favoriser l’innovation et l’internationalisation en équipe, d) Plan d’actions à entreprendre entre les secteurs industriels de la métropole et leurs secteurs correspondants dans les autres métropoles voisines, en particulier au niveau régional, national et européen, afin de favoriser une véritable compétitivité au niveau mondial. Le groupe de projet prépare une balance socio-économique10 consistant à calculer les coûts et performances visibles et cachés de ce projet de renouveau industriel. A titre d’exemple, un projet de ce type, comprenant principalement du temps passé par les acteurs du projet, s’élèverait à un montant très faible (quelques millions d’Euros) en regard des investissements d’infrastructure déjà programmés pour renforcer l’attractivité du territoire, et il suffirait qu’il permette la création ou le maintien de cent emplois sur le territoire pour être rentabilisé, en plus des effets qualitatifs positifs à court terme et à long terme pour notre métropole. Le pronostic est qu’un projet de ce type peut contribuer à créer à un horizon de 3 à 5 ans 40 fois à 100 fois plus de valeur ajoutée que le coût du projet. Il ne s’agit pas ici de critiquer les investissements matériels réalisés dans la métropole, mais d’insister sur la nécessité de compléter ces investissements matériels par des investissements immatériels nécessaires à la cohésion des acteurs autour de stratégies de survie et de développement économique. Le plan d’action stratégique ainsi conçu a aussi pour résultat d’éclairer les pouvoirs publics (Etat, Région, collectivités territoriales et chambres consulaires), en particulier pour éviter que leurs interventions soient concentrées exclusivement sur un nombre très limité de grands pôles de compétitivité mais aussi pour favoriser tous les secteurs ainsi que le travail en équipe et les synergies de toutes natures. Le plan d’action proposé par le groupe 10. Les recherches réalisées par l’ISEOR, Université Lyon 3, démontrent la très haute rentabilité de l’investissement immatériel en potentiel humain lorsque l’on bâtit un projet qui renforce la qualité du travail en équipe pour améliorer le management des organisations et des territoires. Des résultats réalisés sur une centaine d’expérimentations montrent que la rentabilité de ces projets varie entre 300 % et 4000 % selon les projets réalisés.
- 20. - 20 - de projet peut aussi inciter les pouvoirs publics à s'orienter prioritairement vers l'émergence de nouveaux pôles d'excellence à partir de compétences éclatées sur l'espace métropolitain et donc peu visibles mais dont la mise en synergie organisée à l'échelle métropolitaine pourrait conduire à la constitution de pôles industriels forts. La démarche engagée par le secteur de l'agro- alimentaire est de ce point de vue exemplaire; d'autres exemples sont à rechercher (le froid, l'armement, etc.) CONCLUSION Au travers de ses travaux de la session 2008-2009, la Société d’Economie Politique et d’Economie Sociale de Lyon a bien entendu découvert des sujets d’inquiétude pour le développement économique et social durable de notre métropole lyonnaise. Elle met cependant l’accent sur un message d’espoir et propose que notre territoire devienne un pôle intégral de compétitivité favorisant tous les secteurs économiques et industriels dans leur diversité en tant qu’infrastructure des pôles de compétitivité spécialisés. Les données recensées montrent que notre métropole a en mains tous les ingrédients nécessaires à la réussite. La seule condition de succès est de mobiliser les acteurs économiques, politiques et de la recherche au travers d’un groupe de projet où l’agglomération lyonnaise ferait équipe avec les autres agglomérations de la métropole (Région Urbaine de Lyon), en concertation avec la Région Rhône-Alpes et les services de l’Etat. L’enjeu de ce projet est immense à la fois pour la génération des hommes et des femmes actuellement sur le marché du travail dans notre métropole, et pour les jeunes générations qui devront trouver un emploi dans les années à venir sur notre territoire. La SEPL aura l’occasion de débattre sur ce sujet au cours de l’année 2009-2010 et inscrira ses travaux dans le prolongement de ce thème en examinant plus précisément les conditions du renforcement de la coopération entre enseignement-recherche et industrie dans la région urbaine de Lyon.
- 21. Comptes-rendus des conférences de l’année 2008-2009
- 23. - 23 - Conférence 21octobre 2008 « Avenir des industries chimiques à Lyon dans le contexte des évolutions européennes et mondiales » M Alain PERROY, Directeur Général du CEFIC M. Nicolas MILLET, CCI Lyon Après un rappel par Marc BONNET du thème de l’année 08-09 contré sur l’avenir de l’industrie dans la métropole de la région urbaine lyonnaise, M. Robert PARIS présente les deux confé- renciers de ce jour, qui vont nous apporter des points de vue contrastés et complémentaires entre le niveau local et le niveau global: M. Alain PERROY est Directeur Général du CEFIC. Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et du Corps des Mines et a dirigé la DRIRE d’Ile de France. Il avait ensuite rejoint le Groupe Rhône- Poulenc en tant que responsable mondial de la qualité, sécurité et environnement. Il est maintenant Directeur Général du CEFIC, le Conseil Européen des Fédérations des Industries Chimiques. M. Nicolas MILLET est directeur des stratégies territoriales à la CCI de Lyon, après avoir dirigé des services d’aménagement territorial en Franche-Comté, en Bourgogne et à la Région Rhône-Alpes. Il est diplômé de l’EHESS où il a obtenu un Doctorat et il a réalisé une recherche sur la chimie de la métropole lyonnaise dans le cadre de la préparation du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Lyon. Les principaux représentants de la chimie lyonnaise ont été invités et participent au débat de ce soir. 1)Exposé de M. Alain PERROY La chimie européenne est encore la première du monde, avec un tiers de la production mondiale, même si l’Asie va nous dépasser. La balance commerciale de la chimie européenne est positive à hauteur de 40 milliards d’euros. C’est une chimie très intégrée et diversifiée. Elle utilise du personnel hautement qualifié et très rémunéré. Elle est un pilier de l’économie européenne et la
- 24. - 24 - structure du secteur ne se limite pas aux grands groupes puisqu’il y a 30.000 entreprises de chimie en Europe. L’analyse stratégique de la situation fait ressortir des sujets d’inquiétude malgré les points forts de notre intégration et de notre internationalisation : • les rythmes de croissance sont inférieurs à ceux de l’Asie • l’indice de compétitivité se détériore depuis 2000 • l’accès à l’énergie est plus coûteux que dans d’autres régions du monde, notamment le Moyen- Orient • l’environnement réglementaire est plus contraignant qu’ailleurs, alors que nous sommes sur des marchés internationaux • l’aversion aux risques est forte en Europe, les innovations y sont davantage perçues comme des risques que comme des opportunités et les distributeurs demandant des produits « verts » et non toxiques Face à ces contraintes, il nous faut être très sensibles à la demande sociétale au moyen des actions suivantes : • être transparents en s’améliorant sur la santé, la sécurité et l’environnement • être exemplaires pour rétablir la confiance « Reach », par exemple, nous oblige à passer en revue toutes les substances et à avoir des dossiers irréprochables • montrer les bienfaits de la chimie européenne pour le climat, l’énergie, la santé, le patrimoine artistique : on ne sait pas assez communiquer • intégrer la dimension des émissions de CO2 (depuis les accords de Kyoto, la chimie européenne a amélioré de 30 % son efficacité CO2 ), et l’industrie chimique permet d’économiser l’énergie grâce à ses applications
- 25. - 25 - • défendre le respect des règles du commerce mondial, en particulier en ce qui concerne les pratiques du dumping et le non respect de la propriété intellectuelle • investir dans l’innovation, en particulier dans le domaine de la chimie durable 2)EXPOSE de Nicolas MILLET Nicolas MILLET fait part d’une analyse réalisée sur la « vallée de la chimie » lyonnaise par la CCI de Lyon pour le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Lyon. Cet espace de « centralité économique » a pour caractéristiques de regrouper 6.100 emplois à haute valeur ajoutée et elle est la clé de voûte de plusieurs autres industries de la métropole : plasturgie, pharmacie, textile, agro- alimentaire, papeterie, etc …. Il faut noter qu’un emploi direct dans la chimie en génère 3 autres au niveau local. On y observe un ensemble de points forts qui favorisent les synergies : - une concentration de centres de recherche avec l’Institut Français du Pétrole et quatre autres centres de recherche privés - une concentration de moyens de transports : autoroute, hub ferroviaire, port de containers - la stimulation des liens entre industrie et recherche favorisée par le pôle de compétitivité Axelera. - la présence d’un vapo-cracker à la raffinerie de Feyzin qui permet de fournir des molécules aux entreprises chimiques de spécialités - une variété d’entreprises de chimie : parfums, cosmétique, caoutchouc, plastique, produits pharmaceutiques, etc… - un lien avec les industries de « recyclabilité » et avec les autres pôles chimiques de la région - un haut niveau de compétences dans le domaine des technologies de prévention, des risques naturels, industriels et logistiques - une énergie compétitive, y compris au niveau de l’énergie électrique.
- 26. - 26 - Il existe cependant plusieurs faiblesses au niveau de l’industrie chimique de la région métropolitaine lyonnaise : - la visibilité internationale reste faible et il y a peu de manifestations économiques de la chimie organisées à Lyon - un vieillissement de certaines installations et une raréfaction des investissements, ainsi qu’une innovation insuffisante - une forte dispersion du capital dans un contexte où les centres de décision sont extérieurs à Lyon - l’accessibilité reste à améliorer et il y a une vulnérabilité en cas du blocage du Port de Marseille - l’attachement des lyonnais à leur industrie chimique est insuffisante, sauf de la part des communes de la vallée de la chimie. L’analyse des menaces fait ressortir plusieurs évolutions : - au plan financier, on observe une stagnation des investissements en recherche et développement, une baisse de la productivité par rapport à la concurrence, un endettement croissant et un centrage trop important sur les investissements défensifs, comme dans le cas de la mise aux normes « Reach » par rapport aux investissements de conquête. - au plan de positionnement concurrentiel, on constate une montée en puissance de la chimie de l’Inde, une érosion des chaînes de valeurs en amont. Il y a, en outre, une vulnérabilité liée à l’interdépendance des acteurs de la chimie dans la vallée du Rhône et un risque de marginalisation par rapport aux autres candidats. Malgré ces menaces, plusieurs opportunités apparaissent : - des compétences reconnues, en particulier pour la catalyse, les recherches avancées pour le traitement de la matière, les procédés, ainsi que pour la gestion de la sécurité des installations et des transports
- 27. - 27 - - on recense certaines actions d’innovation qui vont dans le sens d’un allongement de la chaîne de valeur - potentiellement les innovations peuvent être générées par la proximité avec les pôles d’excellence des bio-technologies, nano-technologies et du CERN de Genève - des investisseurs s’intéressent à notre territoire. A partir de cette analyse stratégique, plusieurs scénarii peuvent se dessiner : - une absence de volonté stratégique conduisant à un effritement de la compétitivité et à une vallée sans chimie à un terme plus ou moins éloigné - un redéploiement vers la chimie fine - une mise en réseau des principaux acteurs pour stimuler la mutation vers la « molécule vallée ». Une stratégie à étudier pourrait notamment consister à stimuler les actions suivantes : - rechercher les molécules à forts enjeux (« champions du monde ») en lien avec Axelera et en profitant des compétences existantes sur les procédés et sur les réacteurs (chaudronnerie) - développer des molécules non seulement sur la base de la pétrochimie, mais aussi de la bio-chimie végétale et animale - renforcer la stratégie de chimie verte et durable : éco- conception, recyclage en fin de vie, bio-masse, captage de CO2 etc…. 3)Débat avec les participants animé par Robert PARIS - même si les investissements en pétro-chimie se font maintenant dans les pays produc- teurs de pétrole et en bord de mer, il ne faut pas céder au fatalisme du vieillissement de nos équipements. Il faut, en effet, se centrer sur nos installations les plus performantes et accepter des mutations ou des recentrages, en évitant de démolir le « château de
- 28. - 28 - cartes » de notre industrie chimique. Cela suppose de maintenir à niveau et d’améliorer nos infrastructures de transport. En ce qui concerne Lyon, il faut que les financements européens améliorent l’interconnexion entre Lyon et le Rhin, en plaidant pour la liaison Saône-Moselle. - les réglementations « Reach » ne doivent pas être perçues seulement comme une menace, mais aussi comme une opportunité. Nous avons l’obligation incontournable de démontrer l’innocuité des produits chimiques. Nous avons tout à gagner à avoir de l’avance en ce domaine sur les chinois et sur les américains, alors que la mise aux normes va coûter l’équivalent de seulement 0,1 % de notre chiffre d’affaires sur 10 ans. En outre, les importateurs de produits chimiques vers l’U.E. devront à terme respecter « Reach », même s’il faut bien mettre en place les instruments de contrôle avec une Police et des Douanes formées pour le faire, afin d’éviter que l’Europe soit une passoire. - Actuellement, l’industrie chimique européenne fait davantage d’investissements de maintenance que d’inves- tissements stratégiques. Les industriels européens inves- tissent aussi dans les pays émergents, car c’est là qu’ils y trouvent le plus de clients. Toutefois, les évolutions de l’industrie se font à un rythme lent : • on conservera une base pétro-chimique pendant de nombreuses années • les bio-matériaux ont encore un potentiel limité à court terme, y compris pour des raisons scientifiques • la chimie végétale risque d’être entravée par la politique agricole commune, car les approvision- nements en produits agricoles sont plus coûteux que dans le reste du monde - il n’y a pas que l’innovation produits à prendre en compte, mais aussi l’innovation procédés, y compris au niveau des
- 29. - 29 - PMI et des start-ups. Ces innovations permettent de rendre les procédés plus efficaces et moins dangereux et elles sont en partie finançables par des aides de l’U.E. Il faut aussi prendre conscience de la place de la chimie des molécules dans le futur, par exemple pour l’informatique et de nombreuses industries de pointe - Lyon a des cartes à jouer dans l’évolution européenne et mondiale : • jouer sur l’acceptabilité de l’industrie chimique à Lyon, compte tenu de la compétence remarquable dans les métiers de la maîtrise des risques • les PME sont une force considérable d’innovation, en lien avec les grands groupes • à Lyon, on peut devenir compétitifs à long terme dans notre chimie si l’on sait croiser les compé- tences entre nos diverses industries et si on a une politique volontariste d’innovation, en retenant nos ingénieurs et en formant les techniciens. Il faut en particulier organiser la synergie entre la chimie, le bio-pôle et le cancéropôle.
- 31. - 31 - Conférence du 9 décembre 2008 « Prospective énergétique à l’horizon 2030 et perspectives pour la métropole lyonnaise » M. Jean FLUCHERE (ancien Délégué Régional EDF) M. Michel SIMON (ancien Délégué Régional FRAMATOME Marc BONNET rappelle le positionnement de cette séance dans le cadre du thème de l’année sur le développement industriel de la métropole de Lyon-Région. L’énergie est un sujet incontournable dans le domaine industriel parce que les industries ont besoin d’énergie avec une sécurité d’approvisionnement. Notre région dispose potentiellement d’un pôle mondial de compétitivité dans le domaine de l’énergie nucléaire, avec plus de 100 000 emplois qui en dépendent. Robert PARIS rappelle que le thème de cette conférence s’inscrit dans le prolongement des travaux réalisés par le Conseil Economique et Social Rhône-Alpes. Le thème de la soirée rejoint aussi les préoccupations de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes, où Jean-Paul MAUDUY plaide pour une énergie abondante, nécessaire au développement des PMI de notre région. Il présente ensuite les deux conférenciers, tous deux des spécialistes reconnus dans le domaine de l’énergie : Michel SIMON a rejoint le groupe Framatome (AREVA) à la suite d’une expérience de chercheur en physique des plasmas. Après avoir occupé plusieurs fonctions à l’étranger (Allemagne et USA), il a été Délégué Régional de Framatome au moment de la conception du réacteur EPR. Il a également une expérience de Maire, de membre du CESR Rhône-Alpes et travaille dans des commissions de l’ADEME. Jean FLUCHERE, diplômé de plusieurs écoles d’ingénieurs dans le domaine de l’électricité (SUPELEC) et du génie atomique, a également acquis une grande expérience de l’énergie à EDF, et il a notamment dirigé la Centrale Atomique du Bugey. Il travaille
- 32. - 32 - actuellement sur le thème de la compatibilité entre la prospective énergétique et les directives du « Grenelle de l’environnement ». Michel SIMON présente un premier exposé sur le défi de l’approvisionnement en énergie dans le monde à l’horizon de 2030- 2050. Il s’appuie sur l’ensemble des sources disponibles en matière de prévision et de prospective et dresse un panorama extrêmement préoccupant : - la production d’énergie va continuer à croître dans les décennies qui viennent, avec un doublement probable des besoins dans le monde à l’horizon de 2050. Cela est dû à la fois à l’augmentation de la population, qui sera proche de 10 milliards d’habitants, et à l’augmentation de la consommation d’énergie par habitant dans les pays émergents. La moyenne de consommation d’énergie par habitant et par an est de 1,7 tonne d’équivalent pétrole (TEP), ce qui masque de fortes disparités entre les USA (8 TEP), la France (4,5 TEP) et certains pays d’Afrique (0,1 TEP). Une augmentation, même faible, de TEP/an/habitant a donc un effet de levier sur les besoins en énergie en raison du poids démographique des pays émergents. Un scénario probable est que la moitié de la consommation de l’énergie mondiale en 2050 soit faite en Inde et en Chine. Dans ce contexte, les économies d’énergie réalisées dans les pays développés sont certes importantes pour éviter une explosion des besoins, mais cela aura un impact limité au niveau de la consommation mondiale d’énergie. - la production d’énergie est actuellement dépendante à 85 % des combustibles carbonés D’ici 2030-2050, nous devrons limiter le recours au pétrole et au gaz pour la production d’énergie car les ressources vont progressivement s’épuiser (on s’approche de l’« oil peak ») et parce que l’accumulation d’une forte proportion des réserves mondiales au Moyen-Orient crée un risque pour les approvisionnements. Le gaz a l’inconvénient d’avoir un mauvais rendement énergétique, notamment en raison des fuites et des besoins en énergie pour le compresser. Un chiffre donne le vertige : l’humanité consomme chaque année en hydrocarbures ce que la terre a mis un million d’années à produire. Le charbon est plus abondant, notamment en Chine, mais son utilisation a davantage d’inconvénients que les hydrocarbures en raison de son impact sur les rejets de CO2 à un moment où le réchauffement de la planète peut prendre des dimensions catastrophiques. Une option raisonnable devrait être de réserver les précieuses molécules
- 33. - 33 - d’hydrocarbure pour la chimie et non de les gaspiller pour les transports et le chauffage, pour lesquelles d’autres technologies sont disponibles. - les énergies renouvelables doivent être exploitées, mais elles ne suffiront pas à surmonter les défis : l’énergie hydro-électrique est déjà exploitée dans les pays développés comme la France. Elle se développe dans les pays émergents, avec la construction en cours de 1200 barrages qui créent souvent des problèmes environ- nementaux et de déplacement de populations. L’éolien nécessite d’être associé à des centrales électriques à gaz compte tenu de l’arrêt de production par manque de vent les deux tiers du temps, ce qui ne permet pas une réduction significative des rejets de CO2 ni des dépenses d’hydrocarbures. Son intérêt se justifie davantage si les éoliennes sont installées en mer, à proximité des côtes les plus ventées. L’énergie solaire est bien adaptée pour la production d’eau chaude. En revanche, le photovoltaïque a un coût très élevé (6 à 10 fois le prix usuel du KWH) et convient surtout pour l’habitat isolé. La bio-masse a des capacités de développement limitées si l’on veut éviter la déforestation et la compétition entre la production alimentaire et les biocarburants. Par ailleurs, on n’entrevoit pas encore actuellement une révolution des technologies de production d’énergie. En particulier, le programme de recherche ITER est un projet ambitieux qui mérite d’être entrepris, mais dont on ne sait pas s’il produira ou non des résultats avant la fin du 21ème siècle. - l’énergie nucléaire, qui représente actuellement 6% de la production d’énergie dans le monde va connaître un développement important, avec un probable quadruplement de la production d’ici à 2050. Cela devrait toutefois nécessiter que les pays développant cette filière présentent des garanties de maîtrise de la sécurité, ainsi qu’une certaine stabilité politique. L’énergie nucléaire présente l’avantage de ne pas générer de CO2, et les nouvelles technologies (réacteurs de 4ème génération) permettent d’augmenter les rendements des combustibles garantissant à l’humanité plus de 1000 ans de ressources. Jean FLUCHERE prend alors la parole en examinant la situation du point de vue français et rhônalpin en analysant les conditions de compatibilité entre d’une part le respect du Grenelle de l’environnement et de l’objectif de réduction de 75 % des rejets de CO2 d’ici 2050, et d’autre part les besoins d’énergie de la France qui resteront importants si l’on veut conserver une activité
- 34. - 34 - économique et des emplois. Même en prenant en compte les économies d’énergie qu’il faut réaliser, notamment pour le chauffage des bâtiments avec le recours à l’isolation et aux pompes à chaleur, etc., nous aurons besoin de poursuivre notre effort dans le domaine de l’énergie nucléaire pour économiser l’équivalent de 40 millions de tonnes équivalent pétrole par an d’ici à 2030 et pour renouveler les centrales dont la construction remonte déjà à plus de 30 ans. Cela représente au moins une douzaine de tranches de réacteurs EPR à construire principalement sur les sites existants et va nécessiter de renforcer notre filière de formation d’ingénieurs (environ 1000 ingénieurs à former par an) et de forgerons (production de fonds de cuves bombés au Creusot).Nous avons donc besoin d’un véritable plan industriel, avec le lancement d’une tranche par an dans les douze ans qui viennent. Il faut noter que les autres pays européens vont prendre des décisions en ce sens, y compris l’Italie qui avait prévu de sortir de l’énergie nucléaire. L’Allemagne devrait suivre, car elle est actuellement la principale responsable des émissions de gaz à effet de serre en Europe en raison de la multiplication de ses centrales au charbon. Le manque de courage politique en ce domaine risque d’être préjudiciable pour tous, comme cela a été le cas pour l’installation de l’EPR à Flamanville et non dans la région, alors que la Normandie n’est pas une région de forte consommation. Il est en outre contradictoire de prôner la diminution de production de gaz à effet de serre et de décider actuellement la construction de centrales à gaz et au charbon. L’une des difficultés du développement de l’énergie nucléaire tient au caractère passionnel des débats sur le sujet, alors que la sécurité est maintenant très bien maîtrisée dans le cas de la France. En outre, les nouvelles technologies de retraitement des déchets vont permettre de réduire à la fois la quantité des déchets et la durée de la radioactivité, tout en améliorant considérablement le rendement des matières premières. La technologie des tours aéro-réfrigérantes va aussi permettre d’éviter le réchauffement des fleuves. Le renouveau de l’énergie nucléaire est un atout dont la France ne peut pas se détourner car cela concerne à la fois la production d’énergie pour l’avenir et le maintien durable d’emplois en France. Cela constitue également un atout unique de développement économique pour Lyon et la région Rhône-Alpes, si les décisions sont prises à temps. Actuellement, la région de Lyon au sens large (y compris Le Creusot et Marcoule) a pour caractéristique d’être la seule au
- 35. - 35 - monde qui peut maîtriser toute la filière de production et d’utilisation des centrales : enrichissement, forge, métallurgie du zirconium, ingénierie, tréfilage, robinetterie, moteurs, etc. Au total, cela concerne 100 000 emplois dans notre région, et Lyon joue un rôle pilote pour les réacteurs de 4ème génération avec le siège d’AREVA ingénierie installé à proximité de la Part-Dieu.
- 37. - 37 - Conférence du 27 janvier 2009 « Avenir des industries métallurgiques dans la métropole lyonnaise » M. Bruno LACROIX, Président du CESR Rhône-Alpes et PDG d’ALDES Michel GIELLY présente le thème de la conférence de ce soir, qui prend la suite des thèmes de l’énergie et de la chimie. Nous parlerons ce soir de métallurgie, qui est le premier secteur industriel de notre métropole et doit faire face à de nombreux défis dans la concurrence mondiale et face à la crise actuelle. Pour en parler, nous avons l’honneur de recevoir un conférencier qui connaît très bien le sujet, car il dirige une entreprise emblématique du secteur et il a assumé de très nombreuses responsabilités de la profession. Robert PARIS, membre du CESR, prend le relais pour présenter Bruno LACROIX, qui était déjà intervenu il y a plusieurs années sur le thème de la formation : -Il est PDG d’ALDES, leader européen de l’aéraulique et il a reçu le prix d’entrepreneur de l’année 2008 en Rhône- Alpes. Cette entreprise de 1200 personnes réalise un chiffre d’affaires annuel de 220 millions d’Euros. -Il a été président de nombreux organismes patronaux, aussi bien à Lyon qu’à Paris, où il a été vice-président du MEDEF en charge de la formation. Parmi ses nombreuses initiatives, il faut noter le développement du centre de formation de la métallurgie et la création d’ERAI. -Enfin, il assure depuis 2004 la présidence du CESR Rhône- Alpes. Bruno LACROIX prend ensuite la parole et son intervention porte sur la description de son expérience au niveau de la métallurgie et
- 38. - 38 - de son entreprise, avant d’en retirer des enseignements pour le développement des industries métallurgiques dans notre métropole. 1)Evolutions de la métallurgie à Lyon et dans notre région depuis 1975 La métallurgie de notre région regroupe de très nombreux métiers : l’automobile et sa sous-traitance, le machinisme agricole, les industries mécaniques, les industries électriques et électro- mécaniques, les biens d’équipement, etc. Le poids de ce secteur industriel en Rhône-Alpes est comparable à l’industrie métallurgique de pays entiers comme l’Autriche, la Belgique et la Suède. Ce secteur correspond à lui seul à 25 % de la valeur ajoutée régionale et à 20 % de l’emploi direct. Depuis son point culminant en 1975, l’évolution de l’emploi a été marquée par les évolutions suivantes : - Au début des années 70, il y avait 300 000 emplois dans la métallurgie en Rhône-Alpes, dont 1/3 dans le Rhône. - La crise de 1975, suivie par l’arrivée des machines à commande numérique, a fait fondre ces effectifs de 25 % environ. - Lors de la crise de 1993, les effectifs de salariés en Rhône-Alpes étaient de 236 000 et ils sont remontés à 256 000 en 2000, pour redescendre à 230 000 aujourd’hui, dont 56 000 dans le Rhône. Par ailleurs, un grand nombre d’entreprises a été revendu et nous avons perdu des centres de décision. En prenant la présidence de la profession en 1986, Bruno LACROIX a fait en sorte que les organisations professionnelles se regroupent et il a travaillé avec Denis GINDRE qui a pris en charge les actions relatives à la formation. Ces actions ont notamment consisté à former et à réinsérer dans l’emploi des jeunes ou des personnes licenciées, car il était prévisible que les jeunes recrutés au niveau bac + 2 n’allaient pas rester.
- 39. - 39 - 2)Le cas d’ALDES A son arrivée dans l’entreprise en 1967, Bruno LACROIX découvre une petite activité de grilles d’aération et saisit cette opportunité après avoir observé l’intérêt des pays d’Europe du Nord pour la ventilation mécanique, ainsi que l’introduction de normes du CSTB relatives à la ventilation des HLM. Ces normes de ventilation mécanique ont été complétées par les normes EDF pour les chauffages électriques intégrés. Dans un premier temps, la stratégie d’ALDES a consisté à mettre au point un système de double flux avec récupération de chaleur. De nombreuses innovations ont été faites dans les années 80, avec la découpe laser et l’automatisation de la logistique, ainsi que la mise au point d’un système d’aspiration centralisée des poussières. Les années 1995 à 2002 ont été centrées sur le développement international, principalement au niveau européen, avec la création de dix filiales. L’entreprise a aussi lancé de grands projets, tels que la mise en place d’un EPR à partir de 2003, et la réorganisation de la logistique en 2005. Pour le futur, l’entreprise peut appuyer son développement sur les opportunités liées à des normes de plus en plus contraignantes dans le domaine du chauffage. Il est aussi envisageable d’intégrer une pompe à chaleur dans le système de renouvellement d’air à double flux. ALDES devra aussi continuer à se développer en Europe du Nord et offrir des produits à haute valeur ajoutée susceptibles de générer un chiffre d’affaires par maison dix fois supérieur au système actuel : environ 2000 à 4000 € d’installations pour une maison basse consommation, contre 220 € pour un système à modulation de débit. Une autre opportunité est le marché de la rénovation, qui va être considérable. L’entreprise est passée à plusieurs reprises au bord du gouffre au cours de dernières décennies, mais elle a toujours su rebondir grâce à l’énergie de ses équipes. Il y a eu notamment l’effondrement du marché en 1975, à la suite de la crise économique. Une importante hémorragie financière a eu lieu à la fin des années 80, à la suite du rachat de filiales d’Usinor spécialisées dans les réseaux de
- 40. - 40 - conduits. La crise du bâtiment qui a démarré en 1993 a duré 5 ans et l’entreprise a dû laisser fondre d’un tiers ses effectifs. Les principes de management mis en œuvre chez ALDES ont permis à l’entreprise de réussir sa croissance et de surmonter les crises en gagnant des batailles en équipe. Il s’agit des principes suivants : - Le choix de valeurs fortes au sein de l’entreprise : respect des autres, confiance et délégation, engagement. - L’autonomie dans nos choix stratégiques, grâce à l’indépendance financière. - L’innovation à tous les niveaux, en utilisant les moyens d’aide à la recherche et en essayant de la mettre en œuvre par une taille critique: innovations produits, innovations process et innovation sociale. - Le centrage sur les métiers stratégiques de l’entreprise, en sous- traitant le reste. - La capacité à anticiper les évolutions et à prendre des risques. 3)Enseignements retirés de ces expériences pour la métallurgie de Lyon et sa région A la suite de cet exposé, le débat et les discussions qui ont suivi ont permis de formuler des enseignements génériques pour la profession. Il existe des points faibles évidents par rapport à la mécanique et à la métallurgie allemande, où les entreprises sont à la fois plus solides et plus grosses. Cependant, nous pouvons continuer à survivre et à nous développer en mettant en place au niveau de la profession des actions telles que les suivantes : - Aider les PMI à travailler davantage en équipe, et même à fusionner dans certains cas. Cela est nécessaire pour atteindre des tailles critiques pour l’innovation et pour les implantations commerciales. - Aider les dirigeants à trouver en équipe par eux-mêmes des solutions pour la profession, car les idées venant des organisations
- 41. - 41 - professionnelles sont jugées trop intellectuelles et pas toujours appropriées. - Aider les entreprises à passer avec succès les crises de croissance, telles que la crise du passage aux 100 millions d’Euros de CA, et le passage à un nouveau mode de relations sociales lorsqu’on atteint 1000 salariés. - Mettre en place des fonds d’aide au conseil afin de favoriser l’innovation managériale et la construction de stratégies audacieuses. Actuellement, les clubs APM ne s’adressent qu’à des PMI ayant déjà une certaine taille. - Renforcer les dispositifs incitatifs pour l’innovation, tout en rationalisant les aides économiques, beaucoup trop nombreuses et complexes. - Faciliter les processus de transmission, en particulier dans le cas des PMI familiales. - Attirer les jeunes dans l’industrie, en associant les établissements d’enseignement. Il convient en particulier de surmonter les difficultés de recrutement d’opérateurs d’ateliers, alors que de nombreux jeunes sont au chômage. - Développer les formations de techniciens et ingénieurs en alternance, comme le font les allemands pour avoir des cadres ayant l’esprit pratique, afin de rééquilibrer les qualités des formations françaises d’ingénieurs, très centrées sur les dimensions conceptuelles.
- 43. - 43 - Conférence du 24 mars 2009 « Bio et nanotechnologies. Des pôles d’excellence, emblématiques de la région ? Une fertilisation croisée en Rhône-Alpes ? » M. Philippe ARCHINARD, Président de LYONBIOPOLE M. Nicolas LETERRIER, Délégué Général du pôle MINALOGIC Monsieur Gaudichet, membre du conseil de la SEPL et Directeur de la Banque de France introduit les conférenciers et leur demande de présenter les pôles de compétitivité qu’ils président et de débattre sur les possibilités de fertilisation croisée afin de développer le tissu industriel de notre région et d’allonger les chaînes de valeur. - M Archinard est Président de Lyon Bio-pôle. Après un doctorat de chimie à Lyon et un MBA de l’université Harvard, il est devenu directeur général de Transgène. - M. Leterrier est Délégué Général de Minalogic. Il est docteur en électronique et il a été notamment directeur de la recherche- développement de KISS, spécialisé dans les bornes internet. 1)Intervention de M. Archinard Lyon Biopôle est principalement centré sur les enjeux de l’amélioration des soins tout en diminuant les coûts de ces soins. Cela nécessite à la fois la mise en oeuvre d’une stratégie scientifique et de tests cliniques, une stratégie d’innovation industrielle et une stratégie de marché. Les trois principales cibles
- 44. - 44 - stratégiques sont les diagnostics médicaux, les vaccins et les nouvelles thérapies, en ayant le souci constant non seulement des pays développés, mais aussi des pays en voie de développement. Le laboratoire P4 fait partie des grands équipements qui ont donné de la crédibilité au pôle de compétitivité, car c’est le seul site de cette nature en France. Le pôle de compétitivité a mené une réflexion stratégique sur les verrous technologiques à faire sauter à un horizon de 15 ans. Il faut noter que les cycles d’innovation sont très longs dans le cas de ce pôle de compétitivité : 7 à 10 ans pour des méthodes de diagnostic et 15 à 20 ans pour des nouveaux médicaments. L’Etat a fait un très gros effort depuis 2005 pour mettre en place les outils du pôle de compétitivité des bio-technologies, en complément des contributions de Biomérieux, Mérial, Sanofi, Pasteur et le CEA. Il y a aussi une contribution du Grand Lyon, de la Région, du Département et de la DRIRE. Depuis 3 ans, on observe aussi un fort engouement des PME pour rejoindre ce pôle, de façon à combler le déficit de PME fortes et dynamiques dans ce secteur : il s’agit de les aider dans leur processus d’innovation en les rapprochant des grandes entreprises et en développant les transferts de connaissances. Cela s’est fait notamment en liaison avec l’Agence Nationale de la Recherche et avec OSEO, qui a permis de coordonner les aides au niveau de la maturation des PME. Les dispositifs fiscaux, comme le crédit d’impôt-recherche ont également aidé à renforcer les impacts du pôle sur l’économie régionale. La création de fondations de recherche favorise les possibilités de création de chaires d’excellence dans le cadre de l’autonomie des universités. Au total, 50 projets ont été financés depuis 2005, pour un montant d’investissement de 375 millions d’euros et 150 millions d’Euros d’aides ont été mobilisés. Mérieux et le Grand Lyon ont œuvré pour fédérer ce pôle. Celui-ci a maintenant beaucoup de connexions avec Grenoble dans le domaine des nano-technologies. 4 000 chercheurs travaillent dans le cadre de ce pôle, qui se structure progressivement avec la création du campus Charles Mérieux à Gerland. Lyonbiopôle aide à
- 45. - 45 - construire des projets de recherche-développement et à rechercher des financements à la fois pour les entreprises et pour le monde académique (ANR, FUI, OSEO, Union Européenne, etc.). Les activités du pôle de compétitivité consistent aussi à faciliter les processus de création et de maturation des PME, notamment au travers des actions suivantes : - organiser des réunions avec des investisseurs pour lever des fonds, - faciliter les financements européens, - participer à la mise en adéquation des métiers et des formations, - aider à la protection des innovations en lien avec l’Institut National de la Propriété Industrielle, - représenter les PME à l’étranger en coopération avec les autres pôles de compétitivité français, - héberger des équipes collaboratives, comme dans le cas du centre d’infectiologie à Gerland, réalisé avec l’aide du grand Lyon. 2)Intervention de M. Leterrier Minalogic a émergé en 2000, avec le projet Minatech, qui regroupait les universités et les entreprises sur un grand campus. Il y a eu l’investissement dans l’unité de « fabrication-laboratoire » (fab-lab) de Crolles 2, où Motorola, Philips et ST micro- électronqiue ont investi ensemble pour bénéficier d’économies d’échelle. L’objectif de Minalogic est de favoriser la coopération entre acteurs pour obtenir une compétitivité mondiale dans la création de produits issus de nano-technologies ayant une grande efficacité énergétique. Les applications concernent notamment la connectivité et la mobilité, les systèmes embarqués, l’imagerie médicale, la biologie et la santé. A titre d’exemple, les nano- technologies ont permis de créer des tissus intelligents pour les
- 46. - 46 - pompiers, avec des capteurs intégrés, ce qui permet de régénérer les technologies du textile. C’est aussi dans le cadre de Minalogic qu’Essilor met au point un système d’écran intégré dans le verre des lunettes. D’autres projets sont prometteurs, comme la création de panneaux solaires souples et les verres intelligents, capables de filtrer les rayons infra-rouges de manière sélective. L’apport de Minalogic est de contribuer à la réflexion stratégique pour accroître la valeur ajoutée des produits en les rendant plus intelligents et communicants. Cela est d’autant plus nécessaire que la baisse des prix est très rapide dans l’électronique, avec une situation d’hyper- compétition au niveau mondial, où même la Silicon Valley risque de perdre sa compétitivité. Il convient notamment de favoriser la « coopétition », c'est-à-dire la coopération entre concurrents sur le territoire, en mettant en place la confidentialité et la confiance dans le cadre d’une équipe indépendante, et en protégeant la propriété industrielle. Le pôle aide aussi à la recherche de financement des projets, en faisant jouer l’effet de levier du crédit impôt-recherche et des co-financements public-privé : 1 Euro d’argent public permet de lever de 3 à 14 d’argent privé. Des difficultés restent à surmonter : - la faiblesse du nombre d’ingénieurs formés dans la région (il faut près de deux ans en France pour qu’une entreprise puisse recruter 300 ingénieurs, alors que l’on peut recruter 1 000 ingénieurs en moins de deux mois à Bengalore). Il y a aussi des déficits dans certains domaines de la formation, comme dans le cas des techniques des salles blanches où il n’existe pas de formation en France, alors que c’est une compétence critique, - Le manque d’attrait pour les métiers scientifiques et de l’industrie en France : Il faut renforcer l’information auprès des jeunes, comme dans le cas de la fête de la science et des forums scientifiques, - les problèmes de transport, avec l’encombrement permanent de Grenoble et le manque de liaison TGV avec Lyon par exemple : on
- 47. - 47 - a perdu Adobe à cause de l’exaspération des dirigeants à l’égard des embouteillages, - le manque d’éducation du grand public et des médias en ce qui concerne les innovations scientifiques, entraînant des lois contre- productives pour l’innovation en France. Il faut susciter une qualité de débat, de façon à pallier l’ignorance actuelle des médias et de la classe politique sur les questions d’innovation technologique. Il faut aussi donner la parole aux grands chercheurs dans les médias et dans les conférences, car ils sont crédibles et ne peuvent être soupçonnés de tricherie, - des aspects réglementaires ou législatifs défavorables pour notre compétitivité, comme l’obligation de payer à 30 jours, - le manque de coopération entre technologie et sciences humaines et sociales : il faudrait en particulier que les chefs de projets soient capables d’organiser l’interaction entre les dimensions techno- logiques, économiques et humaines des projets, - Le déficit de management de projet pour aller jusqu’au bout du processus d’innovation, ce qui pourrait permettre de doubler les taux de succès et éviter que des entreprises d’autres pays profitent de nos innovations, - on a besoin d’accroître l’excellence académique. Cela ne passe pas nécessairement par des universités ayant un très grand nombre d’étudiants, mais par des universités sur le modèle du MIT, reconnues pour leur capacité d’innovation, avec des grands professeurs ou chercheurs qui soient crédibles. A titre d’exemple, on a pu conserver un centre de RD à Grenoble parce qu’il y avait un prix Pierre et .Marie Curie, mais on a perdu Nokia, car Cambridge était davantage reconnu au niveau scientifique.
- 48. - 48 - 3)Idées issues du débat avec les participants - Les PME sont réticentes aux coopérations technologiques, car elles craignent un pillage de leur savoir-faire. Pour lever cet obstacle, il faut mettre en place des règles de confidentialité très strictes dans les pôles de compétitivité, renforcer la culture des brevets, créer un climat de confiance et faire comprendre que plus l’ambition d’un projet est grande, plus il faut coopérer pour partager les fruits du succès. Ces facteurs de succès commencent à être réunis dans le cas des deux pôles présentés, puisqu’on observe une forte croissance du nombre de PME qui participent. - Les collectivités territoriales ont pris conscience de la nécessité de se mobiliser car elles ont un rôle à jouer pour que le territoire soit un terreau favorable pour l’innovation. Cela est d’autant plus nécessaire qu’il y a une compétition croissante entre territoires au niveau mondial. Par exemple, la concurrence est rude avec Singapour pour les bio-technologies. Dans l’électronique, Taïwan veut devenir le leader mondial et Grenoble risque de rester le seul pôle européen de niveau mondial après les difficultés rencontrées par les allemands. Nous avons tout intérêt à attirer les grands groupes et les centres de décision sur notre territoire si l’on veut sauvegarder notre compétitivité et des emplois hautement qualifiés. - Les Etats-Unis ont une plus grande propension à l’innovation que la France, malgré l’initiative des pôles de compétitivité en France. A titre d’exemple, les Etats-Unis ont pris de l’avance sur les « technologies vertes » et écologiques, malgré l’insensibilité de l’administration Bush sur ce sujet. - Il convient de mesurer les effets directs et indirects ou cachés des pôles de compétitivité. Cela est nécessaire pour montrer que les investissements intangibles dans la coopération (et la « coopétition ») produisent des effets considérables pour un faible montant d’argent public mobilisé. Il faut en particulier éviter de réduire les coûts liés à l’innovation sous prétexte que l’on est en crise. Il convient aussi de différencier les soutiens financiers
- 49. - 49 - défensifs, pour sauver des secteurs en difficulté, des investissements dans les pôles de compétitivité. - Il ne faut pas croire que les petits pôles n’ont pas d’utilité. Il n’y a pas de véritable dispersion des moyens, puisque les 2/3 des financements sont concentrés sur les grands pôles. Certains petits pôles ont mobilisé les entreprises et les ont tournées vers la recherche académique et il en est sorti beaucoup de choses, même si cela n’a pas été évalué et qu’il y a eu des différences selon les secteurs. Il y a en particulier des micro-clusters qui ont réussi à faire dialoguer les PMI de secteurs différents, et qui ont changé les relations entre les PMI et les grandes entreprises, en passant du statut de sous-traitants à celui de partenaires. Il convient cependant de différencier les dénominations de pôles afin d’améliorer la visibilité de distinguer les secteurs qui sont en concurrence frontale au niveau mondial d’autres secteurs où la concurrence est plus locale. - L’innovation ne se décrète pas. Elle doit être intégrée dans la stratégie et le management de l’entreprise, avec une forte implication du dirigeant. L’innovation résulte en grande partie de la performance humaine et sociale des entreprises et des dispositifs de coopération.
- 51. - 51 - Conférence du 28 avril 2009 « Enjeux et perspectives de l’industrie agro-alimentaire française dans la compétition européenne et internationale. Les atouts de Rhône-Alpes et de Lyon Métropole ; quels développements ? » M. Yves BAYON de NOYER Vice-Président de l’Association Nationale des Industries agro- alimentaires (ANIA) M. Bernard GAUD Président de l’Association Régionale des Industries agro- alimentaires Sur le thème : 1)Introduction Marc BONNET accueille les conférenciers et remercie notre hôte, Monsieur BALIGAND, Président de l’ISARA, ainsi que M. LEMOINE, Président d’honneur et M. DESAMAIS, directeur de l’école. Ils ont préparé cette conférence en concertation avec Maurice PANGAUD. Il resitue également la conférence-débat de ce soir dans le contexte du thème de l’année, centré sur les conditions du développement des activités industrielles dans notre métropole. Le cas des industries agro-alimentaires, qui comprend de nombreuses PME et très petites entreprises sur la région, est particulièrement exemplaire. J. BALIGAND présente ensuite l’ISARA, qui offre de nombreux programmes de formation, dans le sillage de la formation d’ingénieur. Il y a notamment des licences professionnelles, des masters internationaux en agro-écologie et des mastères spécialisés en qualité des productions animales, en lien avec l’Ecole Vétérinaire de Lyon. La recherche appliquée concerne plusieurs
- 52. - 52 - domaines, avec notamment une équipe de recherche qui travaille sur la maîtrise des ferments en productions fromagère et panaire. Il y a aussi des activités d’étude, de conseil et de formation continue, touchant notamment des problématiques de management ren- contrées par les PME agro-alimentaires. L’ISARA est fortement impliqué dans la réflexion en cours d’un cluster agro-alimentaire dont l’emblème serait « bien manger ». Ce cluster vise à fédérer les entreprises privées et les coopératives, les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les structures d’appui et le pôle agro-alimentaire de Corbas. L’ISARA est situé dans de nouveaux locaux à Gerland, ce qui lui donne une nouvelle dimension, car il a été possible de regrouper sur ce site une multitude d’entreprises et d’organisations de la filière agro-alimentaire, avec les coopératives régionales d’agri- culture, le R3AP, etc. Maurice PANGAUD introduit nos deux conférenciers de ce soir : - Yves BAYON de NOYER est un ancien de Sodexho et il a travaillé dans différents pays, avant de créer lui-même une entreprise de plats cuisiniers asiatiques qui réalise aujourd’hui 100 millions d’Euros de chiffre d’affaires. Il a notamment une usine à Tarare, « capitale mondiale des plats cuisinés asiatiques ». Il est également très impliqué dans la profession, en ayant présidé le pôle de compétitivité des fruits et légumes. - Bernard GAUD est lyonnais d’origine. Il a été chef de cabinet de Michel DEBATISSE, puis successivement DG de Sodima-Yoplait, Candia, puis Sodial. Il a créé l’entreprise Etoile du Vercors, qui produit des fromages Saint-Marcellin et Saint Félicien. Il croit à la créativité et à l’innovation, et a notamment développé un saucisson sans matière grasse.
- 53. - 53 - 2)Exposé d’Yves BAYON de NOYER - L’agro-alimentaire représente le premier secteur industriel français, avec 415 000 salariés dans 10 600 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires total de 154 milliards d’Euros. Cette industrie comprend 10 000 entreprises, dont 3000 seulement ont plus de 20 salariés. Les entreprises du secteur sont réparties sur l’ensemble du pays et contribuent ainsi à l’aménagement du territoire, d’autant plus que les délocalisations restent à un niveau très faible et que l’on observe une stabilité de l’emploi malgré la crise. L’agro- alimentaire est un secteur qui est globalement exportateur, avec un solde positif de 6,5 milliards d’Euros. Il s’agit aussi d’une industrie organisée en proximité avec le monde agricole Il convient de noter que le prix des produits agricoles est supérieur à la part de valeur ajoutée des industries agro-alimentaires dans le prix final payé par le consommateur et que 70 % des produits agricoles passent par les industries agro-alimentaires avant d’être vendus aux consom- mateurs finaux. Par ailleurs, l’alimentation représente aujourd’hui 14 % du budget des ménages, contre 24 % il y a 20 ans, et contre 6,5 % aux Etats-Unis. Contrairement aux apparences, les produits alimentaires de grande consommation ont moins augmenté que l’inflation. L’industrie agro-alimentaire française conçoit des produits sains, sûrs, diversifiés et typiques, aux goûts multiples et appréciés. Cette industrie s’appuie sur les valeurs françaises de plaisir et de convivialité des repas, qui contribuent au rayonnement de la France dans le monde. Les consommateurs sont aussi conscients du lien entre l’alimentation et la santé et ils sont à 92 % attachés à la variété des produits. Les faiblesses de cette industrie tiennent à son caractère éclaté, fragmenté, ainsi qu’à une trop forte dépendance vis-à-vis des acheteurs. La faiblesse des marges, 2,7 % en moyenne, constitue un handicap pour attirer des investisseurs. A l’avenir, il faut s’attendre à un renchérissement des matières premières compte tenu de la croissance des besoins mondiaux et des normes environnementales, tandis que les marges des distributeurs restent fortes, avec un doublement des prix entre la sortie des usines et la vente aux
- 54. - 54 - consommateurs. Dans ces conditions, il est impératif de renforcer notre compétitivité par quatre moyens : - L’innovation : 1 % en moyenne du CA des entreprises agro- alimentaires est consacré à l’innovation. Ces investissements sont beaucoup plus le fait des grosses entreprises que des petites. L’innovation devrait être stimulée par les 14 pôles de compétitivité qui existent en France, ainsi que par les centres techniques que notre profession a labellisés et par la participation à des projets de l’Agence Nationale de la Recherche. La nouvelle formule du crédit impôt-recherche permet aussi aux entreprises de renforcer leur effort d’investissement dans l’innovation. - L’export : 20 % du CA de l’industrie agro-alimentaire est réalisé à l’export, ce qui représente au total 35 milliards d’Euros, avec une croissance de 5 % par an. La marque « France » est positive sur les marchés à l’export et nous avons des grands groupes de renommée mondiale, comme Danone. Cependant, des progrès restent à accomplir, car trop peu de produits sont exportés en dehors des vins et des produits laitiers, et 80 % des entreprises n’exportent pas encore. Pour progresser, il faudra par conséquent encourager les groupements. - La réponse au défi du développement durable : Il faudra limiter les gaz à effet de serre, mieux valoriser nos sous-produits, prévenir les pollutions et réduire le poids des emballages. De plus en plus, les consommateurs attendent que les produits agro- alimentaires prennent en compte cette dimension. - Le développement de la qualité nutritionnelle : le modèle alimentaire français permet une des espérances de vie les plus longues au monde : on mange des repas variés et à heures fixes, ce qui correspond au slogan des « 5 fruits et légumes par jour ». Notre profession a créé une fondation avec l’INRA pour promouvoir notre modèle d’alimentation. Il convient de défendre notre modèle à l’OMC, pour éviter le risque que notre industrie soit broyée par les normes relevant d’autres valeurs.
- 55. - 55 - 3° Exposé de M. Bernard GAUD Il faut rappeler qu’en 1933, à l’occasion de la 3ème étoile de la Mère Brazier, Lyon a été déclarée en 1933 par Kernoski « capitale mondiale de la gastronomie » en reprenant le terme de gastronomie inventé à Lyon en 1801 par le poète Joseph Berchoux. Paul Bocuse a renforcé cette notoriété en créant l’Institut Paul Bocuse en 1990. Lyon doit sa tradition gastronomique au fait qu’elle se trouve au centre d’une quinzaine de terroirs qui sont étroits, mais qui riches en produits agricoles de qualité avec une grande diversité de cultures et d’élevages. Lyon et les agglomérations de la métropole RUL ont développé une forte industrie agro-alimentaire, avec 23 500 salariés et 4 milliards d’Euros de chiffre d’affaires réalisés par des PME dynamiques et prospères, mais il n’y a pas de siège de grand groupe. Les productions principales sont les pâtes, le chocolat, les fromages, la transformation de la viande et la salaison, les huiles de haute qualité, etc. Un des atouts est de disposer de 7 millions de consommateurs dans un rayon de 100 km autour de Lyon. La région bénéficie aussi de réseaux de distribution très structurés et variés : Carrefour et Casino sont originaires de la région et il y a des entreprises de distribution plus spécialisées comme Grand Frais et les Boucheries André. On trouve aussi les Halles de Lyon, monument unique en France qui rassemble des fournisseurs exceptionnels. Les consommateurs achètent aussi deux fois plus sur les marchés que dans le reste de la France. Notre région urbaine bénéficie aussi de sa position géographique de carrefour européen et elle est bien équipée au plan logistique avec la nouvelle plate-forme de Corbas. Tous ces atouts amènent à se demander pourquoi nous ne développons pas davantage notre industrie agro-alimentaire. En fait, n’avons-nous pas trop d’atouts et notre excès de confort ne devient-il pas un handicap pour stimuler l’innovation ? Il nous manque en particulier une gouvernance au niveau de la profession et une pépinière de nouveaux chefs et de nouveaux entrepreneurs. Trois axes d’action devraient être renforcés pour stimuler l’innovation :
- 56. - 56 - - Fédérer les acteurs professionnels autour de la création de clusters. Cela a commencé avec l’Agrapôle autour de l’ISARA et de l’Institut Paul Bocuse. Il convient en particulier d’aider les entreprises de petite taille à se fédérer. - Renforcer les systèmes d’enseignement en lien avec les industries agro-alimentaires, comme dans l’exemple de l’école de la Roche sur Foron centrée sur la transformation du lait et des viandes. - Faire entrer l’agriculture et l’agro-alimentaire dans la vie culturelle de la région, comme dans l’exemple du mouvement du slow food né à Bra en Italie, où a été créée la première foire mondiale des produits de haute qualité. Il n’est pas normal que le SIRHA, foire de classe mondiale, ne soit pas relayé par des événements populaires. Ne faut-il pas refonder la fête des tréteaux, dans l’esprit de ce qui se faisait à l’occasion de la foire de Lyon dans les années 30 ? La région urbaine de Lyon a donc un vrai potentiel de capitale agro-alimentaire, grâce à la variété et à la qualité de sa production, à sa logistique et à l’existence d’un large marché. Il convient maintenant de lancer le mouvement. 3)Résumé des débats et questions-réponses - Il serait utile de mettre en synergie nos atouts de qualité des produits avec la variété des ressources touristiques de notre métropole. Il faut en particulier développer le tourisme de visite d’entreprises. - Une difficulté à surmonter lorsque l’on veut regrouper les entreprises est la préservation des secrets de fabrication. - Un atout à ajouter à la liste de nos points forts est que nous sommes bien positionnés dans le mouvement du développement
- 57. - 57 - durable. En particulier, nous transformons des produits qui n’ont pas besoin d’avoir été transportés dans la plupart des cas. - Il ne faut pas oublier la variété des terroirs à mettre en synergie autour de Lyon. Par exemple Roanne a une grande variété d’industries agro-alimentaires, y compris avec de grosses entreprises, ainsi que des grands chefs et une tradition culinaire et une capacité d’innovation, comme dans le cas de la cuisine sous vide.
- 59. - 59 - SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE POLITIQUE ET D’ÉCONOMIE SOCIALE DE LYON – : – DÎNER-DÉBAT du LUNDI 29 JUIN 2009 Sur le thème : « Politique économique et attractivité des territoires » Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN Président de la Fondation Prospective et Innovation Ancien Premier Ministre Le Président Marc BONNET.- Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous avons l’honneur d’accueillir ce soir M. Jean-Pierre RAFFARIN. Monsieur le Premier ministre, vous nous faites un grand honneur en venant présider notre dîner de clôture pour la session 2008/2009 de la Société d'Economie Politique et d'Economie Sociale de Lyon .De nombreuses personnalités sont venues pour vous écouter : ! Monsieur le Préfet de région.
- 60. - 60 - ! Monsieur le Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de Lyon. ! Messieurs les Députés et Sénateur. ! Monsieur le représentant du Sénateur- Maire de Lyon. ! Monsieur le Président du Conseil Economique et Social Rhône-Alpes. ! Monsieur le Président de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Rhône-Alpes ! Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon. ! Monsieur le Président du MEDEF. ! Monsieur le Directeur Régional de LCL. ! Messieurs les représentants du monde économique, Messieurs les Présidents et Directeurs Généraux. Chers confrères et adhérents de la Société d'Economie Politique et d'Economie Sociale de Lyon, Mesdames, Messieurs. Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN va nous parler non seulement en sa qualité d'ancien Premier Ministre, mais aussi en tant que Président de la Fondation Prospective et Innovation. Monsieur le Premier Ministre, nous vous remercions de venir conforter nos travaux et nos propositions dans le domaine de la prospective. La SEPL est, comme vous le savez, une société de réflexion et de prospective établie à Lyon depuis près de 150 ans ; elle a déjà reçu des anciens Premiers Ministres et des Premiers Ministres, notamment M. Barre et M. Couve de Murville. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que nous avions reçu il y a déjà près de 50 ans, en tant qu'Hôte d'Honneur, Gaston Berger, considéré comme le
- 61. - 61 - fondateur de l'école française de prospective.Selon sa définition, la prospective exige de voir large, de voir loin, et surtout de toujours penser à l'homme. En cette période de crise, il y a un besoin pressant de développer davantage encore la réflexion prospective, car elle peut nous aider à découvrir des opportunités cachées à saisir, et des perspectives de construction de projets nouveaux, qui insufflent un nouvel espoir pour notre pays. Monsieur le Premier Ministre, votre Fondation a vocation à s'intéresser à des sujets de prospective de niveau national et international, notamment quant à la place de la France dans le monde, dans un contexte de montée en puissance des pays émergents comme la Chine et l'Inde. Nous avons beaucoup à apprendre de vos travaux pour notre réflexion, qui se situe à un niveau beaucoup plus modeste, celui de la métropole lyonnaise, également dénommée Région Urbaine de Lyon, et qui comprend notamment les agglomérations de Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin, l'Ile d'Abeau, Bourg-en- Bresse, Roanne, Vienne, Villefranche-sur-Saône. Le fil conducteur de nos travaux consiste à montrer que la France a besoin de réelles métropoles en plus de Paris, pour jouer pleinement sa vocation d'innovation sociale et technologique en Europe et dans le monde. Dans ce contexte, Lyon et sa région ne pourront vraiment devenir une métropole qu'en faisant jouer les synergies et le travail en équipe entre les agglomérations autour de Lyon, entre les différentes industries des agglomérations de la métropole, entre les organismes de recherche et les entreprises industrielles et les services qui existent dans notre métropole. À la suite de la publication de notre ouvrage, "Construire Lyon Métropole", paru il y a quelques mois, nous préparons la publication des travaux de cette année, centrés sur le potentiel de notre métropole industrielle dans la compétition mondiale. Nos travaux insistent plus particulièrement sur les
- 62. - 62 - conditions à remplir pour que tous les acteurs du territoire mettent en commun leur énergie et fassent équipe dans le contexte de crise. Comme lors des dernières années, nous avons utilisé des méthodes de prospective destinées à dégager des pistes innovatrices pour l'action, en nous appuyant non seulement sur les concepts de scénarios prospectifs de Michel GODET, mais aussi sur ceux de l'ISEOR, laboratoire de recherche lyonnais associé à l'Université Lyon III et à l'IAE de Lyon, utilisant notamment la méthodologie d'interactivité cognitive mise au point par le professeur Savall. Au niveau local, nos travaux sont complé- mentaires de ceux des conseils de développement des diverses agglomérations de la Région Urbaine de Lyon, en particulier le Conseil de Développement du Grand Lyon, vis-à-vis duquel nous apportons un regard complémentaire socio-économique et pas seulement social. Nous jouons aussi un rôle complémentaire à celui du Conseil Economique et Social Rhône-Alpes, qui propose une analyse prospective au niveau régional en nous centrant davantage sur le niveau métropolitain. Tous ces travaux de prospective ne se font pas concurrence, ils sont fondamentaux pour alimenter le débat citoyen en préparant l'avenir au-delà de l'horizon des mandats politiques, nécessairement contraints par les échéances électorales. Ainsi nos travaux de cette année mettent en évidence les conditions de la survie et du développement de l'activité industrielle de la métropole lyonnaise à l'horizon des prochaines décennies, ce qui est vital pour sauvegarder durablement l'emploi de nos concitoyens et de nos enfants. Monsieur le Premier Ministre, nous allons vous écouter très attentivement pour bénéficier de votre expérience nationale et internationale et des travaux de votre Fondation Prospective et Innovation.
- 63. - 63 - Auparavant, laissez-moi remercier les personnes qui ont contribué à nos réflexions de cette année et en particulier nos grands témoins, notamment : ! M. Alain PERROY et M. Nicolas MILLET en ce qui concerne la chimie. ! M. FLUCHERE et M. SIMON dans le domaine de l'énergie. ! M. LACROIX pour la métallurgie. ! M. ARCHINARD et M. LETERRIER sur le sujet de l'interaction entre les biotechnologies et les nanotechnologies. ! M. BAYON du NOYER et M. GAUD dans le domaine des industries agroalimentaires. Nous vous adressons aussi, à vous-même, tous nos remerciements, ainsi qu'à votre équipe de la Fondation Prospective et Innovation en particulier, vos collaborateurs, M. DAVOUX et Mme KERNER. Merci également au Professeur Jean-Paul BETBEZE, qui nous a aidés dans la préparation de cette manifestation. Je remercie de même les partenaires fidèles de notre Société d'Economie Politique et d'Economie Sociale, qui existe depuis 1866, en particulier la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, présidée par M. Guy MATHIOLON, et LCL, représenté par son Directeur Régional, M. DUFLOT. Merci également aux membres du bureau de la SEPL qui ont activement apporté leur contribution cette année : - Madame JIMBERT, notre Secrétaire Générale, pour sa collaboration toujours efficace, assistée de Mme FERRANDEZ et de notre Trésorier M. LHENRY.
