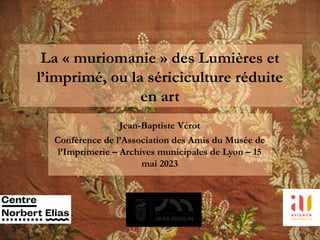
La "Muriomanie" des lumières et l'imprimé ou la sériculture réduite en art.
- 1. La « muriomanie » des Lumières et l’imprimé, ou la sériciculture réduite en art Jean-Baptiste Vérot Conférence de l’Association des Amis du Musée de l’Imprimerie – Archives municipales de Lyon – 15 mai 2023 1
- 2. « Il est bien peu d’arts qu’on puisse apprendre parfaitement par le secours des livres, même des Auteurs qui ont été les plus expérimentés dans les matières qu’ils traitent. Il est déjà reconnu que les livres écrits depuis 25 ans, sur la plantation des mûriers et l’éducation des vers à soie, ne peuvent servir de rien, ou de peu de chose. On n’en trouve pas deux qui s’accordent, et cependant ces auteurs […] assurent qu’ils n’ont pris pour guides que leurs expériences ; il faut donc qu’ils les aient mal faites, ainsi que les calculs nécessaires ». 2 Introduction
- 3. Introduction 1. Comment les liens entre l’imprimé et la sériciculture sont-ils noués par la monarchie à travers sa politique séricicole ? 2. Comment l’imprimé contribue-t-il à la formation de la sériciculture comme branche de l’agronomie naissante ? 3. Quelles connexions ces imprimés établissent-ils entre les mondes de l’administration et de l’agriculture savante d’un côté, et le monde des praticiens de l’autre ? 3
- 4. Plan I. Littérature technique et politique séricicole I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » I.3. L’imprimé et la fabrique administrative des savoirs II. L’imprimé et la structuration des savoirs séricicoles II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs II.2. La médiation des controverses et des collaborations II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs III. « Les livres […] ne peuvent servir de rien » III.1. Quand savoir-faire et pouvoir-dire ne se rencontrent pas III.2. Boissier de Sauvages et la « réduction en art » de la sériciculture III.3. Une question de format : des traités aux précis 4
- 5. I. Littérature technique et politique séricicole I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » I.3. L’imprimé et la fabrique administrative des savoirs 5
- 6. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 6 Portrait de Barthélemy de Laffemas, ca. 1598. Qu’est-ce que « l’entreprise des soyes » ? ● Une politique « mercantiliste » de substitution d’importations. → Diffuser la sériciculture dans le royaume en même temps que les manufactures de soieries. → 1602-1604 : entreprise de fourniture des généralités. → 1604-1608 : entreprise de fourniture des diocèses.
- 7. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 7 « L’entreprise des soyes » et l’imprimé La première littérature séricicole française et le cercle de « l’entreprise des soyes » : ● Olivier de Serres et La cueillette de la soye par la nourriture des vers qui la font (1599), « échantillon » du Théâtre d’agriculture et mesnage des champs (1600)
- 8. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 8 Requête de Gédéon de Serres au roi concernant son projet de sériciculture à Fontainebleau (Bib. de l’Institut de France, Ms Godefroy 194).
- 9. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 9 Promesse de vente de mûriers entre Gédéon de Serres (vendeur) et les entrepreneurs de la fourniture de mûriers engagés avec la commission du commerce (Arch. nat., Minutier central des notaires parisiens, 1602).
- 10. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 10 « L’entreprise des soyes » et l’imprimé La première littérature séricicole française et le cercle de « l’entreprise des soyes » : ● Jean-Baptiste Le Tellier et son luxueux Brief discours contenant la maniere de nourrir les vers à soye…, Paris, P. Pautonnier, 1602. ● Dédié à Rachel de Cochefilet, épouse de Sully. ● Gravures sur cuivre de Philippe Galle, sur des dessins de Stradanus : une réédition commentée de la série Vermis sericus (C. Plantin, Anvers, 1577).
- 11. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 11
- 12. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 12
- 13. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 13
- 14. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 14
- 15. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 15
- 16. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 16
- 17. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 17 « L’entreprise des soyes » et l’imprimé La première littérature séricicole française et le cercle de « l’entreprise des soyes » : ● Jean-Baptiste Le Tellier et les Mémoires et instructions ● 16 000 exemplaires commandés par la commission du commerce ● 1000 l.t. payés par les entrepreneurs aux imprimeurs parisiens Jamet et Pierre Mettayer.
- 18. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 18 « L’entreprise des soyes » et l’imprimé La première littérature séricicole française et le cercle de « l’entreprise des soyes » : ● Laffemas et ses nombreux traités sur la sériciculture, publiés en tant que contrôleur général du commerce. ● Reprise des bois utilisés pour les Mémoires et instructions de Le Tellier.
- 19. I.1. « L’entreprise des soyes » sous Henri IV : une entreprise éditoriale 19 « L’entreprise des soyes » et l’imprimé La première littérature séricicole française et le cercle de « l’entreprise des soyes » : ● L’Instruction de Jehan Vandeveckene et associés : une rareté bibliographique.
- 20. I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » 20 Les usages de l’imprimé par les « hommes à projets » séricicoles au XVIIe siècle. ● Qu’est-ce qu’un « homme à projets » ou projector ? → Joan Thisrk, Economic Policy and Projects. Development of a Consumer Society in Early Modern England, 1978.
- 21. I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » 21 Les usages de l’imprimé par les « hommes à projets » séricicoles au XVIIe siècle. ● Un ouvrage méconnu sur la sériciculture, la Proposition faite au Roy […] Contenant les moyens de rendre la soye aussi commune en France […] qu’elle l’est en la Chine…, Marc Marressé, 1610.
- 22. I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » 22 Les usages de l’imprimé par les « hommes à projets » séricicoles au XVIIe siècle. ● L’Advis au Roy lyonnais de 1627 : un projet porté par Claude Dangon ?
- 23. I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » 23 Les usages de l’imprimé par les « hommes à projets » séricicoles au XVIIe siècle. ● Christophe Isnard, un entrepreneur de moulinages provençal et ses projets à la cour de Louis XIV. → Les Mémoires et instructions… de 1660 (rééd. 1665) et l’art de la dédicace flatteuse à la recherche de haut patronage.
- 24. I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » 24 Les usages de l’imprimé par les « hommes à projets » séricicoles au XVIIe siècle. ● Christophe Isnard, un entrepreneur de moulinages provençal et ses projets à la cour de Louis XIV. → Les Vers à soye presentez au Roy (1669) : un poème publicitaire pour un projet d’exploitation des vers à soie « sauvages » de Madagascar.
- 25. I.2. L’imprimé, outil des « hommes à projets » 25 Les usages de l’imprimé par les « hommes à projets » séricicoles au XVIIe siècle. ● Christophe Isnard, un entrepreneur de moulinages provençal et ses projets à la cour de Louis XIV. → Le Plant de meuriers d’establissement royal (1673) : encore une publicité rimée : « Forcez à force de ducatz, La Nature pour rendre utiles, Les Campagnes plus infertilles »
- 26. I.3. L’imprimé et la fabrique administrative des savoirs séricicoles 26 Le renouveau du volontarisme séricicole sous Louis XV : • Philibert Orry, contrôleur général des finances de Louis XV (1730-1745) • Daniel Trudaine, directeur du Bureau du commerce (1749-1769) → Mise en place d’un réseau de pépinières publiques de mûriers. → Distributions gratuites de mûriers et de vers à soie aux propriétaires. → Création d’ateliers de tirage privilégiés et subventionnés. • Quel rôle de l’imprimé dans ce dispositif ? Portrait d’Orry par Hyacinthe Rigaud, v. 1738.
- 27. 27 Les pépinières publiques de mûriers dans le royaume de France au XVIIIe siècle I.3. L’imprimé et la fabrique administrative des savoirs séricicoles Des administrateurs démunis : - Les instructions manuscrites du jardinier Philibert. - Des instructions trop sommaires : la complainte du directeur de la pépinière d’Issoire.
- 28. 28 I.3. L’imprimé et la fabrique administrative des savoirs séricicoles Un imprimé de commande administrative : - 1740 : Orry demande à l’intendant de Touraine d’encourager la publication d’un traité du sieur Baron. - 1742 : Publication anonyme à Poitiers du Mémoire instructif sur les pépinières de meuriers blancs et les manufactures de vers à soie. Sources ? Diffusion ? Réception ? → Mémoires fournis par Orry, dont ceux de Philibert. → Mémoires de l’Académie des sciences de Montpellier. → Distribution orchestrée par l’intendant en Auvergne. → Réédition en 1745, commandée par les États du Béarn à leur imprimeur ordinaire. → Critique par l’inspecteur des manufactures Henri Sauclières.
- 29. II. L’imprimé et la structuration des savoirs séricicoles II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs II.2. La médiation des controverses et des collaborations II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 29
- 30. 30 II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs La « Muriomanie » : un phénomène éditorial typique des « Lumières agricoles » Évolution du nombre de publications de traités sur la culture du mûrier au XVIIIe siècle
- 31. 31 Page de titre de La Muriomanie de Dubet (1769), livret publicitaire annonçant le traité finalement intitulé La Muriométrie (1770). « Nous voyons que la murimanie (nous prions qu’on nous pardonne cette expression) gagne toutes les parties du Royaume ; cette culture qui paroissoit d’abord devoir se borner aux Provinces méridionales comme la Provence, le Languedoc, le Dauphiné, s’est étendue dans le Lyonnois, déjà même on cultive avec succès les muriers en Bourgogne ; nous en avons vu réussir dans les froides montagnes de l’Auvergne ; la Bresse en éleve, toutes les Généralités de proche en proche veulent faire des soyes. Dans cette émulation universelle, pourquoi la Franche-Comté resteroit-elle oisive ? » « Discours présenté par M. R. De Moedeseule à l’Académie des Sciences, Belles Lettres & Arts de Besançon ; sur la question « quelles sont les différentes espèces de grains, de légumes ou de plantes, dont la culture jusqu’ici inconnue ou négligée en Franche Comté peut y être introduite avec succès ? », Journal de l’agriculture, du commerce, des arts et des finances, juin 1769, p. 3-33. II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs
- 32. 32 Louis-Madeleine Bolet Matthieu Thomé C.-A. Dubet Jean-Baptiste Constant- Castellet Pierre-Augustin Boissier de Sauvages Ladmiral II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs Lieux de publication des traités de sériciculture en France au XVIIIe siècle
- 33. 33 Page de titre de la Gazette, année 1780, n°22. Portrait de Bertin par Alexandre Roslin, 1768. II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs
- 34. 34 Évolution du nombre de contributions relatives à la culture du mûrier dans la Gazette (1763- 1783) II.1. La fédération d’une nébuleuse d’auteurs et de lecteurs La Gazette et le Journal d’agriculture, des « arènes » qui fédère les amateurs de sériciculture.
- 35. 35 Principaux sujets des articles de la Gazette relatifs à la culture du mûrier II.2. La médiation des controverses et des collaborations
- 36. II.2. La médiation des controverses et des collaborations La controverse du greffage : – Matthieu Thomé vs. Jean-Baptiste Constant-Castellet, ou l’intérêt des propriétaires de mûriers vs. l’intérêt des filateurs. – « Voilà donc deux Auteurs qui nous assurent n’avoir écrit qu’après des expériences suivies pendant plusieurs années, diamétralement opposés de sentiment dans un fait. Auquel des deux donnerons nous donc la préférence ? Comment fixer nos incertitudes sur un point aussi important ? Je pense que pour y parvenir, il n’est question que d’inviter les gens bien instruits dans cette partie, à traiter à fond le sujet » Pierre-Louis de Massac, membre de la Société d’agriculture de Limoges, Gazette d’agriculture, 4 février 1766, n°10, p. 74-75. 36
- 37. II.2. La médiation des controverses et des collaborations La controverse du greffage : – Réponse de Constant-Castellet qui détaille ses expériences. – Réponse pragmatique du « Paysan des Cévennes ». – Reprise de la controverse avec Dubet, radicalement opposé au greffage « erreur nationale » de la « dénaturation » des mûriers. – Réponse de « Bertrand Morus, habitant des Cévennes », dans le Journal d’agriculture (octobre 1771) : « Je ne sçais, Monsieur, si en composant votre Traité, permettez-moi de vous le dire, vous n’avez point été un peu trop persuadé de l’infaillibilité de votre systême, si vous avez consulté la nature, le sol, nos besoins mêmes, ou plutôt, si vous avez puisé dans de bonnes sources pour vous procurer certains éclaircissemens » 37
- 38. II.2. La médiation des controverses et des collaborations Les périodiques et l’organisation des collaborations séricicoles : – Nombreuses descriptions d’expériences par des particuliers, comme Vallet, le curé de Sainte-Colombe. – À partir de 1771, nombreuses « lettres d’Italie » concernant la « maladie épidémique » qui frappe les mûriers. Diffusion de l’information concernant le prix de la société d’agriculture de Brescia sur la question. 38
- 39. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 39 Régler l’épineuse question de la question de la nomenclature : Dubet dans sa Muriométrie : « Une chose qui paroît fort singulière, c’est que les Ecrivains n’ont rien de fixe sur la dénomination des espèces de muriers […] Il est à présumer que la nomenclature des muriers s’étendra à l’infini, & suivra la progression des variétés » ← Apparition d’un grand nombre de variétés horticoles du mûrier blanc.
- 40. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 40 Les variétés de mûriers blancs selon le sieur Michel, jardinier de Bagnols (v. 1760)
- 41. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 41 Les variétés de mûriers blancs selon le sieur Puech, sériciculteur au Vigan (v. 1755).
- 42. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 42 Constant-Castellet entend diffuser par l’imprimé une « nomenclature » des mûriers, dans son Art de multiplier la soie (Aix-en-Provence, 1760).
- 43. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 43 « J’ai vu ce que l’auteur appelle mûrier sauvage à feuilles roses, donner des fruits noirs & assez gros ; & la même singularité a eu lieu sur celui qu’il nomme feuille d’Espagne. Les mûriers de la partie du Languedoc où je me suis retiré, approchent beaucoup des espèces des environs d’Aix. J’ai comparé les uns aux autres, & cette comparaison m’a fait reconnoître beaucoup de variétés secondaires de ces espèces qui sont déjà elles-mêmes des variétés ». L’abbé naturaliste François Rozier critique la « division des espèces de mûriers » diffusée par Constant-Castellet et ses « copistes » dans son article « Mûre, mûrier » du Cours complet d’agriculture, Paris, 1786 (tome 7, p. 1-59)
- 44. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 44 La diffusion d’un modèle de plantation de mûriers idéale : La « meurière » idéale de Ladmiral (1757). « Ce projet ménage le terrain, […] épargne beaucoup sur toutes les dépenses des plantations ordinaires. Il met chaque paysan au centre de sa petite location. Il fait de sa location un petit enclos où il n’aura rien à craindre ni des bestiaux ni des voleurs, & il peut faire vivre toute sa famille avec un terrein médiocre » Ladmiral, Traité des mûriers blancs, Paris, 1757, p. 243-248.
- 45. II.3. La diffusion de savoirs normalisateurs 45 La diffusion d’un modèle de plantation de mûriers idéale : Plan de la plantation du sieur Dulac à Lugeac, près de Brioude, 1752 (Arch. dép. du Puy-de- Dôme, 22 Fi 102).
- 46. III. « Les livres […] ne peuvent servir de rien » III.1. Quand savoir-faire et pouvoir-dire ne se rencontrent pas III.2. Boissier de Sauvages et la « réduction en art » de la sériciculture III.3. Une question de format : des traités aux précis 46
- 47. III.1. Quand savoir-faire et pouvoir-dire ne se rencontrent pas Pouvoir-dire sans savoir-faire : le cas du Traité des mûriers signé Louis Lesbros de La Versanne (1769) – Adresse au lecteur extrêmement méprisante à l’égard des paysans. – Propos presque intégralement plagié. – Un texte écrit par le jeune marquis de Sade ? 47
- 48. III.1. Quand savoir-faire et pouvoir-dire ne se rencontrent pas Aucun jardinier, aucun magnanier « professionnel » parmi les auteurs de traités séricicoles. – Pourtant, beaucoup savent écrire, et certains essayent d’être publiés, comme le sieur Bertrand, « pépiniériste » et « négociant en mûriers » de Narbonne, qui demande à l’intendant de Languedoc une aide pour publier un traité sur la culture du mûrier blanc (lettre ci-contre, Arch. dép. de l’Hérault, C 2250, 1751). 48
- 49. III.1. Quand savoir-faire et pouvoir-dire ne se rencontrent pas ← L’imprimé technique établir une frontière entre savoir-faire et pouvoir-dire. – Ce n’étaient pas le savoir-faire des praticiens qui étaient remis en question par les instances de validation qui leur refusaient la publication imprimée, mais leur capacité et leur légitimité à les transcrire dans une langue écrite convenable à la littérature technique. – Les hommes de la pratique étaient considérés par les instances de légitimation des savoirs comme incapables de théoriser et de formaliser leur art en raison de leur enfermement supposé dans les bornes strictes de leur métier et de leur langage éloigné des codes culturels qui distinguaient et légitimaient les hommes de lettres (travaux de Liliane Hilaire-Pérez et Marie Thébaud-Sorger) – « L’acte de textualisation » des techniques comportait en lui-même un effacement et une forme de « colonisation » des savoirs détenus par les praticiens spécialistes de ces mêmes techniques (Dorothy Ko). 49
- 50. III.2. Boissier de Sauvages et la « réduction en art » de la sériciculture 50 Qu’est-ce qu’une « réduction en art » ? • Processus de formalisation des savoirs qui « structure, pendant l’époque moderne, des pratiques de connaissances pour l’action » • Consiste à capter, ordonner et diffuser de manière normalisée des savoirs techniques jusqu’alors épars et diffus. • Objectif : le « bien public », l’« administration réglementée des projets qui intéressent la collectivité ». • Des auteurs et des lecteurs qui « appartiennent au même monde, celui qui, à quelque titre, contribue à l’exercice du pouvoir » (Hélène Vérin et Pascal Dubourg-Glatigny)
- 51. III.2. Boissier de Sauvages et la « réduction en art » de la sériciculture 51 Pierre-Augustin Boissier de Sauvages (1710-1795) et ses Mémoires sur l’éducation des vers à soye : – Éminent naturaliste. – Soutien financier du Bureau du commerce. – Enquête de terrain auprès des sériciculteurs cévenols.
- 52. III.2. Boissier de Sauvages et la « réduction en art » de la sériciculture 52 « Nous avons heureusement chez nous des personnes très en état d’en donner des leçons » Cherche à « réduire en art » la « routine incertaine » de ces praticiens, en mêlant observation de leurs principes et « une saine phisique & le bon sens, sçavoir, celle des expériences & des observations ». Difficultés de communication et un certain mépris : « deviner la pensée de gens grossiers & peu intelligibles, qui [lui] fesoient même quelquefois mystére des moindres choses ». Un art du questionnaire qui repose sur des connaissances préalables : « Il est difficile de faire de bonnes questions & de tirer par cette voie des gens de l’art d’utiles connoissances, si l’on n’en a déjà beaucoup soi-même »
- 53. III.2. Boissier de Sauvages et la « réduction en art » de la sériciculture 53 → Une position intermédiaire, entre élève et maître des « hommes de l’art », qui se sert de ses savoirs naturalistes pour améliorer les pratiques qu’il observe. → Dans sa préface, il affirme que son travail de réduction en art est destiné aux « propriétaires », de manière à les rendre plus capables de diriger les opérations de sériciculture. → Les lecteurs devaient pouvoir se muer en instructeurs des « ouvriers qu’ils [avaient] à leurs gages » et se faire des « interprêtes » de Boissier de Sauvages. → L’amélioration de la sériciculture passe pour Boissier de Sauvages par un processus circulaire, fait d’une succession de transferts et de traductions, processus au sein duquel l’imprimé joue le rôle de fixateur et de pivot.
- 54. III.3. Une question de format : des traités aux précis Retour en arrière : « l’entreprise des soyes » et sa stratégie de diffusion de l’information. 54 Gravures sur la nourriture des vers à soie dans les Mémoires et instructions de Le Tellier (1603).
- 55. III.3. Une question de format : des traités aux précis 55 Délibération des élus-généraux des États de Bourgogne, février 1786 (Arch. dép. de Côte-d’Or, C 3241).
- 56. III.3. Une question de format : des traités aux précis 56 Instruction sur la manière de former les pépinières de Meuriers distribuée par les États de Languedoc dans les diocèses civils du Haut- Languedoc, 1757 (Arch. dép. de l’Hérault, C 11892).
- 57. Conclusions Les traités imprimés de sériciculture : → des outils de gouvernement économique. → des objets d’une mode agronomique élitiste et peu connectée aux réalités de terrain. → des opérations de captation, de formalisation, d’amélioration et de diffusion normalisatrice de savoir-faire. → des sources irremplaçables pour étudier les techiques séricicoles anciennes. 57
- 58. 58 Merci pour votre attention.