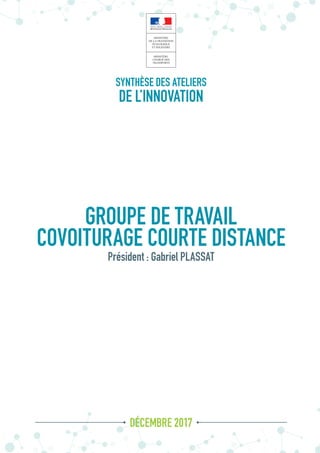
GT covoiturage ASSISES MOBILITE
- 1. GROUPE DE TRAVAIL COVOITURAGE COURTE DISTANCE DÉCEMBRE 2017 Président : Gabriel PLASSAT SYNTHÈSE DES ATELIERS DE L’INNOVATION
- 2. Ateliers de l’innovation - Covoiturage courte distance 1 Sommaire Diagnostic et besoins identifiés...................................................................................3 Orientations stratégiques proposées par le groupe ...................................................4 Objectifs .....................................................................................................................................5 Principales mesures proposées..................................................................................6 Annexes.........................................................................................................................7 Annexe 1 : Présentation générale de la démarche ...................................................................7 Annexe 2 : Propositions détaillées des mesures prioritaires ...................................................9 Fiche de proposition n° 1 : Mesure 1 : Créer un élan national..................................................9 Mesure 1.1 : Une communication nationale..............................................................................9 Mesure 1.2 : Une définition plus précise du covoiturage pour les collectivités, l’État et les opérateurs ..............................................................................................................9 Mesure 1.3 : Le label et La preuve de covoiturage....................................................................9 Fiche de proposition n° 2 : Mesure 2 : Créer un cadre clair pour que chaque acteur (collectivité, entreprise, État…) puisse jouer pleinement son rôle pour inventer le covoiturage au quotidien dans son territoire...........................................................................10 Mesure 2.1 : Ouvrir la compétence covoiturage à toutes les échelles des territoires ...........10 Mesure 2.2 : Déployons un bouquet d’incitatifs grâce à la preuve de covoiturage et l’implication de tous les acteurs : entreprises, État, collectivités…........................................12 Mesure 2.3 : Faire levier des données.....................................................................................14 Fiche de proposition n° 3 : Mesure 3 : Expérimentons et apprenons plus vite ensemble ...........15 Mesure 3.1 : L’Appel à Manifestation d’Intérêt........................................................................15 Mesure 3.2 : La mise en œuvre d’un Fonds Mobilité...............................................................15 Mesure 3.3 : La mise en œuvre un système léger et agile......................................................15 Mesure 3.4 : Accompagner les changements de comportement des citoyens.......................15 Mesure 3.5 : Mutualisation d’études pour faire progresser le covoiturage............................16 Annexe 3 : La question du contrôle du covoiturage.................................................................17 Annexe 4 : Le rôle des différents acteurs................................................................................18 Annexe 5 : Contributions détaillées des membres du GT .......................................................19 Gabriel PLASSAT, Ademe Julie GOZLAN, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère des Transports
- 3. 2 our le covoiturage longue distance, Blablacar a démontré qu’il est possible de créer un niveau de confiance suffisant pour accepter de monter dans la voiture d’un inconnu et de changer les comportements à grande échelle. La prochaine étape devient possible. Le covoiturage courte distance, au quotidien, est devenu la frontière à explorer en matière d’innovation. Au niveau mondial, des acteurs puissants, comme Waze-Google, Didi ou Uber, lèvent des millions et s’organisent actuellement pour tenter d’accompagner ces changements de comportements et nouer une relation forte avec les citoyens, avec les automobilistes, avec les usagers des transports en commun. Le gisement de gains est énorme, tant au niveau des bénéfices énergétiques et environnementaux, qu’au niveau économique. Les places vides en circulation dans les véhicules privés représentent plusieurs milliards d’euros inutilisés de transport « collectif ». Il ne s’agit pas d’innovation technologique mais d’une combinaison inédite d’innovations : sociale, modèle d’affaires, juridique et institutionnelle. En France, notre écosystème est probablement un des plus riches et fertiles. Toutes les parties y sont représentées avec des solutions déjà opérationnelles à des échelles modestes. Les risques à ne pas réussir à faire émerger des acteurs français ou européens du covoiturage courte distance sont grands au regard de son impact dans la vie quotidienne des citoyens et des effets de bord possibles avec les transports collectifs publics. Nous savons maintenant ce que signifie d’avoir une ou plusieurs plateformes dominantes étrangères dans un secteur industriel. La Mobilité ne doit pas être le prochain champ d’action dominé par les GAFA. Mettre au moins deux personnes dans un nombre croissant de voiture doit nous occuper tout autant, et sans doute plus, que le développement de voiture électrique ou consommant 2 l/100 km. Pour que ce changement, qui semble si simple, se réalise, nous proposons de combiner une large communication, des évolutions réglementaires, des expérimentations dans tous les types de territoires et un système de preuve unifié pour simplifier la mise en œuvre d’incitatifs à grande échelle venant de toutes les parties prenantes. C’est donc bien une opportunité unique pour réussir ce qu’aucun acteur seul n’est capable de faire et ainsi créer un nouveau mode de transport collectif efficace pour tous les citoyens dans tous les territoires. Enfin, tout doit être mis en œuvre pour permettre aux opérateurs français d’exporter ce savoir-faire dans d’autres pays le plus rapidement possible. Le mot du président du groupe d’experts, Gabriel PLASSAT, Ademe P
- 4. 3 Diagnostic et besoins identifiés Le covoiturage est défini au Code des transports (article L. 3132-1) comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Les membres du GT s’accordent pour travailler dès à présent dans ce cadre. En complément, il ressort qu’une étude doit être menée concernant une 3e catégorie de transport qui se situerait entre le covoiturage, tel que défini aujourd’hui, et le transport professionnel de personnes (voir le chapitre 3.). Le covoiturage moyenne et longue distance est actuellement bien développé notamment via des opérateurs privés. À l’inverse, le covoiturage courte distance, dont le domicile-travail, possède à la fois un potentiel supérieur mais un développement aujourd’hui plus faible en France et au niveau mondial. En effet, des freins au développement du covoiturage de proximité existent. Il s’agit principalement du faible intérêt financier (réel ou perçu) pour le conducteur comme pour le passager, de la difficulté à gérer des changements sur des trajets quotidiens que les plateformes de mise en relation cherchent à surmonter au travers des systèmes d’évaluation des usagers, des contraintes plus fortes de déplacement (respect d’horaires de travail), ainsi qu’une potentielle incertitude quant au trajet retour (risque d’empêchement du conducteur). Le développement du covoiturage courte distance est considéré comme un axe à fort potentiel, et certains éléments de la réponse seront à adapter selon les spécificités des territoires tout en développant des solutions techniques réplicables pour mieux généraliser l’usage avec le maximum d’éléments standards. Cet équilibre est donc à trouver entre adaptation aux territoires, atteinte des masses critiques locales, et modèle d’affaires pour les opérateurs. Les collectivités ont un rôle à jouer dans l’émergence, le soutien de ces services et la mise en œuvre d’une combinaison d’incitatifs. Aucun acteur n’est capable d’agir seul, il s’agit que chacun agisse dans sa zone de compétence en se coordonnant au mieux avec les autres parties prenantes. Les différentes réflexions en cours sur le sujet ont confirmé la pertinence d’encourager la pratique, en complémentarité des transports collectifs, et non en concurrence. Le covoiturage apparaît comme une solution de transport efficace en zone peu dense, la nuit, ou sur certaines liaisons périurbaines, hors du domaine de pertinence des transports collectifs, ou en remplacement de certains services de transport à la demande (TAD). En zone dense, il est souhaitable de se focaliser en priorité pour améliorer les rabattements vers les systèmes de transports collectifs, en une combinaison de bus et covoiturage et sur les réseaux routiers structurants faisant l’objet d’une congestion récurrente. Le covoiturage comme l’autopartage se développe sur un territoire quand une masse critique d’utilisateurs est atteinte avec, en général, plusieurs opérateurs qui sont à la fois en concurrence et en synergie pour faire changer les pratiques. Le covoiturage se présente donc comme une solution majeure à développer pour réduire rapidement : • la consommation d’énergie ; • les externalités négatives (pollution, bruit, GES) ; • la congestion en redistribuant l’espace public vers d’autres modes ; • la possession automobile et ainsi augmenter l’utilisation des transports publics et modes actifs.
- 5. 4 Orientations stratégiques proposées par le groupe Les membres du groupe proposent d’agir sur 3 volets simultanément : Créer un élan national autour d’un label « covoiturage en France » (ex. : 2par.auto, le Covoiturage Français…) : le système, à la fois label et plateforme technique, permet de distribuer à grande échelle des incitatifs, élément essentiel pour changer les comportements. Les opérateurs ainsi agréés y feront automatiquement converger les preuves de covoiturage, permettant aux autorités administratives de délivrer des avantages monétaires ou non monétaires sans risque de fraude massive. • Start-up d’État pour piloter le développement technique de façon ouverte et mutualisée, • Outre les preuves fournies aux autorités administratives, l'API met en visibilité l'offre dans les moteurs de recherche et calculateurs d’itinéraires (sur le modèle développé dans Vianavigo par IdFM). Une telle API rendra visible l’offre de covoiturage dans les principales applications de mobilité sur Smartphone et encouragera donc significativement son développement. • La marque est le support de toute la communication au niveau État « Devenez acteur de la transition, partagez votre véhicule en choisissant un opérateur agréé ». • À terme, le système pourra rendre interopérables les opérateurs volontaires (ex. : réserver un trajet sur A depuis l’application de B), en étendant l’API à la possibilité de réserver. Créer un cadre clair pour que chaque acteur (collectivité, entreprise, état …) puisse jouer pleinement son rôle pour inventer le covoiturage au quotidien dans son territoire • Autonomie des territoires : − Dans le cadre du SRADDET pour un pilotage régional, application du principe de subsidiarité dans les actions visant à aider à déployer un ou plusieurs opérateurs, à aménager des aires de stationnement pour le covoiturage, communiquer et à inciter; − Intégration obligatoire du covoiturage dans les DSP. • Bouquets d’incitatifs adaptés aux conditions locales en s’appuyant sur toutes les parties prenantes affiliées au label (2par.auto). L’effort sera réparti entre : − les entreprises combinent la mise en œuvre d’une IK covoiturage facultative (évaluée pendant un an) et le renforcement du covoiturage dans les plans de mobilité ; − les collectivités proposent des stationnements à des tarifs réduits, l’utilisation des voies dédiées et du Versement Transport (VT) en expérimentation en commençant par le remplacement de service de TAD ; − l’État met en place un bonus 100 €/ an sur la base de 100 € de preuve1 ; − en complément, les obligés au titre des CEE pourront utiliser les preuves pour financer le covoiturage via les CEE et les concessions d’autoroutes pourront adapter des tarifs de péage pour les covoitureurs. • Faire levier sur les données : − l’adhésion au label (2par.auto) offre la garantie d’un traitement loyal des données personnelles collectées par les opérateurs et l’État ; 1 Ce bonus est inférieur aux externalités estimées : congestion, pollution, CO2, bruit, comprises entre 200 et 2 000 €/an/voiture.
- 6. 5 − Les données domicile-travail contenues dans le système d’information des Déclarations Sociales Nominatives (DSN) des employeurs seront anonymisées et diffusées en open data pour aider à cibler les opportunités de transition. Expérimentons et apprenons plus vite ensemble L’écosystème français des acteurs du covoiturage est un des plus riches au monde. Tous les acteurs ont compris que nous réussirons ensemble en mutualisant et partageant chaque retour d’expérience : • l’État pour l’Appel à Manifestation d’Intérêt qui sera lancé prochainement en vue d’identifier des collectivités candidates pour accueillir des expérimentations, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains dans lesquels l’innovation peut contribuer efficacement à faciliter la mobilité de tous ; • Ademe pour le fonds Qualité de l’Air et Mobilité Durable : droit à l’expérimentation avec un cadre et partageons les résultats ; • la Fabrique des Mobilités pour la mise en relation des offres et demandes, l’animation, la capitalisation des retours d’expérience, la gestion des ressources open sources et la mise en œuvre de guides pour les collectivités avec le CEREMA. Objectifs : En coordonnant ces mesures dès 2018, il est possible d’augmenter le remplissage moyen des véhicules en circulation. Avec un remplissage aujourd’hui de l’ordre de 1,08 personne par voiture dans les déplacements quotidiens, des objectifs de remplissage ambitieux en 2020 et 2025 (par exemple 1,2 puis 1,5) pourraient être fixés en fonction de la densité des territoires.
- 7. 6 Principales mesures proposées Mesure 1 Créer un élan national Un élan national sur le covoiturage (notamment sur les aspects tiers de confiance, sécurité et incitation) est mis en œuvre à travers une communication nationale, une définition plus précise du covoiturage et un label (2par.auto par exemple). Mesure 2 Créer un cadre clair pour que chaque acteur (collectivité, entreprise, État…) puisse jouer pleinement son rôle pour inventer le covoiturage au quotidien dans son territoire Le covoiturage quotidien réussira si des masses critiques locales sont atteintes avec des différences selon les territoires. Tout en créant un label national (mesure 1), il est proposé de donner un maximum de liberté aux acteurs locaux car ils connaissent bien les besoins et les contraintes, pour initier, sélectionner les meilleurs opérateurs de covoiturage et expérimenter des solutions qui correspondent aux besoins des citoyens. L’autonomie des collectivités doit porter sur la compétence, sur les incitatifs à adapter localement et si besoin sur le lancement d’une offre de covoiturage. En même temps, il est nécessaire pour les collectivités territoriales de se coordonner, afin de permettre l’émergence de plusieurs masses critiques localisées pour simplifier le déploiement d’offres. Mesure 3 Expérimentons et apprenons plus vite ensemble L’écosystème français des acteurs du covoiturage est un des plus riches au monde en nombre, diversité et développement. Par ailleurs, tous les acteurs ont compris que nous réussirons ensemble en mutualisant et partageant chaque retour d’expérience. Les expérimentations permettront de qualifier et quantifier des solutions de covoiturage, des choix de gouvernance et d’incitations. Chaque expérimentation sera évaluée et partagée au niveau de sa rentabilité, son équité d’accès notamment au regard du numérique, de son potentiel de développement dans tous les territoires notamment ceux peu connectés. Les développements techniques du système de preuve et d’API unifié seront également évalués.
- 8. 7 Annexes Annexe 1 : Présentation générale de la démarche Composition du groupe de travail Le choix a été fait d’un atelier avec une formation plénière regroupant une trentaine de participants représentatifs du secteur et en format suffisamment restreint afin de permettre à chaque membre de s’exprimer et de contribuer collectivement : Administrations (DRI, DGITM, DGCCL et DSR), CEREMA, start-up, associations de covoiturage, associations d’élus, IdF Mobilités, régions, Ademe, Etalab/start-up d’État… Le groupe de travail était composé des participants suivants : Gabriel Plassat - Président/Animateur du groupe, Ademe et Fondateur de la Fabrique des Mobilités Julie Gozlan – Chef de projet du groupe, DGITM Cédric Grail, DGITM Olivier Binet, KAROS Alain Jean, REZOPOUCE Bénédicte Rozes, REZOPOUCE Julien Honnart, WAYZUP Alexandre Jeanpetit, WAYZUP Laurent, OUIHOP Franck Rougeau, OUIHOP Mathieu Jacquot, Covivo/Roulez Malin Yann Hervouet, Instant-system Marie Martese, LA ROUE VERTE Erwan Brodin, Ecolutis Jérémy Lamoriniere, IDVROOM Frédérique Ville, IDVROOM Jean Dampierre, CITYWAY Nicolas Tronchon, Transportdoux.fr Thomas, tymate.com Albane Durand, Ehop-covoiturage Ophélie Bigot, Ehop-covoiturage Bruno Renard, CEA Romain Cipolla, GART David Delcampe, CEREMA Grégoire Carrier, CEREMA Jean ROBERT, CEREMA Marina Lagune, DGITM/EP3 Frédéric Bisson, ONEPLUSONE Thomas Matagne, ECOV Fabienne Weibel, Blablacar Diane Prebay, Blablacar Frédéric Mazzella, Blablacar David Herrgott, Régions de Fance Florent PORTMANN, CNPA Pierre Pezziardi, Etalab Olivier Vacheret, IdF Mobilités David O'Neill, IdF Mobilités PatriceDecoen, Microstop Mathieu Gardin, OXYCAR Nicolas Sproni, DGITM/DIT/GRN/GRT-ES Denis Collin, LESS (anciennement PALTO) Yann Tremeac, Ademe Marie-France Vayssieres, KEOLIS Jean Coldefy, c3i Anne Cambon, Région Auvergne-Rhône- Alpes Tristan Roussel, Feduco Jean-Marie Carrara, Govoit Yvan Martinod, CD Isère Karim Ait-youcef, WIMOOV Patrick Robinson Clough, Citygoo Gaëlle Paternotte, Ddgitm Marion Gust, CGDD Laurence Matringe, DGITM
- 9. 8 Méthode de travail retenue Trois réunions du groupe de travail ont eu lieu pendant la période des Assises de la mobilité et une en amont : le 7 septembre 2017, le 4 octobre 2017, le 8 novembre 2017 et le 28 novembre 2017. Plusieurs modalités ont été mises en place pour recueillir les propositions de mesures des acteurs souhaitant en faire part à l’atelier d’expert. Plusieurs auditions ont été organisées : Rézopouce, les avocats de « Droit du partage », Heetch.. En complément de ces auditions, un questionnaire a été mis en place pour permettre notamment aux personnes n’ayant pu ou voulu participer aux auditions de pouvoir proposer des mesures. Plusieurs séances de travail ont été mises en place entre le président et la DGITM, le président et des collectivités, le président et les associations d'élus.
- 10. 9 Annexe 2 : Propositions détaillées des mesures prioritaires Fiche de proposition n° 1 : Mesure 1 : Créer un élan national Un élan national sur le covoiturage (notamment sur les aspects tiers de confiance, sécurité et incitation) est mis en œuvre à travers une communication nationale, une définition plus précise du covoiturage et un label (2par.auto par exemple). Les incitatifs sont développés à la mesure 2. Mesure 1.1 : Une communication nationale La communication nationale s’appuiera sur les expérimentations en cours dans les territoires pour les mettre en visibilité, souligner la complémentarité de toutes les parties prenantes, rappeler les bénéfices collectifs et individuels du covoiturage à tous les niveaux (sociaux, environnementaux, énergétiques). Cette campagne sera destinée aux usagers, notamment automobilistes, entreprises et collectivités. Mesure 1.2 : Une définition plus précise du covoiturage pour les collectivités, l’État et les opérateurs Mieux expliciter la notion de partage de frais dans la définition actuelle du covoiturage. Créer dans le code des transports un article réglementaire R. 3132-1 : « Le partage de frais mentionné à l’article L. 3132-1 du même code repose sur le partage du coût entre les utilisateurs du véhicule, à l'échelle du trajet, en retenant comme coût à partager pour tout type de véhicule la valeur du barème kilométrique tel que défini par le code général des impôts CGI à l'article 6B de l'annexe IV pour les véhicules d'une puissance administrative de 5 CV pour un kilométrage professionnel inférieur à 5 000 km. » Mesure 1.3 : Le label et La preuve de covoiturage Le système, à la fois label et plateforme technique, permet de distribuer à grande échelle des incitatifs (décrits au chapitre 2), élément essentiel pour changer les comportements. Le sujet de la preuve de covoiturage a été identifié comme crucial. Dans un premier temps, le label sera attribué gratuitement aux opérateurs capables de valider des actes de covoiturage réels. Puis le label pourra être étendu à d’autres tiers de confiance capable de valider des actes de covoiturage. C’est aussi une solution technique qui va permettre à tous les opérateurs de donner un certificat au passager, au conducteur et au véhicule en précisant l’heure et éventuellement l’origine/destination du covoiturage. En s’appuyant sur l’étude réalisée par les opérateurs dans la Fabrique des Mobilités, en mutualisant ce développement, ce dispositif technique devient un standard à la fois pour les opérateurs et les autres parties prenantes (collectivités, acteurs économiques, utilisateurs…). Il est potentiellement exportable, facilitant le développement des opérateurs à l’international. Grâce à cette preuve, le passager et le conducteur pourront recevoir des incitatifs. Les covoitureurs pourront notamment bénéficier de mesures applicables à la voiture qu’ils auront désignées, dans le système 2par.auto. La preuve sera associée au départ aux plateformes, seules capables de produire des données permettant d’industrialiser ce certificat associé à un horodatage heures/lieu. Les opérateurs ainsi agréés y feront automatiquement converger les preuves de covoiturage, permettant aux autorités administratives de délivrer des avantages monétaires ou non monétaires sans risque de fraude massive.
- 11. 10 Le système technique sera mis en œuvre en deux temps : • Développement du module de preuve (API et CGU) avec les opérateurs volontaires sur 6-10 mois et un financement public par une start-up d’État. Ce dispositif est essentiel puisqu’il permet de certifier un covoiturage et de faciliter la mise en œuvre d’incitatifs par tous les acteurs dont les collectivités territoriales. En parallèle, standardisation des données et diffusion de l’API du STIF comme 1er niveau de standardisation à faire converger avec les données utilisées pour l’API du STIF. Dans les territoires peu denses, en dehors des opérateurs privés, dans un second temps, le système de preuve pourra s’appuyer sur d’autres tiers de confiance. • Avec les opérateurs volontaires, développement et intégration dans une plateforme d’agrégation nationale « 2par.auto » intégrant la preuve et permettant aux opérateurs de se regrouper pour offrir aux citoyens (en plusieurs étapes) un service simplifié (inscription, information, utilisation, paiement, incitations). Il est proposé de créer un GT avec les volontaires pour décrire les fonctions minimales communes. Les zones blanches et les personnes en situation de fracture numérique ne doivent pas être oubliées. L’État doit permettre d’accélérer la connectivité numérique des territoires peu denses et de leurs habitants, en renforçant par exemple les obligations des opérateurs en matière de couverture haut-débit. Fiche de proposition n° 2 : Mesure 2 : Créer un cadre clair pour que chaque acteur (collectivité, entreprise, État…) puisse jouer pleinement son rôle pour inventer le covoiturage au quotidien dans son territoire Le covoiturage quotidien réussira si des masses critiques locales sont atteintes avec des différences selon les territoires. Tout en créant un label national (mesure 1), il est proposé de donner un maximum de liberté aux acteurs locaux car ils connaissent bien les besoins et les contraintes, pour initier, sélectionner les meilleurs opérateurs de covoiturage et expérimenter des solutions qui correspondent aux besoins des citoyens. Le sujet de l’expérimentation est développé à la mesure 3. L’autonomie des collectivités doit porter sur la compétence, sur les incitatifs à adapter localement et si besoin sur le lancement d’une offre de covoiturage. En même temps, il est nécessaire pour les collectivités territoriales de se coordonner, afin de permettre l’émergence de plusieurs masses critiques localisées pour simplifier le déploiement d’offres. Mesure 2.1 : Ouvrir la compétence covoiturage à toutes les échelles des territoires Les différentes échelles, départements, régions, communes, Communautés de Communes (cf. Annexe le tableau détaillant les rôles des acteurs) ont un rôle à jouer. La gouvernance du covoiturage est à assurer par les acteurs publics à la bonne échelle du territoire. Il s’agit de faire levier au mieux de la multitude d’offres en combinant des incitatifs locaux pertinents pour présenter des solutions simples aux citoyens. Il est proposé de donner une totale subsidiarité dans ces actions et ces incitations pour mettre en œuvre des mesures et incitations adaptées aux conditions locales. Sur un territoire, plusieurs opérateurs de covoiturage pourront agir et se développer sans aucun problème. Parmi les actions identifiées pour les territoires, nous retrouvons : ˗ mettre en œuvre des infrastructures (stationnement, aires, voies dédiées) ; ˗ mettre en œuvre des actions d’incitations et de communication ;
- 12. 11 ˗ mettre en œuvre une démarche de suivi et d’évaluation ; ˗ aider à déployer un ou plusieurs opérateurs de covoiturage ; ˗ si besoin, porter et faire vivre une plateforme publique en mise en relation. La région est chargée d’élaborer un Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Il est proposé que le développement du covoiturage soit intégré dans ce schéma en rassemblant toutes les parties prenantes dans un comité régional du covoiturage. Cela permettra à la fois à chaque territoire de développer des solutions adaptées tout en construisant une démarche régionale homogène. • Proposition : élargir la compétence « covoiturage » à tous les échelons en raison des spécificités des territoires pour développer le covoiturage quels que soient les besoins ou l’intérêt de la collectivité (social, transport, culture…), organiser la coordination en mettant en avant la région comme chef de file qui facilite, mutualise, capitalise les retours d’expérience, standardise. L’AMI Mobilités et le fonds mobilités permettront d’expérimenter (voir mesure 3). • Proposition : hors des ressorts territoriaux des AOM urbaines, laisser la région s’appuyer sur des autorités organisatrices de « second rang » (AO2), à qui la compétence « covoiturage » a été déléguée pour mettre en œuvre concrètement la stratégie élaborée dans le cadre du SRADDET. • Proposition : veiller à inclure obligatoirement une ou des offres de covoiturage même si le covoiturage est organisé par une autre autorité covoiturage dans les DSP. • Proposition : donner les compétences à l’AOM pour organiser le covoiturage en l’absence d’offres privées (au même titre que l’autopartage). Modifier l’article L. 1231-15 du Code des transports qui indique actuellement : « (...) En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les autorités mentionnées à l'article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plateformes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d'un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d'attribution ». Proposition de modification : « (…) En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent créer un service public du covoiturage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1 ». Si l’AOM a cette nouvelle compétence, elle pourra alors utiliser le VT en fixant des limites (nombre de trajets, horaires, lieux) en conservant la notion de partage de frais. Exemples : • Le covoit’STAR à Rennes met en contact les automobilistes et les clients du réseau STAR de la ligne 64 (2 lignes de covoiturage avec 9 arrêts stratégiques et un signe distinctif de reconnaissance) et Boogi (covoiturage dynamique) à Bordeaux connecté au réseau de transport. Les conducteurs cumulent des points et accèdent également à des places réservées dans tous les parcs relais P+R. • À Avignon, entre Les Angles et Villeneuve, covoitureurs et covoiturés sont mis en relation via une application mobile offrant une géolocalisation en temps réel des utilisateurs. Les conducteurs peuvent s'inscrire sur www.popcar.fr (FleetMe par Transdev). Les conducteurs qui participent à ce dispositif sont indemnisés (2 euros) à chaque trajet
- 13. 12 même effectué à vide et voient leur « rémunération » augmenter en fonction du nombre de passagers transportés (0,50 euro par passager). Pour les passagers, le coût est équivalent au prix d'un ticket de bus soit 1,40 euro par trajet. • Le département du Val d'Oise, le Parc Naturel Régional du Vexin, la CU Grand Paris Seine et Oise se sont regroupés à partir de 2015 pour expérimenter un service public de covoiturage, avec des stations de covoiturage connectées et un service en ligne (site web, appli mobile), sous le nom COVOIT'ICI. Le dispositif est porté et financé par ces acteurs publics, en coopération avec l'opérateur Ecov, et repose sur l'adaptation et la connexion à internet de l'infrastructure pour permettre la participation spontanée des conducteurs. Mesure 2.2 : Déployons un bouquet d’incitatifs grâce à la preuve de covoiturage et l’implication de tous les acteurs : entreprises, État, collectivités… Les entreprises Les entreprises ont plusieurs intérêts à développer le covoiturage : ˗ le covoiturage est un moyen indirect d’augmenter le pouvoir d’achat en générant des économies quand les pratiques sont installées ; ˗ l’entreprise agrandit son bassin d’emploi ; ˗ les salariés qui covoiturent arrivent le matin moins fatigués et stressés ; ˗ réduit le besoin de stationnement ; ˗ politique RSE de l’entreprise, action concrète liée au PDM. • Proposition : mettre en place une indemnité Kilométrique covoiturage : Comme l’abonnement TC, il est proposé d’intégrer le covoiturage, de façon facultative, dans la prise en charge par les entreprises des frais de transports domicile-travail pour les salariés et permettre aux salariés de conserver leurs indemnités kilométriques domicile-travail lorsqu’ils covoiturent et d’utiliser un véhicule de service. Le montant de l’IK covoiturage devra être calculé de telle sorte qu’il soit beaucoup plus avantageux pour un salarié de covoiturer, même s’il touche des IK en conduisant seul2 . • Proposition : mettre un plafond de 500 € exonéré de charge par salarié (conducteur et passager), correspondant à environ 500 trajets/an ; Ce montant de 500 € pourra être évalué pendant 1 an pour éventuellement l’ajuster3 . • Proposition : supprimer les attestations URSAFF4 de non covoiturage qui indiquent « Le salarié doit en outre attester qu’il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. » ; • Proposition : de ne plus interdire et même d’encourager la pratique du covoiturage, soit dans leur règlement intérieur, soit dans le contrat de travail du salarié lorsque celui-ci prévoit l'utilisation d'un véhicule de fonction. 2 exemple au CNFPT : http://www2.cnfpt.fr/sites/default/files/note_information_frais_transports_aout_2014_-_maj_01_17_1.pdf 3 Si le plafond était porté par exemple à 1000 € / an / salarié, il permettrait à une entreprise de rembourser à 100 % un salarié qui covoiturerait presque les jours (500 trajets de 20 km à 0,10 € / km) et à 50 % un salarié qui covoiturerait presque tous les jours mais habiterait à 40 km de son travail. 4 URSSAF https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais- professionnels/les-frais-de-transport/trajet-domicilelieu-de-travail/prise-en-charge-facultative-des/versement-dindemnites- kilometriq.html
- 14. 13 Pour les entreprises de plus de 100 travailleurs, au 1er janvier 2018, un plan de mobilité doit être réalisé intégrant des mesures de promotion des nouvelles mobilités et téléactivités. Proposition : obligation d'une action « covoiturage » dans les Plans de Mobilité. Proposition : favoriser les entreprises actives en matière de PDM par des exonérations de charges pour la prise en charge par les employeurs de coûts liés au covoiturage. L’État Les avantages pour l’État : ˗ réduction des externalités sans investissement lourd ; ˗ solution performante quelles que soient les énergies utilisées ; ˗ mise en œuvre immédiate avec des bénéfices rapides ; ˗ équité d’accès et réduction de la précarité dans la mobilité. • Proposition : création d’un bonus covoiturage de 100 € / an sur la base de 100 € de preuve de covoiturage. Ce bonus est inférieur aux externalités estimées : congestion, pollution, CO2, bruit, comprises entre 200 et 2 000 €/an/voiture – source CGDD5 - CEDD6 . Ce bonus pourrait être alimenté par une partie des taxes sur les produits pétroliers et basculé sur un crédit d’impôt en 2019. Dans un second temps et en complément, un ciblage plus précis pourrait être adressé pour les personnes qui se séparent de leur voiture et qui deviennent passager. Les collectivités Elles sont capables de proposer une multitude d’incitatifs sous plusieurs formes. Combinés entre eux, ils peuvent agir pour changer les comportements dans tous les territoires. • Propositions concernant le stationnement : ˗ proposer des solutions de stationnement incitatifs pour les covoitureurs en s’appuyant sur la preuve pour certifier l’acte ; ˗ modifier l'article L. 2333-87 du CGCT sur le stationnement payant sur voirie pour rendre plus explicite le fait que les recettes peuvent être utilisées pour des opérations visant à développer le covoiturage ; ˗ définir plus précisément le champ d’application des schémas de développement des aires de covoiturage notamment en dehors des ressorts territoriaux des AOM. Une base de données mutualisées des aires de covoiturage est en cours de production dans la Fabrique des Mobilités ; ˗ identifier et développer des points d’embarquement et de débarquement dédiés au covoiturage qui respectent la sécurité et les flux des différents véhicules, en mentionnant le covoiturage aux articles L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2213-3-1 du CGCT et aux articles R. 411-19-1 et R. 417-10 du Code de la route ; ˗ inclure le covoiturage dans le Code de la route et définir une catégorie de contravention ; ˗ il sera également nécessaire de s’appuyer sur les aires existantes pour produire une charte d’aménagement. L’article 53 de la LTECV stipule que les sociétés 5 Page 26 : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20- %20Analyse%20co%C3%BBts%20b%C3%A9n%C3%A9fices%20des%20v%C3%A9hicules%20%C3%A9lectriques.pdf 6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/CEDD%20-%20S%20030.pdf
- 15. 14 concessionnaires d’autoroutes s’engagent dans la création de places de covoiturage adaptées aux besoins identifiés. • Propositions concernant les voies réservées : Elles constituent un levier puissant en donnant un avantage aux covoitureurs et généralement en créant une contrainte pour les autosolistes. Le contrôle de l’accès aux voies réservées s’appuiera sur la preuve elle- même associée au véhicule par son numéro de plaque. D’autres solutions de contrôle seront compatibles et pourront être mises en œuvre de façon complémentaires (voir Annexe sur ce sujet). • Expérimenter avec les territoires volontaires l’utilisation du VT pour développer le covoiturage, notamment en alternative aux services de TAD. Pour cela, si l’AOM a cette nouvelle compétence, elle pourra alors utiliser le VT en fixant des limites (nombre de trajets, horaires, lieux) en conservant la notion de partage de frais. • Mettre en place des incitatifs locaux : indemnisation directe via un système de gratifications de « points » ou monnaie locale. Les obligés des CEE Le covoiturage est une solution qui permet des économies d’énergies. • Proposition : Les obligés pourront apporter des incitatifs aux personnes qui covoiturent en s’appuyant sur la preuve de covoiturage qui vient ici certifier l’acte et quantifier le gain énergétique, ainsi qu’aux collectivités. • Proposition : Les obligés pourront financer, par l’achat de Certificats d’Économies d’Energie aux collectivités ou AOM, les dépenses que celles-ci réaliseront pour la mise en œuvre de Programmes d’Information référencés, mentionnés à l’article L. 221-7 b du Code de l’énergie, appliquées aux actions favorisant la mobilité économe en énergies fossiles. Les concessions d’autoroutes Par l’article 38 LTECV intégré dans L. 122-4, il est possible d’adapter les tarifs de péage pour les covoitureurs. • Proposition : Un système de contrôle (voir Annexe dédiée) pourra être réalisé par lecture de plaque couplée au système de preuve. Mesure 2.3 : Faire levier des données Les données générées par les plateformes des opérateurs, celles liées aux preuves de covoiturage apporteront de nouvelles connaissances aux collectivités et à l’État pour gérer et prévoir. Des données gérées dans le système des Déclarations sociales nominatives (adresses domicile - travail) pourront être travaillées par Etalab pour une mise en open data. Ces données permettront aux parties prenantes de faciliter la création de masses critiques : • Proposition : En développant une certification centralisée via 2par.auto, les données liées à chaque covoiturage seront gérées par l’État qui garantit alors un traitement loyal de ces données par Etalab. • Proposition : En complément, l’exploitation des données domicile-travail existantes (identité du salarié, adresses domicile-travail, mode de transport) contenues dans le système d’information des Déclarations sociales nominatives (DSN) des employeurs, pourront être publiées en open data par Etalab pour ainsi améliorer la création de masses critiques localisées très utiles pour les automobilistes, les opérateurs de covoiturage et les collectivités.
- 16. 15 Fiche de proposition n° 3 : Mesure 3 : Expérimentons et apprenons plus vite ensemble L’écosystème français des acteurs du covoiturage est un des plus riches au monde en nombre, diversité et développement. Par ailleurs, tous les acteurs ont compris que nous réussirons ensemble en mutualisant et partageant chaque retour d’expérience. Les expérimentations permettront de qualifier et quantifier des solutions de covoiturage, des choix de gouvernance et d’incitations. Chaque expérimentation sera évaluée et partagée au niveau de sa rentabilité, son équité d’accès notamment au regard du numérique, de son potentiel de développement dans tous les territoires notamment ceux peu connectés. Les développements techniques du système de preuve et d’API unifié seront également évalués. Mesure 3.1 : L’Appel à Manifestation d’Intérêt Cet AMI sera lancé en 2018 en vue d’identifier des collectivités candidates permettra d’accueillir des expérimentations, en particulier dans les territoires ruraux et périurbains dans lesquels l’innovation peut contribuer efficacement à faciliter la mobilité de tous. Mesure 3.2 : La mise en œuvre d’un Fonds Mobilité Ce fonds de l’Ademe donnera un droit à l’expérimentation pour les AO avec un cadre pour mieux capitaliser les retours d’expérience. • Proposition : permettre à tous les acteurs d’expérimenter des services de covoiturage (versement d’indemnités aux conducteurs et aux passagers, stationnement…), via l’AMI et le Fonds Qualité de l’Air et Mobilité de l’Ademe ou d’autres guichets de financement, en exploitant tous les schémas possibles d’innovations publiques décrit dans le guide La commande publique au service de l’innovation7 . Mesure 3.3 : La mise en œuvre un système léger et agile Il s’agit de mettre en relation des offres venant des opérateurs et demandes venant des collectivités pour faciliter les expérimentations, l’animation, la capitalisation des retours d’expériences, la gestion des ressources open source et la mise en œuvre de guides pour les collectivités avec le CEREMA. • Proposition : utiliser la Fabrique des Mobilités et créer une base documentaire en ligne (de type wiki) mise à jour en continu par les acteurs pour les collectivités territoriales (méthodologique, contenus d’une DSP « mobilité » et possibilité d’intégrer du covoiturage : conseils, retours d’expérience, résultats obtenus, rentabilité des aides publiques, aide au choix des incitatifs, aide à la communication…) ; chaque projet aidé dans le fonds devra nourrir le wiki. Mesure 3.4 : Accompagner les changements de comportement des citoyens Il s’agira de s’appuyer sur des réseaux d’acteurs locaux (associations, conseillers en mobilités, plateformes de mobilité type Wimoov) pour garantir une équité d’accès et une communication réussie vers tous les publics. • Proposition : impliquer ces réseaux dans la campagne de communication (mesure 1) et les expérimentations, leur permettre de mutualiser des ressources pédagogiques. 7 https://fr.slideshare.net/FabMob/transport-intelligent-la-commande-publique
- 17. 16 Mesure 3.5 : Mutualisation d’études pour faire progresser le covoiturage • Proposition : Pour poursuivre les études en cours comme celle récemment réalisée par l’Ademe avec le GART et le CEREMA sur le covoiturage Régulier8 , il est proposé de mutualiser toutes les études visant à faire progresser les pratiques du covoiturage. • Proposition : Mener une étude/une analyse avec des partenaires européens pour explorer la création d’une 3e catégorie de transport qui se situerait entre le covoiturage, tel que défini aujourd’hui, et le transport professionnel de personnes, donc un transport occasionnel, rémunéré et effectué par des conducteurs non professionnels (inclus dans la catégorie « transports privés » dans le Code des transports). Cette étude devra intégrer à la fois les questions juridiques, économiques (notamment le montant maximum de rémunération pour le conducteur) pour cette économie du partage, et également les territoires dans lesquels ce type de transport rémunéré entre particuliers pourrait être limité (comme les zones peu denses et rurales, mais également les zones denses). • Proposition : réaliser une étude sur la fiscalité liée au covoiturage. Pour inciter un conducteur à laisser sa voiture et devenir passager, une indemnisation directe est à étudier via une évolution fiscale. En effet, l’adaptation du cadre fiscal constitue un des leviers fortement identifiés afin de lever des freins à la pratique du covoiturage : les contribuables qui déduisent en frais réels leurs trajets domicile - travail ont l'impression que s'ils passaient au covoiturage, ils perdraient en impôt les économies qu'ils feraient en réduisant le coût de leurs trajets, car leurs frais diminuant, leurs revenus nets imposés augmenteraient. Afin de lever ce frein au changement comportemental et encourager le covoiturage, l'étude d'un crédit d'impôt financé par une adaptation du barème fiscal kilométrique pourrait être envisagée. Il a été suggéré également de lancer également un benchmark sur les pratiques fiscales européennes en la matière. 8 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/developement-covoiturage-regulier-guide_8629_2.pdf
- 18. 17 Annexe 3 : La question du contrôle du covoiturage Afin d’encourager le covoiturage par des dispositifs incitatifs, le contrôle des véhicules en situation de covoiturage revêt une importance primordiale. Il est la condition nécessaire pour que des avantages soient accordés aux covoitureurs. La problématique du contrôle de l’usage des voies réservées constitue une condition incontournable de leur développement, si les usagers pratiquant le covoiturage y sont autorisés. Lancer une étude de faisabilité confirmant le cadre technique et juridique le plus approprié pour la mise en œuvre de dispositifs de contrôle performants des covoitureurs (pour ensuite l’homologuer en vue de son intégration au contrôle-sanction automatisé). Le contrôle via les numéros des plaques d’immatriculation semble le plus simple et Karos le fait déjà ; il va se développer notamment pour le stationnement. Cependant, au vu des difficultés apparemment rencontrées par la métropole lilloise pour sa mise en œuvre dans le cadre de son dispositif Écobonus (débats avec la CNIL), ce système de contrôle ne semble pas si évident que cela. Par ailleurs, les retours de nombreux pays ont montré que le seul contrôle vraiment efficace est le contrôle humanisé. Pour les zones à circulation restreinte, la possibilité de recourir à la constatation par vidéo- verbalisation semble suffisante pour ne pas chercher à lever (sans certitude de succès d’ailleurs) tous les obstacles à la mise en œuvre d’un contrôle sanction automatique (obstacles réglementaires et techniques). Le rapport du Gouvernement prévu à l'article 56 de la LTECV (sur voies existantes) prend position en faveur d'un contrôle effectif du taux d'occupation des véhicules par un système adapté qui a vocation à faire l'objet d'une homologation en vue d'une intégration au système de contrôle-sanction automatisé du ministère de l'Intérieur. Une expérimentation d'un dispositif de détection du taux d'occupation des véhicules (sans ouverture de voies réservées au covoiturage, à ce stade) est notamment envisagée par la DIRIF début 2018. La question des modalités de contrôle des avantages accordés aux covoitureurs est une question récurrente qui bloque de nombreuses actions d’incitation. Le contrôle reste très difficile pour le stationnement ou pour tout autre avantage qu’une collectivité voudrait proposer. De plus, un contrôle en temps réel conduit à une rigidité sur le régime des incitations. Un contrôle qui serait basé sur un régime déclaratif (statut de covoitureur par exemple) ne semble pas encore mûr.
- 19. 18 Annexe 4 : Le rôle des différents acteurs Tous les acteurs ont un rôle à jouer pour développer la pratique du covoiturage. Le tableau ci- dessous liste les domaines d’actions par type d’acteur à privilégier. Ainsi, par exemple, le développement d’une plateforme et son animation sont à réaliser par les opérateurs de covoiturage. La communication peut être réalisée par plusieurs acteurs privés et publics en se coordonnant. La gouvernance du covoiturage est à assurer à la fois par les acteurs privés et publics à la bonne échelle du territoire. Opérateurs de covoiturage État Région / Dpt Collectivités Entreprise / zone activité Développement d’une plateforme, animation, communauté X Inscription Front office X Connexion X Base de données Permis valide, casier, point conduite, puiss / N° plaque X X Conducteur / passager X 2par.auto Communication / Marketing Contenus / Media X X X X X (PDE, challenge mobilité) Preuve de covoiturage Développement X X Financement Incitatifs X X et obligés CEE X X via stationnement, voies, point, € X via IK Covoit et PDE Infrastructures Aires, signalétiques, voies X (aire, borne) X (stationnement, borne) X Partage Connaissances, Expérimentations, Retour d’expérience, suivi et évaluation Via Fonds Mobilité et wiki X X X X X
- 20. 19 Annexe 5 : Contributions détaillées des membres du GT Voies réservées au covoiturage Zone à circulation restreinte La constatation des contraventions Octobre 2017 Nota : Si cette note a été rédigée pour partie sur la base d’échanges antérieurs avec les services du ministère de l’Intérieur, elle méritera toutefois d’être confrontée à l’analyse juridique de la DSR (direction de la sécurité routière) et de la DLPAJ (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). 1. Le pouvoir de constatation Les policiers municipaux tiennent de l'article L.511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) le pouvoir de constater par procès verbal les contraventions au code de la route. L'article R.130-2 du code de la route fixe l'étendue des pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale dans ce domaine. L'usage des voies réservées au covoiturage (VR2+) et la circulation au sein des zones à circulation restreinte (ZCR) ne sont pas cités dans les exclusions. A noter également l'article 21 du code de procédure pénale et l'article R.2212-15 du code général des collectivités territoriales. 2. La constatation avec interception Elle peut être très peu efficiente en terme de sanction par rapport aux moyens humains sollicités. Elle peut être difficile à mettre en œuvre dans de bonnes conditions de sécurité si les vitesses sont élevées. VR2+ : peu adaptée sur VSA, le nombre de cas où les conditions de faisabilité seront réunies sera très faible. ZCR : adaptée, dans la plupart des cas. 3. La constatation sans interception Elle se fait par simple constatation (sur site). Elle fait appel à des moyens humains significatifs. Elle peut donner lieu à de nombreuses contestations. VR2+ : peu adaptée sur VSA, du fait des vitesses pratiquées ("contestabilité"). ZCR : adaptée, car la vérification des certificats qualité de l’air est possible à faibles vitesses.
- 21. 20
- 22. 21
- 23. 22
- 24. 23
- 25. 24
- 26. 25
- 27. 26
- 28. 27
- 29. 28
- 30. 29
- 31. 30
- 32. 31
- 33. 32
- 34. 33
- 35. 34
- 36. 35
- 37. 36
- 38. 37
- 39. 38 Pourquoi et comment faire décoller le covoiturage courte distance Jean Coldefy, expert indépendant sur les questions de mobilité Chargé de mission mobilité numérique à Transdev Directeur du programme Mobilité 3.0 ATEC ITS France 1 Pourquoi le covoiturage courte distance doit passer de la potentialité à la réalité 98% des déplacements sont locaux (< 80 km) et alors que nos agglomérations – de tailles très variables – se développent, accompagner leur développement pour en assurer l’accessibilité est une priorité absolue. Les deux décennies de 1970 à 1990 ont été celles de la construction d’un vaste réseau d’infrastructures routières, permettant cette accessibilité aux territoires, en voiture. Faute d’un urbanisme régulé, cette accessibilité routière s’est traduite par un allongement des distances – le budget temps de transport dans les pays développé étant une constante s’établissant à environ 1h/personne/j – et donc par l’étalement urbain. La conséquence a été les phénomènes de congestion routière massive aux heures de pointes – et de pollution aux NOx - compte tenu du nombre de véhicules et de la place occupée par la voiture : l’espace public est une ressource rare en zone urbaine. Pour remédier à cette situation, les responsables politiques ont alors engagé dans les années 1990, une politique de report modal, en construisant des réseaux de transports urbains en site propres, soit en métro pour les villes pouvant se les financer, soit en tramways ou en bus. Cette politique visait à offrir des alternatives crédibles à la voiture en termes de temps de parcours et à restreindre les espaces publics dédiés à la voiture. Les résultats en centres villes ont été importants avec des gains de parts modales significatifs, la plus belle réussite ayant été l’agglomération lyonnaise, avec une part modale équivalente à l’intérieur du périphérique entre la voiture et les transports en commun – 25% chacun -, les 50% restant étant assurés par le vélo et la marche à pied. Cependant, desservir les périphéries, indispensable pour accompagner le développement de nos agglomérations et assurer une inclusion urbaine et sociale, s’avère particulièrement difficile : Construire des TCSP en périphéries s’avère particulièrement complexe pour deux raisons simples : s’une part les TC sont pertinents et efficaces en zones denses et en périphéries en dehors de quelques pénétrantes cela n’est pas le cas, d’autre part la rareté de l’argent public. En effet l’usager ne paie aujourd’hui en France que 25% des couts d’exploitation des transports en commun (qui sont de 400 M€/an sur Lyon par exemple : nous avons affaire à des sommes considérables), alors que ce ratio était de 70% en 1975 : ainsi toute nouvelle infrastructure de transport en commun génère automatiquement un déficit d’exploitation de 75%. Si aujourd’hui les solutions à l’intérieur des périphériques pour assurer l’accessibilité sont connues et mises en place dans la plupart des agglomérations, même si beaucoup reste encore à faire, le problème d’accessibilité et de mobilité durable au-delà des périphériques demeure : Même une agglomération comme Lyon – qui est une agglomération riche - est aujourd’hui incapable d’assurer financièrement la desserte en TCSP du quart nord-ouest de l’agglomération, ou d’écarter le trafic de transit du centre-ville en finalisant son périphérique. Il faut ajouter à ce contexte la baisse du cout d’usage de la voiture. En effet si l’on compare 1970 à 2016, on peut s’acheter aujourd’hui 2,5 fois plus d’essence avec une heure de smic. La consommation des véhicules a par ailleurs été réduite de moitié sur la même période. Le prix du pétrole compte tenu de l’explosion à la hausse des réserves a été divisé par deux en quelques années et devrait durablement s’établir aux alentours de 55 $ le baril. Enfin, la mise sur le marché d’ici 2020 de véhicules urbains hybrides rechargeables par tous les constructeurs automobiles mondiaux va encore diviser par deux la consommation des véhicules (2l/100 km), avec qui plus est des véhicules propres en ville car fonctionnant à l’énergie électrique. En 2020, le cout d’usage de la voiture hybride rechargeable sera comparable à celui des transports en commun, même avec abonnement et participation à 50% de l’employeur. Le signal prix envoyé aux usagers est clair
- 40. 39 et produira inévitablement son effet : la circulation automobile augmente (c’est ce qui est constaté au-delà des périphériques) et augmentera si les pouvoirs publics restent inactifs. Est-ce à dire que nous sommes condamnés à une thrombose progressive de nos agglomérations, avec une saturation généralisée des réseaux de transports routiers et en communs, alors que les enjeux environnementaux n’ont jamais été aussi aigus ? 2 Les acteurs en présence et leurs objectifs Avant de détailler les propositions il convient de bien identifier les acteurs en présence et leurs objectifs. Pour les usagers, nous l’avons vu, la priorité c’est la vitesse et le cout du déplacement, modélisé depuis longtemps par les économistes par la notion de cout généralisé. Ceci n’exclut pas d’autres composantes comme le confort, la fiabilité, la sécurité. D’un point de vue des politiques publiques de mobilité, l’objectif c’est d’abord d’assurer l’accessibilité à la ville et ses pôles d’activités économiques, de loisirs, ... ce en limitant la consommation d’espace induite par la voiture et en utilisant judicieusement les fonds publics. Pour les opérateurs de mobilités – publics et privés -, une dizaine par grandes villes (transports en communs, parkings, vélos libre services, covoiturage, auto partage, régulateurs de trafics, trains régionaux), il s’agit de gagner de nouveaux clients et d’avoir des marges financières permettant d’investir et donc d’innover. Par ailleurs, nous l’avons vu, les transports en communs ont à faire face à une difficulté certaine : gagner des clients se fait à coûts croissants pour la collectivité. Le tableau suivant permet d’avoir une vue d’ensemble des couts d’exploitation et de leur financement selon les différents modes de transports : Mode Cout d’utilisation pour l’usager Vitesse moyenne constatée en Km/h Cout pour la collecti Vélo 0 à 100 €/an (<0.03€/km) 10 à 25 (VAE) Entretien de la voirie vélo) : 20 M€/an pou (Lyon, Lille par ex) Voiture 0.22€/km 5 (route congestionnée), 18 (route fluide en centre-ville), 30 (route fluide en périphérie) Transports en commun 0.10€/km (après participation employeur) 18 (bus/tram) 30 (métro) Ex : 400 M€/an pour voyageurs/j sur l’agglom Lyon, 60% payé par l’u net 160 M€/an TER 0.03€/km (après participation employeur) 60 400 M€/an pour 145 00 en Rhône Alpes pa Région Tableau des couts et vitesses par modes en agglomération (sources CEREMA, Métropole de Lyon, Sytral, Région Rhône Alpes, Jean Coldefy)
- 41. 40 3 Propositions pour le covoiturage courte distance Inciter à un usage partagé de la voiture, limiter les usages excessifs de la voiture Dans les agglomérations européennes le nombre de passager par voiture aux heures de pointes est de 1 personne. Les réserves de capacité de la voiture sont très importantes, pour peu que l’on facilite son partage. Le covoiturage courte distance dispose d’un potentiel de 15% de parts modales (CGEDD) contre 4% aujourd’hui. Il ne faut cependant pas nier les difficultés du covoiturage courte distance (entre 15 et 40 km) : - la diversité des O/D et des heures est importante. Trouver des appariements entre conducteurs et passagers nécessite des systèmes temps réel et généralisé - le covoiturage de courte distance nécessite une masse critique et n’est donc pas possible partout - les modèles économiques sont délicats mais évidemment indispensables : ils restent à inventer - le covoiturage de bout en bout est inadapté à la diversité des localisations d’emplois et de logements. Une interconnexion avec les lignes fortes de transports en commun est nécessaire, ce qui implique d’intégrer le covoiturage dans l’offre globale de mobilité. Il s’agit au final de mieux intégrer la voiture dans le système de mobilité en mobilisant l’offre privée pour améliorer l’accessibilité, tout en diminuer les impacts de l’automobile. Nous sommes encore au stade de l’innovation, mais avec la généralisation de puces GPS et cartes SIM en première monte dans les voitures dès 2018 (100% des nouveaux véhicules), les choses pourraient aller plus vite. Avant d’être autonome, la voiture est déjà connectée, ce qui permettra son partage. Plusieurs pré-requis sont indispensables pour permettre au covoiturage courte distance de décoller : - Déployer l’offre là où le service a une chance de décoller : réaliser des analyses mobilité pour cibler les territoires et pénétrantes où une masse critique de covoitureurs a une chance d’être atteinte. - Avoir un service temps réel et fiable pour assurer les lieux et horaires de pose/dépose : la diversité des O/D et des heures de départs et arrivées ne permet pas une gestion prévisionnelle comme le fait blablacar : l’expérience l’a largement prouvée. enjeu de fiabilité des temps de passage en utilisant les données temps réel et prédictive, disponibles dans certaines agglomérations. On le voit l’outil induit va bien au-delà de la simple mise en relation. Par ailleurs sur la voirie, on ne peut stationner trop longtemps au risque de gêner la circulation (à prendre en compte si on pense que la pratique va décoller). - Coupler le covoiturage avec les réseaux de TC : pose/dépose sur un pôle multimodal permettant d’assurer le début/la fin de son parcours. Des O/D de bout en bout seront rares. Couplage avec calculateur multimodal indispensable - Garantir l’offre: C’est déjà le cas avec les dispositifs de rémunération des conducteurs (ou d’une masse minimum) pour garantir une offre à l’aller et au retour. Sans cette offre, la masse critique ne sera jamais atteinte - S’appuyer sur une marque connue : Pour diffuser un service il faut une marque connue, sinon c'est l'échec assuré. La marque des TC en est une, tout comme celles des constructeurs, qui plus est sur du covoiturage, on peut imaginer qu'ils se sentent concernés. D'ailleurs à Munich il y a actuellement un conflit entre l'opérateur de TC et BMW pour porter ce type de service, chacun voulant le faire sous son nom propre. La voiture connectée peut être partagée. Renault comme PSA viennent de créer des business units pour développer des services notamment sur la voiture partagée. Pour l'instant ils se focalisent sur l'autopartage, le covoiturage est à intégrer. Faciliter l’usage (simplicité, interfaces dans les écrans des voitures). Opticities a montré que la facilité d'usage, sans parler des aspects sécurité, avec l'intégration dans les écrans de voiture d'une fonction covoiturage et de l'info multimodale avait un impact très fort sur les comportements. Il faut poursuivre dans cette voie. Une tarification intégrée, dans une logique MaaS est certainement une action à développer. Pour ce faire, sortir des systèmes de billettiques actuels
- 42. 41 - centrés sur le support est nécessaire, vers les systèmes en back office (c’est ce que font tous les opérateurs de mobilité, sauf les transports en commun !). - Mettre en place des « carottes et des bâtons » : on arrive aujourd’hui à garantir une offre aux heures de pointes dans des agglomérations (cf Fleetme opéré par Cityway et Transdev), avec par exemple la promesse de ne pas attendre plus de 5’ pour se rendre à destination entre 8h et 9h, mais trop peu de passagers en profitent. La raison en est simple : les contraintes du covoiturage sont supérieures aux avantages. Il nous faut donc introduire des incitatifs et des contraintes sur les temps de parcours et les couts des services (les deux drivers des comportements de mobilité pour l’usager). Si l’on veut avoir un report modal, il faudra rendre les solutions alternatives à la voiture compétitives : aussi voire plus rapide, moins chères que la voiture. Ceci passera, par des mesures venant améliorer les temps de parcours des solutions alternatives (voies réservées, avec dispositifs de contrôle automatique et en attendant via la force publique, l’amende étant de classe IV, 135 € cela est dissuasif), et d’autres venant dégrader les temps de parcours en voiture, et également les couts d’usage de la voiture. Ces solutions seront à déployer de manière judicieuse selon les territoires : là où l’usage de la voiture ne cause pas de problème, il n’y a pas lieu de la pénaliser. Ce point est clef : il est illusoire de croire que le simple fait de déployer un bon service facilement accessible fera décoller la pratique. Nous n’échapperons pas à une tarification de l’usage de la voiture solo. D’ailleurs, là où existent des péages la pratique du covoiturage est très forte (cf autoroutes d’accès à la Métropole de Lyon) et ont amené les concessionnaires à réaliser des parkings de covoiturage en amont des gares de péage. - Permettre aux agglomérations premières victimes de l’usage excessif de la voiture, à intervenir sur les aires urbaines pour ce type de service. En effet, on constate que dans une métropole, la moitié de la population habite en hypercentre, l’autre au-delà, et il faut ajouter une population équivalente à celle de la métropole en dehors de ses frontières dans l’aire urbaine (l’aire urbaine étant définie par un territoire polarisé autour d’un centre urbain attirant au moins 40% des emplois des communes environnantes). Avec la réforme territoriale, les territoires des aires urbaines hors métropoles sont orphelins de gouvernance (la Région est aujourd’hui bien trop grande pour adresser ces sujets spécifiques) et les dispositifs de syndicats mixtes génèrent lourdeurs et couts de coordination importants dans un pays qui n’en a pas besoin. Autoriser les métropoles et communautés d’agglomérations à intervenir sur les territoires de leurs aires urbaines pour développer des services d’information voyageur et de covoiturage en pénétrante. - Expérimenter les modèles économiques afin de trouver un optimum en terme d’usage de fond public, bien rare aujourd’hui. Il est probable que l’on aille vers un mix public/privé (participation des passagers au service via une commission, participation du secteur public, participation des entreprises dans le cadre notamment des plans de mobilité) dans le cadre de DSP spécifique ou intégré aux DSP de transports en commun. Les études et expérimentations montrent que pour garantir une offre aux heures de pointes il faut indemniser les conducteurs. Cela a un cout, bien moindre que les services de TC ceci dit mais il faut regader la capacité et ramener cela à l’usager transporté. Si la personne publique prend en charge ce cout, les services peuvent s'équilibrer avec un paiement d'une commission par l'usager. Dans tous les cas on est sur un cas classique de DSP mais avec un R/D décent. Par ailleurs les entreprises peuvent financer via les PDIE ou des groupements d'entreprises des services de covoiturage. Elles le font déjà, c'est d'ailleurs la seule ressource des start ups actuelles en BtoB. Pour avancer il faudrait lancer des appels à projets et dégager des financements permettant d’accélérer fortement sur le sujet : Développer les projets de covoiturage courte distance, avec deux axes de travail : fournir une information sur l’ensemble des modes de transports, y compris la voiture, de manière intégrée entre le smartphone et le véhicule, d’une part, et d’autre part élaborer des modèles économiques pérennes. Ceci suppose un travail entre agglomérations, constructeurs automobiles et fournisseurs de services numériques de covoiturage et d’information multimodale. L’expérimentation parait indispensable avant de généraliser une offre qui soit
- 43. 42 - industrialisable par les acteurs privés, en lien avec les autorités publiques. Des fonds gouvernementaux devraient être mobilisés pour faire émerger de tels projets. - Développer les incitatifs au covoiturage : Développement de voies réservées covoiturage, tout comme les parkings, ouverture des couloirs bus aux co-voitureurs avec les contrôles ad hoc (dispositif de preuve de covoiturage à développer sur les plans juridiques et techniques), ce qui est une mesure très demandée compte tenu des gains en temps de parcours. De tels projets pourraient mobiliser 1 à 2 M€ / aire urbaine, soit 30 à 60 M€ si l’on cible 30 aires urbaines (hors Paris, cas spécifique, où la Région est l’aire urbaine ont le même périmètre, avec une densité de population sans comparaison). Une aide de 50% minimum permettrait de gagner 10 ans sur le sujet, si les incitatifs au covoiturage et en parallèle les mesures pénalisant l’usage de la voiture solo sont mises en place.
- 44. 43 Contribution iDVROOM aux Assises de la Mobilité A propos du modèle économique et de l’usage au cœur des plans de mobilité, interconnecté aux transports en commun 1. Le covoiturage de courte distance n’a pas de modèle économique basé sur les seules commissions ; il constitue en revanche un mode de transport qui complète très bien l’ensemble des systèmes actuels, avec un coût qui en fait une solution intéressante (et nécessaire) pour les collectivités. (coût au km passager très comparable, voire moindre que celui d’un bus peu rempli) a. La bonne approche consiste à revoir les plans de déplacements (des agglos, des départements, des régions) en y insérant le covoiturage dès la phase de conception, en recouvrement (coexistence) avec le TP. Il faut étudier dès cette phase les bonnes options : lignes de covoiturage, ou covoiturage classique, intégration des abonnements TC.. en fonction des usages locaux de mobilité. (comme suggéré dans le groupe de travail établir un guide des options possibles serait en effet utile à de nombreuses collectivités) b. La répartition pertinente n’est pas de mettre le covoiturage en zone très peu dense ou la nuit et les TP en zone dense ou le jour, mais de mixer covoiturage et bus en journée, avec un bus qui apporte la certitude d’un passage à heure fixe, et le covoiturage la probabilité d’un passage plus fréquent. c. Ainsi, d’un point de vue usage, il faut accepter une cannibalisation à la marge entre le bus et le covoiturage ; et la voir comme une opportunité de baisser les coûts des organisateurs de mobilité et l’opportunité de faire revenir aux transports collectifs certaines personnes qui ne prenaient que la voiture (« grâce à la garantie retour en TER ou à l’existence d’un bus à heures fixes, je pars généralement en covoiturage mais je sais que j’ai une solution de secours si jamais je n’ai pas de covoitureur, je me rends compte que le service commercial avec un chauffeur professionnel, ce n’est pas si mal ») 2. Les zones denses concentrent la majeure partie des innovations, en particulier celles sous- tendues par un modèle de revente de données ou de commissions importantes, et celles basées sur la vente ou l’utilisation d’un moyen de transport (glisse urbaine, VLS, VTC, VTC partagés…). Mais toutes ces innovations portent sur des trajets très courts (<10 km). Sur les zones péri- urbaines, les VTC sont plus chers, dès qu’on atteint 40km, et le vélo plus sportif…, la voiture solo reprend le pas, voire la mobilité devient clivante (impossibilité d’accepter un emploi pour ceux qui n’ont pas les moyens de se rendre à un travail éloigné) 3. L’affrontement sur un même marché d’acteurs drivés par la revente de données en zones denses et d’acteurs drivés par un souci de desserte de la mobilité nécessite de bien clarifier les règles du jeu, il est urgent de définir jusqu’où on peut incentiver un conducteur en contrepartie d’un engagement sur un nombre de trajets (entre la promo à 20€ sur un nombre restreint de clients et les acteurs qui ont levé des millions € pour acheter une base, quelle définition légale ?) quel nouveau cadre pour un usage entre le covoiturage (strictement borné au partage des coûts entre personnes qui font le même trajet) et le service régulier opéré par un conducteur non professionnel)
- 45. 44
- 46. 45 Assises de la mobilité Atelier covoiturage courte distance Contribution de Lucas CREVET et Anne CAMBON CHANCROGNE Direction des transports de la Région Auvergne Rhône Alpes Vendredi 6 octobre 2017 Quelques précautions qui nous paraissent indispensables… Concernant la définition du covoiturage : La loi définit déjà le covoiturage en général mais une précision serait peut-être nécessaire pour distinguer le covoiturage en général (qui inclus aussi les accompagnements) du covoiturage domicile-travail (lorsque tous les occupants du véhicule se rendent à leur travail) s’il s’agit de définir des mesures qui ne concernent que cette catégorie. Mais dans tous les cas il parait bien inutile de définir le covoitureur par rapport à l’usage d’une plateforme. Concernant la multimodalité : Veillons à ce que les propositions retenues n’entrainent pas d’effets pervers qui conduiraient à favoriser le covoiturage au détriment de la multimodalité, ou bien à inciter à la possession d’un véhicule pour pratiquer le covoiturage. Les propositions qui nous paraissent majeures… 1. La proposition de centraliser un service de certification qui permettrait notamment de produire des certificats sous un format « normalisé » à l’usage des employeurs et des covoitureurs nous parait fort judicieux. 2. Judicieuse également est la proposition d’identifier la « compétence » covoiturage pour les EPCI, les Régions et les Départements afin de leur permettre de s’engager dans ce domaine. 3. Incitations financières Au lieu d’une prise en charge obligatoire des frais de transport public à 50% nous suggérons une indemnité obligatoire mais choisie par le salarié parmi 3 possibilités : vélo, covoiturage ou transport en commun. Cette indemnité serait calculée (et/ou plafonnée) pour favoriser le mode de transport émettant le moins de gaz à effet de serre.
- 47. 46
- 48. 47 Préparation du projet de loi d’orientation des mobilités Proposition d’innovation – contrôle du covoiturage Traitement du « public non connecté » et des « covoitureurs historiques » Attn CGDD/DRI : Mme Marion GUST cc DGTIM /FCD1 : Mme Julie GOZLAN 21 septembre 2017 Eléments de cadrage Lors de son allocution pour le lancement des Assises de la Mobilités le 18 septembre 2017, Madame la Ministre chargée des transports a insisté sur l’importance de développer le covoiturage au quotidien. Les auditeurs auront pu remarquer que la ministre s’est écartée de ses notes en qualifiant le covoiturage d’élément « crucial » des nouvelles politiques que l’Etat doit définir pour le Projet de Loi d’Orientation des Mobilités (PLOM) Il est alors probable que le volet covoiturage du PLOM contiendra plusieurs dispositions incitatives au niveau législatif ou ouvrant la perspective de mesures incitatives de niveau réglementaire, nationales ou locales. Toute disposition de cette nature, accordant un avantage légal ou réglementaire à la catégorie des covoitureurs, a) nécessite un justificatif, que la Fabrique des Mobilités appelle une « attestation » de covoiturage, elle-même fondée sur un processus d’élaboration de preuves de trajets covoiturés b) doit, pour être assurer de sa bonne qualité constitutionnelle : - poursuivre un objectif clairement fixé par le législateur - s’appuyer sur un processus de formation de la preuve de covoiturage auquel tout covoitureur doit pouvoir avoir accès . Quelques données sur l’état des lieux L’extraction des statistiques de l’ENTD 2008 fait ressortir que, parmi les 19 millions d’actifs ayant un emploi et s’y rendant en voiture, en dépensant pour cela 56 Md€, 1.5 millions utilisaient plusieurs fois par semaine le covoiturage en effectuant en moyenne des trajets domicile-travail de 20,6 km. Un covoitureur domicile-travail évite en moyenne, selon nos calculs prudents, l’émission de 300 kgCO2 et les polluants de l’air associés.
- 49. 48 Problématique de recherche et innovation Selon l’état de l’art, les processus émergeants de formation de preuve de trajets covoiturés sont intrinsèquement liés aux processus qui servent au fonctionnement des services de mises en relation de covoiturage dynamique. A notre connaissance, ils utilisent tous les smart phones et sont basés sur la gestion d’un échange pécuniaire du passager vers son conducteur et/ou l’emploi de fonctionnalités de géo-localisation voire de traçage gps. Sans méconnaître l’adéquation de ces processus au besoin de formation d’attestation de covoiturage d’un large public, nous identifions toutefois le risque que leur emploi exclusif d’autres solutions écarte du système incitatif, que les pouvoirs publics souhaitent mettre en œuvre, un public fragile ou satisfait de sa pratique déjà habituelle du covoiturage : Qu’est-ce qui justifierait – d’un point de vue juridique – et quel serait au juste le besoin d’un covoitureur « historique » qui covoiture déjà depuis longtemps ses trajets domicile-travail, sans être passé par une plateforme de mise en relation, d’utiliser un service de mise en relation pour obtenir une attestation de sa pratique régulière du covoiturage ? Si un simple service d’attestation de covoiturage est à sa disposition, comment ce service entre-t-il en adéquation avec la pratique majoritaire qui ne nécessite pas de transfert d’argent du passager vers le conducteur , ou avec la capacité à utiliser un smart phone parfois limitée par la persistance de zones blanches (notamment en milieu rural et périurbain), par des raisons pratiques, de capacité cognitives ou économiques ? Nous parlons ici du public dit « non connecté » en notant qu’aujourd’hui, être « non connecté » peut renforcer les situations de fragilités sociales. Manifestement, le besoin constitutionnel d’égalité de traitement devant la loi, relatif à l’accessibilité des covoitureurs « historiques » et du public « non connecté » conduit à l’identification d’un besoin d’innovation sur les méthodes de preuve et d’attestation de covoiturage veillant à ne pas laisser ce public à l’écart. En résumé, One Plus One souhaite approfondir la recherche de solution d’accès au système de preuve de trajets covoiturés, adaptée à ces catégories de public, en s’appuyant sur l’usage banalisé de simples dump phones et en exploitant les spécificités du covoiturage domicile-travail dont le développement vise notamment l’objectif, en présumant que les motifs du PLOM le rappelleront, d’améliorer la qualité de l’air et de diminuer les émissions de CO2. C’est le sujet que One Plus One propose à la DRI d’examiner, dans un calendrier qui pourra être utilement synchronisé avec les dispositions incitatives du volet covoiturage du PLOM.
- 50. 49
- 51. 50
- 52. 51
- 53. 52
- 54. 53
- 55. 54
- 56. 55
- 57. 56
- 58. 57
- 59. 58
- 60. 59
- 61. 60
- 62. 61
- 63. 62
- 64. 63
- 65. 64
- 66. 65
- 67. 66
- 68. 67
- 69. 68
- 70. 69
- 71. 70
- 72. 71
- 73. 72
- 74. 73
- 75. 74
- 76. 75
- 77. 76
- 78. 77
- 79. 78
- 80. 79
- 81. 80 Covoiturage – Propositions M.Jacquot – Covivo/Roulez Malin 1. Constituer une base open data hébergée par exemple par les start-ups de l'État sur le modèle le point taxi ou chaque citoyen peut déclarer un trajet régulier via un simple formulaire. Cette base de données serait facilement constituée à partir d'une incitation fiscale financière disponible aux seules personnes inscrites à cette base. Cette base permettrait en outre d'avoir des moyens de contrôle simple et efficace. Les collectivités locales ou les opérateurs privés pourrait avoir accès à cette base pour retrouver tes dragées. Une personne souhaitant prendre contact laisserait ses coordonnées qui seraient transmises par le service à la personne ayant laissé son trajet en base de données. Cela permet de sécuriser la protection des données personnelles on est transmettant pas directement aux opérateurs ou au collectif et territoriales. Cela permet en outre de laisser totale liberté aux collectivités locales et aux opérateurs pour développer des services additionnels avec leur propre algorithme. 2. La deuxième proposition partait du principe que l'État refuserait de constituer ou héberger une telle base de données nationale. À ce moment-là j ai proposé que les incitations fiscales ou financières ou en nature mise à disposition par l'État ne puissent être valides qu'à condition que les bases de données des collectivités locales ou des opérateurs privés soit interopérables. L'objectif est d'assurer les conditions de masse critique plus facile à obtenir et de gérer également les trajets frontaliers : le passage d'une région à une autre avec deux bases de données 1 pour chacune des régions ne serait pas un souci grâce a l'interopérabilité. 3. Autoriser les collectivités locales en zone peu denses (c'est-à-dire avec un trajet ayant pour origine ou pour destination une zone peu dense) à organiser le transport de personnes par des particuliers bénévoles c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas déclarées comme transporteur auprès des services de la préfecture mais qui seraient autorisées à être remboursées de leurs frais de déplacement selon le barème kilométrique. Comme pour les plates-formes de covoiturage, la responsabilité de la collectivité se limite à proposer un réseau de mises en relation sans la responsabilité du transport.
- 82. 81
- 83. 82
- 84. 83
- 85. 84
- 86. 85
- 87. 86
- 88. 87
- 89. 88
- 90. 89
- 91. 90
- 92. 91
- 93. 92
- 94. 93
- 95. 94
- 96. 95
- 97. 96
- 98. www.assisesdelamobilite.gouv.fr #AssisesMobilite Direction générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer Tour Sequoia 92055 La Défense cedex Ministère de la Transition écologique et solidaire
