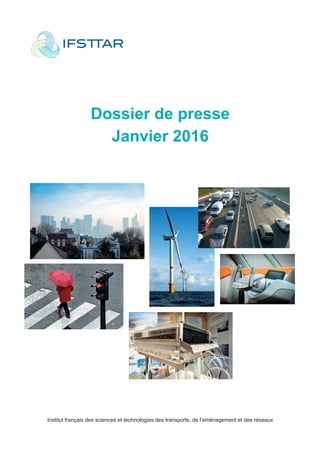
Dossier de presse - janvier 2016
- 1. Dossier de presse Janvier 2016 Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux
- 2. Introduction et Jean-Bernard Kovarik, directeur général adjoint de l'Ifsttar Par Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale de l'Ifsttar L'année 2015 fut riche d'actualité pour l'institut. Celle-ci a culminé par la mise au point d'un démonstrateur de la « route solaire hybride », qui a eu l'honneur d'être exposé sur le Pavillon France de la COP21. Aboutissement d'un travail d'équipes, cet équipement de pointe permet de produire électricité et calories et illustre les nombreuses possibilités réali- sables de la « Route de 5e Génération ». Initié par l'Ifsttar, le projet prend désormais son envol et devient un objet partagé, visible en France et à l'étranger. Grâce à l'appel à pro- jets « Route du futur » lancé par l'ADEME dans le cadre du programme des investissements d'avenir l'été dernier, l'appropriation de ce concept par tous les acteurs devient réalité. Prochaine étape pour la « Route de 5e Génération » : le changement d'échelle, avec l'in- tégration des innovations de la mobilité coopérative, du véhicule autonome, de l'électro- mobilité ou encore du « smart grid » énergétique. Dans ce dernier domaine, des avancées considérables ont d'ailleurs été réalisées et le premier scénario de ville communicante a été inauguré sur le site de l'Ifsttar à Marne-la-Vallée, au mois de mars 2015. Constituée de deux « chalets » instrumentés, cette mini-ville sert de terrain d'expérimentation pour un grand nombre de capteurs, utilisés entre autres dans la mesure et l'analyse de la qualité de l'air et de l'eau, dans la collecte des données liées à l'environnement... La mini-ville a été conçue dans l'optique de faire de la ville du futur un lieu de vie agréable, convivial et rési- lient, capable de s'auto-diagnostiquer en permanence. Ces performances rendront ainsi nos espaces de vie plus économes en ressources, plus propres et plus sains. La version abou- tie de l'équipement sera livrée courant 2017 et la pose de la première pierre est prévue le 11 avril 2016 tout près du siège de l'Ifsttar, au sein du campus Descartes. Aider l'action publique avec des études de mobilité urbaines et péri-urbaines, rendre la ville plus durable par des projets ambitieux comme « la gare à énergie positive », qui per- met de récupérer et redistribuer l'énergie générée lors du freinage des trains en entrant en gare… Autant de solutions que peut apporter l'Ifsttar pour répondre aux enjeux de l'accord Climat 2015. Face aux nombreuses conséquences du dérèglement climatique, les équipes de l'institut travaillent sur des projets destinés à surveiller et renforcer les digues de pro- tection, à l'image du projet VIBRIS ; l'Ifsttar s'investit dans le domaine des énergies renou- velables, à travers le projet CHARGEOL, pour réduire le coût et améliorer la durée de vie des fondations des éoliennes en mer. L'Ifsttar a connu différents événements positifs en 2015 qui soulignent les compétences de ses chercheurs. CIVITEC, société créée pour tester et valider les systèmes d'aides à la conduite et portée par l'institut depuis 1996, a intéressé « ESI group » qui l'a partiellement rachetée, l'Ifsttar conservant 20 % du capital. Dans le domaine des distinctions, au moins deux des chercheurs de l'établissement ont vu leurs travaux récompensés. La médaille d'ar- gent du CNRS a été décernée à Philippe Coussot (laboratoire Navier), chercheur à l'Ifsttar
- 3. et à l'ENPC, pour ses travaux sur la rhéologie. Une bourse d'excellence européenne (ERC), appelée « Consolidator », a été attribuée à Ludovic Leclercq (laboratoire LICIT), chercheur à l'Ifsttar et à l'ENTPE, pour le projet MAGnUM ; ce projet permet aux autorités organisa- trices de la mobilité et aux opérateurs de transport public de développer des stratégies inno- vantes du trafic grâce à une modélisation dynamique des déplacements. L'Ifsttar a débuté en septembre 2015 son opération « Décennies », destinée à mettre en lumière les spécificités scientifiques de chacun des sites de l'institut auprès des partenai- res et de sensibiliser le grand public aux sciences. Le centre de Nantes inaugurait ce « tour de France » avec quatre journées, illustrées par des conférences, des expositions et des visites de ce vaste site qui compte de nombreux équipements majeurs pour le génie civil et les transports. Ces journées furent l'occasion de fêter les 40 ans d'implantation du site dans la région ligérienne, où l'Ifsttar est un acteur clé de la recherche partenariale. Trois autres journées ont également eu lieu dans le courant du mois d'octobre, à Aix-en-Provence puis à Lyon, retraçant 50 ans de recherche en sécurité routière. Depuis plusieurs décen- nies, les équipes qui se sont succédées sur les sites de Salon-de-Provence en région PACA et à Bron dans la métropole lyonnaise, ont œuvré à l'amélioration de la sécurité de tous les usagers de la route en étudiant des dispositifs tels que la ceinture de sécurité, l'er- gonomie des conducteurs et des passagers, leurs protections à bord des véhicules etc. Des travaux d'envergure comme le Registre des victimes de la route du Rhône dont les 20 ans ont été célébrés, associant personnels de santé et de recherche, ont permis de faire avan- cer la recherche en accidentologie. Plus récemment, différentes mesures pour lutter contre la mortalité routière ont été étudiées par les équipes, à l'image de l'interdiction de l'oreillette au volant ou encore du 0,2 g/l de sang pour les jeunes conducteurs. Les « Décennies de l'Ifsttar », journées de partage des connaissances, se poursuivront cette année les 10 et 11 mars sur le site de Villeneuve d'Ascq, puis à la fin du printemps pour les sites franciliens. 2016, sera également une année tournée vers des projets d'avenir pour la société. Dans cette optique, la recarbonatation du béton, objet de recherche porté par nos équipes depuis 2006 et récompensé en 2011 par le premier prix du Trophée Freyssinet, va atteindre sa phase de préindustrialisation. Avec près de deux tonnes par personne et par an, le béton est le matériau le plus manufacturé au monde. Seule la partie la plus impor- tante du béton est composée aux 2/3 de granulats ; une ressource non renouvelable. Les volumes de bétons de démolition toujours plus importants, il s'avérait nécessaire d'étudier des solutions durables en recréant « du béton avec du béton ». Le béton de recyclage devient ainsi un véritable puits de carbone, sobre en ressources naturelles et répond à un double objectif : conjuguer politique climatique et économie circulaire.
- 5. La route de demain, des infrastructures durables, connectées et plus sûres La route solaire hybride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Quand la route produit de l'électricité et des calories … CIVITEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 teste et valide les systèmes d'aides à la conduite automobile Une société créée à partir des travaux de recherche de l'Ifsttar MAGnUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 une gestion multimodale plus efficace des réseaux de transport urbain grâce à une modélisation multi-échelles d'un nouveau genre Maîtriser les risques, renforcer les infrastructures VIBRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Analyser les vibrations naturelles du sol pour surveiller les digues de protection et dévoiler les structures géologiques de nos territoires CHARGEOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Les fondations d'éoliennes en mer dans la centrifugeuse géotechnique de l’Ifsttar Faire de la ville des espaces à « énergies positives » Les gares à énergie positive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Intelligence et technologie pour l'énergie et les transports Une ville miniature nommée Sense-City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Déploiement massif de capteurs pour la qualité de l'air et de l'eau Vers des mobilités urbaines plus durables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Quelques pistes pour l'action publique Sommaire
- 6. Alors comment fonctionne cette route solaire ? Pour éviter un échauffement des cellules photovoltaïques et une dégra- dation de leurs performances (problème bien connu dans les fermes solaires photovol- taïques), une solution a été mise au point. Un fluide caloporteur refroidit les cellules et récupère la partie non utilisée du flux solaire sous forme d'énergie thermique. Ce système hybride augmente d'autant plus le rendement éner- gétique de l'opération que la couche de roulement translucide fait serre (un peu comme dans un chauffe-eau solaire). Puis le fluide est refroidi par échange avec un réseau de chaleur et revient dans le cycle. La faisabilité technique de la route solaire hybride Ifsttar est désormais prouvée et un démonstrateur à échelle réelle a était exposé sur le Pavillon France à l'occasion de la COP21 en décembre dernier. Déjà d'autres fonctions se greffent sur le concept initial. Et si l'énergie électrique et thermique ainsi produite était utilisée en « circuit court » ? pour le maintien hors gel de la surface des chaussées, pour l'alimentation des véhicules électriques qui circulent, pour une signalisation lumineuse dynamique, pour l'éclairage des points sensibles, pour les systèmes de communication en bord de voie… Les équipes de recherche de l'Ifsttar se mobilisent sur tous ces sujets qui forment, avec d'autres encore, le pro- gramme « Route de 5e Génération© ». 6 La route solaire hybride Quand la route produit de l'électricité et des calories… Et si la route devenait une mine d'énergie renouvelable ? Ses surfaces ne sont-elles pas déjà là, sous nos roues, prêtes à recueillir l'énergie du soleil ? Rêvons un peu. Si le million de kilomètres linéaires de chaus- sées que nous avons en France était entièrement équipé de pan- neaux photovoltaïques ou d'une couche d'enrobé capable de capter et d'exploiter la chaleur du soleil, même avec un rendement de 10 %, la puissance ainsi produite serait potentiellement équivalente à la totalité de l'é- nergie électrique consommée en France ! Oui, mais… il faut que la surface de la chaussée continue à frotter au contact du pneumatique de manière à garantir la sécurité routière pour les voi- tures et les camions qui circulent, en réduisant les nuisances sonores. La chaussée doit continuer à résister aux passages des essieux. Avec ses équi- pements, elle doit durer dans le temps malgré les conditions météorologiques parfois sévères : pluie, neige, sécheresse etc. D'ores et déjà, l'on peut trouver sur le marché un certain nombre de solutions pour des routes photo- voltaïques. Citons par exemple le procédé Wattway® de Colas en France, la piste cyclable Solar Road® aux Pays-Bas, le prototype Solar Roadway® aux États-Unis… Les recherches en cours à l'Ifsttar prolongent ce concept vers une optimisation de l'énergie récupé- rée combinant électricité et calories. Le dispositif doit assurer une « praticabilité » de la chaussée en tout point équivalente à celle d'une chaussée clas- sique. Et ce pour un coût acceptable par rapport aux solutions classiques non énergétiques.
- 7. 7 Démonstrateur de route solaire, hybride, thermique et photovoltaïque Le démonstrateur sur la photo ci-dessus a été exposé sur le pavillon France de la COP21. Il est composé d'un empilement de matériaux et différents composants rem- plissant chacun une fonction précise. La couche de roulement, composée d'un enrobé semi-transparent à base de granulats de verre, permet de recueillir le rayonnement solaire et possède une adhérence compatible avec la circulation des véhicules. Des capteurs solaires, placés sous la couche de roulement, permettent ensuite de produire l'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner la pompe d'équilibrage entre les deux bassins amont et aval. Une couche d'enrobé poreux, placée sous ces capteurs solaires et circulée par un fluide, permet de collecter sous forme d'énergie thermique la partie non utilisée du flux lumineux émis par une lampe installée sur l'é- quipement présenté ci-dessus.
- 8. 8 l'environnement en opérant une simulation « physico- réaliste » des capteurs embarqués. Initialement, l'ou- til de simulation permettait de produire des données de ces outils, en vue de développer les modules de perception de l'environnement, et plus parti- culièrement le prototypage, le test, l'évaluation et la valida- tion des algorithmes de fusion de données. Les per- formances de la plateforme se sont révélées efficaces et les applications pouvant être mise en œuvre, très étendues. Forte de ces résultats, la pla- teforme SiVIC s'est rapidement étendue en réponse à des demandes d'utilisation de partenaires exté- rieurs toujours plus croissantes : tant prototypage d'application, de perception et de contrôle/com- mande, ou encore prototypage de capteurs encore non existants1, et même pour des besoins d'ensei- gnement. Les projets de recherche-développement présen- tent des cas d'usages de plus en plus complexes (conditions climatiques variées, des situations rou- tières de plus en plus diversifiées : milieu urbain, périurbain, autoroutier,…). Les applications doivent à présent estimer les attributs de très nombreux acteurs de la scène routière tels que les conduc- teurs, les obstacles, la route, le véhicule, l'environ- nement. Le LIVIC constate un besoin grandissant de disposer de données en grand nombre, de plu- sieurs natures, distribuées dans l'environnement. En 2008, le projet FUI « eMotive » est lancé et pré- sente deux objectifs : • proposer une plateforme préindustrielle pour le prototypage, le test et l'évaluation des systèmes de détection d'obstacle, par une modélisation réaliste de capteurs multi-fréquentiels ; • créer une start-up soutenue par l'Ifsttar permettant de valoriser et de faire évoluer le produit préindus- triel. CIVITEC teste et valide les systèmes d'aides à la conduite automobile Une société créée à partir des travaux de recherche de l'Ifsttar et qui a récemment rejoint ESI Group Le développement d'un outil pour tester et vali- der les systèmes d'aides à la conduite Depuis 1999, l'Ifsttar et son laboratoire sur les interactions véhicules-infrastructure- conducteurs (LIVIC) implanté à Versailles et Satory, est à la pointe des recherches sur les véhicules routiers communicants et automatisés. Il développe des systèmes d'aide, d'automatisation et de partage de la conduite pour améliorer la sécurité routière et le confort du conducteur. Il conçoit des systèmes de gestion du trafic et de la mobilité. Ces systèmes veulent faire de l'éco-mobilité une réalité. Ils sont testés sur des prototypes équipés de cap- teurs embarqués, de moyens de communication et d'applications logicielles (fonctions de perception, de communication, de décision et de contrôle). Ces applications développées sont souvent actives : elles agissent sur la dynamique d'un véhicule par l'inter- médiaire d'actionneurs ; elles doivent naturellement être testées, évaluées et validées avec beaucoup de rigueur afin de garantir fiabilité et robustesse. Pour de multiples raisons tenant par exemple aux conditions climatiques (désirées ou à éviter), aux situations à risques (évitement de collision, atté- nuation de l'impact d'une collision, évitement de sor- tie de voie…), les tests sur prototypes en conditions réelles ne sont pas toujours aisément réalisables. Obtenir des informations très précises, fiables et en temps réel (ce que l'on nomme " vérité terrain ") est un vrai défi, et pourtant ces données restent indispensables pour évaluer et valider les systèmes d'aides à la conduite. Pour répondre à cette problématique, le LIVIC a mis au point des outils de simulation qui complètent effi- cacement les outils de prototypage, de test et d'évaluation des applications embarquées et com- municantes, et permettent d'accélérer considéra- blement le processus d'innovation. Développée en 2002 par Dominique Gruyer, chercheur à l'Ifsttar, la plateforme SiVIC (simulateur de véhicules, d'infrastructure et de capteurs) aide la conception de ces applications de perception de 1 Thèse CIFRE Mines de Paris/Trimble Photo d’illustration
- 9. 9 En 2009, la filiale CIVITEC est ainsi créée. Dans sa version industrielle appelée Pro-SiVIC™, la plate- forme combine la simulation et la gestion d'univers virtuels dynamiques et physiquement réalistes, avec des modèles de capteurs multi-fréquentiels (camé- ras, télémètre laser à balayage, radar, centrale iner- tielle, odomètre…). À partir de ces modèles, il est désormais possible de collecter et d'enregistrer un ensemble de données générées virtuellement et équivalentes aux mesures qui seraient produites par des capteurs réels. En associant des algorithmes spécifiques de traitement de l'information, il devient ensuite possible de produire des cartes dynamiques de perception de l'environnement, des algorithmes d'interprétation, de décision, et finalement de com- mande. Dans le cadre des nombreux projets qui ont utilisé cette plateforme, les nouvelles applications permet- tent de détecter les usagers vulnérables et les obs- tacles (projet ANR LOVe), d'identifier des panneaux de signalisation (projet DIVAS), de détecter et de suivre des marquages routiers (projets eFuture, CooPerCom, ABV), de réaliser un copilote pour la conduite automatisée (projet Have-it), de détecter et d'identifier les défaillances (systèmes et capteurs), de localiser un véhicule précisément et de manière robuste (projets CVIS, eMotive). Cette liste d'appli- cations est très loin d'être exhaustive mais montre bien la polyvalence et l'efficacité de la plateforme. L'outil a depuis 2011 permis le développement de nouvelles plateformes dérivées dédiées à des recherches spécifiques : « eco-SiVIC » pour l'étude et la conception des applications immersives 3D d'éco-mobilité et de consommation de l'énergie (équipement exposé au Mondial de l'Automobile 2014), « Cosmo-SiVIC » pour l'étude et la modéli- sation de modèles cognitifs du conducteur (projets Isi-PADAS et HOLIDES), « SiVIC-MobiCoop » pour le développement des applications connectées et communicantes (projets CooPerCom et SINETIC), « SiVIC-SiRadEM » pour l'étude et l'exploitation des applications exploitant des radars (projets eMotive et CooPerCom). Après 6 ans d'existence, la Société CIVITEC a suscité un fort intérêt de la Société française ESI Group (éditeur de logiciel de simulation), aboutissant en mars 2015 à la signature d'un accord de collaboration entre l'Ifsttar et ESI et au rachat de CIVITEC à hau- teur de 80 % par ESI. CIVITEC est désormais une société du groupe ESI. Deux agents de l'Ifsttar inventeurs de la plateforme SiVIC y travaillent en cumul d'activité en tant que directeurs scientifiques de la société. En rejoignant le groupe ESI, qui réalise plus de 85 % de son chiffre à l'export, CIVITEC profite désormais d'un réel tremplin vers l'international. Cela permet à CIVITEC de se développer sur des marchés auto- mobiles dynamiques notamment en Asie (Chine, Japon, Corée). Les actuels projets de CIVITEC s'appuient sur les technologies développées par l'Ifsttar et ESI dans des domaines à fort potentiel d'innovation tels le control-commande (projet Eclipse, VIPES), le Big Data, et la réalité virtuelle immersive en temps réel avec IC.IDO (projet avec Ford). Réciproquement, ces domaines d'ingénierie bénéficient de l'intégration de la plateforme Pro-SiVIC™. Aujourd'hui, le domaine d'expertise de CIVITEC s'est élargi au-delà de l'automobile et de la sécurité rou- tière. Les expériences passées ont clairement démontré la pertinence de la plateforme sur d'autres marchés, partout où il y a des personnes et des objets en mouvement : sites industriels, gares, aéro- ports, voies ferrées, tunnels… CIVITEC et Pro-SiVIC™ peuvent également inter- venir dans l'univers de la vidéo-gestion avec des fonctions telles que la détection automatique d'inci- dents, l'analyse de déplacement de personnes ou de véhicules, la surveillance d'action, ou encore la détection d'intrusion. Le savoir-faire de CIVITEC est adapté à l'étude de nouvelles générations de moyens de transports indi- viduels ou publics. Particulièrement, grâce aux déve- loppements de fonctions d'automatisation de la conduite et de sécurité, il est possible d'étudier fine- ment les conditions d'accès et d'utilisation de moyens de mobilité pour la population, que celle-ci soit jeune, âgée ou à mobilité réduite, et ce en tout sécurité.
- 10. 10 Pourquoi ce recours croissant au virtuel et à la simulation ? Les essais en condition réelles ont un coût élevé et nécessitent d'équiper spécialement des véhicules et l'infrastructure afin d'étudier les interactions entre les applications embarquées et les événements rencon- trés, et ce sur des dizaines de milliers de kilomètres. Avec le développement des systèmes coopératifs et communicants, les applications deviennent de plus en plus complexes à mettre en œuvre et à valider. La simulation autorise le contrôle des événements et leur reproductibilité, permet de jouer sur des facteurs cli- matiques et d'étudier l'influence et l'impact de paramètres physiques sur la robustesse des fonctions utili- sées dans les applications d'aides à la conduite embarquées, connectées et actives (automatisation de la conduite). Des essais difficiles ou dangereux deviennent facilement accessibles par la simulation comme l'analyse de la performance d'une fonction lors d'un événement singulier (détection d'animaux) alors que sans simulation, des heures d'attente pourraient être nécessaire avant la production de l'événement. La simu- lation permet d'approcher de près la réalité et fait gagner du temps et de l'argent. Pourquoi le test et la validation sont-ils des étapes importantes ? Afin de pouvoir qualifier la qualité d'applications aussi bien informatives qu'actives, il est indispensable de mettre en œuvre un grand nombre d'essais représentant de nombreuses situations critiques. Ces essais permettent de détecter, d'identifier et d'interpréter les défaillances, et d'identifier les non-détections, mais aussi les fausses alarmes en conditions opérationnelles. Ces tests sont aussi une source d'informations pour le paramétrage des modèles de capteurs utilisés en simulation afin que ceux-ci soient encore plus précis. Les essais en « vérité terrain » donnent quant à eux le cadre pour la validation des modèles numériques et leur acceptation comme moyen fiable d'aide à la conception. Ils restent nécessaires et sont encore les seuls à être acceptés par les organismes de certification. À propos d'ESI Group ESI Group est le principal fournisseur mondial de logiciels et services de prototypage virtuel, dont les métho- des s'appuient avant tout sur la physique des matériaux et la fabrication virtuelle. Fondé il y a plus de 40 ans, le groupe ESI a développé un savoir-faire unique afin d'aider les industriels à rem- placer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer, assembler et tester leurs produits dans des environnements différents. Le prototypage virtuel permet ainsi aux clients d'ESI d'évaluer la performance de leurs produits dans des conditions normales ou accidentelles, en prenant en compte les pro- priétés issues de leur fabrication. En obtenant ces informations dès le tout début du cycle de développement, les clients d'ESI savent si un produit peut être fabriqué, s'il atteindra les objectifs de performance fixés, et s'il passera les tests de certification, et ce, sans qu'aucun prototype réel ne soit nécessaire. Véritables moteurs d'innovation, les solutions d'ESI intègrent les toutes dernières technologies en termes de calcul haute perfor- mance et de réalité virtuelle immersive, pour donner vie aux produits avant même qu'ils n'existent. ESI Group est présent dans quasiment tous les secteurs industriels et emploie aujourd'hui plus de 1 000 spé- cialistes de haut niveau à travers le monde, au service de ses clients répartis dans plus de 40 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.esi- group.com/fr
- 11. 11
- 12. 12 MAGnUM une gestion multimodale plus efficace des réseaux de transport urbain grâce à une modélisation multi-échelles d'un nouveau genre Le projet MAGnUM1 vise, pour les autorités organisa- trices de la mobilité et aux opérateurs de transport public, de développer des stratégies innovantes de régulation grâce à une modélisation dynamique des déplacements. Cette modé- lisation d'un nouveau genre s'inscrit à l'échelle de la métropole et se fonde sur un ciblage précis des usa- gers. Le projet a été pensé par Ludovic Leclercq, chercheur au laboratoire d'ingénierie circulation transport (LICIT), une unité mixte de recherche commune à l'Ifsttar et l'ENTPE. Il est soutenu par une bourse d'excellence européenne (ERC) pour une durée de 5 ans. La modélisation des déplacements multi-modaux à l'échelle d'une métropole est traditionnellement basée sur une approche statique (le fameux « modèle à quatre étapes »). Elle reproduit les dif- férents comportements de mobilité, partant, de la répartition de la demande sur les réseaux. Toutefois, ces modélisations ne rendent pas compte des effets dynamiques liés à la congestion, ni des phénomènes de rupture (incidents, accidents…). D'un autre côté, les appro- ches dynamiques utilisées pour la gestion des réseaux de transport fournissent une vision précise des phéno- mènes de congestion, mais leur usage est le plus sou- vent restreint à l'échelle du quartier. En effet la descrip- tion des choix des usagers dans leurs déplacements et des équilibres de réseaux est un problème numé- rique très complexe en raison de la dimension tem- porelle à considérer. La plupart du temps, ces modèles dynamiques sont donc utilisés avec une description volontairement simplifiée de la demande en déplacement. Le projet MAGnUM va concevoir une approche de modélisation innovante basée sur l'intégration et une gestion dynamique des motivations des usagers dans leur déplacement . Ceci permettra de disposer d'une représentation qui soit mieux en adéquation avec la réalité des conditions de circulation dans les différents réseaux urbains. Le projet va par ailleurs mettre au point un « co-simulateur » (usagers / flux) suffisamment rapide et efficace en termes de temps de calcul (viser le temps-réel), afin de pouvoir porter 1 MAGnUM : A Multiscale and Multimodal Traffic Modelling Approach for Sustainable Management of Urban Mobility
- 13. 13 Qu'est-ce qu'une bourse ERC ? Obtenue à l'issue d'un processus de sélection très compétitif impliquant les meilleurs chercheurs européens, les appels ERC ont pour objectif de soutenir l'excellence du porteur à différentes étapes de sa carrière et de lui permettre notamment de déployer son activité au travers de l'encadrement de thèses et de post-doc. Plus spécifiquement, l'appel « consolidator » concerne les chercheurs ayant obtenu leur thèse il y a plus de 7 ans et moins de 12 ans. Les porteurs doivent démontrer leur capacité d'innovation, leur ambition et la faisabilité de leur proposition scientifique. Il n'y a pas de thèmes prédéfinis pour cet appel d'offre et seule l'excellence est prise en compte comme critère d'évaluation (du porteur et de la proposition scientifique). Le montant de subvention maximal par projet est de 2 millions d'euros. Pour plus d'informations : http://erc.europa.eu/ un nouveau regard, à un niveau de recherche plus amont, sur les questions des équilibres multimodaux et de l'affectation sur les réseaux, tout en intégrant explicitement les phénomènes dynamiques. La première phase du projet portera sur un travail d'observation des comportements de choix des indi- vidus au travers de la mise en place de sessions de « jeux sérieux » (simulation games). Il s'agit d'une plateforme de simulation dynamique microscopique où un grand nombre de joueurs (une centaine, voire au-delà) peuvent prendre en main, tous en même temps, les décisions de déplacements. Cette étape permettra de recueillir finement les comportements des usagers dans un environnement contrôlé, faci- lement adaptable aux questions scientifiques et opé- rationnelles traitées. Différents modèles de comportements seront ainsi établis pour ensuite être utilisés à des fins de régulation efficaces et de réduc- tion de l'empreinte environnementale. Ces straté- gies, seront conçues dans l'optique d'exploiter de manière optimale les opportunités obtenues par le déploiement de ces nouvelles technologies.
- 14. 14 VIBRIS Analyser les vibrations naturelles du sol pour surveiller les digues de protection et dévoiler les structures géologiques de nos territoires Le projet VIBRIS1 (valorisation interdisci- plinaire du bruit régional pour l'imagerie sismique) vise à adapter et valider des méthodes d'imagerie sismiques innovan- tes. Ces méthodes sont basées sur l'en- registrement des vibrations naturelles ambiantes, appelées « bruit de fond sismique ». Ce projet financé par la région des Pays de la Loire est déve- loppé par le LPG2 et l'Ifsttar par l'intermédiaire d'OSUNA3. Dévoiler la structure géologique profonde du Massif armoricain Le bruit de fond sismique correspond à toutes les ondes mécaniques de faible amplitude qui se pro- pagent constamment et naturellement dans le sous- sol sans séisme perceptible par l'homme. Il est principalement dû au battement des océans sur le milieu terrestre solide. Ces mouvements incessants du sol dépendent des propriétés du milieu traversé par les ondes sis- miques. L'analyse de ces ondes dans le cadre de VIBRIS permet de retrouver ces propriétés en pro- fondeur, et donc d’ausculter l'intérieur de notre pla- nète pour apporter de nouvelles informations sur la géologie de la région et son histoire. Stations sismologiques utilisées pour imager le Massif armoricain Mesures à échelle réduite sur maquette réalisées à l'aide du banc de mesures ultrasonore sans contact (MUSC) mis au point à l'Ifsttar Ausculter les digues de protection à la mer La houle et le ressac produisent sans cesse des micro-vibrations naturelles du sol. Ce bruit sismique se propage à travers la digue et la vitesse de pro- pagation dépend de ses propriétés mécaniques, notamment de sa rigidité. VIBRIS relie l'observation de variations spatiales et temporelles de ce bruit sis- mique au vieillissement naturel de la digue. L'utilisation des vibrations ambiantes permet de déployer des dispositifs pérennes de surveillance de ces ouvrages de protection contre les inonda- tions. Mesures tests sur la digue de La Parisienne à Bouin (Vendée) Pour agir à ces deux échelles et mieux comprendre les phénomènes de propagation d'ondes mis en jeu, VIBRIS porte également sur la modélisation numé- rique et expérimentale à échelle réduite en labora- toire.
- 15. 15 1 Le projet VIBRIS est un projet développé par le LPG, l'Ifsttar et l'OSUNA et financé à hauteur de 488 300 d’euros par la région Pays de la Loire. Site web : www.vibris.fr 2 LPG : unité mixte de recherche CNRS - université de Nantes, laboratoire de planétologie et géodynamique. Il regroupe une centaine d'acteurs de la recherche qui travaillent sur trois thématiques : intérieurs planétaires, surfaces planétaires, environnement paléo-environnement et bio-indicateurs. Site web : www.sciences.univnantes.fr/lpgnantes/index.php?lang=fr 3 OSUNA : observatoire des sciences de l'univers (OSU) Nantes-Atlantique regroupe 7 unités de recherche de 7 tutelles, CNRS, université de Nantes, université d'Angers, Mines Nantes, Ifsttar, Ifremer et CNAM en Pays de la Loire. Son unité mixte de service (UMS) soutient toutes les initiatives d'observation des sciences de l'u- nivers et de l'environnement sur le long terme en réseau avec les 28 autres OSU français. Site web : www.osuna.univ-nantes.fr Simulation numérique du bruit sismique généré par la mer au contact du pied de digue : les ondes sismiques se propagent dans le corps de digue et apporteront une infor- mation sur sa structure interne ; simulation réalisée en 3 dimensions à l'aide du code SEM développé en éléments spectraux. (version fournie par le CEA pour VIBRIS) Variation des vitesses sismiques dans une digue à marée montante. Les capteurs sont installés en crête d'ouvrage. La profondeur d'investigation est d'autant plus grande que les capteurs utilisés sont distants les uns des autres. Les zones en bleu sont interprétées comme des infiltrations d'eau (travaux en cours)
- 16. À Bouguenais, le laboratoire « Terrassements et Centrifugeuse » de l'Ifsttar mène des recherches fina- lisées en ingénierie géotechnique autour de deux grands enjeux de notre temps : l'économie de res- sources et d'énergie, la réduction des risques dans les structures de génie civil. Le laboratoire étudie notamment l'in- teraction entre les constructions et les sols en prenant en compte la diversité des terrains naturels et arti- ficiels et la variabilité de leurs pro- priétés. Pour mener leurs projets, compte tenu de la complexité croissante des structures, de leurs conditions de service et des conditions environne- mentales, les chercheurs s'appuient sur un équipe- ment unique en France : la centrifugeuse géotechnique (photo ci-dessus). 16 CHARGEOL Les fondations d'éoliennes en mer dans la centrifugeuse géotechnique de l’Ifsttar Le savoir-faire reconnu de l'équipe lui permet aujourd'hui d'étendre ses modèles et ses compétences au développement des fondations inno- vantes, comme celles conçues par STX France pour l'éolien en mer, ou encore en matière de fondations composites dans les sols renforcés. Les fondations pour éoliennes offshore de fortes puissances sont soumises à des chargements sta- tiques et cycliques beaucoup plus complexes que les structures instal- lées à terre. L'équipe travaille sur les phases suc- cessives du projet CHARGEOL initié et porté par STX depuis 2013, et financé par la région Pays de la Loire. Les campa- gnes d'expérimentations visent à caractériser les fondations d'une éolienne de type « jacket » à qua- tre pieux sous des trajectoires de chargements- complexes combinées, monotones et cycliques. Ce projet est exceptionnel du fait de la dimension du pieu : 1,8 m de diamètre pour une fiche de 40 m. Un volet est également consacré aux sollicitations sis- miques. Le projet collaboratif de recherche et de développe- ment CHARGEOL est labellisé par le pôle de com- pétitivité EMC2 et porté par STX France ; Il réunit l'ICAM, l'Ifsttar, l'École centrale de Nantes, Innosea, Hydrocean et bureau Véritas. Porteurs du projet : Manuel Beauvais et Matthieu Gélébart / STX France. Essai d'ancrage d'éolienne off-shore Mise en service en 1985 et constamment amélio- rée depuis, la centrifugeuse géotechnique permet d'étudier le comportement d'ouvrages géotech- niques comme les fondations, les remblais ou les soutènements, en construisant des modèles réduits représentatifs des conditions réelles. Pour cela le facteur de réduction d'échelle du modèle réduit doit correspondre à l'accélération centrifuge appliquée. L'équipement de Bouguenais va jusqu'à 200 G, ce qui le place dans la cour des grands équipements internationaux ! Une fois que cette accélération est appliquée, les efforts sur la structure et la fondation sont exercés en vol à l'aide de vérins ou par un télé- opérateur qui pilote l'essai à distance depuis la salle de commande. Photo d’illustration
- 17. 17
- 18. 18 La gare : un tiers de la consommation énergétique du chemin de fer Beaucoup d'efforts collectifs ont permis des avan- cées techniques significatives pour réduire la consommation d'énergie des trains. Maintenant, pour la plupart des grands opérateurs ferroviaires, c'est aussi sur les gares que se porte l'attention : les gares comptent en effet dorénavant, pour environ un tiers de la consommation d'énergie des lignes de transport ferroviaire, hors ateliers de maintenance. Historiquement les gares ont été conçues pour être isolées énergétiquement du réseau d'alimentation des rames et de leur environnement. Or les gares sont pleines de ressources énergétiques qui ne demandent qu'à être récupérées, comme l'énergie de freinage des trains ou la chaleur due au fonc- tionnement des équipements « chaleur fatale ». On se rend compte que les gares ont un potentiel d'é- change largement inexploité avec, par exemple, les transports urbains électriques, les bâtiments du quar- tier, les services de chauffage… Et si la gare deve- nait un opérateur énergétique de la ville de demain ? Énergie et qualité de l'air Pour l'Institut de transition énergétique Efficacity, viser à améliorer l'efficacité énergétique des gares, c'est améliorer l'efficience des villes, dans leur com- plexité. Le projet « Pôle gare », co-piloté par l'Ifsttar, poursuit l'objectif de mettre la gare sur la trajectoire de l'optimum énergétique et de qualité de l'air, pour aller jusqu'à en faire la « gare à énergie positive ». À ce titre, différentes prestations ont été réalisées par les équipes de l'Ifsttar, notamment les potentialités géothermiques de la future ligne 15 pour le compte de la Société du Grand Paris, ainsi que des recom- mandations pour l'instrumentation innovante des gares. Pour cela, il faut mobiliser la géothermie, l'énergie solaire, récupérer l'énergie fatale de freinage des trains et la chaleur des locaux techniques etc. Mais il faut aussi savoir piloter en temps réel, les flux d'énergie entre la gare (à travers ses composants : sous-stations, bâtiments, ventilation…) et son envi- ronnement urbain (véhicules électriques, réseaux de chaleur…). On crée ainsi un vrai réseau élec- trique intelligent spécifique, appelé aussi micro-grid. Les gares à énergie positive Intelligence et technologie pour l'énergie et les transports Pilotage optimal de la consommation énergétique avec amélioration de la qualité de l’air et du confort thermique Récupération et stockage de l’énergie de freinage du train Fournisseur d'électricité Comment récupérer, stocker puis distribuer l'énergie générée lors du freinage des trains
- 19. 19 Réduire de moitié les besoins énergétiques d'une station en récupérant le tiers de l'énergie de freinage résiduelle des métros Dans un premier temps la température et la ventila- tion dans les gares et stations sont évaluées. Objets de cette étude : la régulation thermique pour le confort des usagers et la qualité de l'air pour la santé tout en réalisant des économies d'énergie ! Une stra- tégie de régulation a été développée et les premiers résultats en simulation sont positifs. Exemple de simulation : relier trois stations par un tunnel où l'on combine le flux d'air généré sous l'effet des pistons des trains avec la ventilation mécanique de chaque station. En moyenne, un train entre en station toutes les deux minutes. Avec la stratégie de régulation ainsi établie, on obtient un gain d'énergie de 45 % sur le débit ventilé tout en maintenant un bon niveau de qualité de l'air. Seconde étape de la démarche : installer des batte- ries et super-capacités pour récupérer et réinjecter dans la gare une fraction significative de l'énergie de freinage des trains, non récupérée et réutilisée pour le démarrage d'autres trains. Il a été démontré que l'on pouvait réduire de moitié la demande éner- gétique d'une station en récupérant le tiers de l'é- nergie de freinage résiduelle d'une ligne de métro, le tout en améliorant la qualité de l'air ! En effet récu- pérer l'énergie par freinage électromagnétique conduit à réduire les émissions de particules du frei- nage mécanique. Quand la gare transforme la mobilité L'optimisation énergétique de la gare passe aussi par une réflexion sur les services offerts aux voya- geurs. La gare à énergie positive facilite l'usage des modes doux et propose des trajets en véhicule élec- trique. Elle s'intègre dans une approche territoriale et sociale : diminuer le besoin de déplacement, offrir des tiers lieux de travail, combiner commerces et mobilité. À propos d'Efficacity « Efficacity est un centre de recherche et dévelop- pement dédié à la transition énergétique des terri- toires urbains. Lancé en 2014, il rassemble sur un même site les compétences de plus de 100 cher- cheurs issus de l'industrie et de la recherche publique dans une logique de collaboration étroite entre tous les acteurs. Efficacity est financé par le programme des investissements d'avenir. »
- 20. 20 Une ville miniature nommée Sense-City Déploiement massif de capteurs pour la qualité de l'air et de l'eau Au sein de la mini-ville Sense-City, sur le campus Descartes situé à Marne-la-Vallée, une grande halle climatique mobile s'élèvera très prochainement. L'équipement d'excellence Sense-City étudie et compare de nombreux types de capteurs pour la ville durable et pour notre santé. Pour ce faire, il est nécessaire de contrôler très précisément et de savoir faire varier les paramètres environnementaux, en particulier les polluants de l'air, le rayonnement solaire, la pluie... Neuf1 organismes se sont regroupés pour former le consortium Sense-City. En 2016, leurs expérimen- tations seront dédiées à l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau. Ce travail est indispensable pour deux raisons : d'une part, la pollution de l'air, toutes causes confondues, causerait 350 000 décès pré- maturés par an en Europe selon l'OMS ; d'autre part, le changement climatique pourrait réduire d'un tiers les réserves d'eau en France et provoquer une dété- rioration générale de sa qualité en 2050. L'enjeu semble évident : il faut donner les moyens aux habi- tants des villes de connaître leur niveau d'exposi- tion pour protéger leur santé. Dans le domaine de la qualité de l'eau, Sense-City veut optimiser les adjonctions de chlore : plus parti- culièrement, l'Ifsttar développe de nouvelles tech- nologies de capteurs ultra-fins (projet Proteus) et développe des systèmes numériques qui pilotent localement de manière très fine les réseaux d'eau potable (projets Smart Water Networks et Micad'eau). Deux réseaux-modèles d'eau potable et d'eau d'évacuation seront déployés en conditions réalistes dans Sense-City en 2016. Les acteurs aca- démiques et industriels pourront y mettre au point et valider leurs technologies. Dans le domaine de la qualité de l'air, le progrès passe par des déploiements massifs de capteurs dans l'environnement urbain. L'objectif est le sui- vant : développer des technologies performantes à un coût unitaire suffisamment faible. L'Ifsttar participe à la mise au point d'outils de suivi de la qualité de l'air intérieur (projet MIMESYS) et développe un réper- toire de nouveaux capteurs (projet Smarty). Sense- City accueillera dès février 2016 un quadrillage ultra dense de 54 capteurs sur 250 m2 en 18 points de mesure. Ces capteurs permettront de suivre en temps réel les niveaux d’ozone, d’oxydes d'azote et de particules fines : cette infrastructure unique en France, proposée par le groupe TERA, est financée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre du projet URBACLIM. La première pierre de la halle climatique de l'équi- pement d'excellence Sense-City, financé à plus de 6,5 M d’euros par le programme d'investissements d'avenir, sera posée le 11 avril 2016. Une réplique du futur équipement a été inaugurée en mars 2015 sur le site de l'Ifsttar et permet aux équipes du consor- tium d'expérimenter différents capteurs. Reconnus par la communauté scientifique, les cher- cheurs de Sense-City contribuant aux bases tech- nologiques de la mesure de demain distribuée au sein des « smart cities », ont établi en 2015 deux records au niveau mondial pour leurs travaux. Le premier portait sur les capteurs de déformation à base de nanotubes de carbone sur plastique que l'on peut noyer dans l'épaisseur des matériaux de construction. Le second concernait les transistors à nanotubes de carbone pour l'analyse simultanée
- 21. 21 d'un grand nombre d'espèces gazeuses. Ce travail, résulte de l'équipe commune à l'Ifsttar et au LPICM (École polytechnique et CNRS) NACRE, et a été réalisé au titre du programme scientifique de Sense- City. Grâce à ces travaux, l'idée de faire de nos villes des espaces durables se concrétise ainsi, chaque année davantage. 1 Le consortium Sense-City regroupe : l'Ifsttar, l'ESIEE, le CSTB, l'Université Paris-Est, l'École polytechnique, le CNRS, le LPICM, l'INRIA, l'Université Paris-Est de Marne-la-Vallée. Représentation numérique de la mini ville instrumentée située à Champs-sur-Marne
- 22. 22 Vers des mobilités périurbaines plus durables ? Quelques pistes pour l'action publique Des études sociolo- giques pour comprendre les logiques d'implanta- tion périurbaines et les modes de vie De nombreuses recher- ches s'attachant à offrir un nouveau regard sur les liens entre la périurbanisa- tion et les valeurs du déve- loppement durable sont menées à l'Ifsttar en parte- nariat avec différents acteurs académiques. Sous la direction d'Anne Aguiléra, chercheuse au LVMT2 pour le compte du PUCA3, en collaboration avec les UMR IDEES4 et LAVUE5, des travaux de recherche s'intéressent aux modes de peuplement et aux mobilités quotidien- nes des habitants de trois communautés de com- munes situées dans le périurbain francilien, à une trentaine de kilomètres de Paris : la Brie Boisée, la Haute Vallée de Chevreuse et Carnelle Pays de France. Pour mener à bien ces projets, des maté- riaux de nature variée ont été mobilisés : des don- nées de recensement de population (RP) et d'enquête de transport (Enquête Globale de Transport, ou EGT), des réponses à un question- naire original distribué dans plusieurs communes localisées sur ce terrain d'étude et rempli par plus de 300 ménages (ces derniers constituant un échan- tillon représentatif de la population des communes étudiées), ainsi que des entretiens en face-à-face réalisés auprès d'une tren- taine de résidents. Les enquêtes visaient à com- prendre les logiques de l'implantation périurbaine et des modes de vie des habitants (territoires fré- quentés et mobilités), ainsi qu'à explorer leurs marges de manœuvre (réelles ou perçues) pour tenter de diminuer leur dépendance à la voiture individuelle, notamment dans une perspective d'augmentation forte du coût des carburants (d'autant plus plausible qu'une hausse significative avait eu lieu quelques mois auparavant). Les principaux enseignements Parce qu'ils parcourent des distances plus élevées et qu'ils utilisent davantage l'automobile, les périur- bains émettent en moyenne pour leurs déplace- ments quotidiens, significativement plus de gaz à effet de serre que les urbains (Combien de fois plus ? Cela dépend de la taille de l'aire urbaine, voir graphique de l'INSEE ci-dessous). Et leur taux de motorisation a continué à progresser depuis le milieu des années 90, alors qu'il est en stagnation dans l'urbain, et même en recul dans Paris. Photo d’illustration
- 23. 23 Cette étude montre cependant un certain nombre de nouveaux signaux qui sont encourageants. La première « bonne nouvelle » est que les périurbains sont en demande de « proximité » pour leurs activi- tés quotidiennes. La seconde concerne les signes de lassitude vis-à-vis du modèle tout-automobile. Les reproches concernent principalement non pas son coût financier (qui, on le sait, est souvent sous- évalué par les ménages) ni (encore moins) son impact environnemental, mais plutôt la perte de temps associée. La troisième enfin est que les ménages périurbains sont une majorité à considérer qu'ils disposent d'un certain nombre de marges de manœuvre pour réduire leur usage de la voiture sans (trop) altérer leur mode de vie ni remettre en question leur choix résidentiel. Mais encore moins du quart des personnes ayant répondu au question- naire estiment qu'elles ne peuvent ou ne veulent rien changer à leur mobilité. Le renoncement complet à la voiture n'est pas à l'or- dre du jour : il serait trop compliqué à mettre en œuvre en l'état actuel des formes urbaines et des modes de vie. Mais les enquêtes suggèrent que les habitants seraient prêts à basculer vers des formes collectives de transport pour certains trajets, et à réduire les kilomètres parcourus si les formes urbai- nes le permettent ou en cas de forte augmentation des carburants. À ce sujet, les analyses montrent toutefois qu'une hausse, même sensible, des prix à la pompe n'aurait, au moins à moyen terme, qu'un effet limité sur l'usage de la voiture, les ménages étant prêts à des sacrifices financiers importants pour continuer à bénéficier des services de l'auto- mobile (et corrélativement à habiter le périurbain). Pour les pouvoirs publics, un enjeu majeur se des- sine autour de la « consolidation de bassins de vie de proximité », dans la perspective d'une meilleure maîtrise des besoins de déplacement, de réduction des distances parcourues et, au moins pour certains flux, de report des pratiques de mobilité vers les modes doux et actifs. Cette consolidation des bassins de vie serait également accompagnée d'un bénéfice social par le renforcement des capacités d'adaptation du périurbain à une crise énergétique sévère, notamment pour les ménages les plus modestes. Il est utile de distinguer les motifs professionnels des autres motifs, parce qu'ils ne se déploient pas sur les mêmes territoires et ne concernent ni les mêmes horaires, ni les mêmes jours de la semaine. Pour les mobilités liées au travail, les ménages expri- ment des attentes à l'égard de services de mobilité mieux adaptés à leurs horaires et à la géographie de leurs trajets. Des enjeux forts se dessinent autour de la continuation du développement et de la diversifi- cation fonctionnelle des pôles secondaires (comme les villes nouvelles) et de leur desserte par des ser- vices très souples de transport collectif et/ou, selon les cas, de véhicules partagés. Dans un autre registre, qui concerne moins directe- ment les acteurs locaux, les enquêtes montrent que développer les possibilités de télétravailler certains jours à domicile ou dans des tiers-lieux de proximité constitue pour certaines professions (notamment les cadres) une perspective intéressante pour réduire l'usage de la voiture, en particulier si les carburants augmentent très fortement. Pour les activités non professionnelles, les enjeux se situent à la fois à l'échelle des pôles secondaires mais également à une échelle plus locale, celle des communes et aussi des inter-communalités, dont les potentialités sont pour l'instant sous-exploitées. Il s'agit, bien sûr, d'étoffer l'offre de commerces et de services. Mais aussi et surtout de mieux hiérarchiser et articuler leur structure spatiale. La tâche est com- plexe, car on se heurte rapidement à la fois à des problèmes de périmètres institutionnels (en particu- lier, le territoire dessiné par les pôles secondaires n'a pas de réalité ou de représentation politique) et éco- nomiques : comment la logique de développement des centres commerciaux peut-elle aller au-delà des perspectives de recettes fiscales et intégrer des vraies analyses sociales et spatiales durables ? la promesse (de création d'emplois locaux) constitue toujours un argument politique puissant mais ne reste pas toujours vérifiée et souffre d'un déficit d'é- valuation. Comment mettre en œuvre un programme de report modal ? Il apparait compliqué de prendre en compte des aspects comme la dispersion spatiale et temporelle pour les d éplacements concernés. 1 Aguiléra A, Nessi H, Sajous P, Thébert M. (2014) Dynamiques de peuplement, des formes urbaines et des mobilités dans les territoires de la périurbanisation. Quels enseignements au regard des enjeux du développement durable ? Rapport pour le compte du PUCA, décembre 2015. 2 LVMT : laboratoire ville mobilité transport, unité mixte de recherche commune à l'Ifsttar, l'université Paris-Est Marne-la- Vallée (UPEM) et l'École des Ponts ParisTech 3 PUCA : plan urbanisme construction architecture 4 UMR IDEES : l’unité mixte de recherche IDEES est née en 1996, de la fusion des équipes MTG à Rouen, LEDRA à Rouen, CIRTAI au Havre et GEOSYSCOM à Caen. Plus d'informations sur : http://umr-idees.cnrs.fr 5 UMR LAVUE : unité mixte de recherche laboratoire, architecture, ville, urbanisme, environnement, du CNRS, créée en 2010. Elle regroupe près de 300 membres. Plus d'informations sur : www.lavue.cnrs.fr
- 24. 24 À l'échelle intra-communale, il faut encourager encore plus le recours à la marche et au vélo par des actions sur les trottoirs, les pistes cyclables, les che- minements pour les piétons, notamment sur les tra- jets à destination des établissements scolaires (voire des activités péri-scolaires). Le développement des mobilités inter-communales et leur basculement vers des modes doux et actifs, notamment le vélo, cons- titue un autre défi. Une réflexion concernant une meilleure distribution des commerces et services à cette échelle, est à cet égard intéressante. Cela per- mettrait de favoriser les déplacements de courte dis- tance tout en résolvant potentiellement certains problèmes, comme la viabilité économique des acti- vités qui s'installent dans les petites communes périurbaines, ou de réduire les réticences exprimées par les populations de voir leur commune accueillir un développement important qui aurait pour effet de faire (trop) augmenter la population. En effet, l'atta- chement à la ruralité est associé à une volonté de préservation d'un certain caractère « villageois » de la commune. Vers des mobilités périurbaines plus durables ? Photo d’illustration
- 25. 25
- 26. 26 www.ifsttar.fr Suivez toute l'actualité de l'Ifsttar sur : Contact presse : Émilie Vidal • Tél. : 01 81 66 82 15 • Mobile : 06 19 71 21 95 • emilie.vidal@ifsttar.fr Ifsttar, siège 14-20, boulevard Newton Cité Descartes - Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée CEDEX 2 Mise en page : Ph. Caquelard, Ifsttar Crédits photos : Arnaud Bouissou, Sylvain Giguet et Laurent Mignaux, MEDDE - Hans Hillewaert
