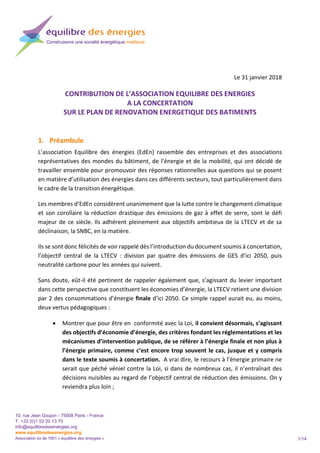
La contribution de l'Association Equilibre des Energies au Plan rénovation énergétique des bâtiments
- 1. 1/14 10, rue Jean Goujon - 75008 Paris - France T. +33 (0)1 53 20 13 70 info@equilibredesenergies.org www.equilibredesenergies.org Association loi de 1901 « équilibre des énergies » Le 31 janvier 2018 CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION EQUILIBRE DES ENERGIES A LA CONCERTATION SUR LE PLAN DE RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 1. Préambule L’association Equilibre des énergies (EdEn) rassemble des entreprises et des associations représentatives des mondes du bâtiment, de l’énergie et de la mobilité, qui ont décidé de travailler ensemble pour promouvoir des réponses rationnelles aux questions qui se posent en matière d’utilisation des énergies dans ces différents secteurs, tout particulièrement dans le cadre de la transition énergétique. Les membres d’EdEn considèrent unanimement que la lutte contre le changement climatique et son corollaire la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, sont le défi majeur de ce siècle. Ils adhérent pleinement aux objectifs ambitieux de la LTECV et de sa déclinaison, la SNBC, en la matière. Ils se sont donc félicités de voir rappelé dès l’introduction du document soumis à concertation, l’objectif central de la LTECV : division par quatre des émissions de GES d’ici 2050, puis neutralité carbone pour les années qui suivent. Sans doute, eût-il été pertinent de rappeler également que, s’agissant du levier important dans cette perspective que constituent les économies d’énergie, la LTECV retient une division par 2 des consommations d’énergie finale d’ici 2050. Ce simple rappel aurait eu, au moins, deux vertus pédagogiques : Montrer que pour être en conformité avec la Loi, il convient désormais, s’agissant des objectifs d’économie d’énergie, des critères fondant les réglementations et les mécanismes d’intervention publique, de se référer à l’énergie finale et non plus à l’énergie primaire, comme c’est encore trop souvent le cas, jusque et y compris dans le texte soumis à concertation. A vrai dire, le recours à l’énergie primaire ne serait que péché véniel contre la Loi, si dans de nombreux cas, il n’entraînait des décisions nuisibles au regard de l’objectif central de réduction des émissions. On y reviendra plus loin ;
- 2. 2/14 Plus important encore, montrer, par le rapprochement entre le facteur 4 sur les GES et le facteur 2 sur les économies d’énergie, qu’aucune politique d’économie d’énergie, si efficace soit-elle, ne saurait à elle seule répondre aux objectifs extrêmement ambitieux retenus en matière de lutte contre le changement climatique. On y reviendra également plus loin. Pour résumer les commentaires qui suivent, les membres d’EdEn sont convaincus de la nécessité d’un plan d’ensemble concernant les bâtiments dans la transition énergétique. Ce plan devrait viser à mettre en adéquation les politiques incitatives, réglementaires et de soutien des pouvoirs publics avec les objectifs nationaux de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Ils constatent avec regret que le document soumis à concertation, même s’il n’est pas dépourvu de mérites, n’aborde, après avoir réaffirmé la priorité de la réduction drastique des émissions de GES, que l’une des facettes de la problématique : la réduction des consommations d’énergie. De surcroît l’aborde-t-il à partir d’une approche du passé, la réduction des consommations d’énergie primaire, sans prendre conscience des contradictions que peut présenter, dans certains cas, l’application d’un tel critère avec l’objectif de réduction des émissions au moindre coût. Plus généralement, ce plan aurait pu être l’occasion d’engager une réflexion sur des outils réglementaires vieillissants : la banalisation des technologies numériques renouvelle aujourd’hui profondément la problématique de l’efficacité énergétique dans le bâtiment et celle de ses relations avec son environnement énergétique.
- 3. 3/14 2. De la nécessité d’agir fort et vite pour décarboner le secteur résidentiel et tertiaire Ce secteur arrive au deuxième rang des secteurs de l’économie, en termes d’émissions de CO2 : près de 24 % des émissions directes en 2015, plutôt 30 % si l’on tient compte des émissions indirectes, via le système électrique, le sourcing des réseaux de chaleur, le transport du bois ; C’est en la réduction massive des émissions de CO2 de ce secteur qu’était fondé l’espoir de réaliser le « facteur 4 » en 2050. La SNBC ne prévoyait-elle pas une réduction des émissions directes de ce secteur de 87 % par rapport à leur niveau de 2013, d’ici 2050 ? Or, paradoxalement, il est clair aujourd’hui que le secteur résidentiel et tertiaire est avec celui des transports, le plus en retard par rapport à la « feuille de route SNBC » ; o Notre association Equilibre des Energies, a maintes fois dénoncé qu’en dépit d’apparences rassurantes dues à un concours de circonstances non reproductibles (division par 2 des émissions de la production d’électricité) ou fortuites (configuration particulière des aléas climatiques), les tendances observées sur la période 2010-2015 n’étaient pas en ligne avec les objectifs de la SNBC ; o La Cour des Comptes, dans son rapport de septembre 2016 « efficience des dépenses fiscales relatives au développement durable », a de son côté conclu que « les résultats ne sont pas à la hauteur » ; o Tout récemment, les indicateurs de résultats publiés en janvier 2018 par le Ministère de la transition écologique et solidaire dans le cadre du suivi de la Stratégie nationale bas carbone montrent, en première analyse, que les émissions dans le secteur résidentiel et tertiaire se sont situées en 2016 à 11 % au-dessus de la trajectoire prévue. L’échec patent des actions menées naguère au regard des objectifs de la SNBC est aujourd’hui sur la place publique et il semblerait inconcevable qu’une action d’envergure telle que celle soumise à la présente concertation, ne se donne pas comme ambition de pallier, dans toute la mesure du possible, cette grave défaillance des politiques antérieures. Tel est le sens des propositions qui sont formulées dans la suite de ce document.
- 4. 4/14 3. Ce que pourrait être une politique de rénovation cohérente avec les objectifs de la SNBC Un préalable indispensable : avoir bien conscience de ce que signifie la cible 2050 de la SNBC pour le secteur résidentiel et tertiaire. Un calcul simple montre qu’une réduction de 87 % en 2050 des émissions, directes et indirectes, de CO2 du secteur résidentiel et tertiaire, implique qu’en moyenne, toutes générations confondues, les émissions des bâtiments de ce secteur soient ramenées aux environs de 3 kg de CO2 par m2 et par an. S’agissant de la rénovation des bâtiments actuels, dont les émissions ont été en moyenne en 2014 de 23 kg CO2 par m2 et par an pour le secteur résidentiel et de 39 kg CO2 par m2 et par an pour le secteur tertiaire1, le chemin à parcourir est évidemment considérable. Quant aux bâtiments que l’on construit aujourd’hui et qui seront des « bâtiments existants » parmi d’autres en 2050, ils ne sont pas tous, et de loin, exemplaires par rapport à la cible de 3 kg de CO2 par m2 et par an. Si des bâtiments mettant en œuvre des pompes à chaleur double service, pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire, respectent d’ores et déjà la cible 2050 ; si des solutions mettant en œuvre des radiateurs électriques très performants complétés par des chauffe-eau thermodynamiques sont déjà presque sur la cible 2050, les logements construits aujourd’hui utilisant le gaz naturel pour le chauffage des locaux et l’eau chaude sanitaire et respectant la RT2012, se situent dans la plage 10 à 12 kg de CO2 par m2 et par an. Identifier les leviers sur lesquels on peut agir pour respecter la « feuille de route SNBC » Comme l’a bien identifié la SNBC dans le prolongement de la LTECV, trois leviers doivent être actionnés de manière concomitante pour assurer efficacement la « décarbonation » de l’économie : o Utiliser rationnellement chaque énergie dans chaque usage pour lequel elle est retenue. 1 Source : CEREN 2015
- 5. 5/14 Dans le cas de la rénovation des bâtiments, cela implique de jouer à la fois sur le comportement des occupants, la gestion active de l’énergie, le remplacement éventuel des équipements d’utilisation des énergies, l’amélioration du bâti, sachant que ce sera généralement un « bouquet » d’actions qui constituera la solution la plus rationnelle, en un moment donné, en termes d’économie, de service rendu et de qualité de vie des utilisateurs. La logique de réduction des émissions voudrait que les économies d’énergie soient d’autant plus poussées que l’énergie utilisée est carbonée. La taxe carbone, dont une forte hausse est programmée dans la loi de finances 2018, répond précisément à cette préoccupation en rendant plus attractifs les investissements économisant les énergies les plus carbonées. o Décarboner les sources d’approvisionnement en énergie du secteur Le bois sous réserve que la politique forestière permette de le considérer comme renouvelable, est une énergie bas carbone, même si certains progrès peuvent encore être envisagés dans les émissions liées à son transport et à son conditionnement. Les émissions en exploitation de la plupart des EnR utilisables dans les bâtiments sont généralement très faibles. Il n’en va pas nécessairement de même si l’on raisonne en ACV, en particulier par référence à l’empreinte carbone2. L’électricité avec des émissions moyennes de 65 grammes de CO2 par kWh (169 grammes pour des applications de type chauffage, 59 pour des applications de type eau chaude sanitaire d’heures creuses) est dès aujourd’hui très largement décarbonée3. Les évolutions du mix national de production d’électricité ont été pensées de manière non seulement à conforter cette décarbonation mais aussi à l’amplifier encore. La SNBC a en outre de grandes ambitions pour la décarbonation du secteur énergétique (- 96 % en 2050 par rapport au niveau de 1990). 2 Le cas des panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine est, à cet égard, emblématique, dont la mise en œuvre conduit, paradoxalement, à détériorer le contenu moyen carbone des kWh électriques produits en France. 3 Source : base carbone de l’ADEME
- 6. 6/14 Une question importante est la poursuite de la décarbonation de l’approvisionnement énergétique des réseaux de chaleur par un recours de plus en plus accru aux énergies renouvelables et de récupération. La problématique la plus délicate est celle du gaz. Le « verdissement » du gaz de réseau par injection de biométhane et/ou d’hydrogène électrolytique est promis par ses promoteurs à un grand avenir. La part du bio méthane dans le gaz distribué est aujourd’hui extrêmement faible (moins de un °/00). En revanche, la LTECV retient un objectif de 10 % en 2030 et certains considèrent comme souhaitable et possible une très large décarbonation du gaz de réseau d’ici 2050. Mais cette vision relève du grand futur, elle est empreinte de grandes incertitudes et il y a lieu de se soucier aujourd’hui du poids du gaz, énergie assez fortement carbonée (243 grammes de CO2 par kWh), dans la satisfaction des besoins thermiques des bâtiments résidentiels et tertiaires : D’une part, ce scénario de très forte décarbonation du gaz est de l’avis quasi-unanime une perspective de long terme. Or les émissions de CO2 ont un effet cumulatif, sur l’effet de serre, compte tenu de la durée de vie extrêmement longue de ce GES dans l’atmosphère ; D’autre part, si ce scénario ne se réalisait pas ou ne se réalisait que beaucoup plus tard, ce qui risque d’être le cas selon la plupart des experts, la reconversion d’un secteur où le gaz, énergie carbonée, jouerait un rôle excessif pourrait se révéler complexe et coûteuse. Pour ces raisons la politique la plus sage car la plus efficace à court-moyen terme et la moins risquée à long terme, consiste à considérer dans les choix énergétiques le gaz pour ce qu’il est aujourd’hui avec son facteur d’émission de 243 grammes par kWh, sachant que ce facteur évoluera au fil des ans en fonction de la réussite plus ou moins complète, plus ou moins rapide, de la politique de décarbonation du gaz qui s’engage aujourd’hui. o Substituer dans toute la mesure du possible des énergies décarbonées à des énergies carbonées. A contrario, s’interdire par principe de substituer des énergies carbonées à des énergies décarbonées La structure actuelle du mix d’approvisionnement énergétique du secteur résidentiel et tertiaire suggère deux priorités :
- 7. 7/14 Réduire encore le poids des produits pétroliers. Il a certes déjà beaucoup baissé au cours des décennies qui ont suivi les chocs pétroliers, mais compte tenu du facteur d’émission élevé du fioul (324 grammes/kWh), il pèse sans doute encore beaucoup trop. Bois (chaudières ou poêles complétés par des chauffe-eau thermodynamiques) et électricité (pompe à chaleur double service) répondent techniquement au problème ; S’attaquer au poids du gaz en termes d’émissions de CO2. Il y a, bien sûr, la solution de décarbonation du gaz évoquée plus haut. Mais il existe aussi de nombreuses solutions de substitution, plus souvent partielle que totale, du bois ou de l’électricité à des solutions gaz en place. Deux exemples : - Compléter une installation de chauffage au gaz par une production d’eau chaude thermodynamique qui offrira une alternative très peu émettrice de CO2 à la production de l’eau chaude sanitaire par une chaudière à gaz double usage dont on sait que le rendement est très médiocre hors période de chauffe ; - Remplacer une chaudière à gaz obsolète par une pompe à chaleur hybride (électricité en base + gaz en pointe). Ce type de solution hybride est encore un peu difficile à justifier avec les prix actuels des énergies mais pourrait avoir un grand avenir compte tenu du poids des ENR dites « intermittentes » dans le mix électrique. Revisiter les critères et les outils de la rénovation. Tout ce qui vient d’être dit relève de l’évidence dès lors que l’on a compris que, comme le rappelle le document soumis à concertation dès son introduction, la réussite d’une politique de rénovation se mesurera désormais à l’aune des résultats qu’elle obtient en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant … o Les pratiques actuelles conduisent trop souvent à des décisions aberrantes au regard de l’impératif de réduction drastique des émissions de CO2
- 8. 8/14 Pour ne citer que deux exemples : Un logement chauffé à l’électricité de type HPE rénovation consomme 150 kWhep/m2/an et émet 9 kg de CO2/m2.an. Un passage au gaz permet de réduire de près de 50 % les consommations d’énergie primaire et d’atteindre le label BBCRéno de 80 kWhep/m2.an, mais augmente au passage de 80 % les émissions de CO2 en les faisant passer de 9 à 16 kg de CO2/m2.an... Un retour d’expérience de Promotelec montre que 36 % des dossiers labellisés électricité passent au gaz, que l’électricité disparaît des logements collectifs BBC rénovation et l’observatoire BBC montre que 83 % des projets BBC rénovation en logement collectif initialement à l’électricité passent au gaz. o L’origine de ces errements est facile à identifier : l’octroi des aides à la rénovation sont aujourd’hui conditionnées à un seul critère, l’économie d’énergie primaire, qui entre fréquemment en contradiction avec ce qui devrait primer : la réduction des émissions de CO2 Le diagnostic de performance énergétique (DPE) comporte, dans un cadre conventionnel mais raisonnablement significatif, quatre indicateurs supposés caractériser la performance énergétique, économique et environnementale d’un logement : sa consommation finale d’énergie par m2 ; sa consommation d’énergie primaire par m2 ; ses émissions de CO2 par m2 ; une estimation normative de sa facture énergétique en €. Il est clair que ce sont les premier et dernier de ces indicateurs qui parlent le mieux à l’occupant ou au futur acheteur mais l’attention réglementaire et l’affichage se portent d’abord sur le deuxième (consommation d’énergie primaire) et, plus à titre d’information que comme critère décisionnel, sur le troisième (émissions) qui devrait pourtant être, dans la logique de la SNBC, l’indicateur privilégié.
- 9. 9/14 L’exemple détaillé dans le tableau ci-dessous est instructif. Deux solutions de rénovation d’un logement « tout électrique » qui serait classé dans les « passoires à énergie » au regard de son étiquette F en énergie primaire, sont comparées : La première consiste à rester à l’électricité, à rénover le bâti et à renouveler les équipements d’utilisation de l’électricité (radiateurs de dernière génération, chauffe-eau thermodynamique). Elle permet d’obtenir une très bonne performance en termes d’émissions de CO2 (étiquette climat B) mais l’étiquette énergie primaire, bien qu’améliorée reste très moyenne (D) ; La seconde consiste après rénovation du bâti à installer une chaudière à gaz double service (avec, bien entendu, sa boucle d’eau chaude et ses radiateurs). Elle permet, certes une amélioration très importante de la performance en énergie primaire (l’étiquette énergie du DPE passe de F à C). En revanche, elle coûte beaucoup plus cher en investissement, conduit à une facture plus élevée pour l’utilisateur que la solution électrique rénovée, et surtout détériore la performance environnementale par rapport à la situation initiale. Alors que cette seconde solution de rénovation est désastreuse pour l’investisseur, pour l’occupant du logement, et, encore plus, pour la lutte contre le changement climatique, elle sera aujourd’hui soutenue au motif, en l’occurrence incompréhensible, qu’elle est la plus efficace pour améliorer la performance en énergie primaire.
- 10. 10/14 Situation initiale : chauffage électrique Rénovation lourde + Emetteur électriques dernière génération Rénovation lourde + chaude condensation gaz individuelle double usage Ubât (W/m2.K)) 1,8 0,75 0,75 Consommation d’énergie primaire chauffage/ECS (kWhep/(m2.an)) 364 163 102 Etiquette Energie DPE F D C Investissement (€TTC/logt) - 16 631 25 088 Facture tous usages + maintenance (€TTC/(logt.an) 1 792 988 1 156 (+ CCE de 100€ en 2020) Emission CO2 chauffage/ECS (kgCO2/(m2.an)) 20 6 24 Etiquette Climat DPE C B D De cet exemple ressort clairement que si l’on entendait piloter la rénovation par la seule énergie primaire calculée selon les conventions actuelles, on s’exposerait à de graves erreurs en matière de lutte contre le changement climatique : élimination de rénovations électriques très performantes en émissions de CO2 au profit de conversions au gaz dégradant le bilan CO2, impossibilité de réaliser certaines substitutions pertinentes de l’électricité aux hydrocarbures fossiles. Constatant que ces difficultés tiennent au coefficient 2.58 appliqué au kWh électrique, une solution approximative pour pallier ces aberrations, pourrait être de « moduler » ce coefficient pour tenir compte du moindre contenu en CO2 du kWh électrique. Une valeur de 2 au lieu de 2.58, qui ne traduirait d’ailleurs qu’une anticipation de l’évolution du mix électrique national, éviterait sans doute quelques erreurs regrettables. Mais il serait assurément méthodologiquement plus satisfaisant et moins opaque en termes de processus décisionnel, d’utiliser un critère mettant en œuvre les deux volets du DPE capables d’expliciter les conséquences d’une opération de rénovation en termes d’énergie d’une part, d’émissions d’autre part.
- 11. 11/14 o Plus encore que le perfectionnement de la méthode de calcul du DPE, c’est la manière dont il est utilisé dans l’appréciation de la pertinence d’un projet de rénovation, qui doit faire l’objet d’une remise en cause. Tout comme le moteur de calcul de la RT2012, la méthode de calcul du DPE souffre d’un certain nombre d’insuffisances dont certaines sont dès maintenant préjudiciables à la rénovation des bâtiments. C’est ainsi que le DPE devrait tenir compte de l’impact de la gestion active des énergies (détection de l’ouverture des fenêtres, détection de présence, régulation pièce par pièce, …) qui est l’un des moyens les moins coûteux et les plus efficaces d’utilisation rationnelle de l’énergie et de réduction des émissions de CO2. Il devrait également tenir compte des systèmes bi-énergies, des moyens de stockage, fixes et mobiles, des possibilités de gestion de la courbe de charge électrique et d’intégration dans les smart grids, …. En revanche, l’opportunité de raisonnements en cycle de vie (ACV) dans le cadre d’une rénovation n’est pas évidente compte tenu du contenu carbone des investissements évidemment beaucoup plus faible que dans le cas d’une construction neuve. Mais cette affirmation mérite discussion. Quoi qu’il en soit, le point essentiel est l’utilisation qui doit être faite des différents indicateurs élaborés dans le cadre du DPE. Conformément aux principes retenus par la LTECV, ce sont les indicateurs d’émissions de GES et de consommation d’énergie finale qui doivent constituer l’ossature d’un DPE pertinent. Dans le cas où il n’y a pas de changement d’énergie pour les usages thermiques, réduction des émissions et réduction des consommations vont évidemment de pair. Dans le cas de la substitution d’une énergie moins carbonée à une énergie plus carbonée en place, il faut évidemment veiller à ce que la substitution, bénéfique en termes d’émissions, permette également des progrès en termes de consommation et de facture énergétique. Un travail de fond est nécessaire pour caler correctement les conditions de cohérence entre les deux critères. Pour obtenir cette cohérence, il faudra évidemment se pencher sur l’échelonnement des différents niveaux d’émission et de consommation définissant les niveaux d’étiquettes.
- 12. 12/14 A titre provisoire et pour changer le moins possible les habitudes, nous proposons de retenir le mode d’emploi suivant des deux volets actuels du DPE, mode d’emploi qui nous semble bien couvrir l’ensemble des situations envisageables : Un projet de rénovation est éligible aux aides publiques dans l’un ou l’autre des deux cas suivants : il permet de réaliser un gain de deux niveaux sur l’étiquette énergie du DPE, assorti d’un gain d’au moins un niveau sur l’étiquette climat du DPE ; il permet de réaliser un gain de deux niveaux sur l’étiquette climat du DPE sans détériorer l’étiquette énergie primaire du DPE.
- 13. 13/14 4. Nos propositions d’évolution immédiate du Plan de rénovation énergétique des bâtiments o Elargir la cible prioritaire aux bâtiments relevant des classes F, G et E, du volet climat du DPE. Compte tenu du dérapage constaté par rapport à la trajectoire SNBC, se contenter de considérer comme prioritaire la cible définie par l’article 5 de la LTECV serait notoirement insuffisant. Au-delà des « passoires à énergie », les « passoires à CO2 » méritent, une attention toute particulière ; o Sans attendre la refonte indispensable à terme du DPE, utiliser ses deux volets de manière à ouvrir le soutien public aux rénovations réduisant le plus les émissions de CO2 et à interdire toute réglementations ou aide publique en faveur de rénovations qui accroîtraient les émissions de CO2 ; o Atténuer les effets dommageables du coefficient de conversion de 2,58 en le faisant passer à 2,0 dans toutes les réglementations où il est appliqué ; o Différer toute préconisation tendant à imposer un objectif de consommation en énergie primaire de 80 kWhep/m2 qui aurait pour conséquence d’accélérer les mutations vers le gaz ; o Enrichir la liste des opérations « massifiées » de manière à favoriser des économies d’échelle. On peut penser ici par exemple à la substitution de pompes à chaleur à des chaudières à fioul ou à des bouquets de travaux combinant des actes d’isolation et le remplacement de convecteurs peu performants par des radiateurs modernes. o Encourager à travers les CEE ces opérations « massifiées » en soutenant des actions concrètes identifiées (par exemple, le remplacement d’une chaudière à fioul par une PAC) et pas seulement l’utilisation de matériels performants ; o Engager des actions de communication grand public insistant en particulier sur l’amélioration du confort et plus généralement de la qualité de vie résultant de ces opérations de rénovation. En conclusion, ce projet soumis à consultation devra être largement repensé pour répondre à l’impérieuse nécessité de replacer le secteur résidentiel et tertiaire sur une trajectoire compatible avec les ambitions de la France en matière de lutte contre le changement climatique. Au-delà de notre réponse à cette consultation, nous pensons qu’il est urgent d’engager une réflexion de fond collective sur les critères, les méthodes d’évaluation et les
- 14. 14/14 dispositions réglementaires, de soutien et d’incitation, qui permettront de promouvoir une politique rationnelle de rénovation des bâtiments résidentiels et tertiaires cohérente avec les objectifs de réduction drastique des émissions de GES de la LTCV et de la SNBC. Notre association est prête à participer très activement à une telle réflexion.