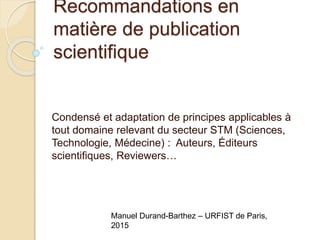
Recommandations en matiere de publication scientifique
- 1. Recommandations en matière de publication scientifique Condensé et adaptation de principes applicables à tout domaine relevant du secteur STM (Sciences, Technologie, Médecine) : Auteurs, Éditeurs scientifiques, Reviewers… Manuel Durand-Barthez – URFIST de Paris, 2015
- 2. Sommaire Rôle et relations des acteurs: ◦ Auteurs ◦ Éditeurs scientifiques ◦ Reviewers Caractéristiques de l’étape de soumission Formalisme de la publication Ces notions seront avantageusement complétées par d’autres présentations spécifiquement relatives à la Propriété intellectuelle et aux Archives ouvertes
- 3. Auteurs Chaque auteur doit connaître le niveau de responsabilité de ses co- auteurs vs. les segments de la recherche publiée et agir en toute confiance avec eux
- 4. Auteurs Un auteur intégral doit avoir totalement : ◦ a) contribué efficacement à la recherche, l’acquisition et l’interprétation des données ◦ b) participé à la rédaction et à la révision de l’article ◦ c) approuvé la version finale de l’article
- 5. Auteurs Tous les co-auteurs sont également responsables des articles soumis Un co-auteur décédé, s’il est reconnu auteur en vertu de tous les critères énoncés plus haut, sera mentionné comme tel Le corresponding author reconnaît la responsabilité collective de l’ensemble des co-auteurs
- 6. Auteurs La seule collecte des sources ou la simple supervision des travaux ne confèrent pas en soi la qualité d’auteur Les contributeurs qui ne réunissent pas toutes les conditions énoncées plus haut seront nommés en Remerciements :(Acknowledgements) C’est notamment le cas des P.I. (participating investigators) et des clinical investigators marginaux vs. les conditions précédemment décrites
- 7. Auteurs L’auteur s’interdit toute critique nominale à l’encontre d’un chercheur dont il conteste les méthodes
- 8. Éditeurs scientifiques (editors) Ils sont le pivot de la revue par les pairs (peer reviewing), garants de la liberté de publier Aucun préjugé, aucun motif extérieur à la sphère de la recherche proprement dite ne doit leur faire écarter un manuscrit Ils doivent préserver la publication de tout conflit d’intérêt, personnel ou financier, susceptible d’attenter à la crédibilité de la revue, des auteurs et des concepts scientifiques exposés Ils doivent prohiber toute critique personnelle d’un auteur vs. d’un autre dans un article
- 9. Éditeurs scientifiques (editors) L’éditeur doit choisir des reviewers réellement qualifiés Ils ne doivent pas faire subir aux manuscrits soumis à leurs équipes de reviewers un traitement excessivement long Ils sont responsables in fine de l’acceptation ou du refus d’un article Les éditeurs scientifiques peuvent être rémunérés et évincés par les éditeurs commerciaux
- 10. Éditeurs scientifiques (editors) Ils doivent s’interdire toute révélation ou «fuite» d’information issue de l’article soumis En particulier, toute transmission à des étudiants ou collègues proches est proscrite Toute réutilisation de l’information soumise au profit de la recherche personnelle de l’éditeur scientifique est strictement prohibée
- 11. Éditeurs scientifiques (editors) Les éditeurs scientifiques doivent obtenir des auteurs tout détail relatif aux fonds de soutien (sponsoring) Si des données scientifiques font partie d’un contrat passé avec un financeur, elles doivent être visées par l’éditeur scientifique et ne pas lui être imposées sans droit de contrôle de sa part
- 12. Reviewers Les reviewers (lecteurs administrés par les éd. scientifiques) doivent retourner ou détruire les manuscrits après lecture. Les manuscrits rejetés ne doivent pas être conservés L’anonymat des reviewers fait question. S’il est levé, les Recommandations aux auteurs de la revue en font normalement état.
- 13. Reviewers Dans le mode de publication « classique », les commentaires des reviewers ne doivent pas être publiés Le cas échéant, auteurs et reviewers doivent s’entendre sur l’éventuelle publication des commentaires de reviewers. Plusieurs revues ont pris ce parti dans leurs principes de base Si plusieurs reviewers sont commis sur un même article, ils est conseillé qu’ils échangent sur leurs appréciations
- 14. Reviewers Un examen trop long peut nuire à la mise à disposition et à la visibilité des travaux Un examen top rapide peut nuire à sa qualité et à la fiabilité de la détection d’erreurs éventuelles Obligation morale de ne pas s’opposer à la publication des études négatives, utiles à la communauté
- 15. Copyright Notion anglo-saxonne, appliquée par conséquent à la plupart des revues STM. La France connaît une notion différente : le Droit d’auteur (voir ces concepts dans les formations dédiées à la Propriété intellectuelle) A pour objet le transfert des droits de l’Auteur vers la Revue, pondéré dans le cas du Libre- Accès (Open Access) en vertu de clauses très spécifiques (voir ces notions dans les formations dédiées aux Archives ouvertes) Exemple hybride : la Dual Publication Policy de l’AGU ( American Geophysical Union) qui prévoit 3 étapes entre le preprint et le postprint
- 16. Confidentialité Si des éléments de la recherche servent de socle à un futur dépôt de Brevet, ils doivent être passés sous silence dans la publication. Cette incompatibilité peut d’ailleurs entraver totalement la publication de l’article. Si des personnes physiques sont impliquées comme sujets de la recherche, leur consentement sera dûment acquis (patients, sujets de photographie médicale…)
- 17. Correspondance La publication d’une correspondance entre spécialistes d’un domaine, éventuellement de nature conflictuelle, est envisageable à condition: 1. que les affirmations initiales soient, autant que possible, publiées en même temps que les réponses y apportées 2. que les motifs de conflit ou de concurrence éventuels soient clairement exposés
- 18. Modifications Un article soumis ayant ensuite le statut d’ «accepted» ne peut généralement pas être modifié par l’auteur après coup, de sa propre initiative. L’éditeur seul peut en décider. Une seconde soumission après rejet ailleurs est ordinaire et fondée. Elle n’est pas, en principe, déconsidérée par des éditeurs sollicités ultérieurement Le rejet peut être une opportunité en vue de l’amélioration de l’article
- 19. Erreurs Erreur mineure ne nuisant pas à la substance de l’article : fait l’objet d’un erratum, signalement dans un numéro ultérieur Erreur naturellement due à l’évolution de la science après la publication : aucune correction
- 20. Erreurs Erreur sous-tendue par la fraude. Retrait alors envisagé dont l’obligation incombe le plus souvent au Premier Auteur sur injonction de l’Éditeur Alternative au Retrait : publication d’un avis spécifique de l’Éditeur sur les doutes flagrants vs. de l’article publié
- 21. Soumissions parallèles On ne soumet habituellement pas un article simultanément à deux revues. Exception éventuelle: publication parallèle d’un même article jugé de première importance pour la santé publique
- 22. Soumissions complémentaires Un mémoire sommaire préliminaire (abstract ou poster) peut avoir déjà été publié avant un rapport plus complet On peut publier un papier complet même après la publication de la version abrégée d’une communication Les compléments peuvent consister notamment en des illustrations graphiques
- 23. Soumissions complémentaires La version plus complète doit mentionner les détails signalétiques de l’ancienne version abrégée, en titre ou en note infraliminaire Elle doit refléter fidèlement les données et interprétations de la précédente version Il faut éviter de morceler les résultats d’une recherche en plusieurs articles qui font se succéder les étapes de réalisation
- 24. Soumissions conflictuelles 1. Les collaborateurs partagent le même objet d’étude mais s’opposent sur l’analyse et l’interprétation Les deux versions devraient être publiées, séparément ou ensemble
- 25. Soumissions conflictuelles 2. Les collaborateurs s’opposent sur la manière d’appréhender les faits étudiés et sur la nature des données devant être publiées La revue devrait refuser la publication tant que le conflit interne à l’équipe n’est pas résolu, surtout si l’honnêteté intellectuelle est mise en cause La solution doit être trouvée au sein de l’équipe et n’est pas du ressort des reviewers
- 26. Soumissions concurrentes Deux équipes distinctes analysent chacune un même ensemble de données Si leurs interprétations présentent des caractères tangibles de similarité, il est raisonnable mais non obligatoire de la part de la revue, de donner la préférence au premier article reçu
- 27. Modalités de publication électronique Les modalités spécifiques à l’article publié électroniquement seront clairement exposées à l’auteur: 1. Archivage 2. Corrections d’erreurs 3. Versioning 4. Annexes L’insertion d’URLs dans le corps du texte doit clairement faire apparaître que, le cas échéant, on sort du site de la revue
- 28. Modalités de publication électronique Un article archivé sur le site Web d’une revue doit y subsister Un retrait sera expressément motivé, expliqué et commenté dans un numéro ultérieur sur une page citable La préservation de l’archive devrait être garantie par un tiers, par exemple une bibliothèque Le dépôt simultané dans plusieurs archives est recommandé
- 29. Formalisme de la publication Le style IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion) est le plus fréquent mais pas obligatoire. La densité des Résultats et Discussion peut justifier leur subdivision Les études de cas, reviews et éditoriaux ne relèvent pas forcément du style IMRAD L’ajout d’annexes doit être négocié avec l’éditeur Le double interlignes facilite le travail des reviewers
- 30. Formalisme de la publication 1. Titre proprement dit : ni trop court ni trop long hautement significatif et moissonnable par les moteurs de recherche de manière intuitive et directe exempt d’abréviations brutes sauf pour les unités de mesure standard ; une forme développée sera suivie de son sigle ou de son abréviation entre parenthèses. Abréviations et sigles seront gardés seuls dans le corps du texte.
- 31. Formalisme de la publication 2. Nom des auteurs. Attention particulière accordée le cas échéant au : Nom translittéré depuis un alphabet non latin Nom double ou composé Nom marital ou d’origine Veiller si possible à la pérennité d’un nom tout au long d’une carrière
- 32. Formalisme de la publication 3. Mention d’affiliation(s) Le non-respect de normes locales entraîne de très importantes difficultés pour le recensement des publications Se référer aux chartes de publication promulguées par les organismes L’hétérogénéité des signatures institutionnelles (abréviations, sigles, codes…) nuit très fortement à la visibilité
- 33. Formalisme de la publication 4. Interlocuteurs Coordonnées de l’auteur désigné par les co-auteurs comme interlocuteur de correspondance avec l’éditeur et la communauté scientifique (corresponding author) Éventuellement, coordonnées d’un correspondant reprint author si les tirés à part sont autorisés. Ou mention explicite du cas contraire 5. Origine des apports (finances, substances, équipements…)
- 34. Formalisme de la publication 6. Comptage des mots ou caractères de préférence du texte brut (pour donner aux éditeurs une idée du gabarit global) ◦ sans le résumé ni les remerciements ni les légendes ni la bibliographie ◦ comptage pour le résumé : à part titres courants (en tête ou en pied, environ 40 car. max. ; facultatif) 7. Dénombrement des figures et tableaux
- 35. Formalisme de la publication 8. Notification éventuelle de conflit d’intérêt 9. Résumé. Vital car: • il sert de base, avec le titre, au moissonnage des moteurs de recherche • il est souvent la seule portion de l’article réellement lue par la communauté • de par son caractère significatif et reflétant vraiment le contenu de l’article, il permet de juger a priori la valeur de celui-ci et d’aller, ou non , plus loin dans sa lecture • On peut ajouter des mots-clés, également importants pour les moteurs de recherche tout comme pour informer très rapidement le lecteur potentiel
- 36. Formalisme de la publication 10. Introduction. Facteurs récurrents: état de l’art du problème, recours à des reviews, à des travaux antérieurs déterminants, sans détailler excessivement leurs conclusions objectifs primaires et secondaires les amener éventuellement sous forme de question(s)
- 37. Formalisme de la publication 11. Méthodes : n’énoncer que les éléments existant de fait au départ de l’étude. Ceux qui sont intervenus pendant celle-ci sont à reporter dans la partie des Résultats • identifier clairement l’objet d’étude, l’échantillon, le data set • définir l’équipement utilisé (modèle, fabricant, version, suivant les cas) • donner les détails techniques de l’appréhension de l’objet par l’équipement (y compris des méthodes statistiques)
- 38. Formalisme de la publication Méthodes (suite) : statistiques les données analysées statistiquement doivent être accessibles par le reviewer aux fins de vérification. Éviter autant que possible l’usage exclusif de P values. mentionner tous les indicateurs (mesure d’erreur ou d’incertitude…) renvoyer aux documents de référence sur ces méthodes expliciter les symboles et le vocabulaire utilisés
- 39. Formalisme de la publication 12. Résultats • les présenter dans une séquence logique associant texte, tableaux et figures • donner dans le texte principal la priorité aux résultats les plus importants. Les autres en annexe • éviter de répéter les données dans le texte et dans les figures ou tableaux • le graphique est destiné à compacter des données trop denses dans des tableaux
- 40. Formalisme de la publication 13. Discussion • mettre en avant les résultats les plus importants en leur conférant un caractère aussi évident que possible • expliciter les mécanismes de leur obtention, en les comparant au besoin à d’autres investigations dans le même domaine • énoncer leurs limites • éviter de tirer des conclusions scientifiques sans rapport direct avec l’étude, ou économiques putatives • éviter d’échafauder des hypothèses dont on ne peut garantir la vraisemblance
- 41. Formalisme de la publication 14. Bibliographie • les reviews, utiles au référencement de l’état de l’art, seront mentionnées en petit nombre • priorité aux articles de recherche • éviter les listes excessivement longues. Peu d’articles, mais marquants, sont préférables • la pratique électronique de la lecture permet d’approfondir la bibliographie par le biais des liens inclus dans les
- 42. Formalisme de la publication Bibliographie (suite) : • éviter de mentionner des abstracts en tant que réf. bibliographiques • ne mentionner des articles « in press » ou « forthcoming » que moyennant : o l’autorisation de leurs auteurs o la vérification de leur statut « accepted » • éviter de citer une « communication personnelle » (ex. : e-mail) sauf nécessité absolue. Le cas échéant, l’interlocuteur et la date seront clairement mentionnés entre ( ). Se prémunir de toute contestation possible en la matière.
- 43. Formalisme de la publication 15. Style des références • il est imposé par la revue dans ses recommandations aux Auteurs • Les logiciels de référencement bibliographiques comme Zotero sont adaptés à cette opération et proposent une très grand variété de styles gérés automatiquement
- 44. Formalisme de la publication 16. Figures, graphiques, tableaux, images • Les recommandations aux Auteurs sont très précises en matière de détails techniques sur leur insertion et leur apparence, y compris pour les légendes • La figure étant souvent isolée sous forme de slide pour une présentation de type Diaporama, elle doit être très claire
- 45. Formalisme de la publication Figures… (suite) • en cas de prélèvement d’un item illustratif à partir d’un autre document, l’autorisation de ses auteurs et éditeurs devra être acquise et spécifiée avec mention de la source • cette autorisation n’est évidemment pas requise si cet item est issu du domaine public
- 46. Formalisme de la publication 17. Abréviations et symboles 1 • dans le Titre, on aura déjà placé entre parenthèses des sigles ou abréviations après leur forme développée. Dans ce cas, abréviations et sigles sont gardés seuls dans le corps du texte • s’ils apparaissent pour la première fois dans le corps du texte, ils doivent être précédés de leur forme développée
- 47. Formalisme de la publication Abréviations et symboles 2 • utiliser le système métrique, les degrés Celsius, chiffrer la pression sanguine en mm de mercure… • si des unités de mesure exorbitantes du Système international sont employées, mentionner autant que possible l’alternative entre parenthèses
- 48. Quelques principes en guise de conclusion Un article devrait être visible par le plus grand nombre afin d’être utile à la communauté scientifique. D’où l’intérêt de l’Open Access Garder à l’esprit que les éditeurs commerciaux ne disposent que des droits que les auteurs leur ont cédés explicitement
- 49. Quelques repères American Chemical Society: Author & Reviewer Resource Center http://pubs.acs.org/page/4authors/index.ht ml American Geophysical Union: Publications, Resources http://publications.agu.org/ International Committee of Medical Journal Editors: Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals http://www.icmje.org/recommendation s/
