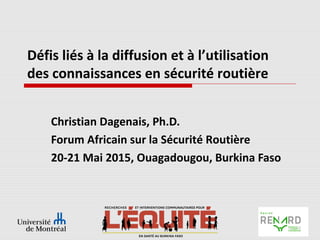
Défis liés à la diffusion et à l’utilisation des connaissances en sécurité routière
- 1. Défis liés à la diffusion et à l’utilisation des connaissances en sécurité routière Christian Dagenais, Ph.D. Forum Africain sur la Sécurité Routière 20-21 Mai 2015, Ouagadougou, Burkina Faso
- 2. RENARD: une équipe de recherche sur le transfert des connaissances Objet de recherche : le transfert des connaissances, appliqué au champ des interventions sociales : éducation, sciences politiques, psychologie, santé publique, psychoéducation, sciences infirmières, administration publique… Principaux axes de recherche: les effets des stratégies de TC les processus par lesquels ces effets sont produits
- 3. Définition : transfert de connaissances 3
- 4. Causes des accidents en Afrique (mentionnées depuis hier…) Conduite en état d’ébriété Vitesse Rouler à moto sans casque Non respect du code de la route Utilisation du téléphone portable Absence de permis de conduire Imprudence Caractère inadapté des infrastructures Manque d’intervention sur la prévention et l’éducation Manque de législations adéquates Mauvaise application des législations existantes Etc, etc, etc… 4
- 5. Quels sont les principaux défis à relever pour réussir le transfert des connaissances en sécurité routière ?
- 6. 1. Défis sur le plan des connaissances 6
- 7. 1. Défis sur le plan des connaissances Disponibilité des CIR (il faut qu’elles existent, or, pas dans les priorités de financement comme pour VIH, palu, ebola) Représentativité (OMS, nord, Afrique anglophone, Ouaga?) Applicabilité (montants des amandes, etc.) Délais de production appropriés
- 8. 1. Défis sur le plan des connaissances (suite) Les CIR sont essentiellement incertaines, dynamiques, complexes, contestables et rarement complètes Elles doivent être interprétées et complétées par des données «informelles» issues de l’expérience locale Les processus délibératifs offrent un moyen de combiner différents types de données de façon transparente et explicite Lomas et al., 2005
- 10. Lemire N., Souffez, K., & Laurendeau, M.-C 2009
- 11. 2. Défis sur le plan des individus 11
- 12. 1. Défis sur le plan des individus; il faut: Tenir compte des caractéristiques des utilisateurs Valeurs, croyances (acceptabilité des comportements à risque, présence de génies, etc.) Contexte local (niveau d’éducation, manque de ressources, etc.) Mieux connaître les comportements des individus sur la voie publique Sensibiliser: connaître les règlements (police) et les risques (recherche) Les déterminants individuels sont importants, mais ne suffisent pas à expliquer l’utilisation
- 13. 3. Défis sur le plan du contexte 13
- 14. 3. Défis sur le plan du contexte; il faut: Mettre en place des mécanisme de concertation entre les acteurs: ICI-Santé / consortium OSCAR / ONASER / Handicap International / OMS/ Police/ Décideurs/Chercheurs/etc. Faire consensus sur les priorités en matière de connaissances à produire et à transférer Tenir compte des réalités locales qui appellent des interventions différentes (urbain-rural)
- 15. 4. Défis sur le plan du processus de TC 15
- 16. Les étapes du processus de transfert de connaissances 16 Lemire N., Souffez, K., & Laurendeau, M.-C 2009
- 17. Deux étapes cruciales: l’adaptation et la diffusion 1. Adaptation Rendre les connaissances compréhensibles Adapter le format et le langage (et la langue) au public cible Ses caractéristiques Ses préoccupations Identifier des pistes pour l’action
- 18. Deux étapes: l’adaptation et la diffusion (suite) 2. Diffusion Processus par lequel le produit de transfert est communiqué Vise à rendre les connaissances accessibles Choisir entre une large diffusion ou une diffusion plus personnalisé en fonction des publics ciblés
- 19. 4. Défis sur le plan des efforts de TC Plusieurs modèles de transfert, mais encore trop peu d’études sur les effets sur l’utilisation Efficacité des modèles Les approches passives sont inefficaces pour changer les comportements Les stratégies qui combinent plusieurs outils, activités afin de rejoindre, de la façon la plus appropriée, les différents publics cibles sont les plus efficaces
- 20. 4. Face au défi sur le plan des efforts de TC; il faut: Choisir une stratégie de transfert appropriée au contexte (activités menées ailleurs?) Transformer les CIR avant leur diffusion Adopter un langage commun Mandater un porteur du message crédible (ex.: CAN; leaders locaux, coutumiers, religieux, etc.) Multiplier les actions, les stratégies Élaborer un plan de travail en concertation avec les parties prenantes ÉVALUER!
- 22. Ğ ŝ Ğ ĞŶĂ Ě ĐĂǁ ǁ ǁ ƋƵƉ ƌ ƌ͘ ͘ christian.dagenais@umontreal.ca
Notes de l'éditeur
- Notes personnelles:
- Notes personnelles:
- Le transfert des connaissances soulève plusieurs questions: Qu’est-ce qu’un transfert réussi? La diffusion est-elle suffisante? Qui sont les utilisateurs potentiels? Ont-ils tous les mêmes besoins? Quelles sont les conditions qui facilitent le TC? Quelles sont les conditions qui facilitent l’utilisation?
- Celles-ci doivent constamment être remises à niveau: alors à partir de quand est-il possible de procéder à un transfert? Exemple de Vioxx Exemple de Cochrane: partent d’un corpus de milliers d’études, appliquent une grille, en retiennent 3 et concluent que les données ne sont pas assez probantes pour recommander un traitement
- individus : perception des utilisateurs que le changement proposé ou que les résultats escomptés en valent la peine (Abrami, Poulsen & Chambers, 2004 ; Rich, 2005), congruence entre les besoins des utilisateurs potentiels et les caractéristiques du changement (Rohrbach & al., 2005 ; NCDDR, 1996a ; 1996b ; Roy, Guindon & Fortier, 1995), congruence entre le projet de changement, les valeurs et les croyances de l’utilisateur potentiel (Bedell, Ward, Archer & Stokes, 1985; Briscoe, 1991; Breslin, Tupker, & Sdao-Jarvi, 2001 ; NCDDR, 1996a) Besoins: si les gens ne ressentent pas le besoin de changer (revenir sur l’exemple du CEFRIO), il y a très peu de chances qu’ils adoptent une nouvelle façon de faire; si le changement proposé va à l’encontre de leurs valeurs. Il faut donc se questionner sur leurs besoins en matière de nouvelles connaissances. DONC: quand on veut introduire un changement, on doit clarifier les raisons de ce changement; s’attaquer à un enjeu important pour l’organisation et démontrer en quoi ce changement est compatible avec les priorités organisationnelles. En général, quand on peut démontrer que le changement sera avantageux pour le « client » il a plus de chances d’être adopté Exemple du programme de nutrition dans une école en milieu défavorisé
- organisations : soutien continu à l’implantation du changement (Joyce & Showers, 1988 ; Mathison, 1992 ; NCDDR, 1996b ; Nutley, Walter & Davies, 2003 ; Roy & al., 1995), leadership d’acteurs clés (Backer, 1991 ; Fullan et Hargreaves, 1997 ; Nutley & al., 2003 ; Rohrbach & al., 2005 ; Walter, Nutley, Percy-Smith, McNeish & Frost, 2004), climat et culture du milieu (Fullan & Hargreaves, 1997 ; Rohrbach & al., 2005 ; Walter & al., 2004 ; Armstrong & Anthes, 2001 ; Lachat & Smith, 2005 ; Nutley & al., 2003 Contexte: Ressources: R-H, $, disponibilités, expertise ressources disponibles : matériel et temps nécessaire (Sleeter, 1992 ; Walter & al., 2004), ressources humaines et financières (McQueen & Anderson, 2000 ; Demers, 1997 ; Roy & al., 1995) Réceptivité: culture organisationnelle (entreprise apprenante) qui est différente d’un milieu à l’autre., etc.; attitudes face à la recherche (expériences antérieures avec des chercheurs, scepticisme, etc.), formation de base (différentes stratégies si on s’adresse à des médecins, qui ont une formation scientifique et à des enseignants), intérêt pour l’information, éducation, sentiment qu’ils devraient changer quelque chose, que quelque chose pourrait être amélioré.
- Notes personnelles:
- p. 17 guide INSPQ Caractéristiques du public pouvant être leur niveau de connaissances précédentes, leur contexte organisationnel, niveau décisionnel aussi. Christian va en parler plus en détails tout à l’heure, mais on cherche dans l’adaptation à développer un contenu dont le message véhiculé est clair, concis, cohérent et en lien avec les préoccupations des utilisateur. On veut que ce message s’articule autour d’idées plutôt que de données, de chiffres, de statistiques.
- Communiqué…pendant une certaine période de temps à travers différents canaux de communications. (sites internet, revue, liste de distribution, bulletin d’information, etc.)
- stratégie pour accroître l’utilisation : implication des utilisateurs potentiels dans les activités de recherche (Barker, 2005 ; Estabrook, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary et Gushta, 2003 ; Huberman, 1990), présence de recommandations explicites quant aux actions à entreprendre (Denis, 2000 ; Hughes & al,. 2000 ; Hanney & al., 2003 ; NCDDR, 1996b), les contacts personnels soutenus entre les diffuseurs de connaissances et les utilisateurs potentiels (Backer, 1991 ; Hanney, Gonzalez-Block, Buxton & Kogan, 2003 ; Huberman, 1989, 1994 ; Landry, Amara & Lamari 2000 ; NCDDR, 1996b)Tenir compte du contexte des utilisateursCelles-ci doivent constamment être remises à niveau: alors à partir de quand est-il possible de procéder à un transfert? Orienter les efforts vers la pratique: Rappel Lancaster Il ne suffit pas que le produit de recherche soit de qualité Il faut transformer dans un mode approprié Accent sur l’action: il est relativement facile d’identifier quoi faire, mais c’est moins facile de décrire quoi faire pour le faire… Exemple; changer un médicament vs une pratique pédagogique Construire sur ce qui existe Contacts personnels soutenus: Pour que la connaissance soit utilisée dans un milieu, ça prend des contacts directs, personnels entre l’organisation réceptrices et ceux qui portent le mandat de diffuser la connaissance (et c’est pas nécessairement les chercheurs eux-même; c.f. CLIPP) Huberman: sustained interactivity: échanges répétés, plus important que la qualité des résultats, car ceux-ci doivent toujours être remis à jour.
- stratégie pour accroître l’utilisation : implication des utilisateurs potentiels dans les activités de recherche (Barker, 2005 ; Estabrook, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary et Gushta, 2003 ; Huberman, 1990), présence de recommandations explicites quant aux actions à entreprendre (Denis, 2000 ; Hughes & al,. 2000 ; Hanney & al., 2003 ; NCDDR, 1996b), les contacts personnels soutenus entre les diffuseurs de connaissances et les utilisateurs potentiels (Backer, 1991 ; Hanney, Gonzalez-Block, Buxton & Kogan, 2003 ; Huberman, 1989, 1994 ; Landry, Amara & Lamari 2000 ; NCDDR, 1996b)Tenir compte du contexte des utilisateursCelles-ci doivent constamment être remises à niveau: alors à partir de quand est-il possible de procéder à un transfert? Orienter les efforts vers la pratique: Rappel Lancaster Il ne suffit pas que le produit de recherche soit de qualité Il faut transformer dans un mode approprié Accent sur l’action: il est relativement facile d’identifier quoi faire, mais c’est moins facile de décrire quoi faire pour le faire… Exemple; changer un médicament vs une pratique pédagogique Construire sur ce qui existe Contacts personnels soutenus: Pour que la connaissance soit utilisée dans un milieu, ça prend des contacts directs, personnels entre l’organisation réceptrices et ceux qui portent le mandat de diffuser la connaissance (et c’est pas nécessairement les chercheurs eux-même; c.f. CLIPP) Huberman: sustained interactivity: échanges répétés, plus important que la qualité des résultats, car ceux-ci doivent toujours être remis à jour.
