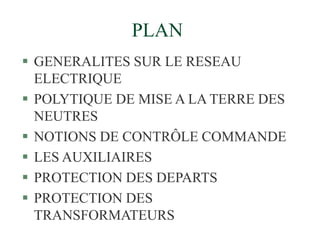
Protections des transformateurs et lignes.ppt
- 1. PLAN GENERALITES SUR LE RESEAU ELECTRIQUE POLYTIQUE DE MISE A LA TERRE DES NEUTRES NOTIONS DE CONTRÔLE COMMANDE LES AUXILIAIRES PROTECTION DES DEPARTS PROTECTION DES TRANSFORMATEURS
- 3. Qu ’attend -on d’un réseau électrique ? Acheminer l ’énergie électrique depuis les points de production jusqu ’aux utilisateurs. Être en mesure d ’assurer la meilleur continuité de service. Assurer la sécurité des installations des personnes et de l ’appareillage alimenté. Produire le moins de perturbations sur les autres installations publiques. Remplir ces missions au moindre coût
- 4. Comment monter un système de protection ? Définir une politique de mise à la terre des neutres. Arrêter un plan de protection en conséquence.
- 5. POLYTIQUE DE MISE A LA TERRE DES NEUTRES
- 6. Politique de mise à la terre des neutres Un plan de mise à la terre des neutres définit : le degré de limitation des courants de défaut le niveau d ’isolement de l ’appareillage Le niveau des surtensions Efficacité plus ou moins bonne des protections.
- 7. Politique de mise à la terre des neutres Configuration des neutres dans les réseaux THT et HT : Les neutres dans le réseau national sont mis directement à la terre sans résistance ni réactance. Les neutres des transformateurs de groupe sont tous mis à la terre. Les neutres côté 225 KV des transformateurs THT sont tous mis à la terre. Un seul neutre 60 KV est mis à la terre par poste d ’interconnexion.
- 8. Politique de mise à la terre des neutres Configuration des neutres dans les réseau MT : Les neutres dans le réseau de distribution dans les postes HT/MT sont mis à la terre à travers une résistance de limitation . Les courants de court circuit monophasé sont limités à 300 A pour les réseaux aériens et à 1000 A pour les réseaux en câbles souterrains.
- 9. GENERALITES SUR LE CONTRÔLE COMMANDE DES POSTES
- 10. Quel est le rôle des protections ? Protéger les installations électriques Contre les défauts de conséquences graves Contre les fonctionnements anormaux Protéger l ’être humain et les animaux Contre les dangers du courant électrique
- 11. Fonctions contrôle commande Protection électrique de l ’appareillage HT et MT Signalisation des événements Contrôle des tensions Commandes de l ’appareillage THT , HT et MT Automatismes associés aux protections
- 12. Structure des postes La THT , HT et MT Découpée en travées pour • Faciliter l ’intervention • Assurer la sécurité • N ’isoler que la partie en défaut lors d ’incident
- 13. Structure des postes La basse tension Découpés en tranches pour • Faciliter la recherche des défauts en cours d ’exploitation • Assurer la sécurité pendant l ’intervention • Limiter les conséquences d ’un incident sur la partie de l ’installation concernée Les principales tranches • Tranches départs THT ou HT ou transfert • Tranches transformateurs THT/HT/MT • Tranches barres THT ou HT
- 14. Structure des postes La basse tension Les principales tranches • Tranches réactances • Tranches transformateurs HT/MT • Tranches barres THT ou HT • Tranche MT dans les postes HT/MT comprenant : – les sous tranches départs et arrivées MT • Tranche commune dans les postes HT/MT (délestage, recherche de terre ....) • Tranche générale
- 16. Mode d ’alimentation de l ’appareillage contrôle commande- Pour que l ’appareillage contrôle commande fonctionne d ’une façon sûre , leur alimentation doit être assurée par une source indépendante Cette source doit être assez fiable pour pallier les défaillances du réseau et permettre les reprises de service.
- 17. Les services auxiliaires Sources auxiliaires d ’énergie BT pour : • Commandes • Signalisations • Alimentation protections • Éclairage • Chauffage
- 18. Les services auxiliaires Trois classes : • Source alternative 220/380V – A partir du transformateur MT/BT (TSA) • Source 127 V continu – Constituée d ’une batterie d ’accumulateurs associée à un redresseur chargeur • Source 48 V continu – Constituée d ’une batterie d ’accumulateurs associée à un redresseur chargeur
- 19. Source 220/380 alternatif La source de cette tension est le ‘TSA’ la permutation automatique des auxiliaire aiguille sur le TSA en service Les services auxiliaires utilisant l’alternatif sont réparties en deux sous ensembles : Auxiliaires secourus (n’admettent qu’un temps de coupure réduit de l’ordre de la seconde) Auxiliaires non secourus ( peuvent être coupé pour un temps relativement long) Les auxiliaires secourus, le sont par un groupe électrogène(poste THT/HT).
- 20. Source 127 Vcc utilisée pour les commandes et informations circulant entre les divers appareillages. La source est un ensemble d’éléments de batteries associé à un redresseur chargeur. Le fonctionnement normal de cet ensemble est en floating . Les bornes + et - sont isolées de la terre
- 21. Source 48 Vcc utilisée pour la télécommandes la téléalarme la télé protection et les signalisations. La source est un ensemble d’éléments de batteries associé à un redresseur chargeur. Le fonctionnement normal de cet ensemble est en floating . La borne + est mise à la terre
- 22. Surveillance des polarités La surveillance de la polarité 127 Vcc revêt un caractère essentiel pour la sécurité des installations. La surveillance porte sur : • Anomalie 127 Vcc (<116 Vcc ou >136 Vcc) • Ouverture des disjoncteur BT de protection 127 Vcc • Terre batterie 127 Vcc • Manque 127 Vcc tranche
- 23. PROTECTION DES TRANSFORMATEURS ET DES REACTANCES
- 24. Protections des transformateurs et des réactances Contre quoi protège-on le transformateur et la réactance? Défauts internes: • Masse cuve • Bucholz • Température • Courts circuit sur la liaison entre le transformateur et les TC de l ’arrivée • Défaut circulation d ’huile et défaut aéroréfrigérants
- 25. Protections des transformateurs et des réactances Contre quoi protège-on le transformateur et la réactance? Défauts externes: • Surintensités due : – à un court circuit réseau – à une surcharge • Surtension
- 26. Protection de température Une élévation excessive de température d’huile est signe de défaut du transformateur. Des sondes immergées dans d’huile permettent de contrôler la température. Elles sont à deux seuils alarme et déclenchement.
- 27. Protection de température Les seuils utilisés pour les transformateurs sont : Alarme à : • 80° pour les transformateurs HT/MT • 90° pour les transformateurs THT/HT/MT Déclenchement à : • 90° pour les transformateurs HT/MT • 100° pour les transformateurs THT/HT/MT
- 28. Protection Buchholz Le dégagement gazeux est signe de décomposition d ’huile donc de défaut interne Le relais buchholz décèle le dégagement gazeux sur la partie supérieur du transformateur à l ’entrée du réservoir d ’expansion de l ’huile Relais à deux seuils Alarme déclenchement
- 29. Protections Masse cuve La cuve du transformateur est isolé de la terre Un seul point de liaison directe à la terre est réalisée par un conducteur sur lequel est placé un TC . Le TC alimente un relais ampèrmétrique.
- 30. Protection contre les défaut de réfrigération Un arrêt de circulation d ’huile ou non fonctionnement d ’un aéroréfrigérant peut entraîner l ’échauffement du transformateur Ce défaut est contrôlé à partir de 20 % de la charge nominale du transformateur.
- 31. Protection maximum intensité Protection contre les court circuits polyphasés: Réalisée par des relais ampermétriques alimentés par des TC de phase. Les relais de phase sont en générale réglés à : • 1.2 In du transformateur s ’il n ’y a pas de protection de surcharge. • jusqu’à 2 In si le transformateur est équipé de protection de surcharge.
- 32. Protection maximum intensité Protection contre les courts circuits à la terre Réalisée par un relais homopolaire alimenté par le TC du neutre HT : • Le réglage du seuil de courant de terre est : – Entre 60 et 100 A HT – 1000A HT pour le deuxième seuil s ’il existe • La temporisation est 3 s avec comme action : – Alarme au seuil bas et déclenchement au seuil haut s ’il y a deux seuils – Déclenchement s ’il y a un seul seuil Un relais à deux seuils permet d ’éviter de déclencher le transformateur par des défauts résistant
- 33. Protection maximum intensité Protection de surcharge: La durée de tenue d’un transformateur à la surcharge est largement supérieur à la tenue aux courts circuits La protection de surcharge permet : • Ne pas déclencher le transformateur en un temps court pour la surcharge. • Éviter les éventuels déclenchement par des courants transitoires • Faire des actions de délestage en fonction de la charge ce qui permet de maintenir le transformateur en service
- 34. Protection maximum intensité Protection de surcharge: Réalisée par des relais ampermétriques alimentés par des TC de phase . Les seuils de réglage en courant sont des paliers de courant commençant de 1.2 In Pour chaque palier de courant la protection produit une action prédéterminée soit: • Une alarme au premier palier • Des délestage en cascade des départ HT en fonction du palier de courant et sa durée.
- 35. Protection maximum intensité Protection du Tertiaire 11 KV: Réalisée par des relais ampermétriques alimentés par les TC bushing 11 Kv . Les seuil de réglage en courant est de l ’ordre de In. la temporisation est de l ’ordre de la seconde.
- 36. Protection contre la surtension La surtension peut provenir de : L ’ atmosphère . Les manœuvres. Mauvais fonctionnement de la régulation de tension. Cette protection est réalisée par un relais voltmétrique alimenté par le TT barre. Les seuils de réglage sont : 125% Un temporisée à 30s pour le 225 KV 125% Un temporisée à 0.4s pour le 60 KV
- 37. Protection défaillance disjoncteur La défaillance d ’un disjoncteur peut avoir des conséquences très graves. Cette défaillance est détectée si un ordre de déclenchement n ’est pas exécuté après une certaine temporisation . L ’action de la protection est l ’ouverture de tous les disjoncteurs raccordés au même jeux de barres que le disjoncteur défaillant.
- 38. Protection défaillance disjoncteur La protection défaillance disjoncteur émet ses ordres de déclenchement via la protection jeux de barres si celle ci existe. Dans le cas du transformateur l ’information utilisée pour détecter la défaillance disjoncteur est la position du disjoncteur via les interlocks .
- 39. Protection différentielle Cette protection est nécessaire pour détecter les défauts entre phases à l ’intérieur du transformateur surtout lorsque la détection des défauts est faite par des bushings placés au secondaire. Pour des considérations économiques dans la plupart des anciens postes surtout HT/MT le transformateur n ’est pas muni d ’une telle protection. La protection dans ce cas est assurée par les protections de distance des lignes qui alimentent le poste.
- 40. Protection différentielle Elle présente l’avantage d’être parfaitement sûre, fiable, rapide, sensible et sélective. Du fait du rapport de transformation et du décalage angulaire, il est nécessaire d’utiliser des transformateurs de recalage des courant a comparer. Les transformateurs de recalage permettent également d’adapter le niveau des courants secondaires des capteurs de mesure aux courants d’entrée de la protection différentielle.
- 42. PLAN Généralités Protection des lignes THT Protection des lignes HT Protection des lignes MT
- 43. Généralités Quelles différences y a t il entre les niveaux THT, HT et MT? En THT et HT les défauts sont alimentés des deux côtés En MT l ’alimentation se fait toujours dans un seul sens du poste source vers la ligne
- 44. Généralités Définition de la fiabilité : Le taux de fonctionnement correct sur le nombre total de fonctionnement d ’une protection. Définition de la sélectivité : Un système de protection est dit sélectif si seule la partie du réseau en défaut est isolée suite à un incident. Intervalle sélectif : C ’est la durée minimale de temporisation entre deux protections qui assure la retombée de la protection non concernée par le défaut
- 45. Généralités Intervalle sélectif : Apparition défaut Temps de fonctionnement Protection concernée Ordre déclenchement Temps de fonctionnement Disjoncteur Disparition défaut Temps de retombée autres Protections Retombée autres protections Axe du temps
- 46. Protection des lignes THT Défauts lignes Protection contre les décharges atmosphériques Protection contre le court circuit Protection contre la surcharge Protection contre la surtension
- 47. Défauts lignes Contre quoi protège - on une ligne ? Les décharges atmosphériques Le court circuit La surcharge La surtension
- 48. Protection contre les décharges atmosphériques Par quoi réalise - t - on cette protection ? Par un câble de garde sur toute la longueur de la ligne pour le THT Par un câble de garde sur une faible longueur de ligne à la sortie des postes
- 49. Protection contre les courts circuits Une protection ampermétrique ne peut pas assurer la sélectivité Nécessité d ’utiliser une protection qui mesure la distance d ’éloignement du défaut
- 50. Protection de distance Le principe d ’une protection de distance est la mesure de l ’impédance Z=U/I L ’impédance Z d ’un tronçon de ligne est proportionnel à sa longueur Le point de mesure de l ’impédance donc de la distance pour un relais de distance est l ’emplacement des TC et TT qui l ’alimentent
- 51. Protection de distance Z < TC TT
- 52. Caractéristiques de la ligne Z = R + J X Si L est la longueur de ligne • R = L x Ru avec Ru la résistance par Km • X = L x Xu avec Xu la réactance par Km La mesure de l ’impédance permet donc de localiser exactement l ’emplacement du défaut mais !
- 53. S ’il y a des erreurs dans la mesure de tension et de courant ? L ’exactitude de la localisation de défaut n ’est plus assuré. Que faire alors ? Tenir compte des erreurs maximales des réducteurs de mesure dans les réglages de la protection.Soit + ou - 20% dans une impédance. Ceci conduit à la définition des déclenchement en stades.
- 54. Échelonnement des stades Le 1er stade de déclenchement est réglé à une portée de 80% de la longueur totale de la ligne Le 2ème stade de déclenchement est réglé à une portée de 120% de la longueur totale de la ligne Le 3ème stade est réglé à une portée au delà de 120% de la longueur de la ligne. Généralement la longueur de la ligne plus la longueur de la ligne adjacente la plus longue multiplié par 120% ( avec un minimum de 140% de la ligne)
- 55. Échelonnement des stades Le 1er stade de déclenchement est instantané ou au maximum 0.1 s Le 2ème stade de déclenchement est réglé à une temporisation supérieure à celle du 1er stade d ’un intervalle sélectif (0.4 à 0.5 s) Le 3ème stade est réglé à une temporisation supérieure à celle du 2ème stade d ’un intervalle sélectif
- 56. Échelonnement des stades d t2 t1 t t3 A B C D
- 57. Autre contrainte qui fausse la mesure ? La résistance du défaut Un relais d ’impédance va mesurer l ’impédance jusqu ’au point de défaut majorée de la résistance de défaut La solution est d ’utiliser des relais de mesure de réactance
- 58. Autre contrainte qui fausse la mesure ? La direction du défaut Un relais d ’impédance va voir de la même manière un défaut amont et un défaut aval La solution est d ’utiliser des relais directionnel
- 59. Autre contrainte qui fausse la mesure ? Le pompage ou oscillations des grandeurs électriques Un relais d ’impédance risque de considérer un pompage comme un défaut sur la ligne La solution est d ’utiliser un relais antipompage qui mesure la vitesse de variation de l ’impédance et verrouille la protection si la variation est lente
- 60. Autre contrainte qui fausse la mesure ? Le courant de service normal avec une chute de tension peuvent être perçus par le relais d ’impédance comme un défaut La solution est d ’utiliser un système de compoundage qui décale la caractéristique du relais
- 61. Autre contrainte qui fausse la mesure ? Un courant de défaut à la terre doit être détecté pour définir le type de défaut La solution est d ’utiliser un relais de terre
- 62. Constituants classiques d ’une protection de distance En générales une protection de distance est composée de : Un relais d ’impédance pour la mise en route de la protection Un relais de terre pour distinguer les défauts à la terre Un relais de réactance pour la mesure de la distance Un relais directionnel pour l ’ orientation de la protection Un relais antipompage Un système de compoundage Un relais temporisé
- 63. Caractéristique d ’un relais d ’impédance R X O Droite correspondant aux caractéristiques de la ligne
- 64. Caractéristique d ’un relais d ’impédance de caractéristique décalée R X O Droite correspondant aux caractéristiques de la ligne
- 65. Caractéristique d ’un relais de réactance R X O Droite correspondant aux caractéristiques de la ligne
- 66. Caractéristique d ’un relais directionnel R X O Droite correspondant aux caractéristiques de la ligne
- 67. Fonctionnement d ’une protection de distance classique Mise en route Réalisée par : 3 relais à minimum d ’impédance alimenté par les tensions composées et 2 courants de phase Un relais de terre permettant de changer l ’alimentation des relais d ’impédances par les tensions et courants simples pour les défauts à la terre Le relais de réactance alimenté par la phase sélectionnée par les relais de mise en route mesure la réactance du défaut et définit le stade de déclenchement
- 68. Évolution de la technologie des protections Électromécanique Statique Numérique
- 69. Apport de la protection statique Rapidité Faible consommation Des caractéristiques sélectives à moindre coût Possibilité de régler le courant de terre à des valeurs faible
- 70. Apport de la protection numérique Possibilité de réaliser plusieurs fonction avec une seule unité Autocontrôle Réalisation aisée de toute forme de caractéristique
- 71. Le système de protection de distance est il complet ? L’élimination en deuxième stade des défauts concernant une partie de la ligne a les inconvénients suivants : Le fait de laisser un court circuit sur le réseau pendant un temps long peut entraîner l ’instabilité du système Risque de non extinction de l ’arc suite au réenclenchement après déclenchement sur défaut fugitif
- 72. Que faire ? La solution est dans la télé protection : Le principe de la télé protection est de créer une communication entre les protections situées sur les deux extrémités de la ligne Par : Une liaison HF (Cas de l ’ONE) Une liaison téléphonique Une liaison radio Une liaison à fibres optiques
- 73. schémas de télé protection Schéma de télé déclenchement simple 1er stade 2ème stade 3ème stade t2 t3 Signale décl Ou Déclenchement Inconvénient : risque de déclenchement intempestif
- 74. schémas de télé protection Schéma de télé déclenchement contrôlé 1er stade 2ème stade 3ème stade t2 t3 Signale décl Ou Déclenchement Contrôle par le 2 ème stade Et
- 75. schémas de télé protection Schéma de télé déclenchement contrôlé 1er stade 2ème stade 3ème stade t2 t3 Signale décl Ou Déclenchement Contrôle par la mise en route Et Mise en route
- 76. schémas de télé protection Schéma d ’accélération de stade 1er stade 2ème stade 3ème stade t2 t3 Signale décl Ou Déclenchement Mise en route
- 77. schémas de télé protection Extension de zone P2 D2 P1 D1 P2 ordonne le premier déclenchement en deuxième stade instantanément : Si le défaut est sur la ligne c ’est bon Si le défaut est sur la ligne adjacente le deuxième déclenchement se fait en 2ème stade
- 78. schémas de télé protection Extension de zone Avantage : Pas de télésignalisation Inconvénient: Déclenchement intempestif systématique Second déclenchement en deuxième stade si le défaut est permanent
- 79. schémas de télé protection Blocage P3 D3 P2 D2 Schéma utilisé pour les lignes courtes pour lesquelles 80% de la réactance est moins que la limite inférieure d ’affichage. P1 bloque le 1er stade de P2 si elle voit un défaut amont. P1 D1
- 80. Et les défauts résistants Le réglage du courant de terre de la protection de distance est limité par un seuil minimal de la protection : 2.5 A pour la LZ31 1.5 A pour la RXAP 1 A pour la LZ92 1 A pour la PXLP La plage de défaut non détectables par la protection de distance est détectée par la protection directionnelle de terre
- 81. Protection directionnelle de terre Mesure de la puissance résiduelle en tenant compte de la direction du défaut Elle a une caractéristique Temps/puissance résiduelle à temps inverse
- 82. Protection directionnelle de terre Le temps de déclenchement de cette protection est : Td = Tc + K/Pr Avec : Tc temps constant K constante définie par la courbe choisie Pr = Ur Ir cos ( - o) Ur et Ir tension et courant résiduels Angle (Ur,Ir) o Angle interne du relais
- 83. Protection directionnelle de terre Le temps de déclenchement de cette protection est : Td = Tc + K/Pr Avec : K constante définie par la courbe choisi Pr = Ur Ir cos (PHI - PHI0)
- 84. Protection directionnelle de terre Pr t Tc
- 85. Protection directionnelle de terre L’angle interne est : 45° pour les anciennes protection PSW et DT n ’est pas bien adapté pour le réseau ONE à configuration de neutre directement à la terre 75° pour les protections statiques PSEL et PDTR adapté au réseau ONE
- 86. Protection directionnelle de terre Pour améliorer la sélectivité de la protection directionnelle du réseau HT avec le neutre du transformateur plusieurs études ont été faites. Une des actions a été de réduire le temps constant à 1s mais sans résultat
- 87. Protection directionnelle de terre Principales contraintes Les courbes de déclenchement choisies pour les anciennes et nouvelles protections ne sont pas cohérentes La différence d ’angle interne aggrave cette incohérence
- 88. Protection de jeux de barres Plusieurs raisons ont fait que les jeux de barre ont depuis toujours été laissés sans protection spécifique : • Les jeux de barres avait un très haut niveau de fiabilité • La peur que les fonctionnement intempestifs n ’entraînent plus de dégas que si elle n ’existait pas • On comptait sur la couverture amont des protections pour éliminer d ’éventuel défaut barre
- 89. Protection de jeux de barres Malgré que le risque de défaut jeux de barre est très minime, il ne peut être ignoré complètement pour les raisons ci après : • la puissance de court circuit sur un jeux de barre est généralement très élevée • Les conséquences d ’un court circuit jeux de barres non éliminé rapidement sont très graves • Un défaut jeux de barres est éliminé en absence d ’une protection jeux de barre dans les meilleurs des cas en 2ème stade des protections de distance • La subdivision du jeux de barre en sections protégées séparément diminuent les conséquences d ’un déclenchement intempéstif
- 90. Protection de jeux de barres Principales qualités exigées d ’une protection jeux de barres : • La rapidité : Essentielle pour le maintien de la stabilité du système et la limitation des conséquences du court circuit • Stabilité : Vue la fréquence très rare des défauts jeux de barres la protection doit être d ’un très haut niveau de stabilité
- 91. Protection de jeux de barres Principaux modes de protection jeux de barres : • Protection assurée par les départs (Cas actuel) • Protection basée sur la recherche d ’une masse sur l ’enveloppe du jeux de barre • Protection différentielle • Protection basée sur la comparaison des phases La dernière méthode n ’est plus utilisée
- 92. Protection de jeux de barres Protection masse enveloppe jeux de barres : X X X Relais TC
- 93. Protection de jeux de barres Principe de la protection différentielle barre: • Basé sur la loi de Kirchoff • La somme vectorielle des courants entrant dans un même nœud est nulle • En cas de défaut jeux de barre un courant de fuite correspondant au courant de défaut apparaît • La somme des courants devient alors égale au courant de défaut
- 94. Protection de jeux de barres Principe de la protection différentielle barre: X X X X X X RELAIS
- 95. Protection des lignes MT Protection contre les surintensités Protection des lignes THT Protection des lignes HT Protection des lignes MT
- 96. Protection des lignes MT protection contre les surintensités : Principes généraux : Un réseau n’est jamais maintenu sous tension après l’apparition d‘un défaut Prévoir toujours deux systèmes de protections l’un pour les défauts entre phases et l’autre pour les défauts à la terre La protection de court circuit doit être indépendante de la protection de surcharge
- 97. Protection des lignes MT protection contre les surintensités : protection contre les courts circuits entre phases : • A l’ONE la protection contre les court circuits et les surcharges était la même . Pour les nouvelles générations de protections il y a deux seuils un seuil surcharge et un seuil de court circuit.
- 98. Protection des lignes MT protection contre les surintensités : • Protection contre les court - circuits entre phases : – La protection contre les court – circuits entre phases est assurée par deux relais ampermétriques alimentés par les courants secondaires de deux TC placés sur deux phases, A et C, du départ • Il y a deux seuils à régler : – Seuil de surcharge – Seuil de court circuit • Pour les anciennes protections un seul seuil est réglé, il assure les deux fonctions surcharge et court circuit.
- 99. Protection des lignes MT protection contre les surintensités : • Seuil de surcharge : – Le réglage généralement adopté est le courant maximum de charge majoré de 20%. • Seuil de court circuit : – Pour la nouvelle génération de protection qui dispose d’un seuil de court circuit il faut calculer le courant minimale de défaut biphasé pour régler le seuil de court circuit.
- 100. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • Les courants de court circuit monophasés à la terre sont limités à : – 300 A dans les réseaux aériens – 1000 A dans les réseaux souterrains à câbles • La limitation est réalisée par une résistance insérée dans la connexion de mise à la terre du transformateur HT/MT de : – 42.5 Ohm dans les réseaux aériens – 12.5 Ohm dans les réseaux souterrains à câbles
- 101. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • Réalisée par un relais homopolaire alimenté par la somme des trois courants de phase selon le schéma du circuit alternatif classique. • Le seuil de ce relais devrait être théoriquement nul mais il y a deux phénomènes qui influencent le réglage de ce suil à savoir : – L’effet capacitif de la ligne protégée – La consommation propre du relais de protection en fonction de la puissance de précision du TC
- 102. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • Influence de l’effet capacitif de la ligne : • Une ligne électrique aérienne ou un câble ont des capacités homopolaires par rapport à la terre • Lors d’un défaut franc à la terre d’une phase les départs voisins du départ en défaut vont voir circuler un courant sur les phases correspondants aux phases seines . • En négligeant la résistance de la terre la tension de la terre devient lors d’un défaut égale à la tension de la phase en défaut.
- 103. Protection des lignes MT A B C A B C Id C0 C0 I01 I02 I01 I02 I01 I02 I01 + I02
- 104. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • On démontre que la valeur maximale du courant résiduel vu par le relais homopolaire d’un départ sein est : Ir = 3 C0 W Un – C0 : Capacité totale de la ligne considérée – W : égale à 100 – Un : Tension nominale
- 105. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : Exemple : • Pour les lignes aériennes : En absence de données réelles des lignes on utilise la valeur standard de 5 F/Km • Ce qui donne en 22 KV Ir = 0.06 A/Km en MT • Pour les câbles souterrains :La valeur standard utilisée est 0.15 F/Km Ce qui donne en 22 KV Ir = 1.8 A/Km en MT
- 106. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • Influence de la consommation propre du relais et de la puissance de précision du TC – La consommation propre du relais homo polaire fait circuler un courant et risque d'entraîner le fonctionnement de la protection • Soit : – Ptc : Puissance de précision du TC – Pr : Puissance du relais
- 107. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • Influence de la consommation propre du relais et de la puissance de précision du TC • La puissance étant proportionnelle au carré du courant, le courant Ir consommé par le relais pour In = 5 ABT est donné par : Ir = 5 Pr/Ptc
- 108. Protection des lignes MT Protection contre les court - circuits monophasés à la terre : • Influence de la consommation propre du relais et de la puissance de précision du TC – Exemple : – Rapport TC 100/5 – Pr = 0.15 VA – Prtc = 30 VA • Ir = 0.35 ABT soit 7 A en MT – Le réglage à afficher doit être supérieur à cette valeur