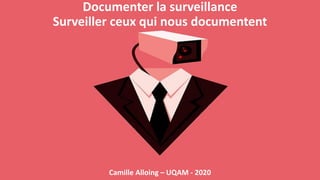
La sousveillance
- 1. Documenter la surveillance Surveiller ceux qui nous documentent Camille Alloing – UQAM - 2020
- 2. Capacités données à chaque citoyen de faire usage des dispositifs numériques pour « regarder d’en bas » (watching from below) les différentes formes de pouvoirs étatiques ou commerciaux (Mann et al., 2002) Reflectionism (Mann, 1998) : détourner les outils construits par certaines organisations afin d’exercer un contrôle citoyen Aujourd’hui la sousveillance est indissociable des médias sociaux numériques La sousveillance ne se limite pas au « cop watching »… mais s’inscrit avant tout dans une démarche citoyenne La sousveillance ?
- 3. La sousveillance ? Renseigner : « apprendre quelque chose à quelqu’un. Plus largement, donner à quelqu’un une indication sur une chose » (Moinet, 2011)
- 4. La sousveillance : pour quoi faire ? Exercer un contrôle sociale sur ceux qui nous surveillent ? Se protéger ? S’informer ? Sous-surveiller ? Documenter les politiques et industries de surveillance ? Savoir être agile dans les environnements numériques commerciaux pour minimiser voire braconner la surveillance automatisée (ou non) ?
- 5. La sousveillance comme désorganisation du panoptique Un concept floue (Thomsen, 2019) qui vise à fournir des moyens d’agir plus qu’à théoriser des usages ou des pratiques Pour Steve Mann, la sousveillance comme un panoptique inversé Si le contrôle sociale s'organise par l'invisibilisation des surveillants, alors les mettre en visibilité va les désorganiser Le but est donc de détourner les technologies de surveillance et de les utiliser de manière désorganisée Il n’y a pas de mise en scène ou d’expressivisme (Allard, 2005) : l’objectif est de multiplier les points de vues pour produire de la dé/remédiation
- 10. Sousveillance et affections La sousveillance comme une affection distribuée (Alloing & Pierre, 2020) ? Via diverses affordances, la mise en circulation des vidéos affectent leurs publics… et leurs acteurs (Eneman et al., 2019) Cette affection laisse une trace (informatique et émotionnelle) L’intensité affective des images passe avant les idéologies véhiculées (Grossberg, 1992) Pour les plateformes comme les médias elle a de la valeur : elle incite à (réa)agir, elle attire l’attention
- 14. Sous-surveillance Si la sousveillance interroge les représentations, la sous-surveillance se veut plus factuelle Contrairement à la sousveillance qui (dés)affecte, la sous-surveillance renseigne : quelles formes d’autorités pour in-former ? La question de la médiation n’est plus évacuée, elle est centrale : les renseignements sont accessibles mais ils nécessitent d’être mis en forme ET en visibilité Autorité réputationnelle (Alloing, 2017) ? Mais quoi qu’il arrive, les médiations sont sous l’emprise des plateformes…
- 15. La sousveillance et les plateformes numériques Les plateformes numériques, médias sociaux en tête, sont au cœur des questions de sousveillance et sous-surveillance Elles jouent de nombreux rôles : médiatisation, éditorialisation, censure, surveillance… La sousveillance montre alors toute l’ambiguïté des distinctions entre sphères publiques et privées qui sont centrales dans les questions de surveillance (Ganascia, 2009 ; Quessada, 2010) Qui surveille qui en ligne : la plateforme ? Les publicitaires ? Les autres usagers ? Les services de renseignement ? Une autre question pourrait être : quel est le « capital » que ces plateformes génèrent via la sousveillance ordinaire ou structurée ? Une hypothèse : elles capitalisent en produisant des contextes aptes à faire de la sousveillance un « contenu » comme un autre
- 16. Sousveillance et capitalisme affectif Les plateformes que nous utilisons nous insèrent dans un contexte nous permettant d’affecter et d’être affectés Les usagers filment, les plateformes mettent en circulation Les usagers documentarisent, les plateformes redocumentarisent Les usagers réagissent, les plateformes personnalisent et ciblent grâce à ces réactions Likes, cœurs, commentaires, etc. Les images (violentes) en ligne sont autant conversationnelles (Gunthert, 2016) qu’émotionnelles : elles attirent l’attention et provoquent des interactions/impulsions
- 17. Sousveillance et capitalisme informationnel La sousveillance alimente les plateformes en « contenus » (images, vidéos, analyses, débats et controverses) Mais la manière de les distribuer repose sur une logique en silo qui peut modifier sensiblement leur réception Le référencement de ces renseignements, leur mise en visibilité et accessibilité, repose sur des choix éditoriaux en grande partie automatisés Ce sont ainsi les plateformes qui évaluent et attribuent en partie la valeur informationnelle de ces « contenus » Pour leur mise en visibilité donc, mais aussi leur mémorisation et leur censure La modération ou non de certaines images, par exemple, est centrale
- 18. Sousveillance et capitalisme de surveillance Sous(sur)veiller c’est prendre le risque de fournir des données qui participent aux logiques d’accumulation des acteurs commerciaux du numérique (Zuboff, 2015) Une accumulation qui peut ensuite devenir utile aux industries militaires et de surveillance étatique Reconnaissance faciale sur des photos (cf. cas Ever) Le fait d’être surveillé pousse aussi à l’autocensure, particulièrement chez les militant-e-s De nombreuses logiques de résistances (plugins, applications sécurisées ou décentralisées) et d’offuscation existent mais supposent une littératie appropriée
- 19. Pour une éducation à la sousveillance ? Steve Mann n’a jamais caché la portée politique de la sousveillance Mais contrairement à certaines approches de la question, il me semble que cela doit être dans une logique collective, pas individuelle Et encore moins transhumaniste! Cela pour en faire une vraie méthode de renseignement citoyen Voir la sousveillance comme une technique de renseignement permet d’évaluer la valeur des informations que l'on produit, les risques pour soi et les conséquences pour les autres des faits que l'on rend visible Il parait donc utile de se questionner sur des pratiques communes plus qu’un solutionnisme technologique Surveiller les surveillants en produisant des dispositifs de surveillance…
- 21. En synthèse La sousveillance… N’est pas du journalisme mais nécessite un travail éditorial pour devenir un moyen de lutte Repose sur des mécanismes affectifs pour sa circulation Participe à la redéfinition de ce qui fait autorité ou non en ligne Nécessite de s’interroger sur ceux qu’elle tente de contrôler (les surveillants) : comment sont-ils affectés et qu’est-ce que cela produit (impunité, changement de comportement) ? Nécessite de s’interroger sur celles et ceux qui permettent le développement des industries de surveillance : sont-ils bien informés et par qui ? Doit continuer à être pratiquée… et débattue!
- 22. Merci.
