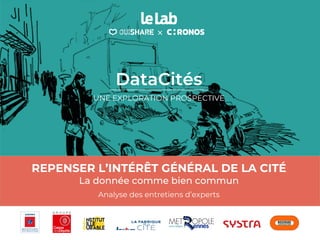
Analyse des entretiens d'experts - Exploration DataCités 1
- 1. REPENSER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA CITÉ La donnée comme bien commun Analyse des entretiens d’experts DataCités UNE EXPLORATION PROSPECTIVE
- 2. Sommaire DataCités-CC-BY-SA I. RÉACTIONS II. EXPERTS PAR EXPERTS III. ENSEIGNEMENTS CROISÉS IV. FACTEURS CRITIQUES ET VARIABLES CLÉS
- 3. 16 entretiens réalisés Energie Civic tech Rôle de l’acteur public & collectivités Communs ● Adrien Kantin, consultant chez Yélé Consulting ● Philippe Tessier, ancien animateur du Groupe Energie-Climate de l'association des Ingénieurs Territoriaux de France, directeur de projet énergie et environnement à l'UGAP ● Olivier Duhagon, Directeur Régional Pays de Loire chez Enedis ● Laurent Schmitt, Directeur Général chez ENTSO-E ● Stéphane Vincent, executive officer à la 27e Région ● Matt Stokes, Chercheur chez NESTA (projet Digital Social Innovation) ● Danny Lämmerhirt, Chercheur chez Open Knowledge Foundation ● Javier Creux & Mara Balestrini, Ideas for Change ● Michel Briand, professeur à Telecom Bretagne, ancien membre du Membre du Conseil National du Numérique, élu de Brest à l’aménagement numérique du territoire ● Isabelle Pellerin, 3ème Vice-présidente - Rennes Métropole en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. ● Jean-Luc Sallaberry, Responsable du Département Numérique chez Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ● Brett Goldstein, chercheur à Université de Chicago (précédemment CDO Chicago) ● Jean-Marc Lazard, Fondateur d’OpenDataSoft ● Valérie Peugeot, Orange Labs ● Francis Jutand, Deputy Executive Director at Institut Mines-Télécom ● Dominique Cardon, sociologue français ● Tom Symons, Chercheur chez NESTA (projet DECODE) 3 DataCités-CC-BY-SA
- 5. Introduction Les experts ont été invités à réagir sur les principales hypothèses émises sur nos 5 axes de travail. Pour chaque axe de travail, nous allons vous présenter les hypothèses, les schémas partagés et les principales réactions des experts. Intérêt général Alliances stratégiques Rôle de l’acteur public Rôle des individus Gestion des données Explications des hypothèses et des schémas Schémas Réactions des experts 1 2 3 4 5 5 DataCités-CC-BY-SA
- 6. Même si tous les cas étudiés dans le benchmark n’en sont pas au sens strict, nous sommes devant des services d’intérêt général dans une acception large : « des services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques ». Nos analyses montrent que nous sommes passés d’une logique où l’acteur public est seul garant de l‘intérêt général à une logique où l’intérêt général, s’il est toujours porté par l’acteur public, est aussi revendiqué par des acteurs privés et par des communautés d’individus. A titre d’exemples : • Waze vise à réduire la congestion urbaine. Il revendique l’intérêt général à travers la multitude d’usagers à qui il apporte un service. • Me SOL Share transforme des particuliers et microentreprises en acteur économique de la transition écologique avec la mise en place de micro-grids. L’intérêt général est revendiqué par le lien avec les communautés locales. • LeTaxi rend compte d’une évolution du maintien de l’intérêt général par l’acteur public, dans la mesure où l’Etat donne aux opérateurs de taxi les moyens de se battre avec les startups mondiales comme Uber. Dès lors, de nouvelles alliances se forment et le rôle des acteurs publics et des individus se transforment. Nous détaillerons ces points dans les designs suivants. L’intérêt général largement revendiqué 6 DataCités-CC-BY-SA
- 7. … challengé par les acteurs privés, communautaires et les usagers eux-mêmes Acteur public Acteurs privés Usagers Communautés Opérateur de l’intérêt général Intérêt général ?! Intérêt général !? Intérêt général !? Basé sur la multitude, légitimé sur l’usage Légitimé sur la proximité avec le public Légitimé sur son mandat J’ai le choix... 7 DataCités-CC-BY-SA
- 8. Verbatims sur l’intérêt général « Pour moi la légitimité est une vraie question. Est-ce que, étant Google, je suis légitime parce que je fais un moteur de recherche utilisé par tout le monde ? Appeler cela légitime me semble abusif ou alors … tout acteur privé qui propose un service, qui fabrique un service est légitime » Est-ce que Europe est un acteur légitime parce que des gens écoutent l'information qu'ils leur donnent ? Cela ne me semble pas évident. Cette légitimité peut faire partie d'un acte de communication ou abriter des tentatives de capture, donc la légitimité nécessiterait pour moi en soi d'être réinterrogée.” Francis Jutand ‘Le garant de l’intérêt général, c’est quand même bien l’acteur public, c’est son mandat. Après, que des acteurs privés y participent, c’est clair, notamment dans les DSP. Usagers porteurs d’intérêt général ? Je ne vois pas très bien, si c’est le cas d’Uber qui se revendique de l’intérêt général, je trouve ça abusif, alors dans ce cas, l’épicier du coin est aussi le représentant de l’intérêt général. » Philippe Tessier « Oui, nous sommes dans une ouverture. Oui de nouveaux acteurs s'immiscent. Un groupe d'acteurs est pourtant absent de ce schéma. Il y a quelque chose qui se joue en France du côté de l'ESS. Nous disposons chez nous d'un tissu coopératif et associatif, ne serait-ce que parce qu'ils présentent les garanties de soutenabilité, de légitimité, d'inclusivité, qu'ils ont une approche éthique en ligne avec l'intérêt général » Stéphane Vincent « Il faut rajouter les acteurs de l'Économie Sociale et Solidaire » Adrien Kantin “L’acteur public demeure le garant de l’intérêt général. Nous sommes des représentants des citoyens, élus par les citoyens. Le risque de ce qui se présente comme de l’intérêt général soit de l’intérêt particulier. La présence de la collectivité et des représentants démocratiquement élus des citoyens d’un territoire c’est important. “ Isabelle Pellerin A propos des acteurs privés : « je n’arrive pas à appeler ça intérêt général. C’est un service utile, utile au consommateur. Si c’est d’intérêt général, tous les services sont d’intérêt général. Amazon ne prétend pas être un service d’intérêt général parce qu’il vend des livres. Pour moi cette image d’intérêt général est un habillage marketing qui cache une gouvernance complètement privée dans laquelle les consommateurs et les pouvoirs publics n’ont aucune voix au chapitre et que la valeur est concentrée entre les mains de quelques acteurs » Valérie Peugeot 8 DataCités-CC-BY-SA
- 9. Remarques des experts sur la redéfinition de l’intérêt général Quels sont les critères qui confèrent une légitimité en matière d’intérêt général ? Régulation Quels sont les acteurs qui respectent ces critères et peuvent se revendiquer de l’intérêt général ? Gouvernance Modèle participatif ; qui réunit tous les acteurs concernés notamment acteur public et citoyens Régulation / Autorité / Commande publique Répartition / distribution de la valeur vs. concentration + + L’acteur public demeure le garant de l’intérêt général de par son mandat. Les acteurs privés, via des délégations de service public, contribuent à cet intérêt général Les acteurs privés qui développent des services hors commande publique créent des services innovants, utiles mais nous ne sommes pas face à des services d’intérêt général. Se revendiquer d’intérêt général est un acte de communication. Les communautés et les individus eux-mêmes défendent des intérêts particuliers (l’intérêt de la communauté et l’intérêt privé) En France, il y a une nouvelle catégorie d’acteurs à prendre en compte : les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Ils présentent une approche éthique en ligne avec l'intérêt général 9 DataCités-CC-BY-SA
- 10. Les alliances stratégiques ici mentionnées ont des formes juridiques variées. Il peut s’agir de soutien financier ou moral, de partenariat, de rachat, d'actionnariat, etc. Dans certains cas, ces alliances se combinent. Alliances entre concurrents Alliances avec un acteur du numérique Alliances avec les acteurs locaux Alliances avec un acteur public légitime Des concurrents dont le cœur de métier n’est pas numérique, s’allient pour contrer les “géants du web”. Cela se fait par choix (les constructeurs automobiles dans Here) ou par obligation (les opérateurs de taxi dans Le.Taxi). Des acteurs s’adossent à des géants du web pour asseoir leur légitimité et gagner en parts de marché. Ainsi de Here avec le géant chinois Baidu ou de Waze avec Google. Terradona ou encore Qurrent s’appuient sur des acteurs locaux (commerces, services de proximité…) pour disséminer leurs solutions auprès d’un public local. Elles consistent à développer des partenariats avec des acteurs qui représentent l’intérêt d’un secteur ou encore d’une communauté. Easy Transport, Ride Austin, Qurrent et Open Data System développent - entre autres - cette stratégie. Typologie des alliances 10 DataCités-CC-BY-SA
- 11. L’acteur numérique dominant permet de revendiquer l’intérêt général par la somme des individus touchés. Cette fédération permet d’augmenter le nombre de données et de se positionner stratégiquement sur un marché. Elle se fait en direct, sans intermédiation. Elle permet de capter des communautés locales. L’acteur public fait l’intermédiaire avec les acteurs locaux. Il est garant de l’intérêt général. Alliance entre concurrents Alliance avec un acteur du numérique Alliance avec un acteur public légitime Alliance entre acteurs locaux 11 DataCités-CC-BY-SA
- 12. Remarques des experts sur les alliances De nombreuses alliances se créent et l’acteur public doit trouver sa place dans ces nouvelles alliances pour ne pas en être écarté “Je partage l'analyse telle qu'elle ressort des constats [DataCités]. Les acteurs publics vont avoir énormément de mal à reprendre la main. Avec le numérique, les villes sont confrontées à un "saut quantique". Stéphane Vincent Les alliances entre opérateurs de services publics et startups : “Les alliances avec les opérateurs traditionnels sont clés notamment pour les startups “ “Ces opérateurs ont envie d’innover mais ils sont dans une situation compliquée car ce sont les acteurs les plus bousculés et les plus challengés.” Adrien Kantin “C’est une remarque qu’on nous fait souvent : les acteurs bougent autour de vous, s’organisent, et finalement, qu’est-ce que la collectivité peut faire dans tout ça ?” Isabelle Pellerin Des alliances absentes de la photographie En synthèse, la forme de l’alliance ne détermine pas s’il s’agit d’un service d’intérêt général “On a été approché par des entreprises : ERDF, Dassault Sytem...ils nous demandent comment peut-on travailler ensemble ? Ce type de relation demandée par les entreprises aux collectivités est nouveau pour elles. C’est compliqué pour nous de savoir comment travailler avec eux dans un cadre juridique légal.” Isabelle Pellerin “Où sont les alliances entre les communautés de communs et les acteurs publics de la ville ?” Valérie Peugeot 12 DataCités-CC-BY-SA
- 13. Acteur public L’acteur public est challengé par les acteurs privés qui revendiquent le respect de l’intérêt général à travers leurs services. Au-delà de la planification et du financement des services publics traditionnels, l’acteur public diversifie ses rôles et ses actions. Régulateur L’acteur public légifère l’ouverture des données publiques mais réglemente aussi plus largement les secteurs avec des politiques sociales et économiques. Le cas de la ville d’Austin qui a imposé ses réglementations à Uber et Lyft contribuant à leur faire quitter la ville, rend compte de ce rôle. Réutilisateur de données Plusieurs exemples existent où les acteurs privés partagent gratuitement certaines de leurs données aux collectivités pour qu’elles mesurent puis optimisent leurs services publics. Waze rentre dans cette catégorie. Client Dans certains cas comme Terradona et Qurrent, les acteurs publics achètent les données aux fournisseurs de services. C’est d’autant le cas lorsque les données collectées sont rares et difficilement accessibles par ailleurs. Créateur de communs C’est sans doute le rôle le plus innovant porté par l’acteur public. Easy Transport, BANO ou Le.Taxi en sont des exemples phares. A travers ces projets, l’acteur public accompagne et soutient la création de communs, voire les développe lui-même en mode startup d’Etat. Investisseur L’acteur public investit dans les services qui lui semblent les plus prometteurs et garants de l’intérêt général. Ainsi la Caisse des Dépôts investit dans Terradona, l’Ademe et la CE financent Easy Transport et l’European Investment Bank investit dans Enevo. 1313 DataCités-CC-BY-SA
- 14. Réutilisateur de données Garant de diagnostics fiables sur les besoins des administrés et d’amélioration des services publics. Les données leur sont remises gratuitement. Régulateur Garant des équilibres sociaux, de la concurrence, du respect de la vie privée, etc. Client des données Garant de diagnostics fiables sur les besoins des administrés et d’amélioration des services publics. Les données leur sont vendues. Garant du développement d’offres adaptées et respectueuses de l’intérêt général. Investisseur Garant du développement de plateformes communes entre des acteurs économiques de la circulation des données, du respect des “loyautés” et des solidarités. Promoteur de l’open data. Créateur de communs 14 Les postures de l’acteur public DataCités-CC-BY-SA
- 15. Remarques des experts sur le rôle de l’acteur public Régulateur Réutilisateur de données Client Créateur de communs Investisseur Les deux rôles fondamentaux de l’acteur public pour garantir l’intérêt général (accessibilité, continuité, égalité, etc…) L’acteur public serait plutôt accompagnateur ou protecteur de communs. Il réunit les conditions favorables à la création de communs. C’est le statut des données qui détermine si l’acteur public est client ou réutilisateur de données Ces deux rôles posent la question des compétences des collectivités. Elles ont besoin de se doter de data analyst pour analyser les données auxquelles elles ont accès Des rôles absents de ce schéma Innovateur Observateur Animateur d’un écosystème collaboratif Tiers de confiance / médiateur Finalement, un acteur public ne devrait-il pas savoir manier tous ces rôles en fonction de ses ressources, des besoins des citoyens et des défis à relever ? 15 DataCités-CC-BY-SA
- 16. Verbatims des experts sur le rôle de l’acteur public Je pense que la réflexion sur le créateur de communs c'est une réflexion adjacente à la réflexion sur la démocratie. C'est reconnaître que dans un monde complexe les choses ne peuvent pas se réguler, s'organiser, se gouverner de façon simple sans créer des acteurs intermédiaires” Francis Jutand “De toute façon, les données vont devoir être croisées entre secteur. Les régulateurs se disent qu’ils doivent avoir les données pour survivre, mais la mutation sera plus puissante qu’ils ne l’imaginent. Vers des régulateurs de plusieurs secteurs ? transport / énergie / télécom ?” Jean-Luc Sallaberry “La gouvernance contributive renvoie au fait que la collectivité n’est plus seulement prescriptrice /fournisseuse, mais animatrice de réseaux d’acteurs sur le territoire. La collectivité porte une direction mais ce n’est pas forcément elle qui assure la mise en oeuvre de ces services. On peut imaginer que les pouvoirs publics deviennent animateur de collaboratif.” Michel Briand “Cela manque peut-être de cette notion d'observation. Être capable de faire un diagnostic de ce qui est en train de se développer, donc se définir par rapport à ce qui est en train de se développer : est-ce qu'on va être investisseur, régulateur, incitateur de commun, etc ? Cette observation par la collectivité me semble quelque chose de clair pour guider la collectivité.” “On manque de compétences & data analyst” Isabelle Pellerin “A la FNCCR, on préconise le modèle d’un acteur public de la gestion des données, comme étant le médiateur de la gestion des données, avec les données du service public et des données issus de plusieurs domaines (ie d’autres acteurs, privés notamment).” Jean-Luc Sallaberry “Tous ? Je n'ai pas envie de sélectionner car un acteur public intelligent c’est celui qui sait utiliser tous les leviers” Valérie Peugeot “Innovateur ! Quand même ! Animateur du débat public, créateur des infrastructures de la contribution, restituteur / médiateur “ Valérie Peugeot 16 DataCités-CC-BY-SA
- 17. Individus Quatre rôles se dégagent de nos analyses pour les individus : consommateur passif, consom’acteur, smart citizen et commun’acteur (dit aussi commoner). Les individus remplissent ces rôles au gré de l’usage qu’ils font des dataservices, selon la façon dont ils partagent, l’intensité avec laquelle ils partagent et la finalité de ce partage. La plupart du temps, c’est le service lui-même qui détermine le rôle que peut jouer l’individu. Consommateur passif Consom’acteur Smart Citizen Commun’acteur ou commoner Les données de l’individu sont captées sans aucune action de sa part et en échange d’un service hyperindividualisé. La donnée est privatisée by design. Here ou Uber convoquent ce statut pour leurs utilisateurs. Quand le promoteur du service prétend organiser la convergence de l’intérêt général et de l’intérêt particulier. Waze se réclame implicitement de l’intérêt général (résorber les congestions urbaines) mais promet surtout un bénéfice particulier (la trajectoire la plus rapide grace au crowdsourcing). Quand l’acteur public le sollicite pour contribuer à un service public. Son action est alors bénévole, civique et gracieuse. L'appellation possible est aussi "connected citizen" dès lors que la médiation est numérique. MLT Transport à Montreal incarne ce statut. Quand il est sollicité pour contribuer à un commun, au sein d’une communauté de pairs (wikis ou civic techs). Dans les projets d’utilité publique comme Easy Transport ou Open Power Grid, le bénéfice individuel est faible, voire nul en échange d’une implication importante. 1717 DataCités-CC-BY-SA
- 18. Consommateur passif Contribue sans aucune action, ses données étant captées de manière passive. Bénéficie d’un service personnalisé en échange. Consom’acteur Bénéficie d’un service personnalisé, partage ses données et participe à l’intérêt général de manière consciente par ce biais. Smart Citizen A la demande d’un acteur public, contribue à un service public par la production de données et l’ évaluation de la loyauté. Commoner Contribue à un commun, au sein d’une communauté de pairs (wikis ou civic techs). volum e disponible degré d’im plication 18 Les postures de l’individu DataCités-CC-BY-SA
- 19. Réactions des experts sur le rôle des individus Il y a consensus sur la nécessité d’engager le citoyen de manière plus active et de le sensibiliser aux enjeux des données Le rôle de l’acteur public est précisément de mobiliser les citoyens “Aujourd’hui la question est de savoir comment on passe de consommateur passif à consom’acteurs ou smart citizen. Cela reviendrait à mettre en place le green button américain chez nous. Je suis un peu pessimiste” Adrien Kantin “Je dirais que la collectivité a un rôle de faire monter les gens. De faire en sorte que les gens ne soient pas seulement des consommateurs passifs mais de les transformer dans les trois autres rôles. On pourrait parler d’ éducation contributive” Michel Briand Les facteurs qui expliquent le difficile passage de consommateur passif à smart citizen Les enjeux économiques des acteurs privés ”Les acteurs économiques ne se laisseront pas faire ;le modèle Wikipedia ne marche pas quand les enjeux économiques sont énormes” JL Sallaberry “La valeur est dans les traces de plus en plus passives “ Dominique Cardon L’accessibilité / le déploiement à des publics moins avertis et moins connectés “Les usagers de Brooklyn dont vous parlez, c’est une petite communauté de personnes, avec une connaissance sur un sujet, public privilégié ou averti” Isabelle Pellerin Les enjeux économiques des usagers eux-mêmes A propos de la sensibilisation sur la question de l’énergie : “Les gens s’en fichent, cela ne coûte pas assez cher.” Adrien Kantin 19 DataCités-CC-BY-SA
- 20. Quatre façons de valoriser les données La donnée comme “actif abondant” En réaction aux acteurs qui organisent la rareté des données, des acteurs comme Navitia ou Catalogue visent à rendre les données abondantes (celles liés à l’expérience utilisateur du moins). En ouvrant les données, ces acteurs organisent l’abondance de ce qui, pour les acteurs du numérique, est le principal levier d’innovation. La donnée comme “ressource d’intérêt général” Le soutien à l’ouverture et au partage des données représente un modèle alternatif de gestion des données. Ce modèle contribue à l’intérêt général ; ce qui n’exclut pas que ces agents poursuivent leur intérêt bien compris. La donnée comme “patrimoine stratégique” Pour les acteurs de la mobilité, la donnée est un patrimoine stratégique. Pour la plupart, la marchandisation de la donnée n’est pas la finalité première des acteurs comme Waze, RideAustin, Uber ou encore Google Maps. La donnée est un actif qui leur permet de dominer leur marché, en concentrant la demande par exemple. La donnée comme “matière première” Les cas étudiés dans le domaine de l’énergie et des déchets ne déploient pas de stratégie particulière pour capter d’autres données, ni pour partager ou ouvrir les leurs. Seul Qurrent les monétise auprès d’autres acteurs de l’énergie. Ces acteurs accordent à la donnée la valeur d’une matière première. La valeur désigne l’intérêt ou l’importance que les acteurs portent à la donnée, voire le prix qu’ils lui confèrent. Le benchmark met en lumière les différences de valeur que les acteurs accordent aux données. On retrouve la notion de plasticité de la valeur des données, qui avait été développée dans le programme DatAct (“La valeur de la donnée doit être dynamiquement estimée en fonction de débouchés évolutifs et d’usages différentiés”). 20 DataCités-CC-BY-SA
- 21. Mode de gestion des données basé sur l’ouverture et le partage des données en vue de créer des services inexistants ou incomplets. Mode de gestion des données basé sur la mobilisation large des données et la capacité à les rendre accessibles en vue de minimiser le rôle central des acteurs du numérique. Mode de gestion des données qui permet aux acteurs d’être dominant sur un marché, en concentrant la demande par exemple. Mode de gestion des données qui permet aux acteurs d’optimiser les services qu’ils proposent. “Actif abondant” “Ressource d’intérêt général” “Patrimoine stratégique” “Matière première” Les valeurs d’usage de la donnée 21 DataCités-CC-BY-SA
- 22. Réactions des experts sur la gestion des données La loi pour une République Numérique à faire évoluer ? Les experts apportent des précisions sur la propriété des données « Les données des services délégués par les collectivités appartiennent au peuple français, c’est la traduction de la loi pour une république numérique (...) « il n’y a pas de propriété sur les données, il y a que de l’usufruit. Je plaide pour un usufruit d’intérêt général ». Jean-Luc Sallaberry “ Dans le cas des services développés en réponse à un appel d'offre, on rentre assez vite dans le cadre des données d'intérêt général de la loi République Numérique. Cette loi reste au milieu du gué à mon sens puisque l'entreprise est censée restituer les données au commanditaire, mais pour autant elle n'a pas d'obligation d'être en opendata. A mon sens, ce devrait systématiquement être reversé en Opendata. Dès le moment où c'est financé par de l'argent public, ça devrait être mis en opendata au moins pour les données d'usage “ Valérie Peugeot A propos de la donnée en tant que “patrimoine stratégique” “Le modèle de gestion des données dépend du niveau de dépendance à la publicité et de la capacité à trouver des modèles économiques alternatifs. Il y en a peu. “ Valérie Peugeot “Les données de l’énergie peuvent créer de la valeur dans des champs qui n’ont rien à voir avec l’énergie. Un assureur pourrait créer une assurance Pay As You Live “ Adrien Kantin 22 DataCités-CC-BY-SA
- 24. Fiche expert - Adrien Kantin Adrien Kantin est consultant chez Yélé Consulting, société de conseil fondée il y a 6 ans et spécialisée dans le secteur de l'énergie. Yélé accompagne des acteurs dans la mise en place de démarches d’innovation dans lesquelles la donnée a une place centrale. ● ENERCOOP : modèle économique innovant qui promeut des valeurs d’intérêt général ● Brooklyn Grid ● Tecsol : autre cas d’usage de la blockchain qui permet de recharger un véhicule électrique avec sa propre consommation solaire QUI Projets“Je pense que l’élément clé, qui manque dans le débat aujourd’hui c’est le fait que la donnée a un coût à chaque étape (collecte, traitement, stockage, …). La question est de savoir si ce coût doit être supporté par la collectivité directement ou par des opérateurs. “ Les spécificités du secteur de l’énergie face au numérique Intérêt général : décentralisation plus faible de l’intérêt général car les usagers finaux sont peu sensibles à la question énergétique et que la dimension technique de ce secteur, notamment de la partie réseau, limite l’innovation. Dans l’énergie, la blockchain est plus révolutionnaire que la donnée pour aider les individus à s’emparer de la question énergétique Alliances stratégiques : ne pas négliger les alliances entre startups et opérateurs de services publics urbains traditionnels (Suez, Veolia, etc.). Les startups ont un rôle de modernisation de ces opérateurs et seront peut être à terme rachetées par ces acteurs. Rôle de l’acteur public : “régulateur” et “investisseur” sont les deux rôles clés Rôle des individus : consommateur passif essentiellement - possibilité de mobiliser le consom’acteur par l’intégration de l’énergie à un sujet plus global comme celui de la maison Gestion des données : la donnée issue du secteur de l’énergie peut être une matière première pour créer des services hors énergie (exemple : assurance PaY As You Live) 24 DataCités-CC-BY-SA
- 25. Fiche expert - Michel Briand Actuellement directeur adjoint de la Formation à Telecom Bretagne et co animateur du magazine Innovation-pédagogique, Michel Briand était élu de 1995 à 2014 à Brest, en charge d’internet et du multimédia. ● Communauté auto-organisée sur Facebook pour covoiturer entre Rennes et Nantes (projet issu du programme Domino) ● Fermes éoliennes créées par des habitants en Bretagne ● ENERCOOP, modèle alternatif dans l’énergie ● Alliance dangereuse entre Education nationale et Microsoft ● Alliance intelligente entre Barcelone et la AirbNb (rôle de régulateur) QUI “Les données ne sont pas neutres, elles sont politiques. Elles sont marquées socialement.” L’acteur public doit mettre en place une gouvernance contributive La gouvernance contributive renvoie au fait que la collectivité n’est plus seulement prescriptrice /fournisseuse mais aussi animatrice de réseaux d’acteurs sur le territoire. La collectivité porte une direction mais ce n’est pas forcément elle qui assure la mise en oeuvre de ces services. La gouvernance contributive s’appuie sur la coopération et les communs à l’échelle du territoire local. Les 3 grands principes sont : “faire avec” i.e engager les citoyens ; “être en attention” i.e mobiliser ; “donner à voir” L’acteur public doit favoriser un écosystème d'émancipation contributive Constat Avec le développement de nos usages des outils numériques, notre société devient plus contributive : il est possible pour chacun d’échanger, de s’exprimer et d’être lu par des personnes du monde entier, mais aussi d’innover et d’entreprendre en réseau. Projets 25 DataCités-CC-BY-SA
- 26. Fiche expert - Valérie Peugeot Vice-présidente du Conseil national du numérique de janvier 2013 à janvier 2016 (mandat de trois ans), où elle était en charge des questions de «transition numérique et société de la connaissance», Valérie Peugeot est chercheuse aux Orange Labs et Présidente de l’association Vecam. • Mes Infos, projet porté par la FING en partenariat avec Orange → modèle alternatif avec une restitution à l’individu • Charte des communs à Bologne : forme d’alliance entre les communautés et l’acteur public • Mairie de Barcelone a créé des infrastructures qui permettent aux citoyens d’entrer dans la gouvernance de la ville QUI Projets« C’est très tendance de prétendre qu’on va sauver le monde quand on est un acteur privé » ; « On a besoin de cette innovation mais cela ne doit pas être un prétexte pour pour détricoter la gouvernance de la ville, à ne pas mettre toutes les parties prenantes autour de la table, à faire participer tous les habitants » Pour une donnée ouverte d’intérêt générale Intérêt général • Dans le cas d’une commande publique : faire évoluer la loi pour une République Numérique et obliger toutes les entreprises qui fournissent des services publics (même celles qui ne sont plus détenues par l’Etat) à partager les données liés à l’usage des service en open data • Dans le cas d’une commande privée (service bottom-up) : encourager l’open data et la mise en commun (gratuite) des données en insistant sur ses bénéfices La vraie question lorsqu’on s’interroge sur l’intérêt général c’est : • la gouvernance : elle doit être participative, inclusive • la répartition de la valeur : elle doit être partagée De ce point de vue là les associations et les coopératives sont des modèles intéressants Evolution de l’intérêt général dans les 10 années à venir : l’intérêt général est dépendant d’une vision politique. On risque de se diriger vers des modèles conservateurs avec une forte recentralisation du pouvoir qui favorise les intérêts privés des proches du pouvoir 26 DataCités-CC-BY-SA
- 27. Fiche expert - Isabelle Pellerin Isabelle Pellerin est élue et vice-présidente déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l’innovation à Rennes Métropole. Isabelle Pellerin a mis en place il y a deux ans un comité de pilotage pour pallier à l’absence de délégation à la donnée. ● Rennes souhaite mettre en place un service public de la donnée avec une gouvernance partagée (élus, techniciens, acteurs économiques, associations, régions) ● RennesGrid ● Smart Saint Sulpice QUI Projets“ll faut rester vigilant sur l’utilisation de la donnée. Je compare cela à la recherche clinique. Le citoyen doit savoir comment sa donnée est utilisée, pourquoi, combien de temps. Il sait pourquoi il donne un peu de lui même.” Le rôle de l’acteur public vu par Rennes Métropole ● Intérêt général : L’acteur public demeure le garant de l’intérêt général. Il représente les citoyens grâce à des représentants élus. ● Alliances stratégiques & rôle de l’acteur public : même si de nouvelles alliances s’opèrent, l’acteur public peut jouer le rôle de tiers de confiance, garantir l’interopérabilité de la donnée et s’assurer de l’acceptation par le citoyen de l’utilisation de ses données ● Rôle des individus : la ville doit jouer un rôle de sensibilisation de ses habitants aux enjeux de la donnée. ● Gestion des données : Rennes reste propriétaire de ses données et en gère l’accès. Rennes revendique la donnée comme un bien commun. Si elle génère de la valeur, elle doit être redistribuée. L’enjeu clé ● Passage d’un projet d’expérimentation local à un déploiement pérenne à plus grande échelle (les enjeux sous-jacents : statut juridique, gouvernance, modèle économique et confiance) 27 DataCités-CC-BY-SA
- 28. Fiche expert - Francis Jutand Le concept de loyauté c'est dire que face à la complexité l'important est d'assurer la confiance entre ceux qui échangent. La valeur sur laquelle on peut créer la confiance, c'est la loyauté. La loyauté revient à donner ses intentions ; et à en rendre compte. La loyauté est importante car aujourd'hui on fait face à une intensification des capacités d'échange, d'argumentation, de discussions effrénées. Le rôle de l’acteur public est d’exiger la loyauté pour éviter la monopolisation des services d’utilité publique par des acteurs comme Waze qui renversent le rapport de force entre acteur public et acteur privé. La justiciabilité. La loyauté est un concept opposable en justice y compris dans le droit anglo-saxon. C'est important de se doter de moyen de contrôle. Directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télecom, Francis Jutand est également l’auteur du rapport sur l'ouverture des données de transport et l’instigateur da la notion juridique “donnée d’intérêt général” “Ils pourraient acheter les données des collectivités. Le troc a l’avantage pour Waze d’éviter de poser la question de la valeur. La démarche de Waze c’est une démarche en trois étapes avec augmentation de la domination par alliances tout en gardant le contrôle de ce qui est fait.” QUI A propos de Waze“L'intérêt général, c'est l'affrontement entre les intérêts d'un ensemble et les intérêts d'individus. La donnée intensifie tous les mécanismes qui président à la construction des "intérêts" : général, particulier, communautaire, individuel. L'irruption de la donnée conduit à une énorme accélération du concept d’intérêt général “ Le concept de loyauté 28 DataCités-CC-BY-SA
- 29. Fiche expert - Jean-Luc Sallabery Jean-Luc Sallabery est responsable du département numérique à la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies). La FNCCR fait valoir, aux niveaux national et européen, le point de vue de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des entreprises concessionnaires (eau, déchets, etc.) ● GIP ATGERI en Aquitaine : mise en place d’une régie de données, à l’origine des données de cartographie puis mélangée aux des données de la filière bois ● Projet SMILE : projet smartgrid en Bretagne ● Projet Pride : plateforme de gestion des données QUI Projets “Il n’y a pas de propriété sur les données, il y a que de l’usufruit. Un usufruit pour celui qui recueille les données”, Jean Luc Sallabery plaide pour un usufruit d’intérêt général. La FNCCR préconise le modèle d’un acteur public médiateur de la gestion des données (données publiques et privées) ● Il préconise une structure de gestion de données, à la maille régionale. Les enjeux stratégiques de développement et la cartographie sont des enjeux régionaux. ● Cette structure doit être ouverte. Toutes les collectivités territoriales doivent pouvoir y adhérer quel que soit leur niveau. ● Cette structure doit fonctionner grâce à une convention de mise à disposition des données du secteur privé vers le secteur public ● L’acteur public doit jouer un rôle de tiers de confiance pour des questions de neutralité et pour s’assurer que les données des privés ne soit pas communiqués à leurs concurrents 29 DataCités-CC-BY-SA
- 30. Fiche expert - Stéphane Vincent Stéphane Vincent est délégué général de la 27e Région, laboratoire de transformation publique. Cette association indépendante épaule les collectivités territoriales désireuses d’améliorer leurs services au public. au travers de programmes expérimentaux. QUI Projets “C’est en effet plus compliqué de produire de l'intérêt général dans ce nouveau contexte. Cette rupture numérique appelle du temps, serons-nous à temps ? “ ● Un laboratoire d’innovation au Danemark réfléchit à la conception de son service et aux usages avant de passer commande ● GIP e-Bourgogne : plate-forme électronique de services dématérialisés ● Bologne et sa charte des communs Constats Stéphane Vincent plaide pour un schéma directeur des usages. Il déplore un manque d’adaptation culturelle des collectivités au numérique. Le numérique impose de passer d’une culture de gestion à une culture servicielle, basée sur les usages. Les administrations cède à la facilité en acquérant et en administrant des produits sur étagère alors qu’elles devraient concevoir des services adaptés aux usages de leurs territoires. ● Élaborer un schéma directeur des usages puis en fonction, ensuite construire un schéma directeur des rôles des acteurs publics et intégrer le numérique dans des documents d'urbanisme, d'aménagements territoriaux type SRADDT ● Créer des "capsules-laboratoire" pour développer une vision plus systémique, plus agile des choses (cf. Etalab) ● Encourager la posture du citoyen actif en inscrivant cette dimension dans un projet politique ● Créer des écosystèmes locaux, favoriser la coopération entre les territoires Idées d’ évolution 30 DataCités-CC-BY-SA
- 31. Fiche expert - Philippe Tessier Philippe Tessier est directeur de projet énergie et environnement à l'UGAP (Union Générale des Achats Publics et aussi animateur du groupe « Energie Climat » de l’AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France). La vision de Philippe Tessier sur les évolutions à venir dans le secteur de l’énergie : ● Gestionnaires de réseaux : un marché assez stable car réservé à des délégataires en situation de monopole qui sont peu mis en danger par les collectivités ● Fournisseurs d’énergie : segment de marché qui devrait être le plus impacté par le numérique grâce à la mise en place de compteurs communicants ○ Nouveaux services : autoconsommation, crowdfunding, plateformes d’achats groupés ○ Nouvelles offres : TURP (Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité) ou de MDE (Maitrise des dépenses énergétiques). ○ Nouvelle tarification : Engie a par exemple sorti une offre « 30% moins cher le week-end Philippe Tessier observe un changement de point de vue de la part des fournisseurs en faveur de l’ouverture données depuis la loi de transition écologique et croissance verte. ● En Belgique, les collectivités font la promotion des groupements d’achat entre particuliers en s’appuyant sur des plateformes numériques d’achat groupé comme Wikipower ● En France, l’UFC Que Choisir joue un rôle similaire QUI Projets “Le garant de l’intérêt général, c’est quand même bien l’acteur public, c’est son mandat. Après, que des acteurs privés y participent, c’est clair, notamment dans les DSP. Veolia remplit une mission d’intérêt général.” 31 DataCités-CC-BY-SA
- 32. Fiche expert - Dominique Cardon Sociologue et anthropologue, Dominique Cardon est professeur au Médialab (SciencesPo). Il s’intéresse particulièrement à l’usage et à l’appropriation du big data par les individus. ● Le sociologue Antonio Casilli propose de fiscaliser les grandes entreprises du numérique pour rémunérer les données des usagers. ● Étalab porte une nouvelle vision de l’organisation de l’État (“plateforme”, “start-up”), qui s’inscrit plus largement dans la réforme numérique de l’administration (CAE). QUI Projets “Les acteurs privés ont une vision complètement individualisée de l'intérêt de chaque individu. L'idée d'une collectivité d'ego est complètement absent de la conception de l'Etat.” Une crise de l’intérêt général Dominique Cardon souligne que les communs sont propres à une communauté, et à ce titre ils ne servent pas nécessairement l’intérêt général. Cependant, le monopole légitime de l’ État dans la définition de l'intérêt général et son rôle de dépositaire garant sont de plus en plus contestés par les transformations de nos sociétés (complexification, individualisation), la perte de confiance dans les institutions, les manquements de l’État. ● Les individus pourraient être dépositaires de valeurs plus respectueuses des conditions d'universalité de l'intérêt général que les institutions. ● Vers un État plateforme : implication des citoyens dans la définition, voire l’organisation et la gestion des politiques publiques. Mise à disposition par l’État de systèmes d’appariements pour que les individus auto-organisent ou assurent en partie le service public. ● Rétribution de celui qui donne ses données -- monétairement ou non -- nécessaire mais difficile à mettre en œuvre car elle ne vaut rien tant qu’elle est individuelle et brute. Idées d’ évolution 32 DataCités-CC-BY-SA
- 33. Fiche expert - Olivier Duhagon Olivier Duhagon est directeur de la région Pays de la Loire chez Enedis, entreprise à la fois nationale et locale. Il est responsable de la mise en place du compteur Linky. ● Le compteur Linky, dont la mise en place s’étale jusqu’en 2021, mesure et transmet automatiquement la consommation d’énergie. ● Enedis ambitionne de devenir garant du respect des contrats sur une plateforme d’échanges de données d’ énergie entre producteurs et acheteurs. QUI Projets “Enedis passe de la gestion de réseau à la gestion de systèmes : facilitation et mise en oeuvre des énergies renouvelables, mise à disposition des données de consommation.” Pour le maintien et la modernisation des missions de service public ● Les missions de service public permettent de garantir l’universalité du service. Les entreprises titulaires de missions de service public sont concurrencées par des nouveaux acteurs ; elle doivent se moderniser en conséquence ; mais cela ne doit pas signifier la fin des missions de service public. ● La mission de service public devrait s’enrichir d’un volet de gestion des données, à travers une plateforme. ● Enedis serait tiers de confiance dans la transaction entre l’acheteur des données et l’individu qui les produit. Il garantirait que le producteur des données est consentant pour la diffusion et l’utilisation qui en sont faites. 33 DataCités-CC-BY-SA
- 34. Fiche expert – Brett Goldstein Entrepreneur et investisseur, spécialiste des questions de criminalité, Brett Goldstein a été l’un des premiers CDO (Chief Digital Officer) d’une grande ville aux US (Chicago, en 2011), où il a mis en œuvre une politique d’Open Data ambitieuse. Il est désormais professeur à l’Université de Chicago ● Il a mis en place le premier outil d’assistance prédictive pour les forces de police, à Chicago ● La plateforme de supervision et d’Open Data qu’il a lancée, WindyGrid devenue OpenGrid, est primée, Open Source et reprise par d’autres villes QUI Projets “Une ville veut prévenir les problèmes avant qu’ils n’arrivent car c’est une mauvaise expérience pour les citoyens, et plus coûteux. La donnée permet d’apporter des réponses spécifiques et localisées à chaque problème” Une communauté autour des données Le secteur public est riche en données. Comment faire mieux que mettre à disposition des données brutes et statiques ? Il vaut mieux utiliser des données imparfaites que pas de données, et cela permet de les améliorer => Utilisez vos propres données ! Les données permettent de personnaliser les politiques publiques Beaucoup d’acteurs privés sont prêts à contribuer avec des données, du temps, des compétences. Parfois ce sont des relations publiques, parfois un désir de contribuer à la communauté. Ce qui compte c’est tout le positif que l’on peut en tirer en faveur du bien commun. En acceptant que ce n’est pas parfait tout de suite, qu’il faut améliorer Le CDO peut travailler avec le directeur des achats pour s’assurer que chaque appel d’offres traite les données comme il faut. Il faut une volonté politique du maire Investir dans les IHM pour toucher les utilisateurs de données non experts Le passage d’une approche « matière première » à un « patrimoine stratégique » est critique pour les acteurs publics aussi bien que privés Approche transversale portée par les dirigeants 34 DataCités-CC-BY-SA
- 35. Fiche expert – Javier Creus Javier Creus est le fondateur d’Ideas for Change, qui développe des projets à impact sociétal en mobilisant les citoyens et en utilisant des technologies Open Source. Ideas for Change a notamment développé « l’approche de Bristol » ● « L’approche de Bristol », une méthodologie déclinée dans plusieurs villes, Bristol et Barcelone en particulier ● Son nouveau projet Salus.coop est très ambitieux dans le domaine des données personnelles de santé QUI Projets “Les acteurs privés ont une vision complètement individualisée de l'intérêt de chaque individu. L'idée d'une collectivité d'ego est complètement absent de la conception de l'Etat.” Les citoyens au centre • Les citoyens comprennent mal la valeur des données, ce qu’ils peuvent en faire, et comment les contrôler aujourd'hui, au-delà de cercles militants/avertis • L’approche de Bristol démontre que l’on peut travailler avec les citoyens pour découvrir / qualifier les problèmes locaux • Des solutions IoT Open Source pour générer de la donnée, par les citoyens, et discuter avec les élus sur la base de ces données • D’abord, remettre les données entre les mains du citoyen, et lui fournir de l’information • L’inciter à partager volontairement, de manière éclairée (ex : données de santé pour la recherche) • Fournir les outils techniques, ouverts, si possibles décentralisés, pour maîtriser la donnée, ne pas dépendre d’un silo ou une solution technique particulière • Accompagner le processus pour faire dialoguer citoyens, élus et techniciens autour de la donnée Principes de fonctionne ment d’un commun Data 35 DataCités-CC-BY-SA
- 36. Fiche expert – Jean-Marc Lazard Jean-Marc Lazard est le fondateur d’OpenDataSoft. Il a une grande expérience de l’ouverture des données publiques et de leurs modalités. • Son entreprise OpenDataSoft, basée en France, est désormais internationale • OpenDataSoft vient de lancer un partenariat avec Waze pour faciliter les échanges de données de tous ces clients avec cet acteur QUI Projets “La vision de la Smart City très programmatique a vécu, du moins en Europe. On est passé à une vision agile basée sur l’observation quantitative et l’auto-évaluation par les villes” Une crise de l’intérêt général La régie de donnée, cela a beaucoup de sens, il faut éviter la centralisation à chaque échelle, utopique. La « plateforme unique », difficilement réalisable et opérationnelle Aux US les données sont très fragmentées entre services et niveaux de gouvernement indépendants => l’Open Data, un choix de rationalisation / efficacité, y compris interne La mise en qualité des données, leur amélioration continue, c’est essentiel. Les ouvrir, cela oblige à enclencher ce processus Pour un bâtiment, un quartier, une ville, assurer l’interopérabilité des données, l’accessibilité et la transférabilité : les villes doivent fixer les règles et s’assurer que les outils existent Des acteurs comme RTE / GRT Gaz mutualisent leur plateforme, pour capitaliser sur les données de l’énergie à plusieurs La technologie est de plus en plus une « commodité » (remise en cause chaque année), donc une plateforme ne doit pas être liée à une solution Aux US les villes expriment collectivement au marché leurs besoins, leurs ambitions Alliances entre acteurs de la ville 36 DataCités-CC-BY-SA
- 37. Fiche expert – Matt Stokes Chercheur chez NESTA, Matt Stokes est responsable du projet DSI (Digital Social Innovation). Il a une connaissance approfondie de nombreux projets exploitant la technologie et les données pour créer de l’impact sociétal ● Le projet Digital Social Innovation, qui arrive à sa conclusion. Nous avons publié un article sur ce sujet QUI Projets “Pour les citoyens contributeurs, il faut distinguer ce qu’ils produisent et comment, de ce qu’ils en retirent, qui n’est pas forcément financier, et qui fonde le modèle de contribution » Intérêt général et impact social L’intérêt général se confond-il avec l’impact sociétal des projets ? Les projets d’innovation sociale (DSI) se heurtent à 4 barrières : • Compétences numériques des citoyens, • Le financement, car les grandes entreprises sont plus adaptées aux processus d’achat complexes (marchés publics) • Le secteur public a peur de perdre en pouvoir ou contrôle • La sécurité des données personnelles • Il y a un manque de coopération entre acteurs de l’ESS ou DSI (Digital Social Innovation). Les acteurs privés sont mieux organisés, ont plus de soutien (startups, entrepreneurs, industriels) • Attention, les modèles de financement par le secteur public peuvent masquer une dépendance et un manque de maîtrise des modèles Open Source / Open Data soutenables • Problème de fond des outils numériques et des données : préservent les inégalités existantes, sans forcément les aggraver, mais sans les réparer. Comment faire mieux ? Comment faire croître les projets d’intérêt général ? 37 DataCités-CC-BY-SA
- 38. Fiche expert – Tom Symons Chercheur chez NESTA, Tom Symons est responsable du projet DECODE, projet européen mené en coopération avec les villes de Barcelone et Amsterdam, pour remettre les citoyens en contrôle de leurs données personnelles. ● Le projet DECODE veut redonner aux individus la maîtrise de leurs données personnelles QUI Projets “Les villes visionnaires s’intéressent aux données personnelles pour l’engagement citoyen, de nouveaux processus démocratiques et construire une nouvelle forme de Smart City” L’acteur public et le citoyen • Beaucoup de nos travaux démontrent le potentiel de coopération entre les villes, les acteurs privés et des ONG. Les données personnelles c’est un sujet nouveau • Aujourd’hui les partages de données personnelles (anonymisées) passent par les opérateurs telco/transport. Comment passer à un « contrôle démocratique des données » ? • Nous constatons l’intérêt des citoyens. Quand on leur donne le choix ils ouvrent volontairement des données très personnelles (localisation, comportements) s’ils en comprennent le sens • Certaines villes comme Barcelone font beaucoup d’innovation sociale grâce à de nombreux contributeurs actifs, volontaires et engagés • Les contributions « passives » sont aussi très importantes : il faut travailler le design pour rendre la contribution intuitive. On surestime ce que l’utilisateur est prêt/capable de faire • Il faut privilégier l’engagement volontaire mais que la contribution de données soit aussi peu intensive que possible L’engagement des contributeurs 38 DataCités-CC-BY-SA
- 39. Fiche expert – Danny Lämmerhirt Chercheur chez Open Knowledge International, Danny a mené plusieurs projets qualifiant et recensant des initiatives à travers le monde où des données sont générées par les citoyens pour résoudre des problèmes sociétaux Global Open Data Index, observatoire des politiques d’Open Government dans le monde « Data and the City: How can public Data infratructure change lives in urban regions. » QUI Projets “Il y a de nombreuses recherches sur les partenariats entre gouvernement et communautés, pour ” Les alliances • Se rappeler que la Data n’est pas neutre, son sens est variable selon le contexte • Qui fournit « l’infrastructure de la Data » ? Qui initie le projet ? Quels sont le contexte et la gouvernance ? Cela définit un projet de crowdsourcing, partage ou ouverture de données • L’alliance entre ONG/associatif et secteur public semble naturelle pour l’intérêt général, mais parfois elle échoue car intérêts divergents • En revanche là où le gouvernement est faible, la donnée permet à des acteurs de la société civile d’agir ensemble et soutenir l’Etat dans ses missions • Il y a la phase de collecte où l’utilisateur peut être impliqué : et ensuite ? Waze s’arrête, d’autres projets utilisent la donnée pour construire des projets avec l’utilisateur, avec la ville (Living Lots NYC) • Les individus s’impliquent soit contre rémunération (Mechanical Turk), soit parce qu’ils s’approprient un problème à résoudre, ils bénéficient de leur propre action Rôle des contributeurs 39 DataCités-CC-BY-SA
- 40. Fiche expert – Laurent Schmitt Secrétaire Général de ENTSO-E, l’association européenne des gestionnaires de réseaux de transport électrique (équivalents à RTE en France), Laurent travaille sur l’usage des données pour le système électrique, en lien avec les Smart Cities • NTSO-E a développé la Transparency Platform qui centralise les informations sur les réseaux électriques à l’échelle européenne • ENTSO-E coordonne et stimule les efforts de tous ses membres (réseau de transport d’électricité) dans les coopérations autour de la donnée QUI Projets “Les villes représentent des communautés, elles jouent un rôle de broker qui facilite l’intelligence des citoyens et l’action des acteurs privés pour offrir les bonnes solutions” Le jeu d’acteurs dans l’ énergie • L’énergie est touchée par la transition sur les modèles de données, mais lentement car ce sont de grosses infras • On peut distinguer d’abord les acteurs privés qui construisent la ville, ceux qui construisent les bâtiments, ou les acteurs du numérique (Nest), ceux qui proposent des services de réseau (batteries pour du trading énergétique) • Les acteurs traditionnels du réseau produisent de la donnée et la diffusent pour les besoins du marché de l’énergie. Plus on se rapproche du compteur individuel, plus la donnée est personnelle • Les villes sont du côté des « communautés » vu de l’énergéticien, dans un rôle de broker qui peut agréger des besoins, faire le relais avec les individus • Elles pourraient développer le positionnement de tiers de confiance autour des données, faciliter la portabilité, éviter les lock-in avec une technologie ou un acteur privé • Ville peut libérer des données, notamment à l’échelle du bâtiment ou du quartier, car elle a le pouvoir de négociation nécessaire • L’alliance avec les acteurs technologiques comme ESRI est un sujet important dans l’énergie Idées d’ évolution 40 DataCités-CC-BY-SA
- 41. Fiche expert – Enrique Dans Professeur d’innovation et de transformation digitale à l’IE Business School, Enrique Dans travaille sur les enjeux de l’Intelligence Artificielle et de services exploitant des données. Il est aussi conseiller auprès de startups de ces secteurs d’activité, et travaille sur les modèles économiques qui en dérivent ● Les algorithmes de « Machine learning » et leurs conséquences sur les modèles économiques ● Publication quotidienne de cas d’études sur son blog (anglais) QUI Projets “Madrid a une politique qui exige des opérateurs de services urbains de partager leurs données. Et ils la font respecter” Les alliances pour l'innovation • Bien comprendre la logique derrière les alliances, c’est le plus intéressant souvent. Les acteurs publics ne peuvent favoriser un acteur donc prennent des mesures générales, équitables • Les villes de toute taille organisent des hackhathons en Espagne, c’est populaire, pour résoudre des problèmes locaux • Dans la gestion de déchets l’IA est appliquée pour prédire le remplissage des poubelles et adapter les tournées • La multiplication des capteurs jusque dans nos poches (smartphone) joue un rôle déterminant • Waze a eu un positionnement de pionnier dans le crowdsourcing de sa cartographies => rachat par Google problème de légitimité potentielle. Doivent donner des gages d’intégrité • Telefonica est un opérateur téléphonie réputé pour la gestion des données, qui les vend de manière traditionnelle. Mais ils se positionnent avec une plateforme Aura pour redonner la maîtrise de leurs données à ses clients Données personnelles 41 DataCités-CC-BY-SA
- 43. Jeu d’acteurs - trois scénarios principaux Scénario de monopolisation des services Scénario de centralisation des données ● Des intermédiaires en situation de domination qui stockent, gèrent et analysent les données, tout en les monétisant. ● Des acteurs privés qui proposent des services urbains et impactent la vision des politiques urbaines, à l’image des supermarchés et centres commerciaux il y a quelques décennies. ● Le plus probable, il se développe rapidement. Déjà à l’action dans plusieurs secteurs (agriculture, distribution, mobilité…). ● Une centralisation des données en biens communs. ● Une régulation des services mis en place. ● Des législations fortes pour obliger les acteurs privés à mettre les données d’usage en opendata lorsqu’il s’agit d’une commande publique. ● L’absolu nécessaire pour éviter le scénario de dépendance. SCÉNARIO RISQUÉ SCÉNARIO SOUHAITÉ Scénario de gestion collaborative SCÉNARIO SOUHAITÉ ● La création de services se fait par des acteurs privés et communautaires (associatifs…). ● Des communs sont créés sur les territoires (pas uniquement des données). ● Les acteurs de l’ESS jouent un rôle essentiel. ● L’idéal en termes d’équilibres entre les catégories d’acteurs et de gestion collaborative de l’intérêt général. Deux scénarios à joindre. 43 DataCités-CC-BY-SA
- 44. Le rôle de l’acteur public ● Un combat est à mener par les acteurs publics contre les acteurs privés dominants qui cherchent à imposer leurs services et leur vision des politiques territoriales. Objectif principal Rôles attendus ● Les acteurs publics sont avant tout des investisseurs. ● Ils agissent aussi par la régulation et doivent notamment se positionner en “garde-fou” pour préserver la vie privée des individus et garantir la cybersécurité. ● Les collectivités doivent animer un écosystème d’acteurs pour faire émerger des innovations et pour inciter les acteurs à mettre leurs données en opendata même quand il s’agit d’une commande privée. Ils sont médiateurs, incitateurs... ● Dès lors qu’il s’agit d’une commande publique, il faudrait obliger les acteurs privés à reverser les données en opendata (réutilisables). ● Passer d’une logique de gestion des services publics à une logique partenariale et servicielle, ce qui suppose de changer de culture et de sortir des organisations en silo. ● Passer d’une administration où l’on choisit les services sur étagère sans stratégie globale, à une logique d’expérimentations et de prescription par les collectivités des services attendus qui garantissent l’intérêt général. Changements nécessaires Moyens identifiés ● Intégrer la dimension numérique dans les schémas d’aménagement du territoire ou encore les schémas de transition écologique et créer des schémas régionaux d’information et d’accès aux données. ● Créer des living labs des biens communs sur les territoires. ● Protéger les communs par la loi, l’entrée dans le capital, les impôts, etc. ● Créer un acteur public de la gestion des données, capable d’interagir avec toutes les échelles territoriales. 44 DataCités-CC-BY-SA
- 45. Deux points de vue complémentaires de l’intérêt général Centré sur la puissance publique Structuré autour de communautés et d’instances d’intérêts privés ● Ce sont les acteurs publics qui sont garants de l’intérêt général. ● Ils représentent les individus qui les ont élus. ● Ils assurent la gouvernance de l’intérêt général. ● L’intérêt général est la résultante d’une confrontation entre des intérêts individuels et les intérêts d’un ensemble. ● L’intérêt général se structure au sein de communautés et aussi d’acteurs privés, les entreprises. ● Lorsque l’acteur public faut dans sa vision de l’intérêt général, les communautés prennent la relève et le redéfinissent. ● Les acteurs privés proposent des services qui sont de l’intérêt de ceux qui les utilisent. Ce n’est pas de l’intérêt général pour autant. 45 DataCités-CC-BY-SA
- 46. Les différences entre les secteurs de la mobilité et de l’ énergie Energie ● Dans les pays où l’énergie est peu chère, mobiliser les individus est difficile dans la mesure où l’accès à l’énergie n’est pas une contrainte. ● L’implication des individus est plus forte dans les pays où l’accès à l’énergie est discontinu. Mobilité ● Les individus s’impliquent aisément dans le secteur des mobilités dans la mesure où c’est une contrainte quotidienne et la première source de revenus. L’implica- tion des individus L’implica- tion des startups ● Pour que les nouveaux entrants créent des services, il est nécessaire de les accompagner en raison de la complexité technique du fonctionnement du réseau. ● Les startups créent de nombreux services car il est facile de se mettre à la place des usagers et d’identifier leurs besoins. ● Une couche servicielle déjà en place, un marché à structurer. ● Une couche servicielle à construire, sachant qu’on va vers un modèle où les individus vont payer pour un service et non plus pour l’énergie elle-même. Un marché à inciter et à construire. Le développe- ment de services Structura- tion ● Modèle jacobin en France, descendant. ● Modèle collaboratif dans les pays du Nord ou dans les pays émergents. ● Modèle ouvert. 46 DataCités-CC-BY-SA
- 48. Définition Qu’est-ce qu’un facteur critique ? Les démarches de prospective opérationnelle s’appuient sur un ensemble de paramètres appelés facteurs critiques qui conditionnent le futur du champ étudié. Ces facteurs peuvent être caractérisés par une “situation historique” - c’est-à-dire la manière dont ils ont évolué jusqu’à aujourd’hui - mais leur évolution à venir relève par définition d’incertitudes, d’autant plus fortes que l’horizon est lointain. Le travail de prospective consiste alors dans un premier temps à envisager des hypothèses d’ évolution. Comment repérer les facteurs critiques ? Il s’agit d’identifier, à partir d’une base de connaissances, les facteurs jugés les plus sensibles et stratégiques pour le champ étudié à l’échelle déterminée. La sélection de ces facteurs implique des experts / professionnels connaisseurs des problématiques concernées. Cette mobilisation d’acteurs est d’autant plus nécessaire que les scénarios d’évolution des facteurs critiques sont incertains et doivent donc faire l’objet de choix pour construire une vision d’avenir partagée par les parties prenantes. Résultat visé Le repérage de facteurs critiques, la sélection des facteurs les plus sensibles pour le champ concerné, puis la formulation de perspectives d’évolutions possibles constituent un outil mobilisable en atelier prospectif pour permettre aux parties prenantes du projet de formuler une vision prospective des besoins à satisfaire et d’identifier des pistes d’offres et de solutions innovantes. La planche 4 propose le rubricage retenu pour expliciter les facteurs critiques. Les fiches facteurs critiques sont réparties sur trois planches pour plus de lisibilité. 48DataCités - CC-BY-SA
- 49. Titre du facteur critique Description Historique Situation actuelle Qualification du facteur Dynamique du facteur Maturité du facteur Impacts sur les modèles alternatifs Définir le facteur et son périmètre, ses caractéristiques > Cette rubrique donne une idée de l’ampleur du facteur et donc de en quoi il impacte potentiellement le projet. Des faits, des chiffres, des observations… le tout à des périodes passées > Cette rubrique donne une idée de dynamique du facteur (inertie/rythme de l’ évolutibilité). Le niveau du facteur aujourd’hui, son état de force ou de maturité > Cette rubrique donne une idée de la maturité du facteur (germe, émergence, croissance, maturité, déclin…). Tendance lourde ou tendance émergente / germe de changement / incertitude (crise, risque) Inertie + ou ++ ou +++ (donc lent) Evolution + ou ++ ou +++ (donc rapide) Naissant, croissant, à maturité, en déclin, en voie de disparition Fort/moyen/faible sur tel ou tel moyen (un aspect peut être fort, un autre faible) 49 DataCités-CC-BY-SA
- 50. Facteurs critiques étudiés dans Datacités Facteurs technologiques ● La montée en charge de la blockchain ● L’APIfication au sein des entreprises Facteurs législatifs ● L’évolution des lois autour du numérique, à l’échelle européenne et nationale ● L’intégration du numérique dans les schémas d’aménagement du territoire et autres schémas de planification Facteurs collaboratifs ● L’implication des acteurs de l’ESS ● L’implication citoyenne Facteurs économiques ● Le modèle freemium ● Les coûts liés à la production et à l’exploitation des données Facteurs liés à la gouvernance et à la gestion des données ● La montée des acteurs intermédiaires qui stockent, gèrent et analysent les données ● La centralisation des données publiques en bien commun Facteurs politiques ● La nouvelle donne politique mondiale (Trump, Brexit, etc.) Facteurs culturels ● L’adaptation culturelle des collectivités au numérique et à la donnée DataCités-CC-BY-SA
- 51. www.datacités.eu ANALYSE DES ENTRETIENS D’EXPERTS 18 AVRIL 2017 CC-BY-SA
