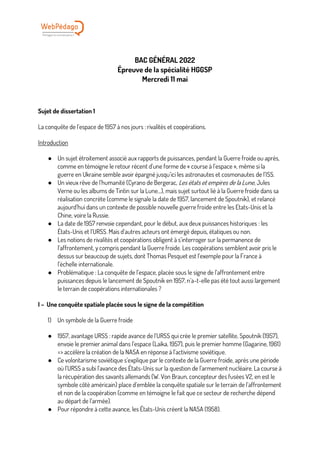
bac 2022 correction HGGSP jour 1
- 1. BAC GÉNÉRAL 2022 Épreuve de la spécialité HGGSP Mercredi 11 mai Sujet de dissertation 1 La conquête de l’espace de 1957 à nos jours : rivalités et coopérations. Introduction ● Un sujet étroitement associé aux rapports de puissances, pendant la Guerre froide ou après, comme en témoigne le retour récent d’une forme de « course à l’espace », même si la guerre en Ukraine semble avoir épargné jusqu’ici les astronautes et cosmonautes de l’ISS. ● Un vieux rêve de l’humanité (Cyrano de Bergerac, Les états et empires de la Lune, Jules Verne ou les albums de Tintin sur la Lune...), mais sujet surtout lié à la Guerre froide dans sa réalisation concrète (comme le signale la date de 1957, lancement de Spoutnik), et relancé aujourd’hui dans un contexte de possible nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine, voire la Russie. ● La date de 1957 renvoie cependant, pour le début, aux deux puissances historiques : les États-Unis et l’URSS. Mais d’autres acteurs ont émergé depuis, étatiques ou non. ● Les notions de rivalités et coopérations obligent à s’interroger sur la permanence de l’affrontement, y compris pendant la Guerre froide. Les coopérations semblent avoir pris le dessus sur beaucoup de sujets, dont Thomas Pesquet est l’exemple pour la France à l’échelle internationale. ● Problématique : La conquête de l’espace, placée sous le signe de l’affrontement entre puissances depuis le lancement de Spoutnik en 1957, n’a-t-elle pas été tout aussi largement le terrain de coopérations internationales ? I – Une conquête spatiale placée sous le signe de la compétition 1) Un symbole de la Guerre froide ● 1957, avantage URSS : rapide avance de l’URSS qui crée le premier satellite, Spoutnik (1957), envoie le premier animal dans l’espace (Laïka, 1957), puis le premier homme (Gagarine, 1961) => accélère la création de la NASA en réponse à l’activisme soviétique. ● Ce volontarisme soviétique s’explique par le contexte de la Guerre froide, après une période où l’URSS a subi l’avance des États-Unis sur la question de l’armement nucléaire. La course à la récupération des savants allemands (W. Von Braun, concepteur des fusées V2, en est le symbole côté américain) place d’emblée la conquête spatiale sur le terrain de l’affrontement et non de la coopération (comme en témoigne le fait que ce secteur de recherche dépend au départ de l’armée). ● Pour répondre à cette avance, les États-Unis créent la NASA (1958).
- 2. 2) Une rivalité qui devient le symbole de la Détente, entre rivalité et esquisses de coopérations. ● Après la crise de Cuba (1962), Détente et déplacement de la compétition sur d’autres terrains : l’objectif devient la Lune. ● Volonté de « concilier la réalité de la compétition avec l’impératif de la coexistence » (H. Kissinger) : signature du traité de l’espace en 1967 pour fixer règles du jeu (non militarisation, non appropriation...). ● Rattrapage rapide des USA, avec premier homme sur la Lune en 1969 (programme Apollo, N. Armstrong). ● Mais arrêt des ambitions : Von Braun démissionne en 1970 à cause du refus de la NASA de lancer le programme vers Mars au profit du développement des navettes. L’URSS abandonne le projet lunaire. ● La reprise de la Guerre Froide (« guerre fraîche », 1975-1985) ne relance pas forcément la compétition : poursuite de la Détente dans ce secteur avec programmes communs : Apollo- Soyouz, 1975 => pose les bases d’une coopération. URSS se lance dans station MIR (1986), missions vers Vénus... ● Mais le projet IDS de Reagan en 1983 accélère l’affaiblissement de l’URSS. 3) En marge de la compétition des superpuissances, l’apparition de nouveaux acteurs. ● Chine : programme spatial dès Mao, mais moins de moyens mis en oeuvre. ● 1975 : création de l’ESA, une coopération dans sa nature même (européenne) => projet Ariane, où France est leader : Ariane 1 (1981), J.-L. Chrétien premier européen dans l’espace (1982). ● Les nouveaux acteurs rejoignent facilement le traité de l’espace (France : 1970). ● Mais d’emblée, on peut dire que ces acteurs ne se situent pas dans la logique de compétition mondiale entre les deux superpuissances. Cela prépare le terrain pour l’arrivée de nouveaux acteurs sur des secteurs ciblés. II – Les limites de la coopération à l’heure des nouveaux désordres mondiaux 1) La fin de la Guerre froide et le début de coopérations multiples. ● ISS (1998) : symbole de la coopération post Guerre Froide (remplace la station Mir, propriété des États-Unis mais accueille beaucoup de nationalités) : programmes de recherche... ● Développement des programmes de l’ESA en parallèle et en coopération, sur missions complémentaires (2005 : sonde européenne sur Titan, satellite de Jupiter, 2014 : 1er atterrissage sur une comète). ● Intégration de la Russie dans ces programmes internationaux. 2) L’arrivée de la Chine et la relance de la compétition. ● Accélération des ambitions chinoises avec Xi Jinping dans le cadre du « rêve chinois » et de la volonté de devenir la première puissance mondiale. ● 2003 : premier vol habité.
- 3. ● 2019 : 1er alunissage sur face cachée de la Lune => ambitions affichées sur la Lune, dans une démarche assez éloignée du traité de l’espace (esprit d’appropriation des ressources). ● 2021 : lancement de la construction d’une 3e station, chinoise (avec Russes : retour des rivalités). 3) L’irruption de nouveaux acteurs : un approfondissement des coopérations ou un retour des rivalités ? ● Nouveaux acteurs, nouvelles ambitions : de nouvelles puissances se lancent dans la course à l’espace comme l’Inde… ● …mais aussi acteurs privés qui prennent en charge des missions jusque là assurées par agences publiques : Blue Origine, Space X envoient des astronautes rejoindre l’ISS en 2020. Ils ont aussi leur propre agenda : tourisme spatial, rejoindre Mars (comme la Chine). ● Entre l’irruption de ces nouveaux acteurs et le renforcement dans les années 2010 des tensions entre Chine et USA qui annoncent une nouvelle Guerre froide, nous assistons à une militarisation de l’espace : création d’un commandement spécifique aux USA et en France, incidents réguliers à l’occasion de destruction par missiles de satellites, présentés comme nécessaires mais qui peuvent être vus comme des démonstrations de force. Conclusion ● Un espace d’abord de compétition, devenu pendant une vingtaine d’années un espace de coopération qui a permis la création de l’ISS. Mais à chaque fois que les tensions montent sur terre, elles ont tendance aussi à monter dans l’espace. Intégrer un paragraphe d’ouverture est facultatif, mais le sujet permet de songer à la multiplication et succès des films récents sur conquête de l’espace, qui confirment autrement le retour de ce sujet au cœur de l’actualité mondiale et des ambitions de l’humanité : Gravity, Seul sur Mars… jusqu’au premier film tourné dans l’espace fin 2021 (russe, ce qui est là aussi un symbole de la réaffirmation des puissances dans la course à l’espace). Sujet de dissertation 2 Les États-Unis et l’environnement à différentes échelles. Introduction ● Un sujet d’actualité : les relations complexes entre les États-Unis et l’environnement (compris ici comme les relations entre les sociétés et les milieux à différentes échelles), notamment après le mandat, controversé sur le sujet, du président Trump. ● Ce mandat passé a justement mis en lumière la question des échelles sur le sujet, entre un niveau fédéral où le climatoscepticisme semblait l’emporter, avec des conséquences sur la scène internationale, et d’autres échelles, locales, où les questions environnementales
- 4. demeuraient centrales : la formule d’« États-Unis » ne doit pas cacher la richesse des situations à différentes échelles. ● Mais la question des échelles peut être lue aussi à un niveau temporel : le sujet n’invite pas seulement à une réflexion contemporaine, mais impose aussi la question du temps, car les États-Unis sont pionniers sur la question depuis le XIXe siècle au moins, avec des évolutions et des paradoxes. ● Problématique : En quoi l’étude à différentes échelles des relations entre les Etats-Unis et l’environnement met-elle à jour de profonds paradoxes, dans le temps et l’espace ? I – La question environnementale aux États-Unis : une suite de paradoxes. 1) Le pays de l’environnement sanctuarisé et piétiné dès le XIXe siècle ● La notion de wilderness présente dès la fin du XIXe siècle à travers le pionniers (voir Henry Thoreau parmi les penseurs) : une nature sauvage, à préserver car sanctuaire naturel et spirituel. ● Mais dans le même temps : exploitation et révolution industrielle qui accompagnent l’extension de la frontière sur les terres des Amérindiens (réseau ferroviaire transcontinental accompagne cette avancée des pionniers). ● Ce contraste entre exploitation et admiration des espaces sauvages se traduit notamment dans l’invention des parcs nationaux, avec Yellowstone (1872). 2) Un modèle de croissance incompatible avec la protection de l’environnement au XXe siècle. ● La mise en valeur intensive du territoire au XXe siècle (voir les grands travaux du New Deal dans les années 1930, avec les barrages…) conduit à une forte exploitation des ressources naturelles. Déjà des tensions entre États voisins sur la gestion de l’eau (Californie/Arizona) apparaissent. ● Un modèle à soutenir, celui de la société de consommation (dès les années 30, plus encore après guerre) : surexploitation des ressources, recul des milieux naturels dans un pays où le sentiment d’immensité est associé à celui de ressources illimitées. ● Mais déjà des réflexes de protection à différentes échelles : ○ fédérale (création de forêts protégées et parcs nationaux sous Th. Rossevelt entre 1901 et 1909) ; ○ États (rôle de la Californie dans la prise de conscience) ; ○ acteurs privés (rôle du Sierra Club dans le Nevada). 3) Le XXIe siècle et la recherche d’une voie, entre climatoscepticisme et volonté de protection, à différentes échelles. ● Le XXIe siècle prolonge ce paradoxe, mais avec la conscience accrue d’une urgence (voir les feux de forêts en Californie, un État plutôt en pointe sur la question). ● mais le maintien d’un fort climatoscepticisme (incarné par l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016, avec par exemple la question de l’exploitation du gaz de
- 5. schiste) confirme les paradoxes de la gestion états-unienne de l’environnement : les États- Unis restent le premier pollueur mondial, malgré la montée de la Chine à ce niveau. ● Face à cela, certains États, des ONG, des citoyens cherchent à compenser en maintenant un fort engagement pour la protection de l’environnement, avec des démarches très diverses et contradictoires : la démarche des géants du numérique de la Silicon Valley (Google) n’a que peu à voir avec celle d’ONG (WWF, Greenpeace) ou de scientifiques. II – Les États-Unis et l’environnement à l’échelle mondiale : la difficulté de trouver une ligne conductrice. 1) Le pays de la prise de conscience mondiale. ● Un rôle de pionnier indéniable au XXe siècle : les premières alertes sur le climat sont largement le fait de scientifiques américains. ● À côté des scientifiques, voir le rôle des ONG, dont le siège est souvent aux États-Unis, avec des moyens et des donateurs considérables : Greenpeace, WWF… 2) Une politique internationale en « stop and go ». ● mais cette prise de conscience de l’urgence environnementale ne se traduit pas toujours au niveau fédéral et donc international. ● voir ainsi la réticence des États-Unis à engager leur signature dans des accords contraignants : accords de Kyoto 1997 non ratifiés en 2005 par G.W. Bush, retrait de l’accord de Paris en 2019 par D.J. Trump… ● l’engagement personnel de certains présidents ou vice-présidents (Al Gore, VP de Bill Clinton et ancien candidat à la présidentielle, retour de Joe Biden dans l’accord de Paris après son élection en 2020) ne peuvent masquer le fait que cette politique de « stop and go » ralentit les efforts concrets au niveau fédéral pour s’engager dans des accords internationaux avec de réels effets. Ces atermoiements peuvent même affaiblir la crédibilité des États-Unis au niveau mondial, en laissant la place à des rivaux comme la Chine. 3) Face à l’urgence, le rôle d’échelles alternatives au niveau fédéral. ● Cette politique de « stop and go » conduit à la mise en valeur d’autres échelles où se jouent les relations avec l’environnement, y compris dans une optique internationale : des États comme la Californie cherchent à compenser par leurs propres efforts les engagements non tenus à l’échelle fédérale. ● Cela peut aussi se traduire à l’échelle des villes. ● Mais cela peut aussi se voir au niveau des ONG, qui traînent en justice l’État fédéral pour utiliser des contre-pouvoirs pour tenter d’obliger l’État fédéral à honorer ses engagements. Conclusion ● Le pays des contrastes sur la question environnementale : à la fois celui qui a inventé ou presque le concept de protection de l’environnement au XIXe siècle, avec des traductions
- 6. considérables au XXe siècle dans la formation de puissantes ONG, et le plus grand pollueur au monde, avec un climatosceptique à sa tête pendant quatre ans à travers Donald Trump. La question mérite donc d’être lue à différentes échelles, d’espace mais aussi de temps, pour mieux mesurer les paradoxes de la position des États-Unis face à la question de l’environnement. Le sujet reste ouvert, tant les évolutions de ces dernières années ne permettent pas de deviner la suite, dans un contexte d’urgence de plus en plus pressante : on ne peut pas dire si les États-Unis seront leaders sur ces questions pour la suite du XXIe siècle.
- 7. Étude critique de documents : l’évolution des formes de la guerre En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos connaissances, caractérisez les différentes formes de guerres. Plan détaillé Introduction - Deux documents proposés, invitant à montrer l’évolution de la guerre depuis le XVIIIe siècle ; deux documents que tout semble opposer. - D’abord, une estampe du début du XIXe s. (après le 2 décembre 1805 en tout cas, date de la bataille d’Austerlitz opposant Napoléon Ier à une coalition, et à l’origine de la fin du Saint- Empire Romain Germanique), par Johann Laurens Rugendaz, pas autrement connu : a priori un exemple des guerres classiques, entre armées constituées, avant le XXe siècle et l’irruption de la guerre totale. - Ensuite, une analyse de 2011 par le général McChrystal à propos de l’Irak dans l’après 2003. Le général n’est pas forcément un inconnu, car il a aussi eu des commandements importants en Afghanistan, ce qui le place à la jonction des deux principaux conflits conduits par les Etats- Unis au XXIe siècle. Quoi qu’il en soit, le texte renvoie aux nouvelles conflictualités, symbolisées entre autres par l’émergence d’Al Qaida et du terrorisme international depuis la fin du XXe siècle. - Entre les deux, des évolutions de la façon de faire la guerre. Problématique : En quoi ces deux documents, de par leur éloignement, montrent-ils l’ampleur de l’évolution des formes de la guerre depuis plus de deux siècles ? - Plan détaillé ci-dessous I- Guerres régulières, guerres irrégulières : deux documents modèles ? 1) Une estampe révélatrice des formes classiques de la guerre avant le XXe siècle ? - Si l’on part de l’observation du doc. 1, on est en présence d’une façon de faire la guerre que n’aurait pas désavouée Clausewitz, le théoricien prussien de la guerre au tournant du XIXe siècle : un champ de bataille identifié (et une date, avec Austerlitz qui représente un symbole de l’affrontement entre Napoléon et la coalition des régimes européens en 1805), des armées dont on peut identifier les corps (cavalerie, infanterie, artillerie). - On semble se situer dans le cadre des affrontements classiques tels que théorisés par Clausewitz à partir de son étude des conflits depuis des siècles, dans son modèle de la « guerre réelle » : un cadre, des armées professionnelles, des règles et des ambitions limitées. - Pourtant, ne pas oublier qu’il s’agit d’une bataille des guerres napoléoniennes, et que certains détails de l’estampe peuvent annoncer la guerre moderne : la forte présence des volutes de fumée dans l’estampe suggère la montée en puissance des moyens de destruction à travers l’artillerie, déjà remarquée lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763), et qui annonce la guerre industrielle et la mort de masse de 14-18 ; la densité des effectifs présentés peut, quant à elle, marquer la nouveauté de la mobilisation de centaines de milliers de soldats non
- 8. professionnels à travers la conscription issue de la Révolution, et qui trouvera là aussi un aboutissement en 14-18, puis 39-45. 2) L’analyse d’un général américain, témoin des nouvelles conflictualités ? - A l’opposé de l’affrontement régulier présenté dans l’estampe, McChrystal témoigne d’un changement d’époque et de style avec l’avènement des guerres irrégulières au XXe siècle : l’exemple est ici la guerre d’Irak après 2003, mais la guerre d’Afghanistan (depuis 2001) peut aussi être évoquée au vu de l’auteur. - Le nouveau modèle présenté ici paraît être celui des guerres irrégulières, asymétriques : « moudjahidines étrangers ayant prêté allégeance à Oussama Ben Laden » contre « forces de la coalition », nous trouvons bien la réalité de la seconde moitié du XXe siècle, où une armée régulière affronte une guérilla (on pense à la guerre d’Indochine de 1946 à 1954, d’Algérie de 1954 à 1962, ou encore du Vietnam de 1963 à 1973). - Mais comme il s’agit d’une affiliation à Ben Laden, il s’agit aussi de la « guerre contre le terrorisme » théorisée par G.W. Bush, qui occupe le début du XXIe siècle : « Son objectif avoué consiste à faire voler en éclats le nouvel Irak en vue d’y instituer un califat ». Avec la lutte contre des guérillas communistes dans le contexte de la Guerre froide ou de la décolonisation, c’est le troisième type de guerre de la seconde moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. On notera que les guerres civiles du type « ex-Yougoslavie » ne sont pas suggérées par les documents, mais sont aussi des guerres typiques de la fin du siècle (on notera que AQI vise « le gouvernement irakien et les chiites du pays », ce qui renvoie à un contexte de guerre civile). - Le doc. 2 semble donc résumer assez bien les nouvelles conflictualités du XXe et du XXIe siècles, après les guerres régulières que semble symboliser le doc. 1. La réalité est plus complexe. II- A la croisée des documents, d’autres formes de guerres 1) La Guérilla 2.0 - C’est un modèle qui apparaît clairement dans l’analyse du doc. 2 : « Les combattants d’Al- Zarkaoui étaient bien adaptés aux régions qu’ils fréquentaient, comme Falloujah et Al-Qaim2, dans la province orientale d’Anbar, et grâce à la technologie moderne, ils entretenaient des liens étroits avec le reste de la province et du pays. Argent, propagande et information circulaient à un rythme alarmant, permettant une coordination rapide et efficace. » - Outre que c’est un modèle inventé à l’époque des guerres napoléoniennes, en Espagne (1808), ce qui fait un lien avec le doc. 1, la citation montre que ce modèle ne cesse de se réinventer au XXe siècle, à partir de l’appui du terrain signalé dans le doc. 2 (cf le rôle du terrain dans la défaite française en Indochine) : le rôle des « technologies modernes » montre que la guérilla se réinvente, notamment dans la communication, dont l’image popularisée de Che Guevara peut être un prototype. Daesh a poussé à son comble l’utilisation de vidéos de propagande reprenant les codes de l’adversaire, ce qui est suggéré dans l’évocation de la « propagande » d’AQI, mais avec des moyens bien inférieurs dans les années 2000.
- 9. 2) L’ombre de la guerre totale - Le rapprochement des documents peut conduire à la notion de guerre totale : le doc. 1, à travers l’exemple des guerres napoléoniennes et de l’ampleur de la destruction suggérée, rappelle que cette période est une lutte à mort entre un régime malgré tout issu de la Révolution française et des (anciens) régimes qui y sont opposés. La guerre contre le terrorisme (doc. 2) théorisée par G.W. Bush est aussi une lutte totale entre des systèmes que tout oppose. - Dans cette optique, il est possible de signaler que les documents proposés, par leur date et leur nature, laissent totalement de côté les deux modèles par excellence de la guerre totale, les deux guerres mondiales. 3) Des évocations des guerres hybrides - L’incompréhension avouée de la part de McChrystal de la façon dont les combattants d’AQI mènent la guerre en Irak après 2003 trouve un écho dans les guerres napoléoniennes évoquées par le doc. 1 (Cependant, plus nous y réfléchissons, plus nous constatons que ce modèle ne fonctionnait pas. Les lieutenants d’AQI n’attendaient pas les directives de leurs supérieurs pour agir, et encore moins les ordres de Ben Laden. Les décisions se prenaient de façon décentralisée, mais rapide, puis étaient transmises horizontalement à travers l’organisation.). On retrouve l’impuissance de Napoléon face aux stratégies de la guérilla espagnole, comme celle de l’armée française face à la guérilla de Hô Chi Minh et Giap en Indochine, mais davantage dans le doc. 2 - En effet, quand McChrystal évoque la façon dont « nous avons entrepris de cartographier l’organisation en lui attribuant une structure militaire traditionnelle, avec ses échelons et ses rangs », puis dont « nous les voyions changer de tactique (passer d’attaques à la roquette à des attentats suicides, par exemple) quasi simultanément dans différentes villes. Ils exécutaient une funeste chorégraphie dont la structure, souvent méconnaissable, était en constante évolution », un nouveau rapport à la guerre s’amorce, qui annonce les combats contre Daech et l’alternance entre des formes de guerre irrégulière et régulière, la guerre hybride. Cette réalité décrite par McChrystal à propos de l’Irak de l’après 2003, mais que nous pouvons rapprocher de celle de l’Europe napoléonienne, entre guerre classique contre la coalition, contournement du blocus continental et guérilla espagnole, renvoie aux formes hybrides dont la guerre prend forme à l’époque moderne. Pas forcément déclarée, elle passe de la guerre classique à la guerre asymétrique (ainsi de la guerre du Golfe en 1991 puis 2003), avant de revenir à des formes plus classiques à la faveur de l’affirmation de Daech comme État après 2014. Conclusion - Deux documents opposés dans le temps et le type de guerre décrit en apparence - En réalité, diverses façons de faire la guerre et diverses facettes des conflits (en particulier à l’époque moderne) qui trouvent des échos dans les deux documents.