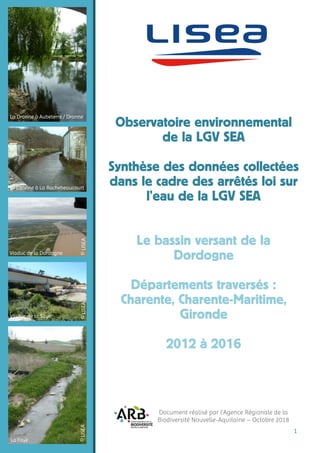
Suivi Eau BV Dordogne - 2012 à 2016 - ARB NA
- 1. 1 La Dronne à Aubeterre / Dronne La Lizonne à La Rochebeaucourt Viaduc de la Dordogne ©LISEA©LISEA Viaduc de la Saye La Faye ©LISEA Observatoire environnemental de la LGV SEA Synthèse des données collectées dans le cadre des arrêtés loi sur l’eau de la LGV SEA Le bassin versant de la Dordogne Départements traversés : Charente, Charente-Maritime, Gironde 2012 à 2016 Document réalisé par l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine – Octobre 2018
- 2. 2 SOMMAIRE 1. Le cadre de l’étude / p.3 1.1. Le contexte 1.2. Les objectifs 1.3. Les données sources et le cadre réglementaire 2. Présentation du bassin étudié : la Dordogne / p.4 2.1. Eléments de contexte 2.2. Les sites à enjeu eau 3. La qualité des eaux superficielles et l’état des cours d’eau / p.8 3.1. Méthodologie et paramètres étudiés 3.2. Evaluation de l’état biologique, physico-chimique et écologique 3.3. Evaluation de la qualité des sédiments 4. Le suivi des eaux souterraines / p.15 4.1. Les mesures de niveaux d’eau 4.2. La qualité des eaux souterraines SYNTHESE / p.25 ANNEXES / p.26 Précautions de lecture L’analyse interannuelle paraît encore parfois peu robuste du fait d’un nombre d’années de campagnes de prospection relativement réduit. Les données complémentaires pour les années suivantes permettront, le cas échéant, d’affiner l’analyse (des suivis ont été réalisés après la rédaction de ce document). D’autre part, les relevés ne sont pas réalisés systématiquement à la même période d’une année sur l’autre pour chaque station. Les résultats des suivis peuvent donc être influencés plus ou moins directement par des facteurs hydro-climatiques (pluviométrie, températures, débits et écoulement des cours d’eau, etc.), ou anthropiques (volumes d’eau prélevés pour différents usages, etc.). Le document présente une synthèse générale pour le bassin versant de la Dordogne, incluant les sites à enjeu sélectionnés dans le cadre de l’Observatoire environnemental.
- 3. 3 1. Le cadre de l’étude La Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique de 340 kilomètres de long traverse 4 bassins versants (l’Indre, la Vienne, la Charente et la Dordogne) incluant chacun de nombreux cours d’eau, des zones humides ou encore des nappes d’eau souterraine. Les bassins versants sont des entités hydrologiques cohérentes dans lesquels tous les écoulements des eaux convergent vers un même point, exutoire de ce bassin. Les ressources en eau d’un bassin versant peuvent être soumises à de fortes pressions anthropiques (usages domestiques, agricoles, industriels, etc.) qui peuvent dégrader sa qualité et porter atteinte aux milieux aquatiques. Potentiellement, la construction d’une infrastructure de transport comme la LGV SEA peut elle aussi avoir de nombreux impacts sur les ressources en eau aussi bien pendant la phase de travaux (2012-2016) que pendant la phase d’exploitation (à partir de 2017). Afin d’évaluer ces impacts, des suivis des différentes ressources en eau sont nécessaires ; ils portent aussi bien sur des aspects quantitatifs que qualitatifs. Dans le cadre de la LGV-SEA, la construction de près de 600 ouvrages hydrauliques (buses ou cadres pour les petits écoulements, viaducs ou ponts pour les cours d’eau les plus importants) a été réalisée sur l’ensemble du tracé afin de faciliter l’écoulement des eaux. Ils ont fait l’objet d’aménagements particuliers pour rétablir la circulation des poissons et des animaux à proximité. Au niveau du bassin de la Dordogne, 6 viaducs ont été construits : Goujonne, Saye, Falaise, Virvée, Dordogne, Ambarès. Ces ouvrages hydrauliques sont prévus pour perturber le moins possible les écoulements naturels mais ne sont pas sans conséquence et peuvent porter atteinte au milieu aquatique et influer sur la continuité des cours d’eau. La réalisation des ouvrages et du rétablissement hydraulique doit respecter le principe de libre circulation des poissons (Code rural) et l’implantation de l’ouvrage doit se faire au plus proche du lit naturel du cours d’eau existant pour éviter une dérivation trop importante. 1.1. Le contexte L’Observatoire environnemental de la LGV LEA mis en place par LISEA a pour but d’enrichir la connaissance et les pratiques notamment en matière de réduction des impacts environnementaux et d’apporter des retours d’expérience utiles aux projets futurs d’infrastructures. Il vise également à évaluer les impacts résiduels réels, positifs et négatifs, du projet sur l’environnement et à s’assurer de l’efficacité des mesures prises pour la réduction et la compensation des impacts notamment en matière de protection du milieu naturel et de l’insertion paysagère. 6 thèmes d’études et 19 sites ont été sélectionnés dont le thème de l’eau avec 16 sites emblématiques répartis le long du tracé de la LGV SEA. Le bassin de la Dordogne est concerné par 4 sites à enjeu eau : la Vallée du Lary et du Palais, la vallée de la Saye et du Meudon, le marais de la Virvée et Ambarès/Lagrave. 1.2. Les objectifs Deux objectifs principaux sont visés au travers de l’étude de l’eau mise en place dans le cadre de l’observatoire environnemental de la LGV SEA : - obtenir des retours d’expérience, grâce à l’analyse de sites emblématiques sur l’incidence du chantier sur les eaux souterraines et superficielles (qualité, niveau et débit) et l’efficacité des dispositifs environnementaux. - sur des exemples spécifiques, évaluer la réussite d’une option, d’une innovation technique adaptée sur les aménagements d’ouvrages.
- 4. 4 1.3. Les données sources et le cadre réglementaire Les données utilisées pour cette étude sont issues des résultats des mesures réalisées lors des suivis des eaux souterraines et des eaux superficielles menés par des bureaux d’étude mandatés par COSEA dans le cadre des arrêtés loi sur l’eau. Les suivis s’effectuent à différentes fréquences et périodes, avant et pendant la phase de travaux (2012-2016), ainsi que pendant la phase d’exploitation (mise en service de la ligne en 2017). Les données analysées ici comprennent plusieurs campagnes de mesures, réalisées en 2009 (état de référence), puis de 2012 à 2016 pour l’état des cours d’eau, et de 2012 à 2016 pour le suivi des eaux souterraines. Les arrêtés d’autorisation Loi sur l’eau ont été obtenus pour les 4 bassins versants concernés par la construction de la LGV SEA à savoir Indre, Vienne, Charente et Dordogne. Le dossier de demande d’autorisation détaille, par bassin versant, les mesures conservatoires correctives ou compensatoires, les plus adaptées pour préserver ce patrimoine commun. Un état zéro a été réalisé et des suivis des eaux superficielles et souterraines ont été mis en place dès la phase chantier conformément à ces arrêtés. >>> La loi sur l’eau La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 est une loi française ayant pour but de transposer en droit français la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000. Elle vise ainsi à préserver les écosystèmes aquatiques et les zones humides, protéger la qualité des eaux, et préserver les écoulements naturels. Les installations, ouvrages, travaux et activités en rivière sont soumis à des contraintes réglementaires. En effet, tout projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (eaux superficielles ou souterraines, zones inondables, zones humides...) doit être soumis à l’application de la Loi sur l’eau. Concernant la Ligne à Grande Vitesse SEA Tours-Bordeaux, les ouvrages et installations liés à sa construction ont été soumis à autorisation. L’ensemble des travaux a ainsi été conçu sur la base d’études hydrauliques, hydrogéologiques et environnementales validées par les autorités administratives, et soumis à enquête publique. 2. Présentation du bassin étudié : la Dordogne 2.1. Eléments de contexte La Dordogne (483 km) prend sa source au Puy du Sancy (point culminant du Massif Central) dans le Puy de Dôme à 1366 m d’altitude. Elle naît de la jonction de multiples ruisseaux, dont les plus connus sont la Dore et la Dogne. Depuis sa source, la Dordogne prend successivement la forme d’un torrent sauvage avant de terminer sa course par la confluence avec la Garonne, au niveau du bec d’Ambès, pour former l’estuaire de la Gironde. Ses principaux affluents sont la Cère (120,4 km), la Maronne (92,6 km), la Vézère (211,2 km) et l’Isle (255,3 km). Le bassin versant de la Dordogne est le deuxième plus grand bassin-versant d’Adour-Garonne (24 000 km2 ) après celui de la Garonne. Il est subdivisé en 6 sous-bassins versants : l’Isle (3 740 km2 ), la Dronne (2 794 km2 ), la Vézère (3 725 km2 ), La Dordogne à l’amont de la Cère (6 580 km2 ), la Dordogne à l’aval de la Cère (4 984 km2 ) et la Dordogne Atlantique (2 100 km2 ). La Dordogne arrose 6 départements (Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, Lot, Dordogne et Gironde, d'amont en aval) et son bassin versant s'étend à 5 autres (Creuse, Haute-Vienne, Lot-et- Garonne, Charente et Charente-Maritime).
- 5. 5 La Dordogne est un cours d’eau abondant de la façade atlantique, bénéficiant d’un climat humide marqué par de fortes précipitations sur une grande partie du bassin. Des fluctuations saisonnières importantes peuvent être observées avec des épisodes de crues intenses en période de hautes eaux et des étiages sévères en période de basses eaux. Trois problématiques principales sont identifiées au niveau du bassin de la Dordogne : les éclusées, les étiages et les crues. Le régime hydrologique de la Dordogne est à l’origine de sa vocation hydroélectrique. Il est marqué par plus de 30 grands barrages (dont la plupart fonctionnent par éclusées) pour une production hydroélectrique totale de 3 milliards de Kwh. (Source : EPIDOR) La présence de ces ouvrages n’est pas sans conséquence pour le fonctionnement des milieux aquatiques et notamment pour la circulation des poissons migrateurs bien que des installations (passes à poissons, etc.) aient été mises en place. Cette problématique est une source de conflits réguliers entre les différents usagers. Sur le bassin de la Dordogne, de nombreux affluents sont régulièrement soumis à des étiages sévères. Ils impactent la vie aquatique, peuvent faire émerger des conflits d’usages et aboutir à des assecs complets de cours d’eau. (Source : EPIDOR) Le bassin de la Dordogne a connu des crues majeures qui ont fortement marqué le territoire. Il est soumis à des risques d’inondation de caractères divers : torrentiel sur les reliefs du massif central, de plaines dans les grandes vallées ou encore fluviomaritime en Gironde. 2.2. Les sites à enjeu eau sélectionnés dans le cadre de l’Observatoire Dans le cadre du projet de construction de la ligne LGV, un programme de surveillance a été établi, depuis 2009, pour suivre l’état écologique des cours d’eau concernés par le tracé. Un état écologique de référence a été réalisé, basé sur des mesures physico-chimiques et biologiques définies par l’arrêté du 25 janvier 20101 , pour 90 cours d’eau répartis dans les 4 bassins Vienne, Indre, Dordogne et Charente. 1 Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement (dernière modification par l’arrêté du 27/07/2015). http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021865356&dateTexte=20160129
- 6. 6 En ce qui concerne plus particulièrement le bassin de la Dordogne, celui-ci est traversé par la LGV-SEA dans sa partie aval au niveau des sous-bassins suivants : Dronne, Isle et Dordogne aval. Différentes ressources en eau, superficielles et souterraines, sont ainsi concernées. Sur les 16 sites à enjeux eau définis le long du tracé de la LGV, 4 concernent le bassin de la Dordogne. Ils sont présentés dans le tableau suivant et localisés sur la carte ci-après. Sites Thème Eau N° du site Nom du site Commune Dpt Eaux superficielles Eaux souterraines 1 Vallée du Lary et du Palais Saint-Vallier/ Clérac/Montguyon 16/17 Le Palais Le Lary + l’Espie LA Goujonne Saint-Vallier Clérac Montguyon 2 Vallée de la Saye et du Meudon Laruscade 33 Le Meudon amont Le Meudon + le Bois Noir La Saye Laruscade 3 Marais de la Virvée Cubzac-les-Ponts/ Saint Romain la Virvée/ Saint Loubés 33 Marais de la Virvée La Dordogne (rive droite et rive gauche) Cubzac-les-Ponts 4 Ambarès et Lagrave - 33 - Ambarès et Lagrave
- 7. 7 Site à enjeu eau n°1 : Vallée du Lary et du Palais > Enjeux eaux superficielles et eaux souterraines Les vallées du Lary et du Palais sont reconnues comme Site Natura 2000. Elles présentent des cours d'eau oligo- mésotrophes situés en milieu forestier ou ouvert avec des secteurs préservés favorables à la faune aquatique et aux habitats humides : forêts alluviales, prairies naturelles humides, bas marais, de grande qualité. Le Vison d’Europe fait l’objet de mentions régulières et une importante voie d'échange et/ou de colonisation entre le bassin de la Garonne et celui de la Charente est reconnue. La présence de nombreuses espèces de la directive habitat et plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs est à noter. Site à enjeu eau n°2 : Vallée de la Saye et du Meudon > Enjeux eaux superficielles et eaux souterraines Les vallées de la Saye et du Meudon sont reconnues comme Site Natura 2000. Le site abrite 13 habitats naturels et 17 espèces d'intérêt communautaire parmi lesquels 3 habitats et 2 espèces (Vison d'Europe et Rosalie des Alpes) dont la conservation est jugée prioritaire par la directive « habitats ». Le site de la Vallée de la Saye et du Meudon est boisé pour plus de la moitié de sa surface. De nombreux marais et tourbières sont également présents. A noter que la Saye est un axe prioritaire pour les espèces migratrices. Site à enjeu eau n°3 : Marais de la Virvée > Enjeux eaux superficielles et eaux souterraines La zone humide du marais de la Virvée est drainée par une série d’esteys (partie d'un cours d'eau qui, soumis au régime des marées, se trouve à sec à marée basse), affluents de la Dordogne. Ce milieu bocager marqué par une aulnaie frênaie alluviale est favorable à la nidification et à la halte- migratoire d’une avifaune variée, notamment les chauves- souris. Le ruisseau de la Virvée est endigué sur l’ensemble de son cours dans la plaine alluviale. L’aval, soumis à l’influence des marées est toujours en eau tandis qu’il s’assèche dans sa partie en amont en période estivale. Dans la plaine inondable, le substrat géologique est composé de tourbes, de vases et de sables. (Source : LISEA) Site à enjeu eau n°4 : Ambarès et Lagrave > Enjeux eaux souterraines Afin d’alimenter en eau potable une partie de l’agglomération bordelaise, l’eau de la nappe superficielle contenue dans les 7 hectares d’anciennes gravières exploitées sur les communes d’Ambarès-et-Lagrave et Saint- Louis-de-Montferrand est prélevée. Leur réalimentation est ensuite assurée à partir de la Garonne, par l’intermédiaire d’une usine de traitement d’eau ne prélevant que lorsque la qualité de la Garonne le permet, notamment en fonction des teneurs en chlorures et en matières en suspension. Cette solution a notamment été mise en place réduire les prélèvements trop importants dans la nappe de l’Éocène. Vallée de la Saye Vallée du Meudon Marais de la Virvée Vallée du Lary Vallée du Palais
- 8. 8 3. La qualité des eaux superficielles et l’état des cours d’eau 3.1. Méthodologie et paramètres étudiés Afin d’obtenir une vision globale de la situation des eaux superficielles du bassin, les résultats obtenus pour chaque station de suivi ont été agrégés et synthétisés. Plusieurs indicateurs ont été étudiés permettant d’évaluer l’état des différents cours d’eau concernés. Pour chaque station de suivi, l’état écologique a été évalué. Il intègre des paramètres biologiques (état biologique prépondérant dans le calcul de l’état écologique) ainsi que des paramètres physico- chimiques (état physico-chimique) soutenant les paramètres biologiques. Les différents paramètres pour l’évaluation de l’état écologique (issus de l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010) Avertissement : Les outils d’évaluation des états biologique, physico-chimique et écologique ainsi que le SEQ-eau V2 (système d'évaluation de la qualité des cours d'eau qui permet d’apprécier la qualité physico-chimique des cours d’eau à travers différentes grilles d'évaluation) acquièrent toutes leurs pertinences dans le cadre d’un suivi régulier des cours d’eau car les caractéristiques physico-chimiques des milieux varient fortement avec la saison (et les conditions hydro-climatiques). La qualité biologique (de l’état écologique) des eaux superficielles est appréciée à travers le calcul d’indices spécifiques sur les organismes aquatiques, établis selon des protocoles de recueil de données normalisés propres à chaque indice (protocoles IBG, IBD, etc.). Les indices utilisés dans le cadre du suivi de la LGV sont les suivants : - Indice Biologique Global (IBG) pour les petits cours d’eau : il repose sur l’examen des peuplements de macroinvertébrés benthiques. Ces organismes plus ou moins polluo- sensibles témoignent de la qualité de l’eau et de la qualité et diversité des habitats du cours d’eau dans lequel ils sont présents : structure du fond, état des berges et qualité physico-chimique des eaux. - Indice Biologique Global Adapté (IBGA) pour les grands cours d’eau : l'IBG ne peut être appliqué que sur des cours d'eau peu profonds (<1m). L’IBGA permet d'évaluer la qualité
- 9. 9 biologique de l'eau d'un cours d'eau au moyen d'une analyse des macroinvertébrés, adapté aux spécificités des rivières larges et profondes. - Indice Biologique Diatomées (IBD) : Il prend en compte la structure des peuplements de diatomées (algues brunes unicellulaires microscopiques fixées). Ces algues colonisent les différents substrats présents dans le lit des cours d’eau. Il reflète la qualité générale de l’eau d’un cours d’eau, et plus particulièrement vis-à-vis des matières organiques et oxydables et des nutriments (azote et phosphore). - Indice Poissons Rivière (IPR) : les peuplements piscicoles constituent de bons outils de mesure de la qualité du milieu. L’IPR est déterminé à partir de la richesse spécifique (nombre d’espèces présentes), la densité et les caractéristiques écologiques des différentes espèces qui composent le peuplement (régime alimentaire, polluo- sensibilité, habitat, etc.). L’évaluation de la qualité physico-chimique des eaux superficielles (de l’état écologique) porte sur des analyses physico-chimiques des eaux basées sur deux outils d’évaluation de la qualité de l’eau : les classes d’état écologique pour les paramètres physico-chimiques généraux et les grilles d’évaluation de la qualité de l’eau par type d’altérations (SEQ Eau version 2). Les mesures réalisées concernent la température, le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, le taux de saturation en dioxygène, le carbone organique dissous, la demande biochimique en oxygène, l’ammonium, les nitrites, les nitrates, les orthophosphates et le phosphore total. L’étude de la qualité des sédiments peut renseigner sur la qualité des eaux, car les sédiments ont la propriété d’intégrer et de concentrer certains éléments présents dans l’eau. Certains polluants présents en très faible concentration dans l’eau tels que les micropolluants organiques et métalliques sont de ce fait plus facilement détectables dans les sédiments. Les mesures réalisées sur les sédiments portent sur différents substances : les métaux lourds (Plomb, Zinc, Nickel, Cadmium, Chrome, Cuivre…), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), ou encore les Polychlorobiphényles (PCB) et les pesticides lors de l’évaluation de l’état de référence en 2009. >>> Les facteurs influant sur la qualité des eaux La qualité de l’eau dépend d’une part du contexte naturel (contexte géologique pour l’eau souterraine par exemple), et d’autre part, de facteurs environnant qui viennent la dégrader (pollution). Cette pollution peut avoir des effets négatifs plus ou moins directs sur les écosystèmes aquatiques : toxicité de certains produits, pollution entraînant des déséquilibres sur la chaîne alimentaire (eutrophisation), etc. La pollution de l’eau peut être physique, elle affecte sa température, sa radioactivité, son taux de turbidité (matières en suspension). Elle peut être organique (rejets d’eaux usées), induisant la disparition de la vie aquatique par manque d’oxygène, et l’apparition d’éléments indésirables. La pollution chimique peut quant à elle affecter directement les organismes aquatiques ou créer des déséquilibres (augmentation de la salinité ou de l’acidité). La pollution peut aussi être microbiologique (introduction de micro-organismes dans l’eau, comme les germes pathogènes issus de rejets dans le sol ou déversés dans les cours d’eau). Ces différents polluants peuvent être émis dans l'atmosphère, évacués dans les eaux usées ou encore répandus sur les sols, sous plusieurs formes : gaz, substances dissoutes ou particules. D’autre part, les épisodes pluvieux importants peuvent provoquer des pics de pollution, du fait du lessivage des sols, entraînant des matières en suspension et d’éventuels éléments indésirables (nitrates, pesticides, etc.) vers les eaux de surface, et les eaux souterraines dans les zones d’affleurement.
- 10. 10 La pollution de cours d’eau par les matières en suspension génère une augmentation de la turbidité pouvant être rapidement préjudiciable à la photosynthèse et à la respiration des organismes aquatiques (colmatage des branchies des poissons par exemple). A moyen terme, elle peut aussi engendrer d’importantes modifications hydromorphologiques (colmatage, modification des vitesses d’écoulement, etc.) venant perturber les habitats aquatiques. D’autre part, ces particules peuvent de plus transporter différentes formes de pollution (organiques, métalliques). 3.2. Evaluation de l’état biologique, physico-chimique et écologique Au total, sur l’ensemble du bassin de la Dordogne, 26 stations de suivi ont été définies le long du tracé de la LGV, d’amont en aval, pour l’évaluation de la qualité des eaux superficielles et de l’état des cours d’eau. Un état de référence évalué en 2009 (avant le début des travaux de construction de la LGV) a été retenu pour chaque station, puis une campagne annuelle est réalisée pour suivre cet état pendant et après les travaux. Le graphique ci-après présente l’évolution de l’état biologique, physico-chimique et écologique des 26 stations de suivi du bassin de la Dordogne. Il tient compte des mesures réalisées pour l’état de référence (2009), puis de 2012 à 2016.
- 11. 11 L’état écologique de référence (2009) a pu être évalué pour 23 des 26 stations (88%) du bassin de la Dordogne. Seulement 7 de ces 23 stations (30%) sont considérées en « bon état » et la majorité en « état moyen » (12 stations soit 52%) ; 2 en « état médiocre » (9%) et 2 en « mauvais état » (9%). L’état biologique 2009 présente sensiblement les mêmes résultats (53% des stations qualifiées sont « en état biologique moyen ») mais 9 stations n’ont pu être qualifiées. Les classements de « l’état physico-chimique » sont bien meilleurs : 15 stations (soit 71%) indiquent une « bonne ou très bonne qualité physico-chimique » en 2009. Les suivis des trois premières années de la phase de travaux (2012 à 2014) semblent indiquer une dégradation croissante de l’état écologique. En 2014, plus de la moitié des stations indiquent alors un état écologique médiocre ou mauvais. Par la suite, après une légère amélioration en 2015, la situation globale semble se stabiliser en 2016. D’une manière générale, ce sont notamment les mauvais résultats de l’IBG et de l’IPR qui sont fréquemment responsables des mauvais classements de l’état biologique (et donc de l’état écologique) des cours d’eau suivis sur le bassin de la Dordogne de 2009 à 2016. Ceci s’explique bien souvent du fait de conditions hydromorphologiques peu favorables à l’installation d'une faune diversifiée (envasement ou colmatage des habitats par des sédiments fins, faibles vitesses d'écoulement et faibles lames d’eau, assecs récurrents, etc.), non imputables à un impact direct du chantier. De plus, les variations des résultats de l’IBG et de l’IPR sont souvent jugées non significatives (par le bureau d’études en charge des suivis), car elles semblent être davantage inhérentes à la méthodologie de calcul de la note, plutôt qu’à une véritable modification des peuplements d’invertébrés aquatiques et/ou de poissons (et de leurs habitats). Il convient aussi de souligner que l’IPR est un outil global qui fournit une évaluation synthétique de l’état des peuplements de poissons. D’autre part, des altérations physico-chimiques de la qualité de l’eau plus ou moins marquées sont également mises en évidence sur l’ensemble des stations, en lien avec la nature forestière et la typologie des sols du bassin versant : une forte quantité de bois dans les cours d'eau peut effectivement entraîner une charge en Carbone Organique Dissous (COD), souvent corrélée avec une Demande Chimique en Oxygène (DCO) importante. Des concentrations importantes en nitrates peuvent aussi être observées, plus ponctuellement, en lien avec le contexte agricole.
- 12. 12 Il est également à noter que 4 stations en aval du bassin (n°23 à 26 au Sud) sont sous l'influence de la marée, et sont systématiquement classées en mauvais état écologique du fait des protocoles d'échantillonnage inadaptés à de tels milieux pour les indices biologiques (les résultats obtenus sont donnés à titre indicatif). Cette particularité conduit également à des altérations de la qualité physico-chimique, notamment vis-à-vis de l’oxygène, du COD ou encore des matières en suspension (bouchon vaseux de l’estuaire). L’état écologique de la dernière année de la phase de travaux (2016) a pu être évalué pour les 26 stations du bassin. Les résultats semblent indiquer une dégradation d’ensemble par rapport à 2009 : en 2016, aucune station n’est considérée en « bon état » et la plupart en « état moyen » (18 stations soit 69%) ; 4 sont jugées en « état médiocre » (15%) et 4 également en « mauvais état » (15%). Cette évolution est cependant à relativiser, notamment du fait de la vraisemblable surestimation de l’état écologique 2009 en raison de l’absence de suivis biologiques (IPR ou IBG notamment) sur 5 stations, et de suivi du COD sur 4 autres stations indiquant une dégradation de l’état écologique. Ces éléments conduisent à considérer alors que la majorité des stations présente un état écologique 2016 plutôt équivalent à celui évalué en 2009 (avant travaux), et dans ce cas, aucun impact du chantier ne semble être ainsi mis en évidence (d’après les seules comparaisons réajustées des résultats de suivi de l’état écologique de ces deux années). Néanmoins, des altérations ponctuelles de la qualité des habitats (dégradation des notes des indices biologiques), vraisemblablement en lien avec un impact du chantier, sont tout de même signalées en 2014 sur le Ruisseau des Lorettes Sud (station n°3), le Ruisseau de Châteauroux (n°7), la Goujonne (n°8) et le Lary (n°10). A signaler aussi que sur ces trois dernières stations, les suivis physico-chimiques complémentaires (Seq-Eau) mettent conjointement en évidence des concentrations relativement élevées de matières en suspension, probablement liées à des ruissellements issus des chantiers. Les relevés 2015 et 2016 semblent ensuite indiquer de légères améliorations de l’état écologique général (pour 3 des 4 stations), avec parfois un retour à une situation proche de celle de 2009. Certaines autres stations indiquent aussi des concentrations importantes de matières en suspension, plus ou moins fréquemment entre 2012 à 2016, sans forcément que d’autres altérations de la qualité de l’eau ne soient alors mises en évidence ou directement reliées. Même si de fortes précipitations peuvent également influer sur la turbidité des cours d’eau, il semble néanmoins fort probable que ces teneurs en particules puissent parfois s’expliquer du fait de l’incidence des travaux (ruissellement issu du chantier), comme le signale le bureau d’études dans ses rapports de mesures sur la Viveronne (station n°1) et le Ruisseau des Lorettes Nord (n°2) en 2013 (avec une charge en COD importante simultanément sur ces deux stations) ou la Nauve du merle (n°5) en 2015. Des concentrations élevées en COD, apparemment liées à des écoulements issus des chantiers sont également signalées en 2013 sur le Palais (n°4) et le Meudon amont (n°14). Les derniers relevés semblent toutefois indiquer une amélioration, avec une baisse des teneurs en COD, notamment pour la station du Palais qui affiche une très bonne qualité vis-à-vis de ce paramètre en 2016 (5 mg/l de COD relevés) ; tandis que, malgré la baisse, les concentrations en COD restent élevées sur le Meudon amont (qualité médiocre avec 12,9 mg/l en 2016).
- 13. 13 3.3. Evaluation de la qualité des sédiments En complément de l’évaluation de l’état écologique des eaux, une évaluation de la qualité des sédiments par rapport à la présence de polluants est réalisée. La grille d’évaluation du SEQ eau (V2) est utilisée pour l’interprétation des résultats. Qualité des sédiments au niveau des stations de suivi du bassin de la Dordogne (26 stations) Evolution depuis l'état de référence (2009) jusqu'en 2016 - 6 métaux (Pb, Zn, Ni, Cd, Cr, Cu) et HAP Nombre de stations par niveau d'altération d'après la grille d'évaluation SEQ-eau (V2)
- 14. 14 L’état de référence de 2009 (avant travaux) indique que seuls les sédiments de la Virvée (station n°25) présentent des altérations de la qualité jugées modérées vis-à-vis des métaux lourds (pour le plomb, le zinc, le nickel et le chrome). Six stations ne présentent toutefois pas de données. Et seules de « faibles » altérations vis-à-vis des hydrocarbures (HAP) sont relevées en 2009 (mais 5 stations ne présentent pas de données). Par la suite, il ne semble pas se dégager de véritable tendance de 2012 à 2016 vis-à-vis des altérations par les métaux, excepté le fait que des altérations « modérées » pour certains métaux (sauf le Cadmium) semblent perdurer sur les cinq stations au Sud, en aval du bassin (n°22 à 26). Par ailleurs, huit autres stations (n°1, 2, 4, 6, 8, 17, 20 et 21) présentent ponctuellement des altérations modérées pour différents métaux, et trois altérations importantes sont à signaler de 2012 à 2016 : vis-à-vis du nickel sur le ruisseau Lafont (station n°22) en 2014 ; vis-à-vis du cadmium sur le ruisseau des Lorettes Nord (station n°2) en 2015 et vis-à-vis du cuivre sur le Baudet (station n°20) en 2016. Treize stations (n°3, 5, 7, 9 à 16, 18 et 19) ne présentent aucune altération jugée « supérieure à faible » par les métaux, de 2012 à 2016. Concernant les hydrocarbures, une nette augmentation du nombre de stations présentant une altération modérée est à noter en 2015, et la situation semble perdurer en 2016. Cependant, ces résultats sont à considérer avec précaution car il semble qu’ils puissent être surestimés (en raison d’une faible teneur en matières sèches du prélèvement). Néanmoins, cette apparente contamination peut être indirectement liée à l'impact du chantier via une mobilisation des sédiments terrestres lors des travaux ou à l'influence des engins motorisés, comme le souligne le bureau d’études sur 4 stations en 2014 (n°3, 4, 6, 8). Pour une autre station (ruisseau de Fontgerveau n°21) il semble toutefois que la proximité de l’autoroute et/ou l’influence urbaine puisse aussi expliquer des concentrations importantes en HAP (et en métaux). >>> La pollution par les métaux La pollution métallique peut être due à différents métaux comme l’aluminium, l’arsenic, le chrome, le cobalt, le cuivre, le manganèse, le nickel, le zinc... ou encore à des métaux lourds comme le cadmium, le mercure ou le plomb, plus toxiques que les précédents, et principalement recherchés dans les analyses de la qualité de l’eau. La majorité des éléments métalliques est toutefois indispensable à la vie animale et végétale (oligo-éléments). Cependant, à des doses importantes, ils peuvent se révéler très nocifs. La pollution métallique des milieux aquatiques pose un problème particulier car elle est non biodégradable. Elle a ainsi tendance à se concentrer dans les organismes vivants. De multiples activités humaines sont responsables de l’émission de métaux lourds dans l’atmosphère telles que : - les rejets d’usines, notamment de tanneries (cadmium, chrome), de papeteries (mercure), d’usines de fabrication de chlore (mercure) et d’usines métallurgiques, des épandages sur les sols agricoles d’oligo-éléments ou de boues résiduelles de stations d’épuration, - l’utilisation de certains fongicides (mercure), - les retombées des poussières atmosphériques émises lors de l’incinération de déchets (mercure) ou de la combustion d’essence automobile (plomb), - le ruissellement des eaux de pluie sur les toitures et les infrastructures comme les routes, les voies ferrées, etc. (zinc, cuivre, plomb).
- 15. 15 4. Le suivi des eaux souterraines Les différentes formations géologiques (calcaires fissurés, karsts, terrains alluviaux, etc.) rencontrées lors de la construction d’une infrastructure telle que la LGV contiennent des nappes souterraines, exploitées pour la production d’eau potable publique, mais aussi pour d’autres usages tels que l’irrigation, les usages domestiques ou les besoins industriels. Les impacts d’une infrastructure linéaire de transport ferroviaire telle que la LGV SEA sur les eaux souterraines peuvent être de deux types : - impacts quantitatifs sur le battement et l’écoulement des aquifères - impacts qualitatifs (pollution accidentelle ou chronique) Ces impacts concernent la phase de travaux et la phase d’exploitation. (Source : Réseau Ferré de France, 2012) Des mesures de niveaux d’eau ainsi qu’un suivi de la qualité des eaux souterraines sont donc nécessaires pour contrôler ces deux types d’impacts. Le tableau ci-après présente les 68 points de suivi souterrains dans le bassin de la Dordogne. Tableau récapitulatif des points d’eau recensés dans le bassin de la Dordogne pour le suivi des eaux souterraines réalisé dans le cadre de la construction de la LGV Issu de l’arrêté inter-préfectoral du 16 janvier 2013 N° du point d’eau Département Commune Type usage Suivi qualitatif Suivi quantitatif 1 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Forage Domestique X 4 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X 12 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Agricole X 20 GIRONDE ST-ANTOINE Puits Domestique X 21 GIRONDE CAVIGNAC Puits Agricole X 26 GIRONDE CAVIGNAC Puits AEP privé X X 29 GIRONDE CAVIGNAC Puits Domestique X 39 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X 44 GIRONDE CAVIGNAC Source Agricole X 45 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 57 CHARENTE-MARITIME NEUVICQ Puits Domestique X 147 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits AEP privé X X 1148-16066 CHARENTE BROSSAC Puits Domestique X 1153-16066 CHARENTE BROSSAC Mare Aucun X X 1161-16066 CHARENTE BROSSAC Source Domestique X X 1196-16357 CHARENTE SAINT-VALLIER Source Domestique X X 1215-16357 CHARENTE SAINT-VALLIER Mare Aucun X X 1222-17054 CHARENTE MARITIME BORESSE-ET-MARTRON Mare Agricole X X 1243-17260 CHARENTE-MARITIME NEUVICQ Puits Domestique X X 1253-17241 CHARENTE-MARITIME MONTGUYON Puits Domestique X 1255-17241 CHARENTE MARITIME MONTGUYON Mare Agricole X X 1276-17110 CHARENTE MARITIME CLERAC Puits Domestique X X 1286-17110 CHARENTE MARITIME CLERAC Mare Domestique X X
- 16. 16 1305-33233 GIRONDE LARUSCADE Puits Domestique X X 1310-33233 GIRONDE LARUSCADE Puits Domestique X X 1348-33114 GIRONDE CAVIGNAC Puits Domestique X X 1359-33114 GIRONDE CAVIGNAC Puits Agricole X 1364-33123 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 1369-33123 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 1371-33123 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 1372-33123 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 1373-33123 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 1375-33123 GIRONDE CEZAC Puits Domestique X 1403-33272 GIRONDE MARSAS Puits Domestique X X 1438-33183 GIRONDE GAURIAGUET Puits Domestique X X 1441-33183 GIRONDE GAURIAGUET Puits AEP privé X X 1454-33018 GIRONDE AUBIE-ET-ESPESSAS Mare Aucun X X 1477-33371 GIRONDE SAINT-ANTOINE Source Public X X 1484-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1491-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1493-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1494-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1503-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X 1507-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1516-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X 1520-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1521-33366 GIRONDE SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC Puits Domestique X X 1523-33143 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Source Aucun X X 1529-33143 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Puits Domestique X 1531-33143 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Source Aucun X X 1554-33487 GIRONDE SAINT-VINCENT-DE-PAUL Puits Agricole X X 1560-33003 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X X 1596-33003-p01 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X 1597-33003-p02 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X 1598-33003-p03 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X 1599-33003-p04 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X 1600-33003-p05 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X 1605-33003 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X 1630-33003-p31 GIRONDE AMBARES-ET-LAGRAVE Puits Domestique X M. BERGUIO GIRONDE AUBIE-ET-ESPESSAS Puits AEP privé X X PZ1 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ2 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ3 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ4 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ5 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ6 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ7 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X PZ8 GIRONDE CUBZAC-LES-PONTS Piezo Aucun X
- 17. 17 4.1. Les mesures de niveaux d’eau La construction d'une infrastructure telle que la LGV peut avoir une incidence sur la possibilité d’accéder aux ressources en eau souterraines. Par exemple, lorsqu’un déblai intercepte une nappe d’eau souterraine peu profonde, un abaissement localisé du niveau de la nappe et parfois un assèchement des puits à proximité peut être observé et, par conséquent, une modification des conditions d’écoulement des eaux souterraines. En vue de contrôler cet impact possible, des mesures du niveau d’eau dans les nappes souterraines sont nécessaires et doivent être effectuées avant les travaux et pendant les terrassements pour suivre les éventuelles variations de hauteur de la nappe. Si le projet traverse des périmètres de protection de captages pour l’alimentation en eau potable, des études spécifiques sont à mener afin que la LGV n’altère pas l’exploitation de la nappe. Cela a d’ailleurs été le cas pour la LGV SEA. Le recensement de tous les points d’eau à moins de 500 mètres de la ligne a permis de mettre en évidence les secteurs sensibles ou inscrits dans un périmètre de protection de captage d’eau potable pour lesquels des préconisations de gestion ont ensuite été faites. 4.1.1. La méthodologie Les mesures effectuées dans le cadre de la construction de la LGV pour le suivi du niveau des eaux souterraines sont réalisées au droit des déblais humides avant, pendant et après la phase de travaux. A cette fin, des piézomètres ont été implantés en amont et en aval des déblais. La périodicité des mesures est de l'ordre du mois. Tel qu’exigé dans les arrêtés, un suivi complémentaire du niveau d'eau dans les puits et forages proches est réalisé au minimum 2 fois par an, en périodes de hautes eaux et en période de basses eaux, avant et pendant la phase travaux, et la première année d'exploitation de la ligne. 4.1.2. Les résultats Sur les 71 points de suivi quantitatif recensés, seuls 39 font état d’un nombre de mesures suffisantes pour être exploitées sur la période mai 2012-novembre 2016. Le suivi du niveau piézométrique NGF (en mètre) de ces 39 points est présenté dans les graphiques ci-après. Pour chaque point de suivi, environ 1 mesure par mois (ou tous les deux mois) est disponible permettant de montrer une évolution globale du niveau de la nappe d’eau souterraine captée sur la période considérée. Les résultats des mesures ont été divisés en 3 graphiques pour une meilleure lisibilité (voir page suivante). D’une manière générale, 2 profils se distinguent sur les graphiques : - certains points de suivi indiquent très peu de variations et montrent un niveau d’eau globalement stable signifiant que la nappe captée n’est pas ou très peu utilisée, et peu influencée par les cycles saisonniers (stations 27 à 39 du 3ème graphique notamment) - à l’inverse, d’autres points montrent des variations plus marquées avec des hausses et des baisses du niveau d’eau selon les périodes, en lien avec les cycles saisonniers de recharge et de vidange des nappes (stations 1 à 26 des 1er et 2ème graphiques notamment) Pour ce second groupe de stations, les tendances semblent suivre celles habituellement observées dans le cycle de recharge et de vidange des nappes d’eau souterraines. En effet, la phase de recharge est généralement observée durant la période automnale-hivernale, les précipitations étant plus abondantes et les besoins en eau moins importants ; la phase de vidange est quant à elle observée durant la période printanière-estivale pendant laquelle les précipitations sont moindres et les besoins en eau tendent quant à eux à augmenter. A signaler tout de même une importante baisse de niveau (de 10 mètres), en juin 2013, sur la station 1305-33233 (Laruscade) visible sur le second graphique. Etant donné que le niveau
- 18. 18 relevé en juillet 2013 est similaire à celui de mai 2013, il semble plus vraisemblable que cette baisse soit le fait d’une erreur de mesure.
- 19. 19 Ainsi, d’après les résultats des suivis des niveaux d’eau mesurés dans les eaux souterraines des 37 points des graphiques précédents, il ne semble pas y avoir eu d’incidence particulière des travaux de la LGV sur le cycle de recharge et de vidange des nappes captées par ces points. Pour certains points de suivi, les niveaux apparaissent stables sur toute la période considérée. En revanche, on ne peut pas conclure quant à l’impact des travaux de la LGV par rapport aux niveaux d’eau habituellement observés pour ces points de suivi. En effet, en l’absence de moyennes interannuelles pour chaque piézomètre, il n’est pas possible de comparer les valeurs mesurées de mai 2012 à novembre 2016 par rapport à un historique de mesures avant le début des travaux de la LGV. Il paraît difficile d’évaluer l’influence des travaux liées à la LGV sur les eaux souterraines concernées d’autant que de nombreux facteurs peuvent influencer le niveau des nappes : des facteurs naturels (précipitations …) et des facteurs anthropiques (usages agricoles, domestiques, industriels, etc.). En effet, les nappes d’eau souterraines constituent des réserves d’eau qui peuvent être exploitées de manière autonome, par des forages privés, notamment pour des usages agricoles, mais également pour l'alimentation en eau potable des populations. D’autre part, le type de nappe captée par chaque point de suivi n’est pas précisé. Il est donc difficile de connaître l’exploitation de la nappe faite par les autres usages. A titre d’exemple, en Poitou-Charentes, 113 piézomètres mesurent le niveau des nappes de manière journalière à raison d’une mesure toutes les heures et cela depuis plus de 20 ans pour de nombreux piézomètres, générant un historique de mesures fiable.
- 20. 20 4.2. La qualité des eaux souterraines La qualité des eaux souterraines est fonction du contexte naturel (contexte géologique des nappes souterraines) mais également de facteurs environnant qui peuvent venir la dégrader (pollution). Dans le cas de la construction d'une infrastructure de transport terrestre, les risques de pollution interviennent essentiellement lors de la phase de travaux en lien avec les installations de chantier (stockage et manipulations de produits polluants comme les hydrocarbures), les eaux de lavage (potentiellement chargées en matières en suspension) et les eaux usées. Les travaux de la LGV SEA peuvent également générer des pollutions indirectes dans les eaux souterraines, comme pour les cours d’eau mais de manière plus différée dans le temps (temps d’infiltration). En effet, les opérations de terrassement favorisent l’érosion des sols, et ceux-ci, potentiellement chargés en polluants, peuvent s’infiltrer vers les nappes, notamment lors d’épisodes pluvieux. Les impacts sont très dépendants de plusieurs facteurs tels que l’existence ou non de formations aquifères, la perméabilité et l'épaisseur des aquifères ou encore les relations existantes entre les nappes d’eau souterraines et les rivières. Pour les secteurs sensibles ou inscrits dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, des préconisations pour empêcher toute pollution ont été faites. Il s’agit par exemple des mesures suivantes : - ravitailler les engins de chantier en dehors des zones sensibles, - installer des tapis filtrants pour retenir les matières en suspension, - mettre en place une collecte des eaux ruisselant sur le chantier et rejetées à l'aval des captages après traitement. 4.2.1. Méthodologie et paramètres étudiés Les mesures du suivi qualitatif des eaux souterraines ont débuté en mai 2012, lors du début de la phase de travaux. Pour les eaux souterraines, il n’y a donc pas « d’état de référence » avant travaux, contrairement au suivi des cours d’eau. Les résultats considérés s’étendent ici sur la période 2012-2016 (résultats partiels pour 2012 avec des relevés s’étalant seulement de mai à décembre ; et pour 2016, de janvier à mars puis en septembre). La fréquence d’échantillonnage, ainsi que les paramètres physico-chimiques analysés varient d’une station à l’autre. Pour chaque échantillon, les mesures portent a minima sur une vingtaine de paramètres, comprenant des paramètres physiques (turbidité, conductivité, pH, température) et la recherche d’hydrocarbures (dissous totaux et 15 HAP1 individuels). Pour certaines stations, notamment les forages privés pouvant être utilisés pour l’alimentation en eau potable, une trentaine de paramètres supplémentaires sont analysés : matières azotées (nitrates, nitrites, ammonium) et phosphorées, éléments minéraux (carbonates, sulfates, chlorures, etc.), métaux et métalloïdes (Cadmium, Fer, Arsenic, etc.), COV2 , paramètres organoleptiques (couleur, odeur) et microbiologiques (bactéries entérocoques et Escherichia coli). Les résultats des analyses pour la turbidité et les hydrocarbures seront uniquement présentés ici, dans la mesure où ces paramètres sont systématiquement analysés dans chaque échantillon, et que leur évolution peut traduire l’éventuel impact (direct et indirect) des travaux de la LGV SEA sur la qualité des eaux souterraines. La turbidité et les teneurs en hydrocarbures des eaux souterraines peuvent varier en fonction de l’intensité des pluies. Ainsi, le cas échéant, les données pluviométriques peuvent être également 1 HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 2 COV : Composé Organique Volatil
- 21. 21 présentées lors de l’analyse de l’évolution des résultats de mesure. Ces données sont produites par Météo France ; la station de mesure pluviométrique « référente » de Bordeaux a été sélectionnée pour le bassin de la Dordogne. Attention, il peut y avoir d’importantes variations de pluies très localisées ; les données pluviométriques mentionnées servent simplement à indiquer une tendance générale sur le bassin. Avertissement : le nombre de mesures effectuées, ainsi que leur fréquence (intra et interannuelle) sont variables d’une station à l’autre, et certaines stations ne présentent pas systématiquement des données chaque année. Cette variabilité induit des difficultés d’interprétation pour traduire et synthétiser l’évolution de la qualité des eaux souterraines (vis- à-vis des paramètres sélectionnés) sur l’ensemble du bassin. Les résultats présentés ci-après doivent donc être pris avec précaution, la représentativité de la situation variant selon la période, et les stations considérées. Ainsi, le nombre d’analyses ou de stations considérées est systématiquement indiqué sur les graphiques d’évolution présentés ci-après. 4.2.2. Turbidité La turbidité traduit le trouble de l'eau et s’exprime en NFU. Elle est due à la présence de matières en suspension entrainées dans les eaux (périodes de pluie), ou à la présence de fer ou de manganèse ou de particules argileuses. Elle constitue l’un des indicateurs de contamination microbiologique, voire chimique de la ressource. Elle peut atteindre 300 NFU pour une eau karstique, 140 NFU pour une eau de surface mais reste faible pour les eaux souterraines profondes (0,2 NFU)1 . 876 analyses de la turbidité ont été réalisées sur le bassin de la Dordogne de 2012 à 2016, toutes stations confondues (39). Les résultats indiquent qu’une grande majorité de mesures (75,8%) sont comprises entre 0 et 2 NFU, et que 13,6% présentent une turbidité comprise entre 2 et 10 NFU. La turbidité dépasse 10 NFU dans 10,6% des cas (dont 7,9% ne dépassant pas 50 NFU). La turbidité moyenne relevée aux différentes stations de mesure est comprise entre 0,72 NFU (août 2015 – 14 stations qualifiées seulement) et 224,05 NFU (octobre 2012 – 25 stations qualifiées). Hormis ce pic de turbidité relevé en octobre 2012, ainsi que quelques hausses moins marquées (autour de 25 NFU en juin et septembre 2012, en mars-avril 2014, ainsi qu’en mars 2016), la turbidité moyenne varie assez peu, évoluant généralement autour de 3 NFU. 1 Source : Agence Régionale de Santé - 2015. La qualité des eaux destinées à la consommation humaine en Poitou- Charentes en 2014. Pourcentages de mesures selon la turbidité (NFU) relevée de 2012 à 2016 sur le bassin de la Dordogne 0 < turbidité ≤ 2 75,8% 2 < turbidité ≤ 10 13,6% 10 < turbidité ≤ 50 7,9% 50 < turbidité ≤ 150 1,1% 150 < turbidité ≤ 300 0,6% turbidité > 300 1,0% Nombre de mesures 876 Nombre de stations qualifiées 39
- 22. 22 Les hausses de la turbidité moyenne du bassin sont induites par des valeurs très élevées sur quelques stations localisées : - à Cubzac-les-Ponts en Gironde (stations PZ1 à PZ8), où la turbidité moyenne de ces 8 stations atteint 690,38 NFU en octobre 2012 (1 seul relevé sur ces stations de 2012 à 2016, durant un mois pluvieux totalisant 115 mm de précipitations), - à Clérac en Charente-Maritime (station 1276-17110 : 10 relevés de turbidité de 2012 à 2016), où la moitié des mesures affiche une turbidité supérieure à 250 NFU, et où de fortes valeurs sont fréquemment relevées : 565 NFU en juin 2012 ; 488 NFU en septembre 2012 ; 264 NFU en septembre 2013, 294 NFU en mars 2014 et 417 NFU en mars 2016. Sur ces deux secteurs, les élévations de la turbidité coïncident généralement avec des précipitations assez importantes. Même si le contexte géologique local (nombreuses fissures, fond géochimique, etc.) a pu amplifier ces hausses, l’éventuelle incidence des travaux de la LGV sur la turbidité des eaux souterraines ne peut être complètement écartée. A noter la présence simultanée d’hydrocarbures relevée dans les échantillons (à forte turbidité) des stations de Cubzac-les-Ponts, mais pas à la station de Clérac.
- 23. 23 4.2.3. Hydrocarbures Les hydrocarbures sont des composés organiques provenant de la distillation du pétrole, généralement utilisés comme carburant ou lubrifiant. Les HAP (sous-famille d’hydrocarbures) sont issus de la combustion incomplète des produits pétroliers. Ces molécules sont généralement reconnues comme toxiques, persistantes dans l’environnement, bioaccumulables et pouvant être transportées sur de longues distances. Des déversements accidentels d'hydrocarbures (engins de chantier) peuvent être à l’ origine de la pollution des eaux. Les dosages en hydrocarbures réalisés ici pour les eaux souterraines portent sur les hydrocarbures dissous totaux (HCT), dont les concentrations sont exprimées en mg/L et sur 15 HAP très répandus (Acénaphtène, Anthracène, Benzo(a)anthracène, Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(ghi)pérylène, Benzo(k)fluoranthène, Chrysène, Dibenzo(a,h)anthracène, Fluoranthène, Fluorène, Indéno (1,2,3-cd)pyrène, Naphtalène, Pyrène, Phénanthrène), avec des concentrations exprimées en µg/L. Les résultats sont présentés ici sous la « somme des 15 HAP », calculée en faisant la somme des concentrations relevées pour chacun de ces 15 HAP dans un même échantillon (lorsque l’analyse d’une molécule est inférieure à la limite de quantification, alors la concentration de cette molécule est considérée comme nulle) A titre indicatif, les résultats sont ici comparés aux limites de qualité appliquées aux eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine (issues de l’arrêté du 11 janvier 20071 ) : - 1 mg/L pour les hydrocarbures dissous - 1 µg/L pour la somme des HAP (même si les 15 HAP recherchés ici ne font pas tous partie de la liste de l’arrêté). 876 analyses portant sur les hydrocarbures (hydrocarbures dissous totaux et 15 HAP) ont été réalisées sur le bassin de la Dordogne de 2012 à 2016, toutes stations confondues (39 au total). Pourcentages de mesures selon les résultats pour les teneurs en hydrocarbures relevées de 2012 à 2016 sur le bassin de la Dordogne Hydrocarbures dissous totaux Somme des concentrations de 15 HAP < seuil quantification 98,29% < seuils quantification 79,45% ≤ 1 mg/L 1,60% ≤ 1 µg/L 20,43% > 1 mg/L 0,11% > 1 µg/L 0,11% Nombre de mesures 876 Nombre de mesures 876 Nombre de stations qualifiées 39 Nombre de stations qualifiées 39 Les analyses réalisées sur les hydrocarbures sont inférieures aux seuils de quantification dans la plupart des cas : sur la quasi-totalité des mesures concernant les hydrocarbures dissous totaux et sur environ 79 % des cas pour les 15 HAP. Et lorsque les analyses peuvent être 1 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465574&dateTexte=20160129 La limite de quantification est la concentration à partir de laquelle le laboratoire menant l’analyse peut indiquer avec une précision satisfaisante la concentration d’une substance. Elle est variable selon les substances et les laboratoires. Une analyse est quantifiée quand le résultat est > seuil de quantification et < au seuil de saturation ou quand le résultat = 0.
- 24. 24 quantifiées, les teneurs relevées sont généralement faibles et restent dans l’ensemble inférieures ou égales à 1 mg/L pour les hydrocarbures dissous ou à 1 µg/L pour la somme des concentrations de 15 HAP. Concernant la somme des 15 HAP, les concentrations moyennes du bassin évoluent généralement autour de 0,03 µg/L, hormis quelques fluctuations, et une hausse plus marquée en octobre 2012 (0,239 µg/L – 25 stations qualifiées), où la présence simultanée de plusieurs HAP a été relevée dans tous les échantillons des 8 stations de Cubzac-les-Ponts. C’est la seule fois où la somme des 15 HAP dépasse 1 µg/L (1,505 µg/L à la station PZ6), de 2012 à 2016. Toutefois, ces 8 stations ont été jugées non représentatives (aspect étrange de l’eau prélevée sur ces zones de marais) et les relevés prévus initialement pour les années suivantes ont ainsi été abandonnés pour ces stations. Plus occasionnellement, d’autres stations sont également concernées par la présence d’hydrocarbures, la somme des concentrations des 15 HAP de l’échantillon dépassant alors rarement 0,1 µg/L. Quant aux hydrocarbures dissous, ils sont rarement quantifiés, la concentration moyenne du bassin semble varier davantage (courbe bleue), mais en fait les pics observés sur le graphique s’expliquent généralement du fait qu’une seule analyse soit quantifiée sur une seule station. Un échantillon indique tout de même 1,03 mg/L, relevé à Saint-André-de-Cubzac en septembre 2013 ; il s’agit de la seule mesure supérieure à 1 mg/L sur la période 2012-2016. Ainsi, au regard des données disponibles, même s’il semble que l’impact des travaux de la LGV sur les teneurs en hydrocarbures des eaux souterraines du bassin ait été plutôt limité, une éventuelle incidence ponctuelle ne peut être complètement écartée.
- 25. 25 SYNTHESE Concernant le bassin versant étudié ici, la Dordogne, des mesures ont été réalisées avant le début des travaux (2009) au niveau des eaux superficielles, puis pendant la phase de travaux, de 2012 à 2016, dans les eaux superficielles et souterraines. Ces mesures permettent d’avoir une première vision d’ensemble des ressources en eau situées à proximité de la LGV SEA, et de suivre leur évolution d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. Cependant, elles n’acquièrent toutes leurs pertinences que dans le cadre d’un suivi régulier à long terme, car les caractéristiques physico-chimiques des milieux, et l’influence de facteurs hydro-climatiques (pluviométrie, températures, débits des cours d’eau, etc.) ou anthropiques peuvent varier fortement selon les périodes. Sur ce bassin, les résultats de suivi ne semblent pas indiquer de dégradation environnementale majeure des eaux superficielles, liée aux travaux de la LGV SEA. En effet, même si les cours d’eau suivis de 2012 à 2016 atteignent rarement le « bon état écologique », ces résultats semblent plutôt conformes dans l’ensemble avec l’évaluation réalisée en 2009, avant travaux. Néanmoins, des altérations ponctuelles de la qualité des habitats, potentiellement engendrées par les travaux, sont tout de même signalées (en 2014) sur 4 des 26 stations du bassin, même s’il semble que ces altérations soient restées temporaires, étant donné que l’état écologie s’améliore ensuite légèrement (en 2015 et 2016) sur ces stations. Par ailleurs, de fortes concentrations de matières en suspension (et de carbone organique dissous) sont parfois relevées sur certaines stations, vraisemblablement en lien avec les travaux de construction (poussières, mobilisation des sédiments, ruissellement…). Et d’autre part, pour la majorité des stations, il semble qu’il y ait depuis 2015, une altération « modérée » des sédiments des cours d’eau par les hydrocarbures (des incertitudes de mesures demeurent). Cette apparente contamination peut être indirectement liée à l'impact du chantier via une mobilisation des sédiments terrestres (potentiellement chargés en hydrocarbures) lors des travaux, ou à l'influence des engins motorisés. La proximité d’axes autoroutiers peut également être une source de contamination. La qualité des eaux souterraines peut être impactée au même titre que celle des cours d’eau, mais a priori de manière plus différée dans le temps (temps d’infiltration) et de façon très dépendante de plusieurs facteurs liés aux conditions intrinsèques de ces ressources (contexte géologique, fond géochimique, perméabilité et épaisseur des terrains encaissants), mais aussi aux conditions climatiques de surface influant sur l’infiltration des eaux (précipitations et évapotranspiration), ou encore aux relations entre nappes souterraines et rivières. Seuls les résultats des analyses pour la turbidité et les hydrocarbures ont été étudiés ici (indicateurs pertinents et meilleure disponibilité de mesures pour ces paramètres). Au regard des données disponibles, même s’il semble que l’impact des travaux de la LGV sur la qualité des eaux souterraines du bassin ait été plutôt limité, des incidences ponctuelles sur la turbidité ne peuvent être complètement écartées. Il semble néanmoins plausible que celles-ci aient aussi été parfois générées ou amplifiées par la conjonction de facteurs naturels (pluviométrie élevée et contexte géologique local). Il en va de même pour les hydrocarbures, dont les teneurs semblent toutefois moins varier, restant souvent cantonnées à de faibles valeurs (sauf exceptions très ponctuelles sur certaines stations). Concernant l’aspect quantitatif des eaux souterraines, il ne semble pas y avoir eu d’incidence particulière des travaux sur le cycle de recharge et de vidange des nappes captées pour les piézomètres étudiés. En revanche, le manque de recul et de données historiques de ces piézomètres ne permet pas d’évaluer avec précision l’influence des travaux sur les niveaux d’eau. D’une manière générale, même s’il semble qu’à ce stade, les précautions prises lors des travaux aient permis d’éviter les effets négatifs sur l’environnement aquatique, le manque de données historiques et/ou les trop faibles fréquences de mesures de certains paramètres ne permettent pas d’avoir suffisamment de recul pour lever les incertitudes liées à la variabilité intrinsèque des conditions d’échantillonnage. De ce fait, il paraît donc difficile de tirer des conclusions définitives quant au potentiel impact de la LGV SEA sur les différentes ressources en eau du bassin. Actuellement, la phase de travaux de la LGV SEA est achevée (été 2016) et la mise en service est effective depuis juillet 2017. Cette étude a vocation à évoluer avec notamment l’intégration de nouvelles données d’année en année qui permettront d’affiner l’analyse de l’impact de la LGV SEA sur l’eau dans sa globalité, en phase de travaux et en phase d’exploitation.
- 26. 26 ANNEXES Tableau récapitulatif de l’état biologique, physico-chimique et écologique pour chaque station de suivi, pour les années 2009 (année de référence), et de 2012 à 2016 (Source des données : Aquabio ; traitement et mise en forme : ARB NA) ND = Non déterminé
