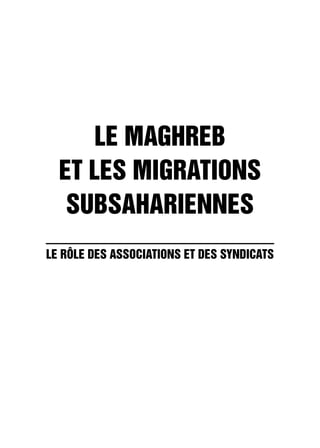
11 le maghreb_et_les_migrations_subsahariennes
- 1. LE MAGHREB ET LES MIGRATIONS SUBSAHARIENNES LE RÔLE DES ASSOCIATIONS ET DES SYNDICATS
- 3. SOMMAIRE Présentation: Préface de l’édition française / Ralf Melzer et Lothar Witte Introduction: La consolidation d’un scénario euro-africain de migrations? / Gemma Pinyol 1ère Partie: TÉMOIGNAGES ET HISTOIRES DE VIE 1.1 La situation des migrants subsahariens au Maroc vécue et racontée par un migrant congolais / Emmanuel Mbolela 1.2 Extraits des interviews avec un visiteur de prison et deux réfugiés ivoiriens en Tunisie / Hassen Boubakri 2ème Partie: LES MIGRATIONS VUES PAR LES ACTEURS 2.1 La situation des migrants subsahariens au Maghreb du point de vue des associations maghrébines / Nadia Khrouz (Association Gadem) 2.2 Les migrations subsahariennes dans la presse quotidienne algérienne / Yassine Temlali 2.3 Le rôle des syndicats maghrébins dans la gestion de la migration subsaharienne / Mustapha Ben Ahmed (UGTT) 3ème Partie: LES MIGRATIONS DANS CHAQUE PAYS DU MAGHREB 3.1 Les migrations subsahariennes en Algérie / Ali Bensaad 3.2 Migration subsaharienne en Libye et contribution des migrants / Laurence Hart 3.3 Les migrants subsahariens au Maroc et leurs droits / Khadija Elmadmad 3.4 Les migrants subsahariens en Mauritanie / Amadou Mbow 3.5 Les migrants subsahariens en Tunisie. Catégories des fl ux et profi ls des migrants / Hassen Boubakri En guise de conclusion: Problématique et modes de coopération / Rafael Bustos et Sami Adouani
- 5. 5 Préface de l’édition française La suppression des contrôles stationnaires aux frontières est sans aucun doute - avec l’introduction de l’euro - l’événement le plus manifeste de l’intégration européenne. Qui aurait pu imaginer que cet acquis, entré en vigueur en 1995 et qui tient son nom de la ville luxembourgeoise de Schengen, puisse être sérieusement mis en question par les bou-leversements survenus dans le monde arabe. Plusieurs dizaines de milliers de réfugiés, en majorité originaires de Tunisie et de Libye, ont débarqué depuis janvier 2011 sur l’île de Lampedusa après avoir risqué leur vie dans une traversée périlleuse. Comparée à une population de plus de 500 millions d’habitants dans les 27 Etats membres de l’UE, cette situation ne constitue, en principe, nullement une raison pour susciter l’alarmisme que répandent certains hommes politiques européens. Mais la décision italienne de délivrer des visas de tourisme aux Tunisiens arrivés à Lampedusa a fait entrer la réalité de la migration irrégulière au coeur de l’UE. Jusqu’à présent, l’Europe n’a guère trou-vé d’autres réponses à ce défi que le repli nationaliste et une mission commune de l’agence « Frontex » en Méditerranée. Heureusement, dans l’opinion publique européenne des voix s’élèvent pour rappeler qu’un nombre beaucoup plus important de personnes avait gagné l’UE lors des bouleversements po-litiques en Europe de l’Est. Plusieurs centaines de milliers de ressortissants des pays du bloc de l’Est, en pleine dissolution, avaient alors quitté leurs pays, notamment pour fuir les guerres qui ravageaient l’ex-Yougoslavie. Heureusement on note aussi des commentaires qui soulignent que ce n’est point l’Europe mais l’Egypte et notamment la Tunisie (avec une population d’en-viron 10,5 millions d’habitants) qui doit supporter le plus lourd fardeau pour venir en aide aux réfugiés libyens. 68.000 travailleurs migrants tunisiens ont quitté, du jour au lendemain, la Libye pour rentrer dans leur pays d’origine – sans avoir pu emporter, pour la plupart d’entre eux, leurs biens et leurs économies. Depuis le début des combats en Libye en février 2011, 680.000 personnes de diff érentes nationalités ont franchi la frontière tuniso-libyenne, dont environ 200.000 ressortissants de pays tiers et 400.000 Libyens (Source : HCR, 7/7/2011). La solidarité dont fait preuve la population tunisienne, si peu de temps après sa propre révolution et en pleine période de bouleversements politiques, mérite toute notre admiration : un grand nombre de réfugiés libyens ont trouvé un logement improvisé dans des appartements inoccu-pés ou ont été accueillis par des familles tunisiennes. Dans certaines villes du Sud tunisien, la population a doublé depuis février. Indépendamment de la situation politique actuelle en Afrique du Nord, la structure de la migration a changé au cours des dernières années : outre la migration des ressortissants du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne vers l’Europe, objet de la plus grande attention, un nombre considérable d’Africains originaires d’Afrique subsaharienne reste désormais au Ma-ghreb. Certains parce qu’ils n’ont pu franchir la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, d’autres parce qu’ils visaient, dès le départ, l’Afrique du Nord ou parce qu’ils avaient décidé, lors de leur séjour, de s’y installer pour une période plus ou moins longue. Le Maghreb est aujourd’hui à la fois pays d’origine, de transit et de destination des fl ux migratoires. Les pays de la région doi-
- 6. 6 vent s’adapter à cette nouvelle donne, relativement récente, et doivent désormais, à leur tour, relever le défi de l’intégration des migrants dans leurs sociétés. Pendant longtemps, les hommes politiques et les milieux scientifi ques ne prêtaient que très peu d’attention aux fl ux migratoires des pays du Sud du Sahara vers l’Afrique du Nord. Pour l’opinion publique européenne, la migration africaine ne présentait un intérêt que si elle était à destination de l’Europe. Dans le passé, les gouvernements européens et nord-africains ont coopéré assez effi cacement afi n de contrôler ces fl ux migratoires pour éviter l’arrivée de ces migrants en Europe. Au cours des dernières années, les drames de réfugiés ne se déroulaient que rarement devant les côtes italiennes ou espagnoles mais le long des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Ceux qui avaient réussi à gagner les pays maghrébins menaient, la plupart du temps, une vie dans l’ombre, dans des conditions d’intégration précaires dans la vie écono-mique et sociale, largement exclus de la vie publique du pays de destination. Une telle vie dans l’ombre comporte le risque d’une exclusion sociale permanente. Aussi, la Fondation Friedrich Ebert s’eff orce, conjointement avec des organisations partenaires, à thé-matiser ces processus de migration dans un débat public, de préférence dans le cadre de notre travail avec les syndicats et les organisations non gouvernementales proches des syndicats. Le choix de cette approche s’explique par le fait que les syndicats défendent traditionnelle-ment aussi les intérêts des travailleurs qui quittent leur propre pays pour s’ouvrir de nouveaux horizons. La protection et la défense des intérêts doivent toutefois aussi inclure les personnes originaires de pays étrangers qui s’installent dans leur pays pour y tenter leur chance. Les syn-dicats représentent les intérêts des salariés et sont de ce fait bien inspirés de faire abstraction des lignes de séparation nationales, de défendre les intérêts de tous les salariés dans leur zone d’infl uence et de contribuer à un équilibre loyal des intérêts. Le projet d’un « Réseau Syndical Euromed » pour la Migration, que la FES-Tunisie est en train de lancer en collaboration avec l’UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail), la confédération syndicale internationale CSI et des syndicats européens, poursuit justement cet objectif. Au cours des dernières années, la Fondation Friedrich Ebert a mis en oeuvre son approche de travail en matière de politique migratoire par le biais d’une collaboration transfrontalière : en Tunisie par exemple en coopération avec le département international de l’UGTT ou dans le cadre des universités d’été, organisées chaque année avec ACMACO (Association Club Mo-hammed Ali de la Culture Ouvrière), une ONG proche du mouvement syndical. Mais égale-ment en Espagne, ce pays européen où les migrants étaient particulièrement bienvenus durant la première décennie du 21ème siècle jusqu’au déclenchement de la crise économique. Le présent livre, fruit de cette approche « transméditerranéenne », est issu d’un séminaire organisé par la FES, en collaboration avec la Fundación Alternativas et la Casa Arabe, en oc-tobre 2009 à Madrid. Outre les analyses et les récits sur les réalités de travail et de vie des mi-grants dans les diff érents pays du Maghreb, ce séminaire a examiné plus en détail les rôles des syndicats, de la société civile et des médias. Les bureaux de la FES à Madrid et à Tunis ont décidé de publier ensemble une version française de l’édition originale espagnole du livre en Tunisie afi n de rendre les résultats du sé-minaire également accessibles aux lecteurs de l’espace francophone et pouvoir les soumettre à discussion en Tunisie et au Maghreb. Ce recueil qui rassemble toutes les communications du
- 7. 7 séminaire est complété par un aperçu de la politique européenne de migration (Situation au début de 2010). Les événements survenus au cours des six premiers mois de l’année 2011 ont engendré indubitablement une mutation profonde des conditions socio-économiques et du cadre po-litico- institutionnel dans les pays d’Afrique du Nord, notamment en Tunisie, en Libye et en Egypte, et jusqu’à présent dans une moindre mesure en Algérie, au Maroc et en Mauritanie. Ces changements se répercuteront bien évidemment sur les réalités de travail et de vie des migrants. Nous pensons toutefois que ce livre qui présente diff érentes études sur les pays ma-ghrébins réalisés avant le « printemps arabe » contribue à une meilleure compréhension de la migration comme phénomène social complexe. Un phénomène qui marquera vraisemblable-ment l’espace euro-méditerranéen dans les années à venir d’une empreinte nouvelle qui n’est guère prévisible aujourd’hui et qui jouera un rôle clé pour atteindre l’objectif d’une « sécurité humaine » commune. Tunis, en juillet 2011 Dr. Ralf Melzer Lothar Witte Représentant Résident Représentant Résident Fondation Friedrich Ebert, Tunisie Fondation Friedrich Ebert, Espagne
- 9. 9 LA CONSOLIDATION D’UN SCENARIO EURO-AFRICAIN DE MIGRATIONS? Gemma Pinyol Jiménez1 1. Introduction En 2005, la croissance des fl ux migratoires à caractère irrégulier qui parvient dans les pays riverains de l’Union Européenne, a mis en relief deux grandes questions. En premier lieu, que les migrations sont un phénomène qu’il convient de traiter de façon globale et deuxièmement, que les fl ux émanant d’Afrique du Nord sont constitués, de plus en plus majoritairement, de ressortissants de pays subsahariens. Par conséquent, les deux ques-tions convergent vers la naissante d’un nouveau scénario migratoire, à caractère euro-africain, dans lequel les fl ux migratoires s’expliquent essentiellement, mais non uniquement, par des raisons économiques. L’instabilité politique, l’absence de développement institutionnel et la faiblesse des politiques sociales constituent d’autres facteurs d’expulsion qui s’étendent au delà du sud du Sahara. Pour l’Union Européenne, la principale préoccupation face à ce phénomène était la pro-tection de ses frontières extérieures, garantissant la sécurité de ses limites maritimes et lut-tant contre les fl ux d’immigration irrégulière en provenance des territoires à l’est et au sud de ses frontières. Toutefois, en 2005, il s’est ajouté une nouvelle préoccupation à cette dimen-sion sécuritaire : celle de tenter d’aff ronter les raisons ultimes qui génèrent les fl ux migratoires, notamment les fl ux à caractère irrégulier. Dans les Conclusions de la Présidence du Conseil européen de Bruxelles (15 et 16 décembre 2005), le Conseil met en place son “Approche glo-bale des migrations” et présente en annexe à celle-ci, sa “Vision globale des migrations : ac-tions prioritaires centrées sur l’Afrique et le bassin méditeranéen”. Les deux documents re-prennent la préoccupation de l’Union Européenne de doter les politiques d’immigration d’une dimension extérieure cohérente, tout en établissant parallèlement que tant la Méditerranée que l’Afrique sont devenues des régions prioritaires dans ce cadre. Ainsi, la transformation des pays d’Afrique du nord en région non seulement d’immigration, comme elle l’avait toujours été traditionnellement, mais également de transit, apparaît clairement. Pour les pays d’Afrique du nord, ceci signifi e l’apparition de nouveaux défi s ; et pour l’Union Européenne, la constatation qu’il convient de modifi er considérablement le dialogue avec cette région et que la coopération avec les pays d’origine devrait également s’étendre au plan géographique. Ainsi, un scénario euro-africain de migrations commence à se dessiner. Diverses études (Lahlou, 2004 ; Haas, 2007 et Bossard, 2007) confi rment qu’il y a eu une augmentation considérable des fl ux migratoires entre les pays d’Afrique sub-saharienne et l’Europe, qui a en outre transformé les pays nord-africains en territoires de transit. Cette trans-formation en pays de transit et de destination, a poussé ces pays à relever des défi s migratoires encore inconnus jusqu’ici : dans la mesure où il s’agissait de pays majoritairement d’origine, leurs politiques migratoires n’étaient pas destinées à contrôler l’entrée par leurs frontières ni à
- 10. 10 accueillir une population migrante nombreuse qui s’établit temporairement dans les villes les plus proches des frontières, avec toute la pression que cela peut comporter en termes de consé-quences sur la vie quotidienne des villes et leurs services publics. La majorité des immigrants africains résident dans les pays européens pour des raisons de proximité géographique, mais également en raison de l’existence de liens historiques et cultu-rels avec les anciennes puissances coloniales. Selon l’Organisation internationale des migra-tions (OIM), en 2005, près de 4,5 millions d’africains résident légalement dans les pays euro-péens (moins d’un million aux Etats-Unis) et près des deux tiers de ceux-ci sont originaires des pays d’Afrique du Nord. La capacité d’attraction de l’Union Européenne pour les migrants des pays d’Afrique sub-saharienne n’a cessé d’augmenter depuis ces dernières années et toujours selon l’OIM, entre 65.000 et 80.000 personnes traversent annuellement le Sahara dans leur ten-tative d’atteindre l’Europe. Les Ghanéens, Nigérians, Sénégalais, Maliens ou Capverdiens font partie des principaux groupes que l’on observe aujourd’hui dans les pays européens. Carte 1. Les principales routes migratoires dans le cadre du scénario euro-africain Fuente: BBC News: Key facts: Africa to Europe Migration, 2007 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6228236.stm La présence et la continuité de ces fl ux indiquent que les liens entre les pays d’origine, de transit et de destination ont augmenté considérablement au cours de ces dernières années, et il semblerait que ceux-ci se poursuivront à court et moyen termes. L’existence de certains désé-quilibres de plus en plus aigus entre les deux rives de la Méditerranée et au-delà, permettent de supposer que les facteurs d’attraction et d’expulsion des fl ux migratoires se maintiendront et avec eux, les dynamiques migratoires actuelles. La Méditerranée, de plus en plus connue comme le Río Grande européen, s’est transformée en l’une des frontières inter-régionales actuelles les plus dynamiques.
- 11. 11 Jusqu’à la deuxième moitié de la décennie 2000, les pays d’Afrique du Nord avaient centré toute l’attention des pays de l’Union en termes migratoires ; mais l’année 2005 a représenté la découverte, de la part de l’Union Européenne, de l’immigration sub-saharienne. En raison de l’augmentation des fl ux mais également, notamment, en raison de l’impact social et média-tique des circonstances diffi ciles dans lesquelles se trouvent ceux qui souhaitent atteindre les frontières européennes par voie maritime, 2005 a été défi ni comme l’année pour l’Afrique et a marqué le début d’une nouvelle période de relations et de collaboration avec les pays africains, mettant de plus en plus l’accent sur la gestion de l’immigration. A partir de là, parler de fl ux migratoires en Méditerranée suppose l’inclusion de la dimension euro-africaine. Ce qui sup-pose également un nouveau défi pour l’Union Européenne. 2. Les progrès en termes de mise sur pied d’une politique européenne de l’immigration En 1993, le Traité de Maastricht offi cialise la coopération des gouvernements européens en termes de justice et de politique intérieure et permet d’inclure l’immigration et l’asile comme thèmes qui, étant d’intérêt commun, doivent être abordés dans le cadre de l’UE. Toutefois, c’est en 1999, avec l’approbation du Traité d’Amsterdam, qu’une partie des politiques liées aux questions de justice et de politique intérieure, dont le contrôle des frontières, l’immigration et l’asile, passe au premier rang. Afi n d’impulser au niveau politique maximal la création de ‘l’Espace de liberté, de sécurité et de justice’, un Conseil européen extraordinaire a lieu au mois d’octobre de cette année, visant à élaborer le plan d’action quinquennal. Le Conseil de Tempere reconnaît la nécessité pour l’UE d’élaborer des “politiques communes dans les domaines de l’asile et de l’immigration, tout en tenant compte de la nécessité d’exercer aux frontières extérieures un contrôle cohérent afi n de stopper l’immigration clandestine et de s’opposer à ceux qui l’organisent et commettent ainsi des infractions relevant de la criminalité internationale”. A cet eff et, quatre éléments essentiels pour la conception d’une politique européenne commune sont mis en relief : (1) la nécessité d’une approche globale de la coopération avec les pays d’origine et de transit ; (2) l’élaboration d’un régime d’asile européen commun ; (3) l’importance d’assurer un traitement équitable aux ressortissants des pays tiers qui résident dans l’UE et (4) la gestion effi cace des fl ux migratoires. A partir du Conseil européen de Tampere, la Commission commence à travailler sur l’harmonisation des aspects concrets, notamment le regroupement familial ou le statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, en proposant des normes minimales communes qui permettraient d’avancer sans plus attendre. Les réticences des Etats membres à céder des compétences dans le domaine des politiques d’immigration expliquent les diffi cultés à obtenir des accords unanimes et l’inclusion d’un nombre croissant d’exceptions nationales dans les directives. En 2004, le Conseil européen adopte le Programme de La Haye, visant à apporter une conti-nuité au programme de Tampere en termes de renforcement de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice pour la période 2005-2009. Bien plus spécifi que que l’accord précédent, le Pro-gramme de La Haye défi nit une série d’orientations concrètes en vue d’une approche globale du phénomène migratoire, ce qui signifi e la prise en compte, dans le cadre de la mise en place
- 12. 12 de la politique européenne d’immigration, de toutes les dimensions du phénomène migratoire, qu’il s’agisse des raisons des fl ux ou des politiques d’admission et de retour ou encore des ins-truments d’intégration. Le programme de travail s’insère dans un nouveau cadre institutionnel, dans lequel le Parlement européen peut prendre une décision conjointe dans les domaines tels que la gestion de l’immigration irrégulière. Suite à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009 et l’approbation du nouveau Programme de Stockholm à la fi n de 2009, l’Union Européenne commence une nouvelle étape avec une architecture institutionnelle ré-novée dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (LSJ). Le Traité de Lisbonne signifi e la communautarisation des politiques dans ce domaine et surpasse la division précé-dente entre le premier et le deuxième pilier qui apportait une complexité juridique et institu-tionnelle supplémentaire et les dote d’une identité propre. Ainsi, l’article 3 du Titre I du Traité indique qu’un des objectifs de l’Union consiste à off rir à ses citoyens “un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène”. Parallèlement à ce développement institutionnel, en 2005, l’Union Européenne présente l’Approche globale en matière d’immigration. Cette Approche globale se transforme ainsi en un nouvel instrument reprenant les eff orts qui, dans le passé, avaient été déployés afi n de lier la politique migratoire aux autres instruments communautaires. Ainsi, déjà lors du Conseil européen de Laeken (2001) et ultérieurement, lors du Conseil européen de Séville (2002), les pays membres relèvent le défi de parler de l’immigration dans un cadre plus large. Sous la présidence espagnole de 2002, l’ancien président de la Commission, Romano Prodi, exprime sa satisfaction du rôle octroyé à l’immigration lors du Conseil de Séville : “j’accueille avec une immense satisfaction votre décision qu’à Séville nous abordions les préoccupations compré-hensibles de nos citoyens au sujet de l’immigration illégale et du trafi c des personnes. A moins que nous soyons en mesure de trouver des réponses effi caces à ces problèmes, il sera de plus en plus diffi cile de mener à bien le débat nécessaire sur la façon de gérer la migration légale et la façon de respecter nos obligations dans le cadre de la Convention de Genève. (…) J’ai pensé qu’il serait peut-être utile de suggérer quelques points concrets que j’aimerais voir abordés à Séville et dont je suis convaincu qu’ils nous permettront d’envoyer le type de signaux positifs que les personnes attendent : - nous devons renforcer le contrôle des frontières extérieures, en élaborant une approche intégrée et globale de ‘stratégie de frontières’ pour l’UE. (...)”1. Toutefois, il a fallu attendre trois ans pour que, de nouveau, l’Union Européenne se pose la nécessité d’aborder de façon plus intégrale les politiques d’immigration. C’est en 2005, dans un contexte marqué par la pression croissante des fl ux migratoires à caractère irrégulier au ni-veau des frontières méridionales de l’Union Européenne - Lampedusa, Malte, les îles grecques orientales ou les îles Canaries – et en raison des assauts sur les enceintes de Ceuta et Melilla, qu’a émergé la nécessité d’articuler des réponses cohérentes et coordonnées en matière de contrôle des frontières maritimes dans le cadre de l’Union Européenne (Kohnert, 2007). En outre, il convient d’articuler un dialogue sur les thèmes migratoires avec les pays d’origine et de transit et, tout particulièrement, de mettre en place un cadre de références et de dialogue commun avec les pays d’Afrique du Nord et leurs voisins les plus immédiats. Ainsi, la ‘crise des 1 Lettre de Romano Prodi, Président de la Commission Européenne. Conseil européen de Sé-ville sur l’immigration illégale. Séville, 21 et 22 juin 2002. Il est possible de la consulter sur http:// ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/immigration/letter_en.htm
- 13. 13 ‘pirogues’2 en 2006, confi rme une nouvelle route atlantique des fl ux d’immigration irrégulière, qui arrivent aux Canaries depuis le Maroc, mais de plus en plus fréquemment, depuis des pays comme la Mauritanie et le Sénégal (Spijkerboer, 2007). Les villes portuaires de ces pays, aux-quelles très rapidement s’ajoutent également le Mali, la Guinée ou la Gambie, se transforment en point de départ du dernier tronçon de l’une des routes, qui, très souvent, a débuté à des milliers de kilomètres auparavant dans d’autres pays africains et, dans certains cas, dans des pays asiatiques. Les diff érents événements de 2005 ont permis de mettre en relief que la frontière sud de l’Union Européenne constituait non seulement une division géographique mais également une profonde séparation en termes d’attentes de richesse et de bien-être. Une ouverture de possi-bilités qui sépare l’Union Européenne du Maroc, mais encore plus des pays d’Afrique sub-sa-harienne. Pour les pays de l’Union Européenne il est apparu clairement qu’afi n de relever les défi s du phénomène migratoire, régulier et irrégulier, il était essentiel de travailler avec les pays d’origine et de transit. De même que le fait d’assumer que leur développement peut se transfor-mer en élément clé de la gestion des fl ux migratoires vers l’Union Européenne (Terrón, 2004). 3. La dimension extérieure de la politique d’immigration européenne En 2005, l’Espagne accorde la priorité à la nécessité de lier la politique migratoire à l’ac-tion extérieure, notamment en faisant référence à l’Afrique de l’Ouest. D’autres pays commu-nautaires et l’Union Européenne oeuvrent dans la même ligne d’idée. C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la proposition conjointe de l’Espagne, de la France et du Maroc d’or-ganiser une Conférence ministérielle euro-africaine sur la Migration et le développement. La Conférence de Rabat, tenue au mois de juillet 2006, réunit les pays d’origine, de transit et de destination migratoire d’Europe, du Maghreb et d’Afrique centrale et de l’Ouest (Noll, 2006), ce qui constitue un jalon notable. Bien que la logique des déclarations ait eu un impact plus important que les mesures spécifi ques, cette conférence représente un “élan pour l’européa-nisation de la politique de coopération migratoire avec l’Afrique”3 et permet de consolider l’existence d’un scénario euro-africain des migrations. De son côté, dans le scénario purement communautaire, la Commission européenne pré-sente, en 2005, plusieurs communications qui infl uent sur la dimension extérieure des poli-tiques d’immigration, suivant la logique instaurée lors du Conseil de Tampere de 1999. Au mois de septembre, la Commission adopte la communication 390 sur “le lien entre migration et développement”, qui indique l’impact que le développement économique et social et la pro-motion des droits civils peut avoir sur la baisse des fl ux migratoires, alors qu’au mois d’octobre de la même année, elle présente la communication 491 sur “Une stratégie relative à la dimen-sion externe de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice” et la communication 621 sur les “Priorités d’action en vue de relever les défi s liés aux migrations : première étape du processus de suivi de Hampton Court”. Lors de cette étape, qui reprend la contribution positive des mi-grations tant d’origine que de destination, la Commission évoque également la nécessité de lier 2 La route des ‘pirogues’, bien plus vaste, ardue et dangereuse que la route méditerranéenne des ‘pateras’, s’est développée de façon spectaculaire. En 2005, près de 5.000 personnes ont atteint les côtes des Canaries par cette route, alors qu’entre janvier et décembre 2006, près de 30.000 immi-grants clandestins y étaient parvenu. 3 Plan Afrique 2006-2008. Résumé. Ministère des Affaires extérieures et de la coopération.
- 14. 14 la migration au développement, d’améliorer la coopération entre les Etats membres par le biais de FRONTEX et d’améliorer la collaboration et le dialogue avec les pays d’origine. Tous ces éléments se concrétisent à la fi n de 2005 dans les Conclusions du Conseil européen de Bruxelles, les 15 et 16 décembre. L’annexe sur “l’Approche globale de la migration”, avance l’importance croissante des migrations pour l’Union Européenne et ses Etats membres et leur rôle vital dans les relations avec les pays tiers, notamment des régions voisines : “Le Conseil européen constate que les questions liées aux migrations sont de plus en plus importantes pour l’UE et ses Etats membres et que les événements survenus récemment ont suscité une inquiétude croissante dans l’opinion publique de certains Etats membres. Il insiste sur la nécessité de mettre en place une approche équilibrée, globale et cohérente, comprenant des politiques destinées à lutter contre l’immigration illégale et permettant, en coopération avec les pays tiers, de tirer parti des avantages de l’immigration légale. Il rappelle que les ques-tions liées aux migrations constituent un élément essentiel des relations entre l’UE et un grand nombre de pays tiers, y compris, notamment, les régions voisines de l’Union, à savoir les ré-gions situées à l’est et au sud-est ainsi que le bassin méditerranéen et il note combien il est im-portant de veiller à ce que des ressources fi nancières suffi santes soient aff ectées à ces politiques. L’UE renforcera son dialogue et sa coopération avec tous ces pays sur les questions liées aux migrations, y compris la gestion des retours, dans un esprit de partenariat et compte tenu des conditions propres à chaque pays concerné”4. Les dernières avancées législatives de l’Union Européenne mettent en évidence l’inclusion de l’immigration dans les relations avec les scénari voisins, notamment dans les pays du scé-nario afro-méditerranéen. La communication 735 du mois de novembre 2006 sur “L’approche globale de la question des migrations un an après : vers une politique globale européenne en matière de migrations” a confi rmé que les thèmes migratoires devaient être inclus dans les plans d’action de la Politique européenne de voisinage (PEV) et dans le cadre Euromed (Doukouré et Oger, 2007), de même que dans le dialogue politique périodique avec tous les pays ACP (pays d’Afrique-Caraïbes-Pacifi que), selon l’article 13 de l’Accord de Cotonou. Dans le cas de la Politique européenne de voisinage, en mai 2007, la communication 247 sur “l’Ap-plication de ‘l’approche globale de la question des migrations’ aux régions de l’est et au sud-est de l’Union européenne”5, est présentée alors que pour les pays ACP, à la fi n de 2006, une confé-rence ministérielle UE-Afrique sur la migration et le développement se tient à Tripoli. Les élans de cette première période (2005-2008) retombent progressivement et peu d’avan-cées notables sont réalisées depuis et jusqu’à présent. L’Union Européenne a mis en route des plans pilote de mobilité (dont l’un d’entre eux avec le Cap Vert), a mené à bien plusieurs mis-sions migratoires dans les pays subsahariens et a mis en place des initiatives comme la propo-sition de la Commission intitulée “Renforcer l’approche globale de la question des migrations : accroître la coordination, la cohérence et les synergies” (COM (2008) 611). Mais pratiquement rien de plus. Les initiatives présentées ne sont pas allées, jusqu’à présent, bien au-delà de la logique des déclarations. Conclusions : les faiblesses d’un scénario euro-africain institutionnalisé 4 Conclusions de la Présidence. Conseil européen de Bruxelles, 15 et 16 décembre 2005. 5 Dans la communication, les pays du Moyen-Orient partenaires de la PEV sont indiqués: Syrie, Jordanie et Liban.
- 15. 15 En 2005, il semblait que l’Union Européenne avait commencé à prêter une attention re-nouvelée aux pays subsahariens et enfi n, à ses voisins méditerranéens, grâce au phénomène des migrations. Entre 2005 et 2008, l’immigration sert à stimuler l’action extérieure de l’Union européenne et à la rapprocher de nouveaux scénari. Cette ‘diplomatie migratoire’ est novatrice tant en termes de défi nition de nouveaux pays d’attention prioritaire qu’en termes d’impor-tance qu’acquiert le phénomène migratoire dans le cadre des relations extérieures, notamment pour les pays frontaliers comme l’Espagne. Pour le gouvernement espagnol, la mise sur pied d’un scénario euro-africain des migrations confi rme la nécessité d’articuler un dialogue plus important et plus développé entre les pays d’origine et de destination des fl ux migratoires, sans oublier la participation des pays de transit dans ce dialogue : “L’Espagne a assumé une position de leader au sein de l’Union Européenne, par le biais de la création d’une doctrine pour l’appro-bation de l’Approche globale sur la question des migrations, et a élaboré un concept novateur de responsabilité partagée entre les pays d’origine, de transit et de destination dans la gestion des fl ux migratoires au moyen de ‘l’esprit de Rabat’ qui émane de la Conférence ministérielle de juillet 2006”6. Depuis 2005, l’Union Européenne a sans cesse mis l’accent, en parlant de l’immigration vers l’Europe, sur l’importance des pays subsahariens, pariant sur la promotion d’une politique commune qui renforcerait les relations avec les pays tiers et qui, à son tour, promouvrait la collaboration et la solidarité entre les Etats membres. En outre, toutes les initiatives confi rment que l’Union Européenne avait une occasion clé pour mettre en place un espace de dialogue et de coopération qui lierait les pays européens de destination aux pays d’origine et de transit d’Afrique du Nord et du sud du Sahara. Toutefois il semblerait que le rythme des initiatives ait baissé au cours de ces deux der-nières années. Mais pas uniquement : il semblerait que la triangulation souhaitée, entre l’Union Européenne, l’Afrique du Nord et les pays sub-sahariens, ne soit pas allée au delà de la logique des conférences. Ainsi, les dialogues de l’Union Européenne avec ses voisins méditerranéens fonctionnent dans un cadre distinct des relations avec les pays sub-sahariens, ce qui a aff aibli le dialogue triangulaire qui semblait naître au cours des années 2005-2008. Le fait qu’existe, en tant que tel, un scénario euro-africain des migrations n’implique pas, pour autant, que celui-ci comprenne une dimension ‘institutionnalisée’. En marge des confé-rences sur les migrations tenues au cours des deux dernières années (la Conférence de Rabat ou la Conférence de Lisbonne) dans le cadre du scénario euro-africain, le reste des initia-tives qui existe dans ce scénario n’aff ecte qu’un ou plusieurs pays participants. Jusqu’à présent, l’Union Européenne a établi des relations de collaboration et de coopération sur les thèmes de l’immigration avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, par le biais du Partenariat euro-méditerranéen et de la Politique européenne de voisinage. Il apparaît également clairement que les migrations ont acquis une importance considérable dans le cadre du dialogue entre les pays de l’Union européenne et les voisins sub-sahariens. Toutefois, en marge des déclarations, les actions ressemblent plutôt à un monologue qu’à un dialogue, dans lequel l’Union Européenne mène la danse. Le fait de demander aux pays du sud de la Méditerranée et au-delà de participer à la gestion conjointe des fl ux migratoires ne peut impliquer, uniquement, l’imitation ou l’utilisation des instruments européens. A cet égard, 6 Conclusions de la Réunion des Ambassadeurs d’Espagne en Afrique subsaharienne. Las Pal-mas, 11-13 juin 2007. Ministère des Affaires extérieures et de la coopération.
- 16. 16 il convient de renforcer les instruments qui améliorent les relations entre l’Union Européenne, les pays du sud de la Méditerranée et les pays du sud du Sahara, mais ces derniers devraient également mettre en place des mécanismes afi n d’établir des voies de dialogue et de coopéra-tion entre eux. A cet eff et, il convient de promouvoir une plus grande connaissance du phénomène migra-toire dans son ensemble, mais également son impact sur les marchés du travail d’origine, de transit et de destination, de même que l’impact et les conséquences de la mobilité du capital humain dans les régions. Il convient en outre de dépasser l’absence de vision partagée sur le phénomène migratoire dans le cadre de ce scénario : pour l’Union Européenne, les priorités se concentrent sur le contrôle des fl ux migratoires, alors que la principale préoccupation de nombreux pays africains est le développement, qui les pousse à exiger des opportunités plus grandes. La mise en route d’un cadre de dialogue structuré à caractère triangulaire semble être le point de blocage de ce scénario euro-africain de migrations. A cet égard, il conviendrait de trouver les points d’intérêt commun comme la lutte contre les réseaux de trafi c et de contre-bande de personnes. Dans tous les cas, le fait de répondre aux attentes de la majorité des pays impliqués constituerait un défi vital pour pouvoir parler d’un scénario euro-africain de migra-tions qui serait plus qu’une simple réalité géo-démographique.
- 17. 17 Références bibliographiques : Documents offi ciels : Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (2007): Resolución sobre “Migration of skilled workers and its eff ects on national development”. (ACP-EU/100.012/07/fi n.), 28 junio 2007. Comisión Europea (2005): Comunicación “El nexo entre migración y desarrollo”. COM 390 fi nal, 2005. Comunicación “Una estrategia sobre la dimensión exterior del Espacio de Libertad, Segu-ridad y Justicia”. COM 491 fi nal, 2005. Comunicación “Prioridades de actuación frente a los retos de la inmigración: Primera eta-pa del proceso de seguimiento de Hampton Court”. COM 621 fi nal, 2005. Comisión Europea (2006): Comunicación “El planteamiento global sobre la migración un año después: hacia una política global europea en materia de migración”. COM 735 fi nal, 2006. Comisión Europea (2007):_Comunicación “Aplicación del «Planteamiento global sobre la migración» a las regiones orientales y sudorientales vecinas de la Unión Europea”. COM 247 fi nal, 2007. Comisión Europea (2008): Comunicación “Reforzar el planteamiento global de la migra-ción: aumentar la coordinación, la coherencia y las sinergias”. COM 611 fi nal, 2008. Comunicación “A common immigration policy for Europe: principles, actions and tools”. COM 359 fi nal, 2008. Comisión Europea (2009): Comunicación “Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos”. COM 262 fi nal, 2009. Comunicación “Justicia, libertad y seguridad en Europa desde 2005: Una Evaluación del Programa de la Haya y del plan de acción”. COM 263 fi nal, 2009. Consejo Europeo (1999): Conclusiones de la Presidencia. Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999. Consejo Europeo (2001): Conclusiones de la Presidencia. Laeken, 14 y 15 de diciembre de 2001. Consejo Europeo (2002): Conclusiones de la Presidencia. Sevilla, 21 y 22 de junio de 2002. Consejo Europeo (2005): Anexo sobre “Enfoque Global de la Migración”. Conclusiones de la Presidencia. Bruselas, 15 y 16 de diciembre de 2005. European Pact on Immigration and Asylum. Bruselas, septiembre de 2008. Disponible en: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13440.en08.pdf Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2005): Plan África 2006-2008. Resumen ejecutivo.
- 18. 18 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2007): Conclusiones de la Reunión de Embajadores de España en África subsahariana. Las Palmas, 11-13 de junio de 2007. Programa de Estocolmo. Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano. 2010/C 115/01. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C :2010:115:0001:0038:ES:PDF Tratado de Lisboa. Diario Ofi cial C-306/61, Bruselas, 17 de diciembre, 2007. Sources secondaires : Barros L., Lahlou M. et alt. (2002): “L’immigration irrégulière sub-saharienne a travers et vers le Maroc”. Cahiers des Migrations Internationales, 54F, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. Bossard, L. (2007) Th e Future of International Migration to OECD Countries. Regional Note on West Africa. OECD, Paris. Carrera, S. (2007): “Th e EU Border Management Strategy: FRONTEX and the Challenges of Irregular Immigration in the Canary Islands”. CEPS Working Documents, nº 261. CEPS, Bruselas. Docquier, F., y Marfouk, A. (2006): “International Migration by Educational Attainment, 1990-2000”, en C. Ozden y M. Schiff , (eds), International Migration, Remittances and Brain Drain. Washington D.C.: World Bank y Palgrave Mc Millan. Fargues P. (dir.), 2006, Migrations méditerranéennes : Rapport 2005, EUI/EUROMED, Bruxelles. Haas, H. de (2006): “Trans-Saharan Migration to North Africa and the EU: Historical Roots and Current Trends”. Migration Information Source Haas, H. de (2007): “Th e myth of invasion. Irregular migration from West Africa to the Maghreb and the European Union”. IMI research report Kohnert, D. (2007): “African Migration to Europe: Obscured Responsabilities and Com-mon Misconceptions”. GIGA Working Papers, nº49. Lahlou, M. (2004) : Le Maghreb, nouveau espace d’immigration”. Ponencia presentada en el Congreso Mundial de Movimientos Humanos y Migraciones. Barcelona 2-5 Septiembre 2004. http://www.iemed.org/mhicongress/ Martín, I. (2009): Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab Mediterra-nean Countries: A Regional Perspective. Final Report. Florence: European University Institute. Moratinos, M.A. (2006): España: una nueva política exterior hacia África. Política Exterior, 111, mayo-junio, p. 57-63. Noll, G. (2006): Th e Euro-African migration conference: Africa sells out to Europe. Open Democracy, 14 July 2006.
- 19. 19 Pinyol, G. (2007): “España en la construcción del escenario euroafricano de migraciones”. Revista CIDOB d’afers internacionals, nº 79-80, p. 87-105. Sorroza, A. (2006): “La Conferencia Euroafricana de Migración y Desarrollo: más allá del ‘espíritu de Rabat’. ARI nº93/2006. Real Instituto Elcano, Madrid. Spijkerboer, T. (2007): “Th e Human Costs of Border Control”. European Journal of Migra-tion and Law, 9, p. 127-139. Terrón, A. (2004): “Migraciones y relaciones con países terceros. El caso de España”. Docu-mentos CIDOB Migraciones, nº 2. CIDOB, Barcelona. Zapata-Barrero, R. y De Witte, N. (2007): “Th e Spanish Governance of EU borders: Norma-tive Questions”. Mediterranean Politics, 12:1, p. 85-90.
- 21. 1ère Partie : Témoignages et histoires de vie
- 23. 23 LA SITUATION DES MIGRANTS SUBSAHARIENS AU MAROC VECUE ET RACONTEE PAR UN MIGRANT CONGOLAIS Emmanuel Mbolela (Réfugié, Congo) L’Afrique du sud du Sahara se trouve depuis l’accession à l’indépendance de la plupart de ses pays dans les années 1960, dans une situation de sous – développement carac-térisé notamment par une pauvreté en pleine progression, comme nulle part ailleurs dans le monde. A la situation d’extrême indigence provoquée notamment par des causes à la fois internes (mauvaise gouvernance où excellent ses dirigeants) et externes (multiples interférences exté-rieures aussi bien politique, du temps de la guerre froide, qu’économiques de l’ère actuelle de la mondialisation)7 se sont ajoutés depuis ces dernières années des confl its armés aggravant ainsi la misère et plaçant la population dans une incertitude d’avenir sans précèdent. Dans cette conjoncture et en l’absence de perspectives crédibles pour se réaliser, les hommes et les femmes, en majorité des jeunes, sont obligés d’émigrer. Cette émigration qui débute souvent par un exode rural pour se terminer dans le pays voisin, s’est prolongée, à cause de la généralisation de la crise dans toute la région de l’Afrique subsaharienne vers les pays lointains. Ainsi depuis l’an 20008 on assiste à l’émigration massive de ces jeunes vers les pays du Maghreb avant qu’ils prennent la direction de l’Europe. Car ils pensent avec raison que l’Europe off re des perspectives de réalisation, d’accomplissement et de reconnaissance qu’il est impossible de trouver dans leurs pays d’origine.9 A cause du manque de moyens légaux pour voyager, dû notamment au durcissement des conditions d’obtention du visa, les migrants sont contraints d’emprunter des chemins qui ne sont pas à l’abri du danger. Ils sont victimes de toutes sortes d’atrocités : atteintes aux droits hu-mains, vols et arnaques. Les femmes sont assujetties à plusieurs formes de violences et essen-tiellement le viol déclenchant diverses maladies. Leurs enfants sont exposés aux intempéries, à la diarrhée et au décès pour les plus faibles, puisque sans accès aux soins de santé tout au long de leur parcours. Les femmes se trouvent dès lors souvent contraintes à se prostituer. Beaucoup ont ainsi des grossesses non désirées et certaines sont alors obligées plus tard d’avorter dans des conditions inhumaines, ce qui engendre la mort subite de plusieurs d’entre elles.10 Au terme de ce pénible cheminement sur une durée 15 à 21 mois, les migrants après la tra-versée du désert du Sahara, parviennent pour la plupart à atteindre le territoire maghrébin qui 7 Houria Alami M’chichi, Bachir Hamdouch et Mehdi Lahlou: Rapport « Le Maroc et les Migrati-ons », Friedrich Ebert Stiftung-Maroc, Rabat 2005. 8 Hein de Haas: « Rapport sur la Migration irrégulière d’Afrique occidentale en Afrique du nord : une vue d’ensemble ». Publication de l’OIM, 2008. 9 Anne–Sophie Wender: Rapport sur la situation alarmante des migrants subsahariens en tran-sit au Maroc et les conséquences des politiques de l’Union Européenne, publié par Cimade en 2005. 10 Anne–Sophie Wender: « Témoignage d’une réfugiée congolaise à la formation d’asile – Ma-roc », organisé en 2005 à Bouzinika au Maroc. Voir l’acte de formation.
- 24. 24 sert de transit pour accéder à l’Europe. Comment l’arrivée des subsahariens dans le Maghreb est-elle perçue dans cet espace et comment réagissent les pays maghrébins à la présence de migrants subsahariens face aux nouvelles politiques de l’Europe face à cette problématique? C’est sur cette question que portera la quintessence de mon intervention, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et l’organisation des migrants dits irréguliers. Je donnerai un accent particulier à la situation du Maroc où j’ai vécu comme réfugié pendant quatre ans et créé une organisation de défense de droits et libertés de réfugiés et demandeurs d’asile. Et je terminerai par quelques propositions pour aider les organisations non gouvernementales travaillant sur la migration. La vie des migrants subsahariens au Maroc Signalons d’abord que les causes d’émigrations précitées nous permettent de distinguer deux catégories de migrants se trouvant actuellement au Maroc. Nous citerons d’une part les réfugiés et demandeurs d’asile et d’autre part les migrants dits économiques. Les réfugiés et demandeurs d’asile Les réfugiés sont des personnes qui ont été forcées de quitter leur pays pour des raisons de menaces et/ou de persécutions politiques, sociales ou résultant de confl its armés, et qui sont empêchées d’y retourner suite à la persistance de ces menaces. Ils ont demandé et obtenu le statut de réfugiés à la représentation du Haut Commissariat aux Réfugiés (H.C.R) au Maroc. Ils se diff érencient des demandeurs d’asile dans le sens que ces derniers ont demandé l’asile et attendent encore la décision des instances compétentes, notamment du Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés pour le cas du Maroc où la procédure d’asile est quasiment inexistante, malgré le soutien du Bureau des Réfugiés et Apatrides placé sous la tutelle du mi-nistère des aff aires étrangères et de la coopération internationale. On estime à ce jour à 823 le nombre de ceux qui ont obtenu leurs statuts de réfugiés dont 197 enfants soit 24%, et 248 femmes environ, c’est-à-dire 31 %. Les demandeurs d’asile quant à eux s’élèvent à 485. Parmi lesquels il y a ceux dont les demandes sont à l’étude et d’autres en appel. La majorité des réfugiés fuit des pays ravagés par la guerre comme la Côte d’Ivoire 35 %, la République Démocratique du Congo 28 %, l’Irak 14 % ; les autres sont issus du Libéria, du Rwanda, de la Palestine, de l’Algérie et de la Sierra Leone.11 Quant au Maroc, bien que les réfugiés et demandeurs d’asile subsahariens qui représentent d’ailleurs un nombre très infi me par rapport aux autres migrants, soient reconnus par le HCR, ils ne bénéfi cient d’aucune protection juridique de la part des autorités marocaines qui refusent de reconnaître leur présence. Ce qui se manifeste par le refus de leur accorder la carte de séjour et le titre de voyage, comme prévu par la convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés et ratifi ée par le Maroc. Et en dépit de la signature de l’accord de siège intervenu depuis le 20 juillet 2007 entre le HCR et le gouvernement marocain, ce dernier n’accepte toujours pas de valider le statut de réfugiés délivré par le HCR, ce qui place les réfugiés dans une situation telle qu’ils ne peuvent 11 Bureau du HCR au Maroc.
- 25. 25 pas bénéfi cier de leurs droits notamment en matière de séjour régulier, de travail et d’accès au service public et à la liberté de circulation. Les migrants dits économiques La diff érence avec les réfugiés consiste dans le fait qu’ils ont émigré volontairement bien que forcés également par des conditions économiques et qu’ils peuvent retourner dans leurs pays quand ils le veulent. On citera dans cette catégorie des gens originaires de pays comme le Mali, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée. Fort de l’expérience vécue, je dirai que la plus grande disparité entre ces deux catégories de migrants réside surtout en ce que les migrants dits économiques ont bien planifi é leur voyage. Les uns par leurs propres économies, les autres par la fortune de leurs parents. L’émigration étant non seulement une aff aire individuelle mais aussi de la famille tout entière qui y contri-bue fi nancièrement. Cela dans l’espoir que le départ de leur fi ls ou fi lle, neveu ou nièce apporte-ra plus tard un soulagement à la misère de la famille. Tandis que les réfugiés ont été contraints de quitter leur pays sans avoir le temps de préparer leur départ et en laissant derrière eux non seulement leur fortune, mais parfois aussi leurs êtres les plus chers. L’estimation de tous les migrants au Maroc, réfugiés et demandeurs d’asile y compris, se situe actuellement entre 5000 et 600012 personnes ; contrairement bien entendu aux estima-tions d’une certaine presse marocaine et européenne qui fait état de centaines de milliers de migrants subsahariens vivant au Maroc dans l’attente d’entrer en Europe. Cependant l’ensemble de ces migrants (réfugiés, demandeurs d’asile et migrants dits éco-nomiques) se retrouve aujourd’hui au Maroc voire dans l’ensemble des pays du Maghreb, dans la même situation d’atteintes aux libertés et droits fondamentaux. Ayant moi-même vécu dans ces conditions, je dirai qu’il n’y a pas de mot pour traduire cette vie. Un chercheur français à qui je faisais visiter un jour le ghetto13 des migrants à Takhadoum14 n’a pu retenir son émotion en s’écriant: « ça c’est une vie de chien ». Cette vie est caractérisée notamment par: 1. Manque de logement. L’insuffi sance de ressources est à l’origine de la promiscuité et de son cortège de problèmes. Plusieurs personnes partagent la même petite chambre, hommes, femmes, enfants, avec pour conséquence les abus sexuels dont sont victimes les femmes de la part de membres de leur propre communauté, entrainant grossesses non désirées et avortements. D’autre part les femmes ne pouvant pas contribuer fi nancièrement obtiennent une place au prix des services rendus aux tenanciers, réduites ainsi au statut d’esclaves sexuelles. C’est le sort en particulier des fi lles mineures et sans défense, dont la plupart deviennent fi lles mères. Elles seront d’autant plus asservies qu’elles pourront encore moins subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Si on ajoute à ce tableau les mauvaises conditions d’hygiène, 12 Mehdi Lahlou: “L’année migratoire 2006 vue à partir du Maroc”, document du travail col-loque sur la migration, les droits fondamentaux et la liberté de circulation organisé à l’Insea II à Rabat en 2007. 13 Terme utilisé par les migrants pour désigner les maisons où ils habitent. 14 Un quartier de Rabat où sont concentrés les migrants subsahariens.
- 26. 26 on comprendra que ces migrants sont inévitablement exposés aux maladies sexuellement transmissibles et à la tuberculose. Le 13 mars 2006, Mademoiselle KM15, 17 ans, vient se plaindre dans notre association : « dans la chambre où je dors, il y a trois garçons avec qui on partage la chambre et la nuit tous ces garçons me choquent beaucoup, aidez-moi à trouver une autre place pour dormir». J’ai moi-même vu une femme que ses chambriers chassaient de la maison au seul motif qu’elle ne se soumettait pas à leurs sollicitations. 2. L’impossibilité d’accès aux soins médicaux. Au Maroc on refuse aux migrants sans papiers et aux réfugiés l’accès aux soins dans les hô-pitaux, en alléguant que les soigner provoquerait un appel d’air pour les autres migrants. Cette attitude a pour conséquence la mort de nombreuses personnes dont je cite les circonstances de décès d’un certain nombre. Le décès de Tony Mbombo le 24/10/2006 à l’hôpital IBN SINA/ Avicenne de Rabat se dis-tingue parmi tant d’autres. En eff et Tony est un petit garçon de 8 ans qui avait été bousculé par l’enfant d’un Marocain à Sidi Moussa, une ville périphérique de Rabat. Tony fut soigné dans un hôpital de bienfaisance marocain, où l’on s’est limité à lui poser un plâtre fermé sur des blessures ouvertes , ce qui a provoqué une infection non soignée pendant presque un mois. Et pourtant sa mère était une réfugiée reconnue au bureau du HCR. L’équipe de la télévision espagnole (TVE) au Maroc fi t la connaissance de Tony et l’emmena à l’hôpital Ibn Sina/Avicenne de Rabat. À l’hôpital Avicenne, les médecins annoncèrent que Tony devait être soumis à une légère intervention chirurgicale d’un quart d’heure que, pour des motifs inconnus, Tony n’a pas surmontée. L’enfant reçut une anesthésie générale et, après l’in-tervention, fut abandonné dans un couloir de l’hôpital sans aucun soin ni contrôle.Quelques minutes plus tard, dans ce même couloir, Tony cessa défi nitivement de respirer. Ce petit gar-çon qui parlait parfaitement l’arabe, dira à sa mère peu avant sa mort que l’infi rmière lui disait en arabe que « attends, tu vas mourir ». Le 16 avril 2007 l’ AFVIC (Association de familles victimes de l’immigration clandestine), une association marocaine travaillant à Casablanca, lance un communiqué sur la liste de diff u-sion Manifeste Euro-Afrique faisant état de la découverte de 18 cadavres de migrants subsaha-riens à la morgue de l’hôpital IBN Rochd de Casablanca. Si dans un autre communiqué diff usé plus tard par la même association les médecins parlent de mort naturelle, on se demande toutefois si ces migrants ont été soignés lorsqu’ils étaient à l’hôpital ou s’ils étaient abandonnés comme c’est le cas pour d’autres migrants décédés à l’hôpital IBN SINA de Rabat. 3. La déscolarisation des enfants. Les enfants dont la famille a fui les guerres, les persécutions, les désastres économiques, et qui se retrouvent au Maroc, ne sont pas admis dans les écoles publiques parce que leurs parents n’ont pas de papiers. 15 Je connais bien le nom de cette fi llette qui est consignée dans nos bases de données, mais par respect pour la vie personnelle j’utilise les lettre KM.
- 27. 27 4. Le manque de travail. Les migrants sans papiers ainsi que les demandeurs d’asile et les réfugiés n’ont accès à au-cune activité génératrice de revenu. En 2007 le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés a organisé en partenariat avec la Fondation Orient-Occident, une série de formations professionnelles notamment en maintenance informatique, en aides soignantes et en télé conseil et hôtellerie en vue de per-mettre aux réfugiés de trouver un travail rémunérateur. Cette formation qui avait pourtant suscité l’enthousiasme des réfugiés qui y ont pris part massivement car aspirant à travailler et à devenir indépendants, aboutira à une déception. Pour être engagé par un centre d’appel, j’ai moi-même suivi la formation en télé conseil et obtenu le diplôme avec mention satisfaction. Pourtant le directeur de la Fondation Orient-Occident nous annonça vers la fi n de cette for-mation qu’un ordre des autorités marocaines venait d’interdire aux entreprises disposées à nous embaucher d’employer du personnel sans carte de séjour ; il était de notoriété publique que les réfugiés subsahariens n’avaient pas cette carte. Le manque d’activité a de lourdes conséquences sur la santé; non seulement sur la santé physique, mais aussi au niveau de l’équilibre psychique. Je citerai ici le cas de deux Congolais que les terribles conditions de vie et le désespoir ont conduit à la dépression. Ils avaient tous deux un niveau universitaire. L’un avait quitté son pays à la suite de menaces pour avoir dénoncé les manquements aux droits humains. Il s’était retrouvé au Maroc, face à une situation diffi cile et surtout sans issue. Au début on le rencon-trait dans la salle de lecture de la Fondation Orient- Occident, discutant avec les Marocains de divers sujets. Plus tard, on pouvait le voir dans les rues de Rabat, parfois nu, agité, parlant tout seul, fouillant dans les poubelles… L’autre était arrivé à Rabat après cinq années d’errance. Il avait laissé une femme et cinq en-fants au pays. C’est l’espoir de trouver du travail en Europe et de préparer l’avenir de ses enfants qui l’avait mis sur la route. Après six mois dans la forêt de Bel Younes dans l’espoir d’une tra-versée vers l’Espagne, il est arrivé à Rabat en octobre 2005, à la suite des évènements de Ceuta et Melilla16. Il était en contact avec son frère en Europe; ce dernier lui avait même envoyé l’ar-gent du voyage, mais un passeur impitoyable l’avait escroqué. Son frère, ne connaissant pas les réalités du Maroc, avait alors coupé tout contact avec lui. Ce compatriote s’inquiétait à la fois pour sa propre vie et pour celle de sa femme et de ses enfants restés au pays. Nous mêmes nous avions essayé de contacter le frère en Europe, mais celui-ci après l’avoir soutenu pendant cinq ans, nous dira au téléphone : « C’est un homme, il faut qu’il sache se débrouiller ». Ce Congolais a perdu la raison, et fi nalement a été porté disparu. 5. Rafl es et refoulement. Le calvaire de migrants subsahariens est davantage aggravé par les rafl es et le refoulement dont ils font sans cesse l’ objet. Signalons en passant que durant une rafl e, même les deman-deurs d’asile et les réfugiés reconnus par le HCR sont arrêtés et refoulés. Dans la nuit du 22 16 Les événements de l’automne 2005 ayant conduit au massacre de 12 migrants qui tentaient de franchir les frontières européennes et au refoulement de centaines d’autres dans les zones déser-tiques près des frontières algéro-mauritaniennes.
- 28. 28 au 23 décembre 2007 nous avons assisté à une rafl e accompagnée du refoulement de plus de 200 migrants parmi lesquels il y avait 73 réfugiés et demandeurs d’asile reconnus au bureau du HCR.17 La rafl e et le refoulement ont des eff ets désastreux sur les migrants. L’opération se passe à partir de 4 heures du matin; les policiers vont de maison en maison de migrants en cassant la porte de ceux ou celles qui refusent d’ouvrir; ils arrêtent les occupants en torturant ceux qui essayent de se défendre, comme les réfugiés et demandeurs d’asile qui brandissent leurs papiers délivrés par le HCR. Ainsi arrêtés, les hommes, femmes et enfants , même des bébés sont vite reconduits de très bonne heure à Oujda, à la frontière Algérie – Maroc. A Oujda un autre calvaire les attend. Les migrants sont parfois récupérés par les policiers algériens qui les dépouillent de tout avant de les renvoyer au Maroc; d’autres fois il y a échange de tir d’armes à feu entre les policiers marocains et algériens. Les femmes endurent toutes sortes d’atrocités et sont violées aussi bien par les forces de l’ordre algériennes que par les rodeurs marocains et d’autres subsahariens qui font la loi dans cette partie de la frontière dé-nommée vallée de la mort. Parmi les centaines de migrants subsahariens refoulés le 23 décembre 2006, une femme enceinte, de nationalité camerounaise a fait un accouchement prématuré qui a entraîné la mort de son enfant. Tandis qu’une autre jeune fi lle de la nationalité congolaise fut enfermée et violée par des délinquants. Les migrants ainsi refoulés à Oujda sont obligés de regagner Rabat à pied car ils sont refusés par le transporteur des bus et des trains sur ordre des autorités. Et en revenant à pied ils encou-rent les menaces d’ agresseurs marocains. Le 20 février 2008, un demandeur d’asile nigérien refoulé à Oujda et qui tentait de regagner Rabat à pied a été tué à l’arme blanche dans un village par des délinquants marocains. Les migrants subsahariens et les medias marocains Aux souff rances ci-dessus, s’ajoute également la criminalisation dont les migrants subsaha-riens sont victimes de la part de certains medias marocains. Ces derniers en eff et, véhiculent toujours une image négative et considèrent des migrants d’origine subsaharien comme : • des personnes qui présentent une menace sécuritaire pour le Maroc ; • des gens malhonnêtes, trafi quants de drogue, arnaqueurs, terroristes ayant commis des crimes de guerre et des actes d’épuration ethnique et qui se cacheraient au Maroc ; • les femmes migrantes seraient des prostituées, atteintes du virus du Sida. Outre la presse écrite qui véhicule des messages à caractère xénophobe, il faut dire aussi qu’au Maroc les migrants subsahariens sont instrumentalisés également dans les medias au-diovisuels. Ainsi à la télévision le bulletin d’information rapportant l’arrestation de Marocains cherchant à gagner clandestinement l’Espagne est souvent accompagné de supports visuels diff usant l’image de migrants subsahariens. Il semble que les migrants subsahariens servent 17 Gadem: “La chasse aux migrants aux frontières sud de l’Europe, conséquences des politiques migratoires européennes”. Rapport sur le refoulement de décembre 2006 au Maroc, rédigé et publié en juin 2007.
- 29. 29 à présent de boucs émissaires pour masquer la réalité d’émigration dite clandestine des Ma-rocains ; pourtant ils n’ont fait qu’emprunter les voies de passage inaugurées plusieurs années auparavant par ces mêmes Marocains qui émigrent pour les mêmes raisons qu’eux. Les migrants subsahariens et la société marocaine Le comportement et l’attitude de la population marocaine par rapport aux migrants sub-sahariens sont fonction du traitement de ceux - ci par la police et du message véhiculé dans les medias. Ainsi le comportement singulier de la police et les messages publiés par la presse sont souvent accompagnés d’une montée de la xénophobie et d’actes racistes. A chaque arres-tation on assiste aux mêmes incidents : certains jeunes Marocains crient aux subsahariens «az-zia »pour dire esclave, les propriétaires des maisons délogent les subsahariens, d’autres refusent de louer leurs maisons aux migrants et les agressions par les rodeurs marocains se multiplient dans les divers quartiers où vivent les migrants. Les Marocains moyens habitués à ces images et aux mauvais traitements infl igés au subsa-harien, voient en celui-ci un pauvre hère, misérable et non instruit qui vient au Maroc pour lui voler son travail et aggraver sa situation, comme ne cessent de l’écrire certains journaux. Et l’on ne fait pas allusion qu’au Marocain sans niveau d’instruction, puisque ce discours qui évoque le migrant comme un fardeau pour le Maroc est même tenu par certains professeurs d’uni-versité et chercheurs marocains, bien que les réfugiés et migrants ne reçoivent rien de gratuit du service public marocain. C’est ainsi que les migrants comme les réfugiés subsahariens sont rendus responsables de la situation sociale un peu dégradée que vivent quotidiennement les Marocains. Cette image négative de migrants misérables et non instruits a été contredite par les migrants à travers leurs organisations. L’organisation des migrants au Maroc Avant le 20 avril 2005, aucune organisation de défense des droits et libertés n’existait, créée et dirigée par les migrants ou les réfugiés au Maroc. A cette date seulement j’ai réfl échi et inté-ressé certains camarades à la possibilité de mettre en place l’association des réfugiés et deman-deurs d’asile congolais, (ARCOM). J’ai été motivé surtout par les rafl es et le refoulement des réfugiés et demandeurs d’asile survenant dans les grandes villes du Maroc notamment à Rabat et cela dans un silence total. A l’époque la grande majorité des demandeurs d’asile sont congo-lais. Les autres communautés vivent dans la crainte de sortir, même pour se rendre au bureau du HCR ; c’est le cas des Ivoiriens qui ont fui la guerre qui faisait rage dans leur pays. De plus les migrants ne se fréquentaient pas entre communautés, ils éprouvaient de la méfi ance entre eux. C’est dans ce contexte que l’ARCOM est créée et s’est assigné comme objectifs : 1. de revendiquer le respect de notre droit fondamental qui est l’inviolabilité de nos droits et libertés, 2. de cultiver un esprit d’entraide, de solidarité et d’assistance au sein de la communauté des réfugiés et demandeurs d’asile. Par ces objectifs, nous nous sommes eff orcés à travers les conférences –débats, les activités culturelles comme la musique et le théâtre, d’eff acer l’image négative du migrant et de signa-
- 30. 30 ler parmi eux la présence de gens instruits détenteurs de diplômes universitaires, possédant diverses qualifi cations qu’ils n’ont pas pu exploiter dans leurs patries et qui sont à la recherche d’un pays où règnent l’ordre et la paix afi n de valoriser leurs capacités et leurs talents. Parmi nos actions et activités, nous citerons : • le Sit–in que nous avons organisé le 19 septembre 2005 devant le bureau du HCR pour dénoncer le refoulement des réfugiés et demandeurs d’asile subsahariens arrêtés pendant la rafl e dans la nuit du 16 au 17 septembre 2005, et pour amener ainsi la responsable du HCR de l’époque à rompre son silence et à prendre des dispositions pour le retour des refoulés à Rabat. Il faut dire que cette manifestation couverte par une journaliste espagnole, était une première au Maroc et a marqué le début de l’engagement et de la prise de conscience des réfugiés et demandeurs d’asile à défendre leurs droits. • La sensibilisation des églises et ONG, notamment le SOS Racismo présent à l’époque au Maroc, la collecte des fonds qui ont permis l’envoi d’un collègue à Oujda qui a organisé le retour des demandeurs d’asile et des réfugiés refoulés par groupes. • La création en janvier 2006 d’un centre de scolarisation des enfants des réfugiés et mi-grants, refusés dans les écoles marocaines à cause de l’absence de papiers de leurs parents . • L’accompagnement des malades dans les hôpitaux et l’encadrement des femmes et des mineurs. • L’organisation des conférences et des activités culturelles. • La collaboration avec les pasteurs des églises chrétiennes et d’autres organisations non gouvernementales de soutien aux migrants. Et nous avons participé à plusieurs rencontres internationales au Maroc et notamment au contre sommet de la société civile élaboré en marge de la conférence ministérielle Euro- Afrique sur la migration et le développement à Rabat en été 2006, au colloque international sur la migration organisé par les avocats de Khemisset en décembre 2006, aux deux univer-sités ouvertes instituées par le professeur Mehdi Lahlou à l’Institut National de statistiques et d’économie appliquée de Rabat au Maroc en 2006 et 2007, au forum social du Maroc en 2008 où nous avons constitué pour la première fois une Assemblée Générale de migrants qui fut animée et dirigée par les migrants, au camp d’été organisé par l’Attac Maroc en 2007. Dans toutes ces rencontres nous ne cessons d’élever nos voix pour défendre la cause des migrants et réfugiés. Signalons cependant qu’il nous était impossible de répondre aux invitations des rencontres organisées en Europe et en Amérique, à cause du manque de papiers. Ce qui implique que les leaders des associations des migrants et réfugiés subsahariens, comme tous les migrants et réfugiés, se retrouvent privés de toute liberté de circulation et assignés ainsi dans une prison qui ne dit pas son nom au Maroc. Moi-même en juin 2006, je fus invité à deux reprises au Canada par le conseil canadien aux réfugiés mais je n’ai pas pu répondre par manque de titre de voyage, et malgré les démarches eff ectuées par le représentant du HCR auprès des autorités marocaines, ces dernières ont re-fusé catégoriquement de me délivrer un titre de voyage. Et en 2007 j’ai été encore invité par
- 31. 31 Casa Arabe ici en Espagne à la table ronde sur la migration mais n’ai pas pu y assister faute de papie ; et lorsque j’irai personnellement au service de police des étrangers pour demander le papier, le commissaire de la police me dira qu’il a reçu l’ordre de ne pas délivrer de papiers aux réfugiés subsahariens. L’ARCOM est maintenant membre du réseau Manifeste Euro – Afrique pour la liberté de circulation et les droits fondamentaux. Pour revenir à l’organisation de migrants au Maroc, il semble irréfutable que notre expérience a permis aux migrants et réfugiés d’autres commu-nautés de s’organiser. Et nous comptons actuellement au Maroc une dizaine d’associations et d’organisations informelles créées et dirigées par les migrants et les réfugiés. Ce qui a créé une dynamique non seulement de revendication de droits et libertés de migrants et réfugiés au Maroc mais aussi de dénonciation des politiques d’externalisation de l’asile et des fermetures des frontières de l’union européenne. La nouveauté parmi ces organisations est le réveil des femmes subsahariennes, migrantes comme réfugiées, avec la création en été 2007 d’un comité rassemblant les femmes de toutes les nationalités au sein d’une seule organisation appelée Comité de femmes et enfants subsa-hariens victimes de l’immigration, COFESVIM. Ce comité a organisé une journée de festivité en date du 1ère septembre 2007 à Rabat à la Fondation Orient – Occident. Cette journée qui a connu la participation de plusieurs organisations de soutien aux migrants tant européennes que marocaines, consistait d’abord à rendre la visibilité des femmes subsahariennes vivantes au Maroc et à créer le rapprochement entre elles et les femmes marocaines. Et à travers les activités organisées, notamment la cuisine, l’exposition et la musique, les femmes migrantes ont voulu partager les cultures des divers horizons d’Afrique et mettre en valeur les talents et les capacités dont elles disposent. Outre ces organisations de revendication, il faut signaler aussi la création par les migrants des églises informelles. On dénombre plusieurs groupes de prière organisée dans des maisons de plusieurs quartiers de Rabat. Dans ces églises on encourage quotidiennement les migrants à garder le moral en dépit des souff rances, à ne pas se livrer à la prostitution, à la délinquance ni au vol, à développer l’amour fraternel et la solidarité entre eux. Dans certains cas de confl it communautaire ou intercommunautaire nous avons recours aux pasteurs de ces églises qui arrivent parfois á résoudre ces confl its et à instaurer la paix au sein de la communauté. Ces églises servent aux migrants de garde-fou moral. Les fi dèles de ces églises essayent de bien se conduire pour éviter l’opprobre des autres membres. Je dirais que ces églises représentent en quelque sorte la famille au sens africain. Les diri-geants de ces églises communément appelés pasteurs ou évangélistes, sont souvent des per-sonnes faisant preuve d’une bonne moralité et jouissant de la confi ance et de la considération de leurs membres. Les off randes collectées pendant le service sont bien gérées par un conseil de l’église et servent à assister les femmes qui accouchent ou des personnes qui sont malades ou dans une situation particulièrement critique. Cette organisation originale en son genre, d’une population qui survit dans des conditions extrêmement diffi ciles, mais qui s’eff orce de résister et de ne pas se livrer à la délinquance n’a jamais eu d’écho dans la presse marocaine. Ceux qui en ont parlé ne l’ont fait que de manière à criminaliser les migrants. Comme l’indique le titre du journal arabophone « Al Nahar Al Maghribia », à la une de son N° 835 en date du mardi 06 février 2007 : “Avertissement aux
- 32. 32 intermédiaires de louer aux Africains” :”Des campagnes de ratissage de la police révèlent l’uti-lisation des Migrants pour le prosélytisme, l’intégrisme et le trafi c de drogue”. On peut lire aussi dans cette publication: “La Wilaya de Rabat a lancé une campagne contre les Migrants Africains … “Les autorités ont découvert que des migrants travaillent pour ces personnes dans le prosélytisme à travers la distribution de tracts appelant à épouser la religion chrétienne ». Grâce à cette organisation, au-delà de tout discours sécuritaire et politique, la présence de migrants subsahariens au Maroc est également source d’échange de culture et de civilisation. En s’organisant sans crainte dans les collectifs, associations et églises informelles pour reven-diquer publiquement mais de manière pacifi que et par des moyens légaux leur droit dans une société dont certains jeunes considèrent la violence comme le seul moyen de faire entendre leur voix, les migrants amènent une autre mentalité , introduisent une culture de paix et de dialogue qui est conforme aux principes et aux valeurs universelles proclamés par les Nations Unies. A travers les conférences-débats et les activités culturelles que nous avons organisées, nous n’avons jamais cessé d’appeler les réfugiés et les migrants au respect des lois, des valeurs et de la culture du Maroc, cela à la grande surprise de tous. Nous avons démontré à travers nos activités culturelles et artistiques (musique, expositions) que nous avions aussi de quoi off rir à la société marocaine. Nous l’avons dit précédemment, la grande majorité de migrants subsahariens qui arrivent au Maroc ont planifi é leur voyage. Ils sont arrivés au Maroc avec suffi samment d’argent pour leur séjour et pour leur voyage. Mais se retrouvant face au mur de barbelés construit par l’Eu-rope, ils ont été obligés de rester un peu plus longtemps que prévu au Maroc, ce qui les oblige ainsi à dépenser leurs économies en achetant les biens et services de consommation sur le marché marocain, à payer le loyer, l’eau et l’électricité de leur logis. Ceci explique la prédilection qu’éprouvent à leur encontre les propriétaires de maisons marocains, car non seulement ils paient plus cher qu’un Marocain mais surtout ils paient leur loyer régulièrement. Ajoutons à cela que certains migrants n’arrivant pas à traverser à temps reçoivent réguliè-rement de l’argent de la part de leurs proches qui sont en Europe, et que d’autres touchent de l’argent de leur pays d’origine leur permettant de faire face au quotidien. Ces sommes d’argent sont consommées dans le marché marocain. Que dire du budget dépensé quotidiennement dans l’économie marocaine par des organi-sations d’assistance aux migrants, notamment le comité d’entraide internationale de l’église évangélique, la Caritas, l’assemblée chrétienne de Rabat, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés, les médecins sans frontières, les médecins du monde… Ces organisations achètent journalièrement des biens et services comme les produits pharmaceutiques, l’alimen-tation, et assistent parfois certains migrants et réfugiés en diffi culté pour payer le loyer, l’eau et l’électricité avec de l’argent liquide. Ils paient les prises en charge dans les hôpitaux marocains publics comme privés pour que les migrants et les réfugiés soient traités, bien que dans les hôpitaux publics les migrants aient toujours des diffi cultés à être soignés.
- 33. 33 Conclusion et propositions La situation des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile au Maroc et dans l’ensemble des pays du Maghreb reste encore préoccupante et demande une grande mobilisation de la part des ONGs et de la communauté internationale. Nous proposons: 3. la sensibilisation des Ongs au renforcement du travail en réseau et la création de cel-lules juridiques où les avocats pourront utiliser les conventions internationales et quelques dispositions protectrices consignées dans les lois internes pour défendre les cas des mi-grants. 4. D’exercer des pressions sur l’union européenne et notamment l’Espagne pour que leur coopération cesse sur la gestion dite de fl ux migratoire avec les pays du Maghreb, dont le respect des principes élémentaires des droits humains souff re encore d’application. De soutenir matériellement et fi nancièrement les organisations des migrants afi n de les aider à faire face à leurs besoins quotidiens.
- 35. 35 EXTRAITS DES INTERVIEWS AVEC UN VISITEUR DE PRISON ET DEUX RÉFUGIÉS IVOIRIENS EN TUNISIE (2007)18 Hassen Boubakri (Université de Sousse, Tunisie) 1. Le témoignage d’un visiteur des prisons La seule personne qui peut rentrer en contact et connaître les prisonniers subsahariens dans les prisons tunisiennes est JF, visiteur des prisonniers de confession chrétienne (de toutes nationalités et origines) détenus pour des délits et des crimes commis en Tunisie. JF a un avantage considérable que personne d’autre n’a en Tunisie : l’autorisation ouverte de rendre visite, sans rendez-vous préalable, aux prisonniers chrétiens (ou se déclarant chré-tiens) dans toutes les prisons tunisiennes. Non seulement il pourvoit aux besoins quotidiens des prisonniers en leur fournissant produits de toilette, vêtements, nourriture, petites sommes d’argent, mais il met aussi en relation les prisonniers avec leurs familles ou proches, en Tunisie ou à l’étranger. Les prisons visitées sont celles de : Mornaguiya, Borj el Amri, Mornag, Messaadine… Les principales prisons abritaient: • Tunis 9 avril (avant son transfert hors de Tunis): 26 prisonniers chrétiens africains sur 37 occidentaux chrétiens. • Mornag : 1 Africain et 2 occidentaux • Mornaguiya : 4 Africains sur 23 chrétiens. • Borj el Amri : 108 Africains • Toutefois, le « centre d’accueil » le plus connu en Tunisie se situe à el Ouardiya, dans la banlieue sud de Tunis. Il abrite les « sans papiers » arrêtés ou emprisonnés, le temps de leur expulsion. Des informations en provenance d’anciens détenus ont fait état de cas de femmes éthiopiennes détenues à el Ouardia avec leurs enfants. JF confi rme qu’aucun contact n’est possible, aucune assistance au profi t des sans papiers, ni au profi t des personnes « libérées ». La raison avancée par les autorités : « El qanûn » (c’est la loi!). Leur réclusion achevée, les « sans papiers » sont retenus et regroupés, puis envoyés par petits groupes, de Ouardia à Sousse puis Sfax, sous la responsabilité de la police. A Sfax, l’ar- 18 Ce témoignage et cette histoire de vie sont extraits de l’étude, non publiée, réalisée par l’au-teur de cet article pour le compte du CISP (en collaboration avec l’ACMACO), intitulée « Recherche sur l’immigration subsaharienne irrégulière en Tunisie. Rapport de recherche et d’enquête », Tunis, 2008.
- 36. 36 mée prendrait la relève : les sans papiers sont convoyés dans des camions militaires, puis sont « déposés » dans le « désert » à la frontière tuniso–libyenne, c’est-à-dire une zone de no man’s land désertique et marécageuse le long de la frontière commune. Des témoignages, qui restent à vérifi er, évoquent des cas de violence physique et de mauvais traitements contre les migrants irréguliers (fl agellation sur les plantes des pieds pour enrayer tout déplacement et contrarier ainsi une éventualité de retour en Tunisie…). Une fois « relâchés » dans le désert, les migrants irréguliers courent plusieurs risques: • Tomber sur une mine héritée des périodes d’extrême tension entre la Tunisie et la Li-bye dans les années 70 et 80. • Mourir de soif si c’est la fi n du printemps ou l’été. • Etre arrêtés par les forces de sécurité libyenne avec à la clef des périodes de détention qui peuvent aller jusqu’à 2 ans, suivies de l’expulsion vers le pays d’origine, ce qui peut re-présenter une menace sérieuse sur les personnes des migrants, surtout s’il s’agit de réfugiés ou de demandeurs d’asile. La situation des prisonniers étrangers africains de confession musulmane est assez signifi - cative de l’opacité (ou du manque) de la réglementation tunisienne, dans la mesure où ceux-ci ne reçoivent pas de visite, n’ayant généralement pas de parents proches en Tunisie. Or, seuls les membres des familles apparentées aux détenus ont droit à la visite. Cette situation a généré de nombreux cas de « trafi c de statuts ». Pour bénéfi cier de la vi-site de JF et de l’aide qu’il apporte aux prisonniers (argent de poche, vêtements, couvertures, produits de toilette, médicaments), de nombreux ressortissants africains de confession mu-sulmane se déclarent chrétiens, ou rachètent au prix fort les produits de l’aide aux prisonniers chrétiens rapportés par JF. Enfi n, JF est le témoin « d’un monde fou ». « Tout le monde connaît tout le monde ». La délinquance, les manipulations, les escroqueries sont très courantes dans le milieu des ressor-tissants subsahariens de Tunisie : trafi cs en tout genre (exemple : saisies fréquentes de devises en liquide (de 3 000 euros à 47 000 Euros), de faux billets). JF évoque par exemple le cas de deux Nigérians : condamnés pour escroquerie, emprisonnés pendant 3 ans et demi, puis libé-rés et expulsés. Ils reviennent en Tunisie quelques mois après, avec de fausses identités sur de faux passeports. Ils récidivent (escroqueries, fausses monnaies). Le verdict est très lourd : 12 ans de prison pour chacun. Source : entretien réalisé par H. Boubakri. Tunis. 2007.
- 37. 37 2. Témoignage d’un couple de réfugiés ivoiriens: (Lné, l’époux étudiant & Mna, l’épouse) Statut : Certifi cat de réfugiés du HCR19 Domicile : « Hay Essahafa » (Cité des Journalistes), dans un îlot assez pauvre et sous équipé à la périphérie nord du quartier, mais juste à 10 minutes à pied du terminus de la ligne de bus n° 27. Situation actuelle : Lné est inscrit en Master spécialisé en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) à l’Université Privée de Technologie (UTECH) à Tunis. L’ins-cription (150 Dinars) et les frais de scolarité (3500 TND, payés en deux tranches par le HCR à Tunis). Vie et famille en Côte d’Ivoire La résidence familiale est à Abidjan. Lné, 41 ans, est né à Odienné / Sous Préfecture de Ma-dinai (Nord de la Côte d’Ivoire). Il est de confession musulmane. Le père, décédé, était paysan dans le secteur du cacao. La mère est commerçante au port de pêche. Il a une soeur veuve, avec 8 enfants. Il s’était marié avec Mna (33 ans) en octobre 2002, un mois après le retour de Tunisie. Mna est née en 1974. Elle a un faible niveau scolaire. Son père, agriculteur, est décédé, alors que sa mère est commerçante. Elle a un grand frère commerçant au port de pêche, une soeur mariée avec enfants, deux petits frères et une petite soeur. Itinéraire scolaire et universitaire de Lné: Bac C (Maths-physique) à Abidjan. Mention très bien. Accès à l’Université : 1ère année de l’Ecole Normale Supérieure. Spécialité : Mathématiques). 1994 : Obtention d’une bourse de la Banque Islamique du Développement (B.I.D) pour faire ses études en Tunisie. 1995. Inscription à la Faculté de Médecine de Sfax après son orientation aux études de mé-decine par le Ministère Tunisien de l’Enseignement Supérieur. 1996 : Arrête ses études en médecine (décision qu’il regrettera beaucoup quand il sera trop tard) et s’inscrit en Maîtrise de sciences électroniques à la Faculté des Sciences de Tunis. 2001: Maîtrise en sciences électroniques. Reprise des études en 2007-2008 : inscription en Master spécialisé en technologie de l’infor-mation et de la communication (TIC), à l’Université Privée de Technologie (UTECH). Langues parlées: le Dioula, le français 19 Le bureau du HCR à Tunis, ne délivre pas de carte de réfugiés en raison de l’absence du Statut de Réfugiés dans la loi interne tunisienne.
- 38. 38 Langue parlée et écrite : le français L’échec du retour en CI pour cause de guerre civile Dés l’obtention de la maîtrise, Lné a pris une décision ferme de rentrer en CI. Même s’il dit ne pas avoir eu de problèmes particuliers en Tunisie, il voulait renter dans le pays pour cher-cher un poste dans l’enseignement et surtout aider sa famille (en particulier sa soeur veuve avec 8 enfants). Le billet étant pris en charge par la BID, il prend l’avion d’Abidjan où il arrive dans la nuit du 19 au 20 septembre 2002. C’était le même jour de l’éclatement de la rébellion du MPCI (Mou-vement Patriotique de la Côte d’Ivoire) ou Forces Nouvelles. A 3h du matin, 15 minutes après son arrivée dans sa famille, il entend les premiers coups de feu. Le même jour, le couvre feu est décrété à partir de 19h à Abidjan. Depuis ce jour, la situation n’a cessé de se dégrader et les menaces se sont multipliées contre les nordistes et les musulmans. De jour en jour, le nombre d’exactions, de meurtres, de dis-paritions et d’arrestations n’a cessé d’augmenter, touchant les Abidjanais originaires du Nord. Lné évoque l’histoire d’un voisin nordique du quartier qui a été interpellé par « Les Patriotes » (milices proches du président Gbagbo). Il a été sauvé par sa connaissance de la langue des populations de l’Ouest. Il a été relâché après avoir été roué de coups. La personne arrêtée avec lui, originaire du même quartier, a eu moins de chance. Elle été abattue par les miliciens dés qu’ils se sont rendus compte qu’elle était originaire du Nord. Devant la dégradation de la situation et la permanence de l’insécurité, la famille de Lné (femme et parents) l’ont incité à retourner en Tunisie (surtout qu’il avait son billet retour en-core valable jusqu’à la fi n de l’année 2002). 9 décembre 2002 : retour à Tunis Hébergé par ses copains étudiants africains dans le quartier de «Omrane supérieur », il a été conseillé par un étudiant tchadien pour demander l’asile auprès du HCR où il a déposé une demande de certifi cat de réfugié. Il n’arrive pas à trouver de stages. Avril 2003 : La BAD est délocalisée à Tunis. Environ 2000 personnes s’installent à Tunis: personnels, accompagnés de leurs propres personnels de services (cuisiniers, domestiques). Avril 2003 : arrivée de Mna (au même temps que la BAD). Commerçante à Abidjan, elle avait mis de côté une bonne épargne avec laquelle elle a acheté son billet d’avion. Elle avait éga-lement fait des achats de produits et d’articles fortement demandés en Tunisie: tissus africains, plaqué-or, articles de l’artisanat africain. La vente de ces produits a permis au couple de passer les premiers temps à Tunis sans trop de diffi cultés (loyer et dépenses courantes). Le couple (Lné et Mna), avait, un temps, partagé le studio avec un autre couple ivoirien durant deux mois à «Hay Essahafa» (cité des journalistes). Location du studio occupé actuellement par le couple, dans le même quartier, grâce à l’ex-ploitante de la cabine téléphonique (« taxiphone »). Loyer : 100 DT.
- 39. 39 Mna est engagée comme femme de ménage auprès de familles des employés de la BAD dans le quartier d’El Manar puis à Carthage (2 jours par semaine par famille). Revenus : 150 à 200 DT/mois. Sept 2003 : Lné assure des cours à domicile au profi t des enfants des employés de la BAD dans les banlieues résidentielles de Carthage, d’El Manar, de Ennasr II, et d’el Manar. Res-sources : 150 à 200 DT/mois. Mais quelques mois après, Mna tombe malade, atteinte du zona. Après plusieurs tenta-tives avortées auprès du HCR pour prendre en charge son hospitalisation, c’est la Caritas qui s’acquitte de son hospitalisation et de son traitement à la clinique « Saint Augustin » à Tunis. La maladie a laissé des séquelles au niveau des yeux surtout. Mais Mna n’a pas pu non plus reprendre son travail de domestique en raison des séquelles du zona. Fin 2003 : le couple obtient le certifi cat de réfugies du HCR Sept 2004 : naissance d’Abderrahmane, décédé 3 ans après (septembre 2007). Mna a été admise à l’hôpital public (Rabta) pour l’accouchement. Son certifi cat de réfugiés lui a permis de ne pas payer les frais d’accouchement. Depuis : les revenus du couple ont diminué. L’indemnité (régulière) payée par le HCR est de 230 dinars (pour trois personnes : le couple et leur enfant). Les conditions de logement et les relations avec le voisinage Etat du domicile actuel : Une maison de deux pièces, cuisine et salle d’eau. Seules la salle de séjour (bien aérée et ensoleillée) et la salle d’eau sont en relatif bon état. Les murs de la cuisine et de la chambre à coucher ont totalement perdu leur peinture et leur crépi, à cause de l’humi-dité excessive. Le couple est désormais obligé de dormir dans la salle de séjour. La cuisine est sous équipée : manque de bahut ou de meuble de rangement pour la vaisselle. Les relations avec le voisinage : du rejet à la solidarité. Sauf quelques cas isolés d’aff rontements ou de tensions entre étudiants africains et des jeunes de quartiers, par exemple à Hay (Cité) Ibn Khaldoun, où il logeait durant sa scolarité universitaire, Lné déclare ne pas avoir particulièrement souff ert en Tunisie durant sa vie es-tudiantine. Boursier de la BID, il était relativement privilégié par rapport aux autres étudiants africains non boursiers ou même ceux qui étaient boursiers de leurs Etats d’origine. C’est toutefois en couple qu’il a été exposé à des agressions et à des diffi cultés dans son voisinage. Durant la première année de leur installation dans le quartier, Lné et Mna ont été agressés et méprisés par les enfants surtout. Lné a en eff et reçu des pierres sur la tête à deux reprises. A chaque fois, il a du aller se faire soigner à l’hôpital sans jamais porter plainte. Les enfants lançaient des pierres ou faisaient éclater des pétards à sa fenêtre. Les « guiras, guiras » (des mots de mépris lancés aux Noirs) étaient fréquentes dans la bouche des enfants du quartier en particulier. «Les enfants le faisaient devant leurs parents qui rigolent quand ils voient leurs enfants nous embêter».
- 40. 40 Il a fallu l’intervention énergique du propriétaire (qui habite juste derrière le studio du couple) auprès des parents pour que les enfants deviennent plus sages. Toutefois avec le temps, se sont développées progressivement des formes de sociabilité et proximité entre le couple et les familles voisines. Mna commence à parler avec ses voisines dans la rue. Elle est parfois invitée pour prendre un thé avec elles ou c’est elle qui les reçoit. Avec les fêtes du mouton, le propriétaire off re tous les ans un gigot d’agneau à Lné et Mna. Le couple déclare ne pas recevoir d’autres formes d’aide en nature des voisins dans le quartier. Deux moments importants vont encore rapprocher Mna et Lné avec leur voisinage. La naissance d’Abderrahmane : au retour de Mna de l’hôpital, ses voisines sont venues lui rendre visite et sont restées proches d’elle durant ses premiers 15 jours. Les enfants étaient très curieux de voir et découvrir ce « bébé noir ». Un an après sa naissance, et durant les deux ans qui ont précédé son décès, les enfants du voisinage ont bien accueilli et intégré Abderrahmane dans leur groupe. Le décès d’Abderrhamane (septembre 2007). C’est le moment le plus fort de cette solida-rité. Les voisins sont venus pour les condoléances, leur ont demandé de ne pas faire à manger pendant 3 jours (période du deuil durant laquelle l’on allume pas le feu) et se sont chargés de les nourrir (à tous les repas) pendant le deuil. Une ancienne voisine tunisienne qui avait démé-nagé à Zarzis est venue voir le couple et lui apporter réconfort et aide alimentaire. Depuis, Mna et Lné sentent leurs voisins plus proches et plus attentifs. Source : Entretien réalisé par H. Boubakri. Tunis. 2007, in CISP: Rapport annuel 2008. Dans le cadre du Projet :«Les migrations subsahariennes irrégulières au Maghreb».
- 41. 2ème Partie : Les migrations vues par les acteurs
- 43. 43 LA SITUATION DES MIGRANTS SUBSAHARIENS AU MAGHREB DU POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS MAGHREBINES Nadia Khrouz (Association GADEM, Maroc) « L’imagination, associée à la raison, peut faire de l’utopie d’aujourd’hui les options de de-main »20 Le Maghreb : une région de mobilité ancestrale et historique Les pays du Maghreb, en premier lieu foyers d’origine des migrations vers les états du Golfe et de l’Union Européenne (UE), en particulier l’Espagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique, sont devenus des pays de transit et de destination. Le Maroc et l’Algérie sont avant tout et depuis la fermeture des frontières européennes dans les années 70, des pays d’émigration. Celle-ci leur permet de bénéfi cier des transferts de fonds de leurs citoyens à l’étranger. Le Maroc compte près de 3 millions de ressortissants à l’étranger qui ont transféré 5 milliards d’euros en 2007, ce qui représente une des plus importantes res-sources du pays avec le tourisme et les phosphates21. Néanmoins les pays du Maghreb ont toujours été des pays d’immigration, immigration de transit et d’installation, migration circulaire et de travail. Ces migrations sont anciennes et historiques, comme l’illustrent les échanges de commerçants ou entre le Maroc et le Sénégal, dans le cadre de la communauté tidjane. Elles ont cependant pris de l’ampleur et les popula-tions migrantes ont évolué depuis les années 90 et en particulier 2000. Les migrations subsa-hariennes ont également adopté un nouveau visage par suite du déclenchement de diff érents confl its dans des zones comme la Côte-d’Ivoire, qui accueillaient auparavant une bonne partie de la migration de l’Afrique de l’ouest. La Libye occupe une place particulière au Maghreb. Deuxième pays le plus étendu de la région et l’un des moins peuplés du monde, elle est devenue depuis le début de son enrichis-sement, dû notamment à la découverte du pétrole, un grand pays d’accueil de migrants : maro-cains, tunisiens, égyptiens, soudanais, tchadiens, maliens, nigériens. La Libye est également un pays de transit, du fait notamment de la longueur de la frontière qu’elle partage avec ses pays voisins, de la liberté de circulation et de l’attrait de la politique pa-nafricaine du pays (exemple de la création de la Communauté des Etats du Sahel et du Sahara – Comessa - annoncée en 1999 par le chef d’Etat libyen). Le nombre de migrants en situation irrégulière en Libye est estimé entre 1,5 et 2 millions de personnes. 20 Cimade : « Maroc, Algérie, Mali, Sénégal, Mauritanie, Pays d’émigration, de transit et de blocage : état des lieux de la situation des migrants en 2008 », document d’analyse, pôle solidarités internationales. 21 Convention de circulation et d’établissement Mauritanie/Sénégal et Mauritanie/Mali.
