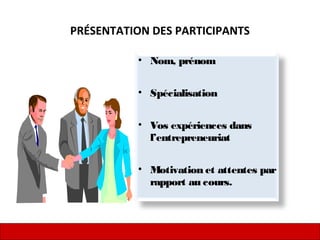La formation sur l'entrepreneuriat et l'innovation, dirigée par Victor Ehoussou, vise à doter les participants de compétences clés en entrepreneuriat, notamment la compréhension des motivations créatives et des stratégies de financement. Le document souligne également les 30 causes majeures d'échec entrepreneurial, telles que le manque de discipline, les influences négatives et la mauvaise gestion, ainsi que l'importance de l'initiative privée dans le contexte socio-économique de la Côte d'Ivoire. Enfin, il met en exergue la nécessité d'un développement culturel pour encourager l'esprit d'entreprise dans le pays.