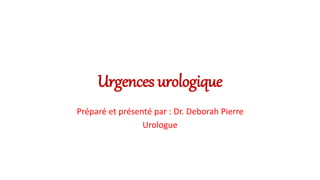
Minimum quarante caractères requis pour c
- 1. Urgences urologique Préparé et présenté par : Dr. Deborah Pierre Urologue
- 2. Objectifs • Être en mesure de reconnaitre les différentes urgences Urologiques • Être en mesure de poser leur diagnostic et initier leur prise en charge
- 3. Plan • Hematurie • Retention aigue d’urine • Pyelonephrite aigue • Colique nephretique • Prostatite aigue • Orchi-epydidymite • Torsion testiculaire • Traumatisme testiculaire • Fracture du corps caverneux • Traumatisme de l’uretre • Priapisme • Gangrene de Fournier
- 4. Hématurie
- 5. Hématurie • Présence de sang dans les urines • Hématurie macroscopique: Visible à l’œil nu ≥ 500 hématies/mm3 • Hématurie microscopique: Non visible l’œil nu (BU/ECBU) • Seule l’hématurie macroscopique est une urgence urologique
- 6. Physiopathologie • Deux cadres nosologiques : Urologique ou néphrologique Urologique : • Liée à une lésion du parenchyme rénal ou de l’arbre urinaire • Effraction (micro- ou macroscopique) de vaisseaux sanguins
- 7. Physiopathologie Néphrologique: • Liée au passage des hématies à travers une membrane basale glomérulaire altérée. • Absence de caillots lors d’une hématurie macroscopique d’origine néphrologique • Action fibrinolytique de l’urokinase tubulaire • Présence de cylindres hématiques ou d’hématies déformées sur l’analyse du culot urinaire • Association fréquente à une protéinurie (≥ 0,3 g/24 h), voire à un syndrome néphrotique ou néphritique.
- 8. Clinique • L'interrogatoire peut vous orienter sur l'origine du saignement : • Y a-t-il des caillots dans les urines ? • Quelle est la couleur des urines ? • Les urines sont rouges au début ou à la fin de la miction ? - Epreuve des 3 verres de GUYON Rechercher des signes fonctionnels urologiques ayant une valeur d’orientation
- 9. L’épreuve des 3 verres de GUYON • L’Hématurie initiale - Coloration des urines plus marquée en début de miction - Origine plutôt urétro-prostatique ou cervicale • L’Hématurie terminale -Coloration des urines plus marquée en fin de miction - Origine plutôt vésicale • L’Hématurie totale -Coloration des urines constante au cours de la miction - Pas de valeur localisatrice : l'hématurie peut être d’origine glomérulaire, urologique du haut appareil, ou encore de toute origine si elle est très abondante
- 10. Diagnostique • La bandelette urinaire détecte la présence de sang dans les urines (≥ 5 hématies/mm3) grâce aux propriétés per oxydasiques de l’hémoglobine. • La sensibilité de cet examen est de 90 % • Il existe des faux-positifs : myoglobinurie, hémoglobinurie. • Eliminer toute fausse hématurie avant de réaliser un bilan étiologique.
- 11. Etiologies
- 12. Diagnostique • Cystoscopie • Examen à effectuer pour toute Hématurie macroscopique : - Asymptomatique - Chez un patient présentant un facteur de risque néoplasique et/ou âgé >35 ans. • Permet de visualiser l’urètre et la vessie. • On l’associe à une cytologie de rinçage
- 13. Diagnostics différentiels • Hémorragie de voisinage • Urétrorragie (persistance d’un saignement en dehors des mictions). • Génitale (menstruations, métrorragies), hémospermie. • Coloration liée à une prise médicamenteuse - Antibiotiques : rifampicine, érythromycine, métronidazole. - Anti-inflammatoires : acide aminosalicylique, salazopyrine, ibuprofène. - Vitamines : B12. - Laxatifs contenant de la phénolphtaléine.
- 14. Diagnostics différentiels • Contact avec antiseptique : povidone-iodine, eau de Javel. • Coloration d’origine alimentaire : Betteraves, mûres, myrtilles, rhubarbe, choux rouge, colorant alimentaire : rhodamine • Origine métabolique : - Hémoglobinurie par hémolyse. - Myoglobinurie par rhabdomyolyse. - Urobilinurie - porphyrie. - Intoxication : Plomb ,mercure
- 15. Prise en charge • Evaluation du retentissement hémodynamique • La palpation hypogastrique à la recherche d’un globe vésical (RAU sur caillotage). • Hospitalisation si: - Anémie -RAU sur caillotage - Insuffisance rénale - Infection urinaire - Chute d’escarres
- 16. Conduite à tenir En cas de RAU: • Pose d’une sonde vésicale à double courant avec mise en place d’un lavage continu au sérum physiologique /Decaillotage • Parfois : Nécessité d’un décaillotage endoscopique au bloc opératoire • Bilan ECBU ,NFS , TP-TCA ,GR-Rh • Surveillance volume de la diurèse, coloration la vitesse de l’irrigation réglée en fonction de la coloration des urines
- 18. RAU • Impossibilité d'uriner, douloureuse • Douleur sus-pubienne de plus en plus intense • Besoin d'uriner permanent Emission de quelques gouttes d'urines (Miction par regorgement ) • Globe vésical: Vessie tendue, ronde, douloureuse, mate, convexe • Rétention vésicale "aiguë": à début brutal – Globe vésical • Rétention vésicale "chronique" – mictions par regorgement
- 19. Etiologies • Etiologies des dysuries Obstacle - Adénome, cancer de la prostate, prostatite - Rétrécissement de l'urètre - valves de l'urètre postérieur - Lithiase urétrale - Sarcome du sinus urogénital - Tumeurs pelviennes et rétrécissements de l'urétre - Fécalome Dysfonctionnement neurologique - Racines S2,S3,S4 - Méningite, polyomyélite - SEP, zona - Traumatisme médullaire Médicaments -Atropiniques - Neuroleptiques
- 20. Prise en charge • Drainage des urines, soit par sondage vésical , soit par cathétérisme sus-pubien en URGENCE • Noter l'importance du globe vésical (+++) • Touchers pelviens (++++++) • E.CB.U • Drainage en circuit fermé • Asepsie • Vidange discontinue (hémorragie a vacuo) • Echo abdominale /réno vésico prostatique possible pour confirmer le diagnostic
- 21. Sondage urinaire
- 22. Contre-indications Sonde vésicale • Prostatite / Infection urinaire • Sténose urètre Cathéter sus pubien • Tumeurs de vessie Hématurie • Troubles de la coagulation • Cicatrice Médiane sous ombilicale • Pontage fémoro-fémoral
- 24. Définition • Syndrome douloureux aigue lombo-abdominal résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d’un obstacle quelle qu'en soit la cause .
- 25. Colique néphrétique • Douleur lombaire aigue due à une obstruction sur l’uretère avec distension des voies urinaires au dessus l’obstruction. • Symptômes : Douleur irradiant vers les organes génitaux Sans position antalgique et augmentant avec l’excès de boisson Agitation, Parfois: hématurie, Nausées, Vomissements Si Fièvre : possible infection urinaire associée/ Pyélonéphrite
- 26. • Nhvbnm
- 27. Physiopathologie • Deux mécanismes essentiels provoquant la douleur : 1- Augmentation de la pression et dilatation des voies excrétrices en amont d’un obstacle la sécrétion de prostaglandine E2 par la médullaire rénale l’augmentation de la pression intra rénale . 2-Distension du haut appareil urinaire contracture des fibres musculaires lisse urétérales prolongée la production d’acide lactique la stimulation des fibres nociceptives • L’ensemble de ces mécanismes abouti à une violente douleur
- 28. Clinique Douleur lombaire latéralisée: -Brutale et intense. -Paroxystique, sans position antalgique -Topographie lombaire latéralisée. -Irradiation vers les organes génitaux externes. Signes fonctionnels urinaires: -Syndrome irritatif (pollakiurie , impériosité , douleur vésicale.) -Parfois des nausées/ vomissement; arrêt de transit . • Ces signes peuvent être absents
- 29. ParacliniqueEchographie • Fait en 2 temps : 1- au moment de la crise : l’ASP et l’échographie abdomino- pelvienne 2- après la sédation de la douleur : UIV , Uroscanner
- 30. Urographie intraveineuse (UIV) • Ne se fait quasiment plus • Remplacé par les clichés tardifs de l’uro-scanner
- 31. Etiologies Lithiase : • 1 cause de colique néphrétique . Autres: • Toute obstruction intrinsèque ou extrinsèque : - Un syndrome de la jonction pyélo-urétérale - Une urétérite ( radique ,infectieuse ,tuberculeuse ,iatrogène …) - Une tumeur de la voie excrétrice supérieure - Compression urétérale extrinsèque (grossesse , fibrose et adénopathies retro péritonéales , tumeurs pelviennes)
- 32. CN compliquée • Colique néphrétique fébrile (T°38°) • Colique nephretique hyperalgique malgré morphinique • Insuffisance rénale aigue obstructive Selon terrain: • une grossesse • une insuffisance rénale et uropathies préexistantes • Rein unique fonctionnel ou anatomique • Rein transplanté • Patient sous anti-coagulants • Selon calcul: taille>6mm, calculs bilatéraux
- 33. Conduite à tenir • Constantes • Calmer la douleur : Anti-inflammatoires en IV (ou IM), parfois Morphine IV • Restriction hydrique • BU + ECBU (si fièvre) + NFS (si fièvre)+creatinine • ASP , Echographie , Uroscanner • Sortie des urgences : - Si douleur calmée + absence d’infection urinaire associée - Poursuite AINS quelques jours
- 34. Conduite a tenir (suite) • Hospitalisation : - Si obstacle avec dilatation importante - CN non calmée - CN fébrile avec ou sans dilatation des voies urinaires - CN chez la femme enceinte • CN hyperalgique : Renforcement du traitement antalgique Surveillance Drainage des urines si nécessaire LEC rapide dans les 48h si calcul obstructif uretère pelvien • CN fébrile avec obstacle complet (Urgence chirurgicale) : Drainage en urgence des urines infectées (Sonde double J ou Néphrostomie percutanée )
- 35. Prise en charge suite Drainage des urine Sonde JJ • But : Dérivation interne ( sans poche ) du rein par endoprothèse Reno vésicale • Indication : Drainage d’un rein en obstruction en attendant le traitement étiologique ou de longue durée en cas de traitement palliatif • Drainage temporaire après geste urologique • Technique : AG sous contrôle radiologique
- 37. • Infection bactérienne des voies urinaires hautes et du parenchyme rénal. • La contamination se fait essentiellement par contamination urinaire ascendante et rétrograde à partir des flores digestives, génitales et cutanées • Les germes les plus fréquent: bacilles Gram négatif (BGN) type entérobactéries, Escherichia coli en tête. • Le pic de fréquence se situe chez les femmes de 15 à 65 ans mais les pyélonéphrites peuvent concerner des sujets de tout âge et des deux sexes
- 38. Pyelonéphrite aigue • Touche 5 fois plus la femme que l’homme • Chez la femme, elle est plus fréquente pendant la grossesse • Le début est souvent brutal : -Brûlures mictionnelles avec pollakiurie -Douleur(s) lombaire(s) unie ou bilatérales - Défense de la fosse lombaire -T° à 39°- 40° ; frissons - Urines infectées • Diagnostic : Arguments cliniques Bandelette urinaire positive ECBU positif
- 39. Prise en charge • En absence de gravite peut être traite a domicile • Echographie – ASP-ECBU- hemoculture • Antibiothérapie probabiliste - Fluoroquinolone en monothérapie PO 10-20 jrs ou C#G POS pdt 10 jr Réévaluation clinique J2-J4 avec bilans Hospitalisation si anomalie imagerie ou Non apyrexie après 48 hres d’antibiothérapie ECBU de contrôle 1 mois après l’arret d’antibiotique
- 40. Prise en charge • En présence de signe de gravite ou problème medico-social • Hospitaliser • Echo-ASP-ECBU+- UroTDM • Bi-antibiotherapie probabiliste • - Fluoroquinolone ou C3G IV , relaye PO a la sortie - Associée a un aminoside jusqu’à l’apyrexie Exeat possible après 48-72 hres d’apyrexie ECBU de contrôle après un mois après l’arret des antibiotique
- 41. Prise en charge • Chez la femme enceinte: Pas de fluoroquinolone -béta-lactamine, associée à une surveillance du fœtus. • Pyélonéphrites avec obstruction urinaire (calculs, tumeurs): -Mise en place d’un drainage des urines obstruées par sonde JJ ou néphrostomie • Pyélonéphrites compliquées de phlegmon périnéphrétique, d’abcès rénal ou d’une pyonéphrose: Nécessité de réaliser un drainage
- 42. Prostatite aigue
- 43. Prostatite aigue • Infection aigue de la prostate • Germes responsables principalement urinaires . D’origine digestive : E coli, Proteus mirabilis • Parfois associée à une urétrite (MST) • Symptômes :- Hyperthermie avec frissons -Pollakiurie - Brûlures mictionnelles- Dysurie -Parfois RAU • Diagnostic: TR (prostate très douloureuse) et ECBU positif
- 44. Mécanisme de l’infection • 4 voies de cotamination du tissu prostatique: 1) Voie urétrale : La plus fréquente. Origine ascendante ou descendante • Ascendante: Prostatites induites par sondage ou manœuvre endoscopique, prostatites secondaires à une urétrite • Descendante: Les germes de l’urine d’amont colonisant les canaux prostatiques par reflux d’urine
- 45. Mécanisme de l’infection 2) Voie rectale : Voie directe . Fréquente en post Biopsie prostatique 3) Voie hématogène : Le plus souvent d’infections staphylococciques ou streptococciques, à partir d’un foyer oto-rhino-laryngologique, dentaire, cutané ou digestif, ou encore d’infections virales qui déterminent une prostatite aiguë manifestement secondaire. 4) Voie lymphatique :
- 46. Conduite a tenir • Antibiothérapie mise en route après l’ECBU puis adaptée selon l’antibiogramme • ATB: Fluoroquinolone P0 pdt 4-6 semaines Si CI : C3G • Repos , Antipyrétiques • Surveillance des constantes : TA- T°C- Pouls ECBU – NFS • Evolution : Normalisation de la T° Stérilisation des urines après traitement d’au moins 3 semaines • Si compliquée: Cathéter sus-pubien , fluoroquinolone ou C3G + aminoside • Sortie avec un traitement alpha bloquant
- 48. Orchi epididymite • Infection aigue du testicule et de l’épididyme • Voie de contamination surtout rétrograde • Symptômes : Douleur scrotale brutale avec irradiation. T° 39°- 40° +/- frissons Bourse augmentée de volume , douloureuse, rouge et chaude voire . Parfois : pollakiurie, brûlures mictionnelles • Traitement : Antibiothérapie après ECBU . Repos au lit - Antalgiques - Anti-inflammatoires Abstinence ou rapports protégés • Evolution Sortie après 48H d’apyrexie avec ATB pendant 3 semaines
- 50. Torsion testiculaire • Interruption de la vascularisation du testicule par la torsion du cordon spermatique entraînant une nécrose testiculaire rapide • Délai maximum de 6 hrs
- 51. Torsion testiculaire • Urgence chirurgicale • Survient préférentiellement au moment des pics d’activité hormonale (adolescents) . • Rare après 40 ans • Age moyen = 16 ans • 99% unilatérale • 10 fois plus fréquent chez les individus souffrant d’une cryptorchidie
- 52. Physiopathologie
- 53. Etiologies • Testicule plus mobile que la moyenne • Anomalie congénitale de la vaginale -Hyperlaxité - Absence de mesorchium ou de gubernaculum
- 54. Clinique • L’examen physique sera bilatérale et comparatif • Début brutal, douleur scrotale violente et unilatérale • Bourse inflammatoire et très douloureuse à la palpation • Testicule dur, ascensionné . TR normal • Orifices Herniaires libres. +/- troubles digestifs, nausées et vomissements • Abolition du reflexe crémastérien . • Parfois , palpation du tour de spire • Toute douleur testiculaire unilatérale brutale est une torsion du cordon jusqu’à preuve du contraire .
- 55. Paraclinique • ECBU: limpide, absence de germe. • Bilan sanguin: normal, CRP normale • Echographie doppler des bourses. • Bilan pré-opératoire : NFS- GR+Rh- TP/TCA
- 56. Torsion testiculaire • Urgence chirurgicale : • Exploration chirurgicale: -Détorsion + Orchidopéxie bilatérale ou orchidectomie • Orchidectomie (si testicule nécrosé) • Prothèse testiculaire à froid
- 58. Diagnostics différentiels • Torsion de l’hydatite sessile de Morgani • Hernie inguino-scrotale étranglée • Cancer du testicule • Trauma testiculaire • Orchi-epididymite aigue • Torsion du cordon spermatique negligée • Subdétorsion • Torsion du cordon spermatique sur testicule cryptochide • Hydrocèle
- 59. Evolution • Suivi post-opératoire: - Evolution favorable corrélée à la précocité de l’intervention - Sinon, fibrose testiculaire post-ischémique • < 3 heures : 100% testicules sauvés • < 6 heures: 90% • < 10 heures : 50% • Taux global: 40-70% • +/- ablation du testicule (si nécrosé) • +/- prothèse • Surveillance post-opératoire surveillance des constantes • Pansements Sortie à J + 1 si suites simples
- 60. • Toute douleur aigue scrotale nécessite une exploration urologique en urgence • Le diagnostic reste avant tout clinique (urgence chirurgicale) • Les conséquences: - Psychologiques - Endocrinologiques: quasi nulles - Fertilité: nombreuses études, effet délétère sur le spermogramme (création d’Ac anti-spermatozoïdes)
- 62. Cas clinique • Homme 18 ans, traumatisme périnéal et scrotal sur la fourche de son scooter • A l’examen: douleur testiculaire gauche et hématome scrotal et périnéal
- 63. Etiologies • Morsure animal • Choc direct • Mutilations • Sport • Accident AVP Considérer: • Traumatisme ouvert = CHIRURGIE + antibiothérapie • Traumatisme fermé = ECHO +/- CHIRURGIE
- 64. Clinique • Miction? (oui, urine claires) • BU (sang +++) pas de signe d’infection • Echographie • Hématome péri-testiculaire • Rupture de l’albuginée
- 65. Priapisme
- 66. Définition • Etat d'érection involontaire, prolongé et souvent douloureux sans désir sexuel. • Touche essentiellement les corps caverneux mais le gland et le corps spongieux restent flasque. • Danger : Au-delà de 4 heures, un risque de lésions définitives des corps caverneux et donc d'impuissance.
- 68. Rappel anatomo physiologique ( suite)
- 69. Etiologie Maladies du sang : • Drépanocytose, polyglobulie, thrombocytémie • Leucémies , troubles thrombo-emboliques. Affections de la région pelvienne : • cancers de la région pelvienne... Cause traumatique périnéal ou pénien • Rare – haut débit – pas de danger d’ischémie • Toxique (marijuana, cocaïne, alcool) Causes iatrogènes: • IIC, Neuroleptiques, Héparine de bas poids moléculaire. Autres causes plus rares: • Amylose, déficit en G6PD, tumeurs du cerveau, myélites, tétanos.
- 70. • On distingue deux sortes de priapisme : 1-Le priapisme à bas débit, • Le plus urgent et le plus courant. Véritable URGENCE urologique • Conséquence directe d’une anomalie du retour veineux • Au-delà de 4 heures, les premières lésions d’anoxie surviennent avec lésions progressives des fibres musculaires lisses du corps caverneux • Lésions éventuellement définitives exposant à une dysfonction érectile définitive. • L’érection est douloureuse, ne concerne que les corps caverneux.
- 71. • Causes : - Hématologiques - Une localisation secondaire des néoplasmes urogénitaux ) - La drépanocytose - Un trouble de la coagulation (Thrombose) - causes iatrogènes (injections intra caverneuses :cause la plus fréquente). - Injection de stimulant érectile - les traumatismes médullaires, par lésion du système sympathique (modérateur de l’érection)
- 72. 2-Le priapisme à haut débit • Moins fréquent. Les corps caverneux ne sont pas ischémique, le patient n’a donc pas de douleur. • Suppose une augmentation du flux artériel de manière prolongée et non régulée • Lié en général à un traumatisme périnéal, voire à une lésion d’une artère caverneuse lors d’une injection intra caverneuse qui peuvent engendrer une fistule. • 30 à 50 % des cas idiopathiques
- 73. Prise en charge • Dépend du type de priapisme • Le délai de consultation est un élément important pour la décision thérapeutique. • En cas de doute diagnostic entre priapisme à haut et bas débit, un Doppler pourra être proposé.
- 74. Prise en charge La prise en charge du priapisme à haut débit nécessite un bilan clinique et surtout morphologique très précis, et donc peut être différée. • L’examen de référence est l’artériographie pelvienne. • Une embolisation peut être envisagée devant le diagnostic d’une fistule. • L’évolution est en règle générale favorable pour ce qui est de la récupération d’une fonction érectile normale.
- 75. Prise en Charge Priapisme à bas débit • Dépend du délai de consultation et de la sévérité de l’anoxie estimée grâce à la gazométrie du sang caverneux. • Le bilan clinique est indispensable afin de déceler un éventuel facteur étiopathogénie : - La drépanocytose (transfusion et oxygénothérapie) - La leucémie myéloïde chronique (chimiothérapie en urgence)
- 76. Prise en charge « petits moyens » Avant 6 hres • Rapport sexuel et éjaculation répétée • Réalisation d'un effort physique important • Réfrigération cutanée pénienne
- 77. Prise en charge Entre la 6e et la 24e heure, en l’absence de signes d’anoxie et de contre-indications on préconise les alpha stimulants • Prise orale d'alpha-stimulants (Effortil jusqu’à 6 cp/j) • Inefficacité = Injection intra-caverneuse de drogues alpha-stimulantes. (EffortilR 1 à 2 mg direct jusqu’ 10 mg ou effedrine) Surveillance TA et pouls (risque HTA sévère) • On peut associer aux injections intra caverneuses la ponction intra caverneuse qui consiste à décomprimer les corps caverneux et retirer le sang de stase. • Cette technique est non seulement efficace du point de vue thérapeutique mais permet aussi d’effectuer une gazométrie.
- 78. Prise en charge La ponction est indiquée d’emblée après la 24e heure et en cas d’échec ou de contre-indications d’injection intra caverneuse d’alpha stimulants . • Ponction intra-caverneuse (évacuation sang +/- suivie d’une injection alpha- stimulant) • Shunt caverno-spongieux au bloc opératoire (gland ou base des corps caverneux) • Pontage caverno-spongieux
- 79. Fracture du Corps caverneux
- 80. CAS Clinique • Homme de 35 ans, • Douleur brutale lors d’un rapport sexuel au niveau de la base de la verge • Depuis, augmentation de volume (hématome) • Verge aubergine
- 82. • L’IRM de la verge peut être utile en cas de doute diagnostique. Le traitement est chirurgical. • Il s’agit d’une urgence relative (< 24 h) avec nécessité d’une évacuation de l’hématome, de suturer le corps caverneux. • On peut escompter une cicatrisation après 6 semaines sans rapport sexuel.
- 84. • Les traumatismes rénaux sont fréquents • Retrouvés dans 10 % de l’ensemble des traumatismes abdominaux. • Ils sont majoritairement fermés • En rapport avec un choc direct ou une décélération brutale
- 85. • Signes cliniques les plus fréquents : hématurie et la lombalgie. • Le meilleur examen diagnostique est l’uroscanner. • La classification la plus utilisée est celle de l’ AAST qui décrit 5 grades de gravité croissante sur la base des images scannographiques. • Le traitement est conservateur dans l’immense majorité des cas • Essentiellement basé sur une surveillance clinique. • Les traitements radio-interventionnels et endoscopiques sont réservés à des cas très sélectionnés • Le recours à l’exploration chirurgicale est exceptionnel.
- 86. Conduite a tenir • NFS, Bilan de coagulation, Ionogramme, Uree-creatinine • ASP- Echographie abdominale • Scanner abdominal =Stadification
- 89. Gangrène de Fournier • Une fasciite nécrosante des Organes génitaux et du périnée • Infection sévère des tissus mous touchant les fascias superficiel et profond. • Résulte d’une infection polymicrobienne dont la source peut être génito-urinaire, colorectale, cutanée ou idiopathique et qui est potentiellement létale . • Les germes responsables : anaérobies; E. Coli, Pseudomonas Aeruginosa et streptocoques. • Cause la plus fréquente de perte de substance de peau génitale.
- 90. Etiologies : • Idiopathiques chez 75 à 100 % des patients. • Colorectale dans 13 à 50 % des cas • Urogénitale dans 17 à 87 % des cas . • Les autres causes incluent les infections cutanées et les traumatismes locaux Facteurs favorisants : • Immunité déprimé : Diabète (60% des cas ) ,VIH, malnutrition, néoplasie, corticothérapie, obésité morbide , pathologies vasculaire pelvienne • Alcoolisme, âges extrêmes, mauvaise hygiène,
- 91. Physiopathologie • Établissement d’une infection locale adjacente à un point d’entrée • Progression rapide vers une endartérite oblitérante entrainant une nécrose vasculaire cutanée et sous-cutanée • Nécrose tissulaire secondaire a l’ischémie locale
- 93. Prise en charge • Urgence médico-chirurgicale avec une prise en charge réanimatoire. • Examens complémentaires indispensables : NFS, créatinine, hémostase, groupe sguin /Rh, gaz du sang, lactates, bilan bactériologique (hémocultures, ECBU, prélèvements locaux). • Triple antibiothérapie parentérale, active sur les germes anaérobies : pénicilline, métronidazole, aminosides. • Par ailleurs, un traitement chirurgical sous anesthésie générale est requis avec une excision/parage de tous les tissus nécrotiques, à renouveler tant que les lésions progressent. • À distance, une reconstruction du périnée et une greffe de peau peuvent être envisagées. • Le pronostic est mauvais avec un taux de mortalité de 30 %
Notes de l'éditeur
- Ces pathologies urgentes qui comptent à peu près une vingtaine de cas se répartissent en cinq grands ensembles : Les urgences urologiques traumatiques Les urgences urologiques infectieuses Les urgences urologiques génito-scrotales Les urgences urologiques obstructives Les urgences urologiques avec hématurie
- Hématurie macroscopique Coloration rosée, rouge ou brunâtre des urines visibles à l’œil nu (≥ 500 hématies/mm3) Les urines normales contiennent moins de 10 hématies /mm3 (ou 104 /ml). L’hématurie est la présence, en quantité anormale, d’hématies émises dans les urines (≥ 10/mm3 ou 10 000/mL), lors d’une miction. .
- Les hématuries micro- et macroscopiques peuvent intervenir dans deux cadres nosologiques : en cas d’hématurie d’origine glomérulaire, la sécrétion d’urokinase dans les tubules rénaux prévient la formation de caillots.
- Cette physiopathologie explique l’absence de caillots lors d’une hématurie macroscopique d’origine néphrologique, en raison de l’action fibrinolytique de l’urokinase tubulaire la présence de cylindres hématiques ou d’hématies déformées sur l’analyse du culot urinaire l’association fréquente à une protéinurie (≥ 0,3 g/24 h), voire à un syndrome néphrotique ou néphritique.
- Valeur sémiologique: Identique ==== atteinte du parenchyme rénal ou de la voie excrétrice urinaire (cavités pyélo calicielles, uretères, vessie, urètre) L’examen clinique initial permet d’orienter, dans la majorité des cas, le bilan vers une étiologie urologique ou néphrologique, et conditionne le choix d’examens complémentaires adaptés. L'interrogatoire peut vous orienter sur l'origine du saignement : · Y a-t-il des caillots dans les urines ? • si oui, vous pouvez conclure qu'il s'agit d’une hématurie d’origine urologique • en cas d’hématurie d’origine glomérulaire, la sécrétion d’urokinase dans les tubules rénaux prévient la formation de caillots. · Quelle est la couleur des urines ? • urines rosées : l'origine de l'hématurie se situe probablement au niveau des voies urinaires excrétrices • urines presque brunes (coca-cola, thé) : l'origine est plus probablement glomérulaire . Les urines sont rouges au début ou à la fin de la miction ? • souvent plus difficile à faire préciser, mais essayez ! En pratique, seule l’hématurie macroscopique permet de reconnaître (au travers de l’épreuve des 3 verres de GUYON Des signes fonctionnels urologiques peuvent avoir valeur d’orientation. une pollakiurie et une dysurie évoqueront une étiologie du bas appareil. Des douleurs lombaires chroniques ou des coliques néphrétiques feront évoquer plutôt un caillotage de la voie excrétrice ou une pathologie lithiasique. Une hyperthermie, des brûlures mictionnelles feront penser à un processus infectieux. Il existe des symptômes évocateurs de néphropathie comme la prise de poids, la présence d’œdèmes, et l’existence de signes indirects d’HTA (céphalées, acouphènes…). un contact lombaire, évoquant une tumeur ou une polykystose. La percussion des fosses lombaires peut mettre en évidence une douleur de colique néphrétique (par lithiase ou caillotage de la voie excrétrice). La recherche d’une varicocèle (signe de compression de la veine spermatique gauche ou de la veine cave) est parfois évocatrice d’une tumeur rénale gauche. Les touchers pelviens sont requis à la recherche d’une hypertrophie ou d’un cancer prostatique, ou d’une masse pelvienne. L’inspection et la palpation des membres inférieurs doivent rechercher des œdèmes
- Toute hématurie même sous anticoagulant doit être explorer Eliminer toute fausse hematuire avant de réaliser un bilan étiologique, la présence de fausses hématuries est à éliminer par un examen direct du sédiment urinaire lors d’un ECBU. Le compte D’ADDIS ou « hématie leucocytes minutes » (seuil pathologique > 10 000/min).
- Evaluation du retentissement hémodynamique en prenant le pouls et la tension artérielle === hypovolémie en cas d’hématurie macroscopique massive : tachycardie, hypotension artérielle, marbrures hypertension maligne en cas de néphropathie glomérulaire sévère. La palpation hypogastrique est indispensable à la recherche d’un globe vésical (rétention aiguë sur caillotage). Evaluer le retentissement NFS+créatinine+ECBU Hospitalisation si: anémie RAU sur caillotage insuffisance rénale infection urinaire chute d’escarre
- Le patient arrive le plus souvent en urgence Rassurer et installer le patient Prise des constantes
- l ’examen clinique : - globe vésical = masse hypogastrique tendue, pouvant remonter jusqu ’à l ’ombilic, mate à la palpation, douloureuse et la palpation augmente le besoin d ’uriner Impossibilité d'uriner douloureuse Douleur sus-pubienne de plus en plus intense Besoin d'uriner permanent, n'aboutissant au mieux qu'à l'émission de quelques gouttes d'urines ( Miction par regorgement ) Globe vésical: vessie tendue, ronde, douloureuse, mate, convexe Sondage et cathéter sus pubien: noter l'importance du globe vésical (+++) • Touchers pelviens (++++++) • E.CB.U CAT = écho abdominale si possible pour confirmer le diagnostic - en post-op = sondage sans écho Rétention vésicale "aiguë": à début brutal – Globe vésical • Rétention vésicale "chronique" – mictions par regorgement
- Etiologies des dysuries Obstacle sur le col vésical et ou de l'uréthre – adénome, cancer de la prostate, prostatite – rétrécissement de l'urétre – valves de l'urètre postérieur – lithiase urétrale – sarcome du sinus urogénital – tumeurs pelviennes et rétrécissements de l'urétre – fécalome • Dysfonctionnement neurologique – racines S2,S3,S4 – Méningite, polyomyélite – SEP, zona – Traumatisme médullaire • Médicaments – Atropiniques, neuroleptiques Pour les deux sexes différentes causes : - urologiques = tumeur vésicale ou urétrale, corps étranger intra-vésical - neurologiques : méningite, poliomyélité, SEP, trauma rachidiens - médicamenteuses : atropiniques, neuroleptiques - autres : tumeurs rectales, fécalome, hématome périnéal
- Echo abdominale /reno vesico prostatique possible pour confirmer le diagnostic - en post-op = sondage sans écho
- la colique nephretique est un symptôme fréquent, elle représente un motif courant de consultation aux urgences urologiques.
- Lacune intra pyelique droite
- 1-la lithiase : -concrétion de sels minéraux dans les voies urinaires . - cause n°1 colique nephretique . . 2-Autres: Toute obstruction intrinsèque ou extrinsèque : - Un syndrome de la jonction pyélo-urétérale - Une urétérite ( radique ,infectieuse ,tuberculeuse ,iatrogène …) - Une tumeur de la voie excrétrice supérieure - Compression urétérale extrinsèque (grossesse , fibrose et adénopathies retro péritonéales , tumeurs pelviennes)
- Elles sont rares Caractérisées par leur survenue sur : - Rein unique - Anurie - Etat fébrile - Hyperalgique résistant au traitement antalgique (morphiniques) - La femme enceinte . Nécessitant une hospitalisation en urgence
- Constantes (recherche de la fièvre ++) BU + ECBU (si fièvre) + BES +/- NFS (si fièvre) ASP (calcul ?) Echographie (dilatation ?) +/- Uroscanner (si forme compliquée : fièvre, hyperalgie malgré antalgie, anurie, …) Calmer la douleur +++ Médecin en ville ou aux Urgences Anti-inflammatoires en IV (ou IM) – parfois Morphine IV Sortie des urgences Si douleur calmée + absence d’infection urinaire associée Filtrage des urines - poursuite AINS quelques jours
- La pyélonéphrite aiguë (PNA) est une des principales étiologies de syndrome infectieux aux urgences.
- . Le diagnostic est généralement facile et basé sur l’association d’une fièvre, d’une douleur lombaire unilatérale et d’un ECBU positif. La biologie et l’imagerie visent à rechercher toute forme de pyélonéphrite compliquée, en particulier la forme obstructive due à un obstacle (le plus souvent un calcul) sur les voies urinaires et qui est une urgence chirurgicale. La prise en charge dépend de l’existence de signes de gravité ou de complications associées. Le traitement repose sur l’antibiothérapie, à débuter d’emblée, initialement probabiliste puis secondairement adaptée à l’antibiogramme. Les patients hospitalisés dans les services d’urologie seront ceux qui présentent une pyélonéphrite compliquée
- L’atteinte du rein se fait habituellement par migration à partir d’une infection urétrovésicale. La pyélonéphrite aiguë touche 5 fois plus la femme que l’homme chez qui une symptomatologie urinaire fébrile devra faire évoquer jusqu’à preuve du contraire une prostatite aiguë. Chez la femme, elle est plus fréquente pendant la grossesse sous l’effet conjugué d’une dilatation physiologique urétérale et des calices rénaux dès la 12e semaine de grossesse (probablement sous l’action myorelaxante de la progestérone) et de la compression urétérale basse par l’utérus gravide. Cette dernière prédomine sur l’uretère droit expliquant que la grande majorité des PNA chez la femme enceinte soit latéralisée à droite. La pyélonéphrite aiguë touche 5 fois plus la femme que l’homme chez qui une symptomatologie urinaire fébrile devra faire évoquer jusqu’à preuve du contraire une prostatite aiguë. Chez la femme, la pyélonéphrite aiguë est plus fréquente pendant la grossesse sous l’effet conjugué d’une dilatation physiologique urétérale et des calices rénaux dès la 12e semaine de grossesse (probablement sous l’action myorelaxante de la progestérone) et de la compression urétérale basse par l’utérus gravide. Cette dernière prédomine sur l’uretère droit expliquant que la grande majorité des PNA chez la femme enceinte soit latéralisée à droite.
- L’antibiothérapie initiale est probabiliste puis doit être adaptée aux résultats de l’antibiogramme. La modalité du traitement varie selon la gravité de l’atteinte : • pyélonéphrite aiguë simple : monoantibiothérapie par fluoroquinolone per os ou céphalosporine de troisième génération (C3G) injectable. La durée du traitement varie entre dix à 15 jours, voire moins dans les formes les plus simples ; • pyélonéphrite aiguë compliquée : biantibiothérapie par fluoroquinolone ou C3G, associée à aminoglycoside. La durée du traitement est généralement de 21 jours, voire plus en cas de complications
- Une antibiothérapie probabiliste pendant 7 à 14 jours sera débutée une fois l’ECBU réalisé, sans en attendre les résultats. Il est recommandé d’utiliser : - une fluoroquinolone systémique par voie orale (en l’absence de nausées ou de vomissements) : ciprofloxacine 500 mg P.O. bid, Ofloxacine 200 mg P.O. bid, lévofloxacine 500 mg P.O. qjour, ou par voie injectable en cas de troubles digestifs. En cas de contre-indication aux fluoroquinolones (allergie ou intolérance, utilisation récente) une céphalosporine de 3e génération (C3G) (ceftriaxone, cefotaxime) injectable, est recommandée. En cas de Gram positif à l’examen direct une amino-pénicilline associée à un inhibiteur des bétalactamases est recommandée. - L’antibiothérapie de relais est guidée par les données de l’antibiogramme. - En l’absence de résistance, le cotrimoxazole et l’amoxicilline sont une alternative. - En présence d’un agent pathogène résistant à l’acide nalidixique et sensible aux fluoroquinolones systémiques, il est recommandé de ne pas utiliser cette classe d’antibiotiques.
- Chez l’homme, l’infection urinaire ne se limite pas à l’infection vésicale, la prostate est aussi touchée Les bacilles à Gram négatif sont majoritairement en cause dans les prostatites aiguës et chroniques. L
- Il est classique d’admettre que les agents pathogènes parviennent au tissu prostatique par quatre voies : 1) Voie urétrale : C’est de loin la plus fréquente. Elle peut être d’origine ascendante ou descendante. Elle est évidente chez l’homme dans de nombreuses circonstances : prostatites induites par sondage ou manœuvre endoscopique, prostatites secondaires à une urétrite, flore prostatique identique à la flore vaginale de la partenaire, notamment dans certains cas de prostatite chronique. L’infection peut également se produire par voie descendante, les germes de l’urine d’amont colonisant les canaux prostatiques par reflux d’urine dans les canaux prostatiques, généralement en cas d’obstacle sous-vésical (hypertrophie prostatique, sténose urétrale, dyssynergie vésicosphinctérienne).
- 2) Contamination directe par voie rectale : La fréquence des prostatites aiguës après biopsies prostatiques échoguidées transrectales est estimée à 1 % soulignant l’importance de la préparation du rectum et de l’antibioprophylaxie. Par ailleurs, une contamination directe de voisinage par des germes présents dans le tube digestif a également été évoquée, indépendamment de toute procédure invasive. 3) Voie hématogène : Il s’agit le plus souvent d’infections staphylococciques ou streptococciques, à partir d’un foyer oto-rhino-laryngologique, dentaire, cutané ou digestif, ou encore d’infections virales qui déterminent une prostatite aiguë manifestement secondaire. 4) Voie lymphatique : La propagation de l’infection par voie lymphatique à partir du tube digestif a été évoquée, et pourrait pour certains expliquer un certain nombre de prostatites sans cause identifiée.
- Voie de contamination surtout rétrograde remontée de l’urine infectée de l’urètre vers l’épididyme par le canal déférent
- Interruption de la vascularisation du testicule par la torsion du cordon spermatique et entraîne une nécrose testiculaire rapide . Irreversible après 6 hres Système artériel: • Artère spermatique (testiculaire): branche de l’aorte (L2), chemine dans le pédicule spermatique qui traverse le canal inguinal dans le cordon spermatique. • Vaisseaux de l’épididyme: artère spermatique et déférentielle (branche de la vésiculo-déférentielle, issue de l’artère iliaque interne). • Vaisseaux du canal déférent: branches de l’artère déférentielle. • Artère funiculaire: origine = artère epigastrique inférieure. Système veineux: 2 plexus - Plexus antérieur: se dirige vers VCI et VRG - Plexus postérieur: veine épigastrique inférieure. URGENCE CHIRURGICALE • Torsion du cordon spermatique et son enroulement sur lui-même affectant vaisseaux et nerfs destinés aux testicules et le canal déférent. • Normalement la vaginale empêche la rotation du testicule autour du cordon. • Le plus souvent aigue, intravaginale et complète, de degré varié (serrée ou non). (forme du nouveau-né supra vaginale et forme rare inter épididymo-testiculaire) • Peut entraîner si non intervention au delà de 6 heures une destruction totale du tissu testiculaire par ischémie, puis infarctus du testicule par torsion de l’artère spermatique.
- Interruption de la vascularisation du testicule par la torsion du cordon spermatique et entraîne une nécrose testiculaire rapide . Irreversible après 6 hres Très fréquent, tout âge, surtout entre 15 et 30 ans (rare > 40 ans) • 1/4000 • 2 pics de fréquence: péri-natal et post-pubertaire (74% < 20 ans et 9% < 20 ans) • Age moyen = 16 ans • 99% unilatérale • 10 fois plus fréquent chez les individus souffrant d’une cryptorchidie
- Clinique : Début brutal, douleur scrotale violente et unilatérale Douleur intense unilatérale empêchant la marche normale, irradiation inguinale fréquente, parfois lombaire. Palpation très douloureuse Abolition du reflex Crémasterien Ajout Clinique : Pas de fievre ni de signe d’infection urinaire ( o ecoulement urethral, TR non douloureux , BU negative) Orifices herniaires libres Abdomen souple et non douloureux Testicule contralateral normal Douleur intense unilatérale empêchant la marche normale, irradiation inguinale fréquente, parfois lombaire. • Malade apyrétique • +/- troubles digestifs, nausées et vomissements • Palpations: - Gênée +++ par l’importance de la douleur testiculaire -Testicule surélevée œdèmatié - Epididyme souple - Réflexe crémastérien aboli -TR normal
- En règle générale, les examens complémentaires sont peu utiles car ils retardent le diagnostic. Echographie doppler des bourses: si doute clinique, objective la torsion, l’épaississement (> 1 cm), et le raccourcissement du cordon, l’aspect spiralé des vaisseaux, la dévascularisation du testicule concerné et l’hypervascularisation réactionnelle des tissus péritesticulaires.
- Prévenir du risque d’orchidectomie si testicule non viable , d’atropie testiculaire et du risque ultérieur d’hypofertilite La chirurgie ne doit etre retardee par aucune exploration complementaire des qu’une torsion du cordon est suspectee En cas de doute toujours effectuer une exploration chirurgicale Ouverture de la vaginale testiculaire / Prelevement bacteriologiques en cas d’hydrocele reactionnelle. Exteriorisation du testicule , bilan lesionnel , detorsion , appreciation de la recoloration et de la viabilite du testicule . Si testicule est viable orchidopexie et orchidopexie controlaterale , si non viable : orchidectomie ( envoie de la pierce en anatomipathologie ) Toujours orchidopexie controlaterale . Pas de pose de protheses testiculaire dans le temps ( risque infectueux) Détorsion manuelle, sans pour autant différer l’intervention (rétablissement des flux vasculaires, stabilisation des lésions tissulaires) • Urgence chirurgicale: orchidotomie: exploration et détorsion du cordon avec fixation du testicule à la vaginale, ainsi que du testicule controlatéral (3-18% de risque de torsion controlatérale) • Orchidectomie
- Torsion Hydatite : Douleur moins vive qu’une torsion du cordon . Palpation d’une boule douloureuse au pole superieur du testicule. Prservation du reflexe crémastérien Hernie inguino scrotale : Signe digestifs associe Cancer du testicule : Necrose ou l’hemorragie intratumorale peut etre tres douloureuse Atypie : Torsion negligee: Une fois la necrose installee ,la douleur diminue
- Augmentation du volume et de la douleur en quelques heures et nécrose testiculaire responsable d’une atrophie si aucune intervention n’est réalisée dans les 6 heures, rendant l’orchidectomie inévitable.
- Le priapisme désigne un état d’érection prolongé, dépassant 3 heures, parfois douloureux, en dehors de toute stimulation sexuelle. Cette érection inappropriée devient rapidement douloureuse. Le priapisme touche essentiellement le corps caverneux. Le gland et le corps spongieux sont en règle générale épargnés.
- Le priapisme est une affection rare. Son incidence est de 1.5 pour 100 000 personnes à l’année. Cette incidence tend à augmenter avec l’accroissement de prescription des injection intracaverneuse . La plupart des facteurs étiologiques sont des causes pouvant diminuer le retour veineux ou au contraire augmenter le flux artériel (artère caverneuse), donc causer un déséquilibre entre le flux entrant et sortant (de la ‘’pompe ‘’).
- On distingue deux sortes de priapisme : Le priapisme se doit d’être classé en deux types de mécanismes, veineux anoxique à bas débit et artériel à haut débit : Le priapisme à bas débit est une véritable urgence urologique. Au-delà de 4 heures, les premières lésions d’anoxie surviennent avec lésions progressives des fibres musculaires lisses du corps caverneux, lésions éventuellement définitives exposant à une dysfonction érectile définitive. L’érection est douloureuse, ne concerne que les corps caverneux. Le priapisme à bas débit, manifestement le plus urgent et le plus courant. C’est la conséquence directe d’une anomalie du retour veineux due à des causes hématologiques, hématologiques, dans la plupart des cas : - La leucémie myéloïde chronique - Une localisation secondaire des néoplasmes urogénitaux (compression mécanique) - La drépanocytose - Un trouble de la coagulation (Thrombose) - On peut aussi citer des causes non hématologiques, qui n’en sont pas moins importantes; comme les causes iatrogènes : a) Les injections intracaverneuses en sont la cause la plus fréquente; avec des priapismes dans 1% des cas d’injections de prostaglandines et jusqu’à17% des cas ayant reçu une injection de papavérine b) Instillation intra urétrales de prostaglandine c) Les antidépresseurs (tradozone) d) Et la cocaïne (qui n’est pas prescrite en général;) . - les traumatismes médullaires, par lésion du système sympathique (modérateur de l’érection)
- 2-Le priapisme à haut débit Moins fréquent Suppose une augmentation du flux artériel de manière prolongée et non régulée, ce qui est lié en général à un traumatisme périnéal, voire à une lésion d’une artère caverneuse lors d’une injection intracaverneuse qui peuvent engendrer une fistule. Dans les cas de priapisme à haut débit, le tissu du corps caverneux n’est pas ischémique, le patient n’a donc pas de douleur. Le traitement peut être différé, devant permettre de réaliser dans les meilleures conditions une artériographie visant à mettre en évidence une éventuelle fistule posttraumatique, et éventuellement une embolisation. 30 à 50 % des cas idiopathiques, on rapporte une stimulation sexuelle prolongée accompagnant le début d’installation du priapisme.
- Entre la 6e et la 24e heure, en l’absence de signes d’anoxie et de contre-indications on préconise les alphastimulants (drogues qui simulent l’effet du système sympathique)
- La ponction est indiquée d’emblée après la 24e heure et en cas d’échec ou de contre-indications d’injection intracaverneuse d’alphastimulants - L’intérêt de la chirurgie dans ce cas, est de mettre en place un shunt caverno-spongieux (ou anastomose caverno-spongieuse), afin de permettre au sang des aréoles caverneuses d’emprunter les voies de drainage veineux du corps spongieux.
- Suspicion de rupture des corps caverneux Bilan rapide Bilan préopératoire echographie +/- IRM (si possible)
- Douleur avec perte de la rigidité de la verge en érection dans les conséquences d’une fuite de sang par effraction de l’abulginée puis de la présence ensuite d’un hématome abondant qui peut donner à la verge un aspect caractéristique (aspect en aubergine), la perception subjective d’un craquement.
- Urgence par : Terrain: Enfant Instabilité de la TA Evolution : Choc cardiogenique Risque de décès par hemorragie
- La classification la plus utilisée est celle de l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST) qui classe les traumatismes rénaux en 5 grades de gravité croissante sur la base des images scannographiques.
- Pronostic s’est également considérablement amélioré et les traumatismes rénaux aboutissent désormais très rarement au décès ou à la perte du rein.
- La Gangrène de Fournier est une forme de fasciite necrosante genitale, perineale perianale qui résulte d’une infection polymicrobienne dont la source peut être génito-urinaire, colorectale, cutanée ou idiopathique et qui est potentiellement létale . Cause la plus fréquente de perte de substance de peau génitale. Les germes responsables sont : anaérobies, E. Coli, Pseudomonas Aeruginosa et streptocoques.
- La gangrène est le plus souvent secondaire à une infection locale (fistule anale, abcès périnéal, lésion cutanée…). Elle survient souvent sur terrain fragilisé (diabète, éthylisme chronique, immunodépression…). Certains facteurs sont aggravants comme un retard de la prise en charge initiale et/ou la prise d’antiinflammatoires. Les sources colorectales englobent les abcès périrectaux et périanaux, les instrumentations rectales, les perforations coliques secondaires à un cancer, les diverticuloses, et le coït anal chez les homosexuels. Les sources urogenitales incluent les stenoses de l’urètre avec extravasation d’urine et infection periurethrale , les instrumentations urethrales ,y compris les sondes a demeure surtout chez les paraplegiques . Des cas de gangrene de Fournier ont été rapportes avec circoncision , cure d’hernie et après implantation de prothese penienne . Les sources cutannees comprenne les infection cutannees aigues et chroniques du scrotum , les hydadenites suppurees , les balanites et les trau,atismes intentionnels ( piercing scrotal
- Si nécessaire, une colostomie de décharge sera confectionnée en cas de lésions proches de l’anus, voire une cystostomie de décharge. Les testicules sont parfois protégés temporairement par enfouissement au niveau inguinal ou sur la face interne des cuisses. Des pansements doivent ensuite être réalisés très régulièrement (toutes les 48 à 72 h), nécessitant souvent des anesthésies générales itératives. À distance, une reconstruction du périnée et une greffe de peau peuvent être envisagées. Le pronostic est mauvais avec un taux de mortalité de 30 %