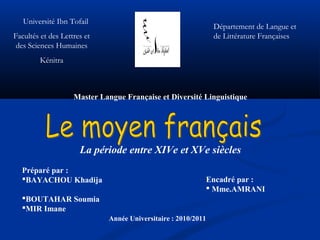
Moyen franais
- 1. Université Ibn Tofail Département de Langue et de Littérature Françaises Facultés et des Lettres et des Sciences Humaines Kénitra Master Langue Française et Diversité Linguistique La période entre XIVe et XVe siècles Préparé par : BAYACHOU Khadija Encadré par : Mme.AMRANI BOUTAHAR Soumia MIR Imane Année Universitaire : 2010/2011
- 2. Plan I. 1. 2. I. II. 1. 2. 3. III. Introduction Langues et dialectes du moyen âge Langue d’oc Langue d’oïl Aperçu historique sur la période (XIVe- XVe siècle) Caractéristiques du moyen français: Au niveau phonétique Au niveau graphique Au niveau lexical Corpus Conclusion
- 3. Introduction Le moyen âge est une longue période de l’histoire qui se situe entre l’Antiquité et la Renaissance. Le moyen âge: une période d'instabilité politique, sociale et économique qui a favorisé un mouvement de «relâchement linguistique». Nous ne connaissons le français médiéval que par les textes. À partir des années 1200, leur nombre ne cesse de croître, si bien qu’aux XIVe et XVe siècles, la masse de livres et des documents écrits en français devient incommensurable. Les études révèlent deux caractères importants de la langue écrite à savoir:
- 4. Premièrement, on constate que persistent des variations notables entre les régions dans la façons d’écrire le français. Deuxièmement, on voit qu’entre le XIIIe et le XIVe siècle, l’ancien français évolue vers ce qu’il est convenu d’appeler le moyen français.
- 5. I. Langues et dialectes du moyen âge Langue d’oïl / langue d’oc: L'usage du terme « langue d'oïl » est attesté dès la fin du XIIIe siècle, il vient de Dante qui avait nommé trois langues romanes selon la manière de dire « oui » : la « langue d'oïl » (français), la « langue d'oc » (lenga d'òc, occitan) et la « langue de si » (italien). Oïl vient du Latin: hoc ille (celui-ci), oc de hoc (ceci), et si de sic (ainsi).
- 7. En vert: les langues d’oïl En rouge: les langues d’oc En jaune: le franco provençal
- 8. 1. Langue d’oïl Le terme langue d'oïl désigne globalement la branche des langues gallo-romanes qui se sont développées dans la partie Nord de la Gaule, puis dans la partie Nord de la France, dans le sud de la Belgique (Belgique romane) et dans les îles Anglo-Normandes. On rencontre ce terme au singulier ainsi qu’au pluriel : -au singulier (français au sens large), variété du domaine d’oïl sont des dialectes de la langue française. -au pluriel : il y a des langues distinctes dans le domaine d’oïl (le berrichon, le champenois, le français, le picard, le lorrain, le gallo, le wallon, …). NB : l’une des formes locales de la langue d’oïl est devenue la langue française, qui s’est développée en l’Île-de-France et dans l’Orléanais et qui, au cours des siècles, s’est imposée comme langue officielle à l’ensemble du territoire français.
- 9. 2. Langue d’oc L’occitan ou langue d’oc (en occitan : occitan, lenga d’òc ou óucitan, lengo d’o) est une langue romane parlée dans le tiers sud de la France, les Vallées occitanes et Guardia Piemontese (en Italie), le Val d’Aran (en Espagne) et à Monaco. L’Occitanie est l’espace linguistique et culturel de l’occitan. L’occitan présente une grande variabilité (six dialectes, plusieurs normes littéraires, plusieurs normes graphiques), une importante production culturelle et une littérature prestigieuse qui font sa richesse. Un locuteur de cette langue parle un des dialectes d’oc car il n’existe pas de standard oral unifié. Les dialectes de l’occitan sont l’auvergnat, le gascon, le languedocien, le limousin, le provençal et le vivaro-alpin.
- 10. L’occitan est à la fois une langue orale, parlée par des millions de personnes jusqu’à aujourd’hui; une langue littéraire, qu’à partir du XIIe siècle les troubadours vont véhiculer dans toutes les cours d’Europe; et aussi une langue administrative encore utilisée en Catalogne. En France et en Italie, elle fut aussi une langue administrative et juridique en concurrence avec le latin pendant le Moyen Âge. Cet usage se poursuivra parfois jusqu’à l’époque contemporaine, puis elle fut remplacée progressivement par le français ou l’italien.
- 11. II. Aperçu historique sur la période XIVe – XVe siècles Avec les XIVe et XVe siècles, s'ouvrit une période sombre pour la France, qui sombra dans un état d'anarchie et de misère. C'est l'une des époques les plus agitées de l'histoire de ce pays au point de vue sociopolitique: guerre de Cent Ans avec l'Angleterre, guerres civiles, pestes, famines, etc. Hors de France, l'Église était compromise par des abus de toutes sortes et des désordres scandaleux, qui lui firent perdre son crédit, pendant que l'Empire ottoman mettait fin à l'Empire romain d'Orient.
- 12. Évidemment, la langue française - ainsi que le latin- allait subir les contrecoups de ces bouleversements. La période du moyen français sera avant tout une période de transition, c'est celle qui allait permettre le passage de l'ancienne langue au français moderne.
- 13. III. Caractéristiques du moyen français: Si le français varie dans l’espace, il change aussi beaucoup dans le temps. On situe habituellement l’apparition du moyen français avec l’arrivée du premier Valois, Philippe VI, en 1326 et le début de la guerre de Cent Ans (1337/1339). Mais des traits du moyen français étaient déjà présents au XIII e siècle et des caractères de l’ancien langue ont pu persister ou réapparaître durant le XIVe siècle. Cela dit, les changements touchent tous les niveaux de la langue, phonétique, morphologique, syntaxique et lexical.
- 14. 1. Au niveau phonétique Plusieurs transformations touchent la phonétique: Un trait distinctif du moyen français est la réduction des hiatus. L’ancienne langue comptait un grand nombre de rencontres de voyelles qui se prononçaient séparément, un phénomène devenu rare en français moderne et souvent marquée par un tréma sur la seconde voyelle comme dans le mot « Noël ».beaucoup d’ hiatus se résorbent à un son unique dans la langue XIV et XV e siècles « raençon » devient « rençon » ou « cooin » se change en « coing» .
- 15. Les nombreuses diphtongues et triphtongues disparurent, se réduisant à des voyelles simples dans la langue parlée; par exemple: le « i » de « vengier » ou de « aidier » tend à ne plus se prononcer. Seule la langue écrite conserva les traces les traces de la prononciation de l’époque précédente dans les mots comme: « oiseau », « peau », « fou », « fleur », « cœur » et « saoul ».
- 16. 2. Au niveau graphique L’une des transformation les plus importantes, souvent retenue comme le principal trait distinctif du moyen français, est la disparition des marques de flexion. Le phénomène concerne l’ensemble du groupe nominal: déterminant, substantif et adjectif, qui tous perdent les traits qui auparavant pouvaient les distinguer selon qu’ils se trouvent en position de sujet ou de complément dans la phrase. Le moyen français généralise la marque du féminin des adjectifs par l’ajout d’un « e » final. Il demeure une exception notoire: « grande » ne s’impose que lentement et « grant » peut déterminer un nom féminin encore au XVe siècle.
- 17. La résistance est particulièrement forte lorsqu’il est antéposé au nom: ainsi écrit-on encore « grand-mère » ou à « grand-peine ». La disparition de la flexion se répercute sur la structure même de la proposition, la construction complémentverbe-sujet devient très rare en moyen français où domine très nettement la forme sujet-verbe-complément. Pour marquer le rang deuxiesme ,troisiesme, quatrièsme et cinquièsme .
- 18. Aussi on a tendance à restituer des consonnes doubles disparues en ancien français par exemple: «belle» d’après le latin «bella», «flamme» pour «flame» d’après «flamma», etc Pour lutter contre les confusions dues, à l’initiale des mots, à l’alternance entre la lettre [u] et [v] dans la graphie. On ajouta un [h] initial, ce qui permit de distinguer des mots tels « huis » de « vis », « huître » de «vitre »,etc
- 19. 3. Au niveau lexical Le moyen français pouvait compter sur ses propres ressources pour la création de nouveaux mots par exemple des mots anciens acquièrent un sens nouveau : ymaginer différents actes de la pensée Des mots voient leur sens se modifier par un ressourcement à leur origine latine comme louer qui perd son sens de conseiller ou errer qui retrouve le sens de errare (se tromper)
- 20. Le vocabulaire du moyen français s’enrichit par des procédés habituels de : Suffixation : crapaudaille ,pietaille , chevaucherie, deablerie . Préfixation : promener ,produire , superexellent , superabondance . Juxtaposition : saige femme .
- 21. Toutefois, le procédé d’enrichissement lexical de loin le plus utilisé demeure la création de néologismes par voie d’emprunt ou de calque du latin. Un grand nombre de verbe latin deviennent français par la substitution de la terminaison (-er) au latin (-are) qui en fait des verbes de premier groupe. Il y a aussi tous ces substantifs latins abstraits et savants qui sont francisés par la simple modification de leur terminaison:
- 22. Par exemple: les substantifs latins abstraits en (-as), (-atis) ou les noms d’agent en (-or) donnent respectivement en français des noms en (-é) ; ex: « absurdité » ou en (-eur); ex: «preteur» Quant aux mots latins formés de suffixe (-alis), ils trouvent leur place en français en prenant soit la forme (-al); ex: « legal», soit celle en (-el); ex: «rationnel »
- 23. Conclusion Le français s'est développé librement entre les IXe et XIVe siècles, mais le XVe siècle annonce déjà l'époque du «dirigisme linguistique», caractéristique du français qui va suivre . Les différentes transformations de la langue que nous venons de présenter enrichissent le français comme langue d’écriture et d’argumentation. Cette évolution avait considérablement éloigné le français de la fin du Moyen Age de l’ancien français.
- 24. Bibliographie CHAURAND, J.,(1999), Nouvelle de la langue française, éd. Du Seuil, Paris JONIN, P., (1972), Pages épiques du Moyen Age Français, Tome I, éd. SEDES, Paris Webographie
