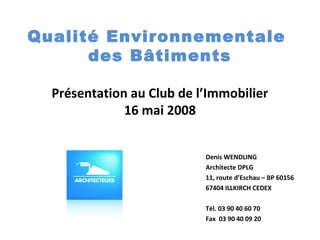
Qualité environnementale des bâtiments
- 1. Qualité Environnementale des Bâtiments Présentation au Club de l’Immobilier 16 mai 2008 Denis WENDLING Architecte DPLG 11, route d’Eschau – BP 60156 67404 ILLKIRCH CEDEX Tél. 03 90 40 60 70 Fax 03 90 40 09 20
- 2. Formation Q.E.B. PREALABLE Nous tenons à faire un retour en arrière sur notre formation Q.E.B. (Qualité environnementale des bâtiments) en essayant de faire simple sur certains acquis que nous avons eus en tant qu’architecte, afin de permettre la compréhension de la Q.E.B. à des Maires, Collectivités Locales ou intervenants divers dans l’acte de construire. Notre souci, à ce niveau, est de démystifier nos grandes connaissances (théoriques) pour prôner le retour au BSP (bon sens paysan), que nous avons malheureusement occulté, dans un souci de consommation effréné à partir des années 1960. Rappelons d’abord que la qualité environnementale des bâtiments est la ligne qui occupe l’acte de construire dans le vaste chantier du développement durable. Le terme H.Q.E. employé à tort par beaucoup d’intervenants n’est qu’un label au même titre que le label Minergie.
- 3. Définition du développement durable «C’est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Notre but est donc de prouver par des mots simples que la construction peut être intelligente (ou moins bête) en employant un certain nombre de concepts de base réfléchis et pesés.
- 4. ENJEUX Maîtriser notre consommation d’énergie est devenu aujourd’hui un enjeu économique et social de portée mondiale. L’impact des activités humaines sur les écosystèmes, la biodiversité et la santé est tel, que la notion d’éco-responsabilité se développe dans tous les secteurs d’activités aujourd’hui. Protéger notre planète est sur toutes les lèvres, du politique en discours de campagne, à l’habitant d’un petit logement qui s’interroge sur sa responsabilité face à notre planète. Nous devons tous nous engager en faveur d’une démarche écoresponsable, veillant ainsi à la qualité environnementale des bâtiments à construire.
- 5. QUELQUES CHIFFRES Les bâtiments utilisent plus de 40 % de l’énergie consommée. Une habitation bien isolée n’utilise que 27 % de l’énergie nécessaire pour chauffer une maison construite en 1974. Une bonne isolation de tous les bâtiments en Europe pourrait à elle seule générer une réduction de 400 millions de tonnes de CO2 qui permettrait de réaliser les objectifs du protocole de Kyoto et de combattre efficacement les changements climatiques. Construire et protéger notre environnement implique tous les maîtres d’ouvrage, les architectes, les maîtres d’œuvre, ainsi que tout citoyen dans ses actes de tous les jours.
- 6. Démarche H.Q.E. DEFINITION C’est le management de projets qui vise à construire ou réhabiliter une construction en maîtrisant les impacts sur l’environnement. Ce management implique : la maîtrise du déroulement des opérations en phase de conception, de construction, d’utilisation, d’adaptation et de démolition la qualité environnementale des bâtiments vise 14 objectifs appelés « cibles » regroupés en 2 domaines autour de 4 grands thèmes (familles), à savoir : Maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur Maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur l’éco construction l’éco gestion Création d’un environnement intérieur satisfaisant le confort la santé
- 7. MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Ces 4 familles regroupent un certain nombre de cibles, à savoir : L’Eco construction Cible 1 Cible 2 Cible 3 relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat choix intégrés de produits, systèmes et procédés de construction chantier à faible nuisance L’Eco gestion Cible 4 Cible 5 Cible 6 Cible 7 gestion de l’énergie gestion de l’eau gestion des déchets d’activités gestion de l’entretien et de la maintenance
- 8. MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Le confort Cible 8 Cible 9 Cible 10 Cible 11 confort hygrothermique confort acoustique confort visuel confort olfactif La santé Cible 12 conditions sanitaires des espaces Cible 13 qualité de l’air Cible 14 qualité de l’eau
- 9. Aussi, chaque question spécifique d’une opération ou système de management d’opérations (SMO) doit prendre en compte ces 14 cibles suivant 3 niveaux de performance : B (comme basse) P (comme performant) TP (comme très performant) Le maître d’ouvrage doit choisir parmi les 14 cibles, celles qui devront être au niveau P ou TP. Le SMO, qui s’apparente à une procédure, lui permet de hiérarchiser ces cibles et d’organiser la façon de les atteindre. Prenons un exemple pour un bâtiment tertiaire : pour reconnaître un bâtiment conforme à la démarche HQE, les 14 cibles devront avoir atteint des niveaux de performance suivants : 7 cibles au moins au niveau B 4 cibles au moins au niveau P 3 cibles au moins au niveau TP.
- 10. ANALYSE DES CIBLES Nous allons maintenant entrer au cœur du sujet, à savoir l’explication des cibles. Nous allons tenter, un fois de plus, de rester simple et de ne pas partir dans des batailles d’experts, afin de garantir la compréhension de tous. Usons de bon sens paysan !
- 11. CIBLE 1 Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat Rappelons que nous construisons un bâtiment pour des hommes et des femmes qui vont y habiter, y vivre, y travailler ou exercer une activité culturelle ou sportive. Construire un bâtiment est aussi un acte fort, compte-tenu qu’il ne s’agit pas d’un acte éphémère, puisque le bâtiment va durer et s’imposera durant toute sa vie aux visiteurs et à ses riverains. Dialogue avec le site Un bâtiment doit faire corps avec son site. La meilleure réponse, à l’achèvement de la construction, est de constater sa parfaite intégration et de pouvoir se dire qu’il est évident qu’il soit là, à cet endroit. Il a toujours été là ! Dialoguer avec le site, veut dire tenir compte du climat, des vues, des nuisances, des pollutions, des ressources locales ou du site, des eaux pluviales. Bien-sûr, la réponse ne sera pas uniquement à l’échelle de la parcelle du terrain, mais prendra en compte également l’environnement proche et immédiat. Prendre en compte les caractéristiques générales du site, veut déjà dire qu’à l’entrée du projet, on refuse l’immeuble produit et que chaque réponse de projet est unique.
- 12. Aménagement de la parcelle Un terrain est différent d’un autre, qu’il convient d’analyser en portant non seulement son intérêt sur la topographie, mais également sur la faune et la flore de ces lieux et des alentours du site. L’analyse portera sur différents points : accès à la parcelle et ses rapports avec son environnement immédiat organisation des voieries et cheminement sur la parcelle même (piétons, 2 roues, véhicules légers et autres) organisation des stationnements sur la parcelle organisation des espaces plantés aménagement des zones « espaces verts ». A ce stade, se posent déjà les questions fondamentales sur le projet, questions qui doivent être prises en compte dans le cadre du programme. Nous parlons, tout d’abord, d’organisation de la parcelle vis-à-vis de la ville. Situer son projet par rapport à son contexte immédiat et ses rapports avec lui.
- 13. CIBLE 2 Choix intégrés de produits, systèmes et procédés de construction Dès le début du projet, il faut tenir compte de la durabilité d’un bâtiment, de ses choix de procédés constructifs et des choix des matériaux employés. Adaptabilité et durée du bâtiment La première question à se poser lorsque l’on construit un bâtiment est sa durée de vie envisagée. L’autre question immédiate porte sur sa flexibilité dans le sens des dispositions prises pour reconfigurer le bâtiment en fonction de l’évolution des usages. Dans son évolutivité, ne pas figer le bâtiment et le faire évoluer avec les changements technologiques, Dans son extensibilité, en prévoyant de suite une possibilité d’extension, soit horizontale ou verticale, Dans sa convertibilité, pour changer complètement son usage, Dans la fin de vie du bâtiment, sa destruction doit être assurée à faible impact environnemental et en revalorisant les matériaux.
- 14. Choix des procédés de construction Intégration d’un projet, des impacts environnementaux et sanitaires et aux choix de construction. Mettre en avant des procédés de construction permettant, en cours de vie, une certaine flexibilité d’une part, et un tri facile en vue de la déconstruction, en fin de vie, d’autre part. Exemple : un bâtiment en structure béton est beaucoup plus lourd à travailler en changement de l’usage intérieur et en déconstruction qu’un bâtiment en structure bois. Choix des produits de construction Le choix des matériaux doit porter sur plusieurs éléments, à savoir : Limiter les consommations de produits non renouvelables Limiter les produits à lourde consommation énergétique (exemple : aluminium) Limiter la consommation d’eau, cette notion intervient sur l’eau et également l’énergie nécessaire à la fabrication d’un matériau. Cette énergie s’appelle l’énergie grise Limiter la production de déchets solides
- 15. CIBLE 3 Chantier à faible nuisance Cette cible porte sur cinq points, à savoir : 1 – Préparation technique du chantier 2 – Gestion différenciée des déchets de chantier 3 – Réduction des nuisances et des pollutions 4 – Maîtrise des ressources en eau et en énergie 5 – Déconstructions sélectives 1. Préparation technique du chantier Le but est de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion. Une bonne conception s’opère en amont sur la planche à dessin par un bon calpinage des matériaux, par un plan des réservations soigné, par des procédures limitant les accidents de chantier. La même conception sera qualitative dans la gestion des déchets de chantier et dans le mode de fonctionnalité, de stockage et de tri de l’évacuation des déchets. Réflexion : beaucoup trop de chantiers sont encore très mal gérés en tri de chantier comptetenu d’une part, de la non application des intervenants (ou de leur « menfoutisme ») et d’autre part, dans l’absence totale de gestion pour les petits chantiers.
- 16. 2. Gestion différenciée des déchets de chantier Encore une fois, la meilleure gestion est celle que nous n’avons pas à faire, soit limiter au maximum les déchets des chantiers. Trois types de déchets sont référencés : - les déchets inertes (DI : 65 % de la masse des déchets) - les déchets industries banals (DIB : 33 %) - les déchets industriels spéciaux (DIS : 2 %) Les déchets doivent être triés et ramenés sur des plates-formes de regroupement de tri. 3. Réduction des nuisances et des pollutions L’enjeu est de limiter les nuisances d’un chantier auprès des riverains, des ouvriers du chantier et de l’environnement. La responsabilité du maître d’ouvrage est engagée dans l’intérêt de générer un chantier qualifié de chantier « vert » qui oblige des accès à mettre en œuvre, le respect d’une charte « chantier vert » et le management des comportements sur le chantier.
- 17. 4. Maîtrise des ressources en eau et en énergie Il s’agit simplement de limiter la consommation d’eau et d’électricité sur le chantier. 5. Les déconstructions sélectives Il s’agit de la bonne gestion d’une démolition d’un bâtiment et de l’optimisation de la gestion des déchets.
- 18. CIBLE 4 Gestion de l’énergie C’est la cible la plus complète et la plus connue de l’ensemble des cibles. Tout d’abord, l’énergie non dépensée est celle que nous ne consommons pas et que nous ne payons pas. Aussi, il est impératif que les bâtiments à construire ne soient pas énergivores et soient intelligents par leurs qualités intrinsèques. L’objectif est de ne plus gaspiller les ressources épuisables en énergie fossiles (fioul, charbon) et les remplacer par des énergies durables en maîtrisant parfaitement les gaz à effet de serre. Les leviers sur lesquels nous avons moyen d’intervenir sont les postes suivants : Chauffage et climatisation Ventilation Eclairage Eau chaude sanitaire et autre usage
- 19. Isolation de l’enveloppe Un ingénieur thermicien suisse me disait encore il y a quelques semaines « agissez sur une bonne orientation, une bonne répartition des ouvertures, veillez à supprimer tous les ponts de froid en enveloppant correctement votre bâtiment qui doit être de forme simple et vous atteindrez facilement les normes prévues pour 2015 ou 2020 ». Oui, cela est possible aujourd’hui par des bâtiments différents de ceux que nous connaissons si nous faisons abstraction des pressions d’organismes ou de grandes entreprises, comme EDF, ISOVER ou d’autres. Une bonne isolation de l’enveloppe passe par plusieurs points. Pont thermique Les ponts thermiques ou appelés ponts de froid en Suisse, représentent 10 à 40 % des déperditions totales du bâtiment. Ces ponts thermiques sont liés à la conception même du bâtiment et plus leur part de déperdition augmente, plus l’isolation du bâtiment est performante.
- 20. Inertie thermique L’inertie thermique est la valeur qu’à un bâtiment de stocker ou de déstocker l’énergie comprise dans sa structure, c’est-à-dire dans sa masse. Elle définit la vitesse à laquelle le bâtiment se refroidit ou se réchauffe. Cette donnée est essentielle pour le confort d’été. Une inertie plutôt forte amortit les surchauffes diurnes et favorise l’étalement de la fraîcheur nocturne. Vitrages Outre leur fonction, la première étant l’éclairage, les vitrages ont la qualité de favoriser le soleil d’hiver, mais ont le défaut de favoriser les surchauffes en été. Nous savons mettre en place des vitrages peu émissifs, à double vitrage, voire à triple vitrages aujourd’hui.
- 21. Etanchéité de l’air Ce concept est nouveau, mais participe de manière importante à la performance énergétique globale du bâtiment. Cette étanchéité est déterminante dans les bâtiments à ossature bois, qui sont plus filtrants que les bâtiments en maçonnerie ou en béton. Isolation de l’enveloppe Suivant un concept purement français, l’isolation était placée à l’intérieur du logement. Cette disposition favorise les ponts thermiques. La lutte contre les ponts thermiques demande une isolation extérieure d’une épaisseur de 20 à 30 cm, en Suisse, qui permettra outre ses capacités à isoler le bâtiment, de lutter efficacement contre les ponts thermiques. Cette sur-isolation est valable pour les parois verticales du bâtiment, mais également pour sa toiture ou pour son contact avec le sol.
- 22. Solarisation du bâtiment Une règle de bons sens est de travailler les apports solaires gratuits pendant la saison de chauffe, permettant de la sorte une source importante d’économie d’énergie, qui n’est pas demandée. L’approche environnementale permet d’orienter notre réflexion sur l’orientation des bâtiments et de leurs vitrages et sur les espaces capteurs. Orientation des bâtiments et de leurs vitrages L’implantation des bâtiments participe à la maîtrise des dépenses énergétiques. L’orientation Sud doit être privilégiée pour les baies éclairantes et la façade Nord doit être fermée au maximum. L’espacement entre les bâtiments doit être étudié de manière attentive pour permettre la pénétration du soleil dans les logements lors de ces besoins cruciaux, à savoir l’hiver. Aussi, une distance minimum est calculée et doit être parfaitement intégrée sur les PLU des villes. La contrepartie de cette donnée, demande également que les façades les plus exposées au soleil direct, en période chaude, bénéficient de casquette et d’écrans végétaux à feuilles caduques, qui permettront d’effectuer un effet de masque sur ces façades exposées. Cette donnée oblige une attention particulière dès la conception du plan de masse de l’ensemble. Ces éléments, alliés à la conception, sont axés sur la non-utilisation d’une climatisation qui n’est qu’un dispositif technique, plaqué sur un bâtiment, pour palier à ses mauvaises performances énergétiques d’origine.
- 23. Espaces capteurs 1 – Serres et vérandas Les apports solaires passifs peuvent être amplifiés par la construction de vérandas, de serres accolées, constituant des espaces tampons dans l’architecte bioclimatique. Ces apports peuvent couvrir jusqu’à 20 % des besoins de chauffage. Ces espaces tampons peuvent également servir à préchauffer l’air neuf avant l’introduction dans la maison. 2 – Solarisation en tertiaire Dans ce type de bâtiment, il est préférable, compte-tenu de l’occupation, de récupérer les apports internes dans les espaces de circulation. 3 – Murs capteurs accumulateurs Des murs capteurs ou murs trombes peuvent accumuler le rayonnement solaire capté durant la journée et le restituer en partie la nuit.
- 24. Economies d’énergie L’énergie la plus économique est celle qui n’est pas consommée. Le choix du type de chauffage, qui n’est qu’une résultante de la qualité du bâtiment, est donc primordial. Il en est de même pour le rafraichissement du bâtiment (puits canadien). Energies renouvelables C’est le débat sur : - l’énergie solaire - l’énergie éolienne - l’énergie hydraulique - la cogénération, etc …..
- 25. CIBLE 5 Gestion de l’eau 5.1. Récupération des eaux de pluie Une fois de plus, et avec beaucoup de BSP, la bonne gestion de l’eau passe par celle que nous ne devons pas dépenser ou gaspiller. Aussi, une attention particulière doit être portée à plusieurs niveaux, à savoir : La réduction des fuites L’utilisation d’appareils performants L’utilisation d’eau gratuite à savoir la gestion des eaux pluviales Le prix de l’eau ne va cesser de croître dans les années à venir, et par voie de conséquence, il faut l’économiser. Il faut savoir que le prix de l’eau a déjà augmenté de près de 40 % en l’espace de 10 ans. Si toutes les dispositions sont prises pour éviter le gaspillage d’eau, pensons maintenant aux systèmes de récupération d’eaux de pluie.
- 26. La vérification de cet objectif passe d’une part, bien sûr, par les possibilités de captage de l’eau de pluie (surface de toiture) et d’autre part, de la pluviométrie de la zone dans laquelle nous nous situons. Le principe est de récupérer l’eau de pluie de la toiture, la diriger vers une cuve de récupération d’eau et utiliser cette eau pour diverses fonctions, à savoir : Arrosage Nettoyage des voitures Alimentation des chasses d’eau des WC Nettoyage du linge (cette utilisation est assez controversée) Aujourd’hui, des fabricants de cuves ont des procédés qui permettent une automatisation complète de la récupération d’eaux de pluie et la restitution dans ses divers objectifs.
- 27. 5.2. Gestion des eaux pluviales sur la parcelle L’objectif est de réduire les réseaux collectifs de récupération d’eaux de pluie, principalement par période d’orages. La gestion de ces eaux de pluie diminue également les risques d’inondation en limitant, cas par cas, les risques de pollution. Les principes pour gérer l’eau de pluie sur la parcelle sont les suivants : Toitures-terrasses Dans une toiture végétalisée, l’eau s’infiltre déjà dans l’épaisseur de terre de cette toiture et retarde par là-même son rejet dans le réseau collectif. Chaussées à structure « réservoir » L’eau de pluie est stockée dans le corps de la chaussée et est renvoyée vers le réseau collectif de manière calculée ou régulée.
- 28. Puits Des puits d’absorption sont aménagés pour infiltrer l’eau dans le sous-sol, soit vers la nappe phréatique, soit vers une zone infiltrante. Tranchées Des tranchées (ou fossés) peuvent être aménagées aux abords directs des bâtiments pour stocker temporairement l’eau, avant son infiltration naturelle dans le sol. Elles participent également à l’épanouissement des espaces verts ou plantations aux abords des bâtiments. Fossés ou marres Les fossés, nous ou marres fonctionnent sur le même principe que les tranchées. Cette disposition est appliquée sur les sols moins infiltrants ou dans les réseaux urbains.
- 29. CIBLE 6 Gestion des déchets d’activités La problématique aujourd’hui est de gérer au mieux nos déchets et de limiter les volumes à stocker en décharges autorisées. L’objectif est de générer moins de déchets et de mieux les valoriser par un tri sélectif. Plusieurs modes existent pour la valorisation de ces déchets
- 30. Valorisation organique Les déchets organiques et les déchets verts doivent être valorisés suivant une méthode de compostage ou de méthanisation. Le but est de réaliser, soit du compost, soit du biogaz. Valorisation matière Le tri sélectif peut permettre de recycler du papier plastique, métaux, verres. Il s’agit de réintroduire chez les fabricants des produits triés qui leur permettront d’obtenir une nouvelle matière première nécessaire à leur production. Valorisation énergétique Nous parlons à ce niveau, d’incinération de nos déchets pour produire de l’énergie. Cette valorisation d’énergie peut être reliée à un réseau de chauffage urbain. Pour conclure, ce tri sélectif passe bien sûr par une prise de conscience de tous les habitants, mais également par des dispositions de locaux qui doivent être suffisamment importants pour permettre le tri sélectif des déchets. La même question se pose bien évidemment pour les déchets de chantiers et les déchets générés par tous les bâtiments, soit tertiaires, soit publics.
- 31. CIBLE 7 Gestion de l’entretien et de la maintenance L’enjeu majeur quand on conçoit un bâtiment est de préserver le plus longtemps possible la destination pour lequel il a été construit. Il s’agit de prendre en compte l’investissement initial et le coût de maintenance obligatoire. Aussi le bons sens paysan nous dira qu’il ne faut pas construire des usines à gaz qui demandent un polytechnicien pour gérer le bâtiment. Le bâtiment doit répondre à plusieurs critères, à savoir : Durabilité Facilité d’entretien et de maintenance Qualité environnementale de l’entretien et de la maintenance Organisation de l’entretien et de la maintenance
- 32. CIBLE 8 Confort hygrothermique Le confort thermique exprime le bien être d’un individu par rapport à la chaleur et à l’hygrométrie. Cette cible se décompose en deux chapitres : Confort thermique d’hiver La sensation de confort thermique est liée aux individus. Confort ne rime pas simplement avec température, mais d’autres paramètres entrent en ligne de compte, à savoir : Température L’analyse de la température doit se faire sur trois axes différents : 1 – Température de l’air 2 – Température des surfaces des parois 3 – Température résultante, qui est la moyenne des deux premières.
- 33. Effets de parois chaudes et de parois froides Des parois froides de type marbre rayonneront le froid, alors que des parois chaudes de type bois permettront un abaissement de température intérieure. En Suède ou en Finlande, une température de confort est de l’ordre de 17 à 18°. Ecarts de température La diffusion de la température doit être uniforme et il faut bannir les zones froides et les zones chaudes. Vitesse de l’air La vitesse de l’air doit être limitée à 0,15 m/s en hiver. Hygrométrie de l’air Entre 30 et 70 % l’hygrométrie de l’air est neutre par rapport au confort thermique.
- 34. Confort thermique d’été Le confort d’été s’exprime en fonction de la chaleur, de la vitesse de l’air et de l’hygrométrie. L’enjeu est essentiel et principalement d’ordre énergétique. La solution résulte dans un niveau de confort compatible avec les conditions de travail ou de vie dans un bâtiment, tout en recherchant l’efficacité énergétique. Cela reviendrait à dire qu’il faut impérativement bannir la climatisation en réalisant un bâtiment autonome et bien conçu, suffisant à lui-même.
- 35. Définition des conditions de confort Avant la RT 2000, la réglementation parlait d’une température maximale de 27°, fenêtres fermées. Aujourd’hui, la réglementation définit pour le confort d’été, une température intérieure conventionnelle de référence à ne pas dépasser. Ce seuil de température n’est pas une donnée unique, puisqu’elle doit associer le type d’occupation des locaux et bien-sûr la nature de l’activité, la tenue vestimentaire et le taux d’humidité relatif qui ne doit pas être supérieur à 70 %. Une autre donnée du confort est le brassage de l’air. C’est le rôle de la ventilation ou des ventilateurs qui permettent un mouvement d’air.
- 36. Orientation et protection des vitrages Des vitrages exposés au Sud engendrent en été une surchauffe manifeste. Toute surface vitrée verticale orientée de Nord/NordOuest à Nord-Est, demande une protection solaire extérieure. La nature et l’inclinaison des lamelles seront judicieusement calculées suivant la latitude et la longitude du lieu. Je parlais bien de protection solaire extérieure puisque les stores intérieurs ne permettent pas de réduire les apports solaires d’été, qui ont déjà traversé le vitrage avant d’être arrêtés par la protection intérieure.
- 37. Apports internes et ventilation Encore une fois, usons de bon sens paysan (BSP) et affirmons qu’il ne faut pas, en période estivale, créer des surchauffes, et par conséquent, favoriser l’éclairage naturel et bannir l’utilisation de lampes à incandescences, etc. Le renouvellement d’air par la ventilation permettra d’éliminer les surchauffes et d’assurer un rafraichissement de nuit. Il est bon de rappeler à ce niveau, qu’en été, les fenêtres doivent être fermées toute la journée et ouvertes la nuit, pour permettre à l’air frais nocturne, de rafraichir le bâtiment.
- 38. Isolation de la toiture La toiture est un des éléments du bâtiment le plus exposé aux rayons du soleil par la nature de son matériau (généralement des tuiles) et par son inclinaison favorable. Il s’agit donc de travailler avec des matériaux performants, comme la fibre de bois, qui empêchera la chaleur sous les tuiles de passer au travers de l’isolant.
- 39. Inertie du bâtiment Comme nous l’exposions tout à l’heure, la ventilation sera favorisée la nuit lors de l’abaissement nocturne de la température. Les fenêtres vont être ouvertes et cet air rafraichi, doit pénétrer dans les matériaux de masse du bâtiment, qui restitueront cette fraîcheur 12 heures après leur accumulation, soit lorsque le soleil recommencera à briller. Là encore, la conjugaison de plusieurs procédés, comme le puits canadien permettra de rentrer naturellement de l’air frais dans le bâtiment, évitant de la sorte le recours à la climatisation.
- 40. CIBLE 9 Confort acoustique Une bonne qualité d’ambiance acoustique favorisera une qualité du travail et de bonne relation entre les usagers d’un bâtiment, l’inverse aura des effets négatifs, principalement sur la santé des occupants à travers la déprime et le stress. L’étude acoustique d’un bâtiment passe par plusieurs stades. Les dispositions architecturales générales Le plan masse doit être étudié pour lutter contre les nuisances extérieures immédiates, tels que aéroport, voie routière, usine, etc. L’étude première du plan masse doit prendre en compte ces données, en n’oubliant pas que certains facteurs peuvent être aggravants, comme les vents ou les réverbérations liées aux paysages environnants. L’architecte sera également attentif aux dispositions des locaux mitoyens, aux superpositions des locaux et aux dispositions intérieures des locaux.
- 41. Assurer une bonne isolation acoustique L’isolation acoustique d’un local se mesure en dB. La réponse d’isolation pour un bâtiment situé à côté d’un aéroport n’est bien sûr pas la même que celle d’un bâtiment situé en campagne. Tous les points singuliers, comme fenêtres, portes doivent être étudiés pour assurer une bonne isolation par rapport aux bruits extérieurs (entrée de bruit par les grilles d’entrées d’air, par système de ventilation). Assurer la correction acoustique des locaux Si une source de bruit n’est pas corrigible, parce qu’une route n’est pas déplaçable, par exemple, il faut agir sur la notion même du bruit. Ces investigations passent par une étude acoustique spécifique, qui déterminera le temps de réverbération d’une source de bruit, d’un niveau sonore, pour décroitre les 60 décibels. Cette correction se fera d’abord par une élimination massive des sources, mais également par une absorption massive par les parois horizontales et verticales, de manière à éviter la propagation du bruit.
- 42. CIBLE 10 Confort visuel La lumière est déterminante dans les bâtiments, soit par la lumière naturelle, soit par l’éclairage artificiel. Une bonne lumière ne fatiguera pas les yeux et permettra dans le tertiaire, une meilleure qualité du travail. Profiter de la lumière naturelle en bannissant les éblouissements Il faut disposer au mieux de la lumière naturelle du jour. C’est une donnée fondamentale de l’architecture. L’éclairage naturel agira autant sur un plan physiologique que psychologique. L’unité de mesure recueillie en la matière est le lux. Suivant la qualité des locaux, les taux d’éclairement varient de 200 à 800 lux. L’éblouissement doit être contrôlé pour éviter le soleil direct qui peut être une source d’inconfort.
- 43. Eclairage artificiel confortable Ces niveaux d’éclairement varient selon le type d’activité des locaux. Il faut assurer une bonne uniformité de l’éclairement, tout en évitant les éblouissements. Relations visuelles avec l’extérieur La position des bâtiments, les uns par rapport aux autres, sera déterminante dans la qualité de la relation visuelle. Ce point rejoint les préalables à ne pas occulter pour la qualité d’un plan masse. Nous rappelons que certains locaux doivent également bénéficier d’une certaine intimité.
- 44. CIBLE 11 Confort olfactif Il s’agit encore de bannir les sources de pollution provenant de l’extérieur ou de l’intérieur des bâtiments. Réduire les sources d’odeurs désagréables Le choix des produits de construction doit être judicieux afin que ces produits n’émettent pas d’odeurs désagréables. Il ne faut pas oublier, non plus, l’entretien du bâtiment, et bannir l’emploi de produits de nettoyage à odeur désagréable. Une attention particulière sera portée dans les entreprises pour stocker les déchets d’activités pouvant être source d’odeurs désagréables. Pour conclure, rappelons que certains polluants, comme la fumée de cigarettes ou le CO2, sont facilement maîtrisables en les interdisant simplement.
- 45. Limiter les sensations olfactives désagréables C’est le rôle de la ventilation des locaux en assurant un débit d’air suffisant pour un confort intérieur. L’air doit être renouvelé en permanence, tout en n’engendrant pas des courants d’air, avec des vitesses supérieures à 0,15 m/s. Nous rappelons également à ce niveau, l’intérêt du puits canadien, qui permet un réchauffement en hiver ou un rafraichissement en été de l’air neuf, au lieu des traditionnelles entrées d’air que nous connaissons aujourd’hui dans les châssis de fenêtres.
- 46. CIBLE 12 Qualité sanitaire des espaces Nous parlons aujourd’hui beaucoup de santé. Une attention particulière doit donc être portée sur l’environnement extérieur ou intérieur d’un bâtiment au regard de la santé. Même si un premier travail a déjà été fait sur les réglementations applicables à l’amiante et au plomb, un immense travail nous reste à faire sur les conséquences d’exposition à certains matériaux dans le bâtiment. Sans se lancer dans une psychose effrénée, il faut s’interroger sur le risque des matériaux par rapport à un fonctionnement normal du bâtiment, sur la nature du risque par rapport aux matériaux et sur son degré de gravité, et pour finir, sur les mesures à prendre dans la mise en œuvre du matériau.
- 47. Les choix des matériaux et des produits de construction Nous trouvons trois classes de matériaux : 1. Matériaux fibreux Nous n’allons pas refaire le procès de l’amiante. Nous pouvons cependant nous interroger sur les laines minérales et sur l’évolution de la réglementation à leur sujet. 2. Matériaux émettant des composés organiques volatiles et du formaldéhyde Les COV sont des substances chimiques qui se volatilisent aux températures d’ambiance habituelles. Nous trouvons ces COV dans les matériaux tels que les contreplaqués, agglomérés de bois, mousses et colles urée-formol, tapis et moquettes, sols plastiques et les solvants de peinture ou vernis. Leur réaction peut être simplement irritante, mais aussi cancérogène. Une analyse fine des fiches produit permettront une sélection judicieuse des composants à utiliser ou à bannir.
- 48. 3. Produits toxiques ou pathogènes Nous avons déjà évoqué le problème du plomb contenu dans les peintures, qui aujourd’hui est parfaitement interdit. Les bactéries ou légionelles prolifèrent dans les milieux humides et s’amplifient dans les installations de traitement d’air mal conçues et mal entretenues. Les produits de combustion (cheminée à foyer ouvert, poêle) peuvent être dangereux par monoxyde de carbone et responsables d’intoxications graves, voire mortelles. L’ozone O3 générée par les imprimantes ou les photocopieurs est à surveiller . Nous ne parlerons pas des dégagements de fumées accidentelles pouvant provenir, soit de feux sauvages ou d’incendies, qui peuvent générer d’importantes pollutions dans lesquelles il ne faut, bien sûr, pas rester exposé.
- 49. Nous ne ferons qu’évoquer des domaines également sensibles sur la santé dus à la radioactivité et aux ondes électromagnétiques. Il s’agit de prendre en compte des zones en France, dont les sous-sols sont fortement chargés de radon. Second point : les ondes électromagnétiques, générées soit par l’installation électrique elle-même, soit par une source aérienne, type ligne haute tension. Pour conclure, à ce jour, aucune étude ne permet d’établir avec certitude ou d’exclure les effets des champs électromagnétiques sur la santé.
- 50. CIBLE 13 Qualité sanitaire de l’air La qualité de l’air dépend de deux facteurs, c’est-à-dire la limitation des polluants à la source et la ventilation efficace des locaux.
- 51. Maîtriser les sources de pollution Nous l’avons déjà évoqué plus haut dans une démarche attentive de gestion des risques de pollution par des produits de construction riches en COV, en formaldéhyde ou en substances radioactives contenues dans les revêtements intérieurs, les isolants thermiques et acoustiques, les produits dérivés du bois, les colles, les solvants ou produits d’étanchéité. Il convient également de gérer les risques de pollution par des équipements sur les points suivants : Combustion : prescrire des générateurs à faible émission atmosphérique Installation d’équipements de contrôle des émissions polluantes. Système de ventilation et de climatisation Nous en avons déjà parlé, mais il convient de maîtriser les filtres à air, de travailler la qualité des humidificateurs d’air et de vérifier de manière périodique, les circuits de distribution d’air. Bien sûr, certaines activités dans certains locaux nécessiteront une attention plus poussée. Gérer les risques de pollution par les milieux environnants le bâtiment Nous avons parlé dans la cible 12 du radon, mais il faut également veiller à la qualité de l’air neuf introduite dans un bâtiment. Du BSP nous dirait qu’il ne faut pas mettre une bouche d’extraction d’air à côté d’une prise d’air neuf.
- 52. Limiter les effets des polluants d’air sur la santé Notre intervention, à ce titre, sera de deux ordres : Par une ventilation efficace Nous en avons déjà longuement parlé Par un traitement de l’air ambiant qui sera à étudier, cas par cas, selon la nature des activités des locaux.
- 53. CIBLE 14 Qualité sanitaire de l’eau La qualité de l’eau relève du confort et de la santé. Ces préoccupations sont à prendre en compte dès la conception, mais également durant la vie du bâtiment. Transport de l’eau Aujourd’hui, présentes que dans les anciens bâtiments, les canalisations en plomb sont bien sûr à remplacer, dès constatation de leur présence.
- 54. Légionellose Les légionelles sont des bactéries présentes dans l’eau et les milieux humides. Elles se développent par des températures comprises entre 25 et 50°. Il s’agit par conséquent, de porter une attention particulière aux milieux favorables, à la prolifération de ces bactéries et d’appréhender les moyens de prévention de leur développement. Contrôle d’accès au réseau de distribution collective d’eau Des analyses périodiques du contrôle de l’eau sont effectuées par les services publics. Il peut être intéressant, mais pas systématique, de préconiser des systèmes d’adoucissement ou de traitement de l’eau en fonction de la qualité de la fourniture d’eau.
