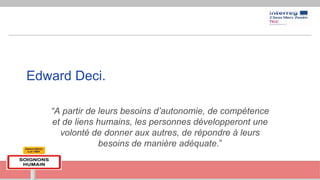
E_DECI.pptx
- 1. Edward Deci. “A partir de leurs besoins d’autonomie, de compétence et de liens humains, les personnes développeront une volonté de donner aux autres, de répondre à leurs besoins de manière adéquate.”
- 2. Deci étudie pendant 20 ans les facteurs de la motivation personnelle. Sa conclusion est : “La question n’est pas de savoir “comment des personnes pourraient motiver d’autres personnes?”. La question est : “Comment des personnes peuvent-elles créer les conditions pour que d’autres personnes trouvent en elles-mêmes leurs propres motivations personnelles?””. Il effectue pour cela des centaines d’expériences de sociologie appliquée, pour comparer les effets de différentes approches sur l’atteinte de résultats par des humains : pure autonomie, récompenses, punitions, menaces, pressions etc.
- 3. E.Deci définit la motivation intrinsèque comme le fait de choisir une activité pour ses bienfaits “propres”, qu’elle procure par elle-même. C’est le cas par exemple du comportement apprenant des jeunes enfants, ou le nôtre lorsque nous nous engageons dans des actions personnelles, simplement pour les sensations d’excitation, d’auto-réalisation et de satisfaction personnelle qu’elles nous procurent. Les expériences de E.Deci lui apprennent que la motivation intrinsèque est fortement diminuée en présence de toute sensation de contrôle extérieur : récompenses, punitions, délais, objectifs imposés, surveillances et évaluations extérieures. Il en conclut que notre sensation d’autonomie (ou sensation de liberté pour s’auto- gouverner) est un facteur déterminant du maintien de la motivation intrinsèque.
- 4. Avec l’autonomie, la sensation de sa propre compétence nourrit la motivation intrinsèque, ainsi que le besoin de liens humains E.Deci observe que la sensation d’être personnellement efficient/compétent/performant à une tâche constitue une satisfaction en soi. Elle peut être assez puissante pour alimenter toute une carrière professionnelle. Chez les enfants, on observe cette tendance à explorer, et expérimenter, cet appétit de nouveauté et de découverte, liés à ce besoin d’être compétent. Enfin, avec l’autonomie et la compétence, le besoin de liens humains de qualité est mis en lumière par les recherches de E.Deci comme troisième facteur : “soutenir l’autonomie signifie entrer en relation avec autrui comme un être humain, digne de soutien, plutôt que comme un objet qui serait à manipuler en vue de ma propre satisfaction. Cela signifie adopter sa perspective, et voir le monde de son point de vue à lui.”
- 5. Pour des activités complexes comme le soin par exemple, le type d’engagement humain qui permet de trouver les solutions optimales nécessite la motivation intrinsèque. Et celle-ci suppose des personnes ayant la compréhension de comment atteindre les objectifs souhaités, et se sachant compétents pour cela. La suite sera grandement facilitée si le contexte interpersonnel soutient l’autonomie des personnes. Grâce à ces ingrédients importants, les personnes seront rendues capables de fixer leurs propres buts, développer leurs propres normes, suivre eux-mêmes leurs progrès, et atteindre des buts qui ne bénéficieront pas qu’à eux-mêmes, mais aussi aux groupes et organisations auxquelles ils appartiennent ou avec lesquelles elles coopèrent.
- 6. E.Deci s’intéresse aussi au contexte du soin, en cherchant à comprendre comment aider les patients à mieux prendre soin de leur santé. Il observe que lorsque les personnes sont “contrôlées” (= moins autonomes), elles sont plus susceptibles d’adopter des comportements qui renforcent leurs pathologies. Il constate également que la propension des patients à être autonome/s’auto réguler, dépend directement de la manière dont les soignants entrent en relation avec eux. Quand les soignants comprennent l’importance des facteurs psychosociaux dans les comportements de santé, et de ce fait adoptent un mode de relation qui encourage l’autonomie, les patients ont effectivement plus de chances d’être plus autonomes dans leurs motivations, et de se comporter d’une manière plus adaptée à leur santé sur la longue durée.
- 7. E.Deci identifie six postures des soignants pour être “centré patient”, favoriser son autonomie et l’aider à prendre soin de sa santé 1. Considérer le point de vue la personne (=le patient), considérer la situation depuis sa perspective à lui 2. Offrir plusieurs choix, ouvrir plusieurs options 3. Fournir des informations utiles auxquelles la personne n’avait pas accès, qui pourront l’aider à gérer lui-même son affection 4. Expliquer le pourquoi des prescriptions, recommandations et conseils prodigués 5. Accuser réception, valider et accepter les ressentis de la personne 6. Réduire au minimum les mots et les attitudes contrôlantes
- 8. E.Deci étudie les mécanismes de “paiement à la performance.” Il les classe dans la catégorie “carottes et bâtons”, et rappelle qu’ils étaient à la base du “management scientifique” déployé par Taylor au siècle dernier : être payé pour chaque pièce produite… Le rationnel sous-jacent est “les gens veulent de l’argent. Structurons donc leur rémunération de manière à ce qu’ils fassent ce que nous voulons.” Ses recherches démontrent que ce type de schémas motivationnels détruisent la motivation intrinsèque et génèrent des effets de bords négatifs importants. Plus grave, ils détournent l’attention des acteurs du travail en lui-même, pour les focaliser sur les récompenses promises, résultant en des pratiques moins efficientes et moins créatives. Dans des environnements complexes et volatiles, où les acteurs doivent mobiliser de multiples compétences, et utiliser toutes leurs ressources de réflexion et d’engagement personnel (comme la santé), ce type de mécanismes sont inopérants et contre-productifs.
- 9. E.Deci. Bibliographie 1. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons. E.Deci & R.Flaste 1995