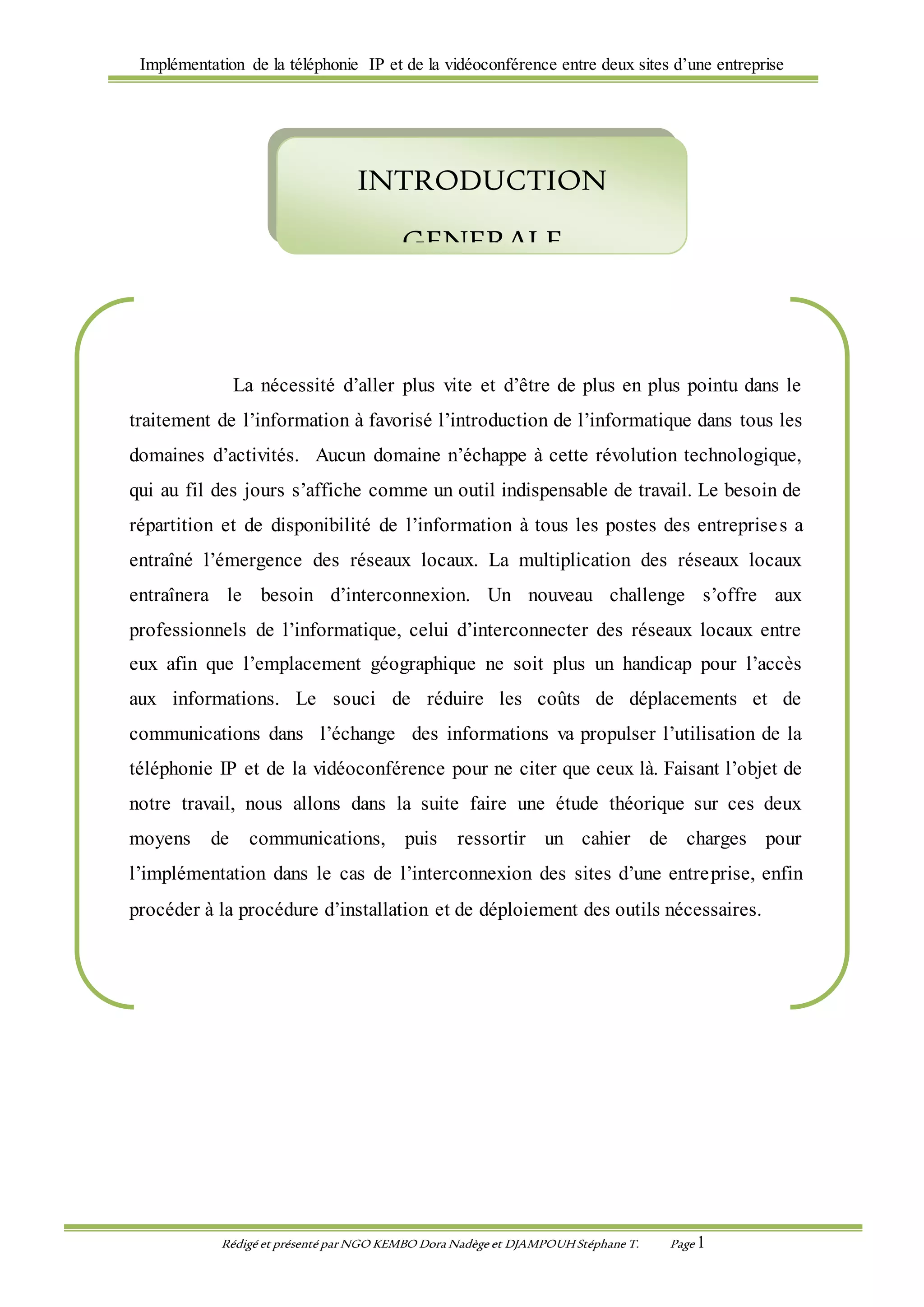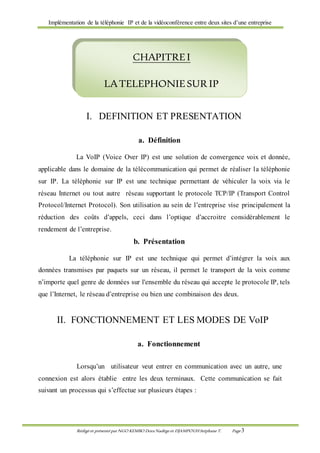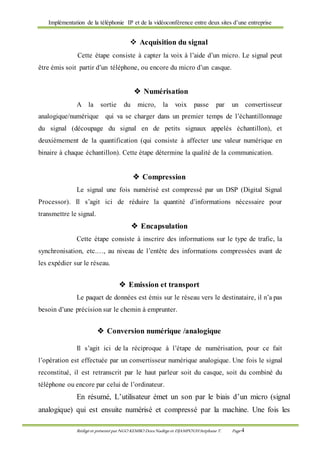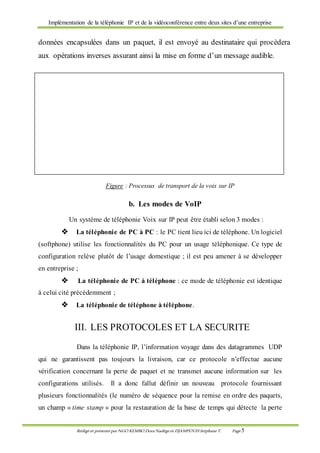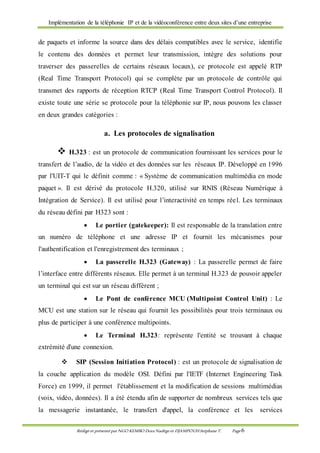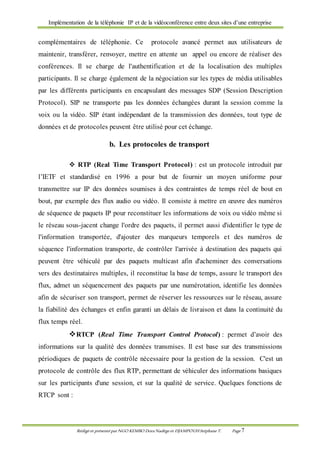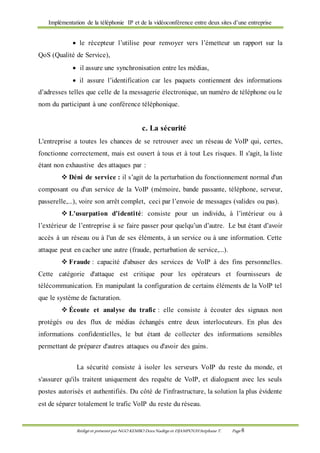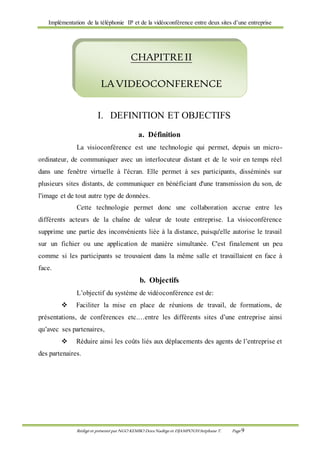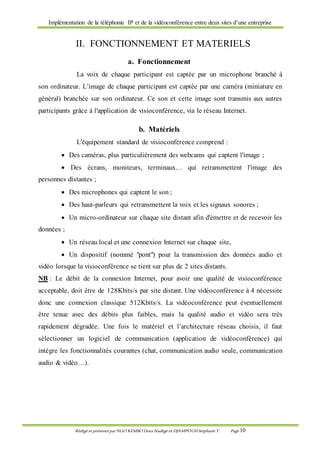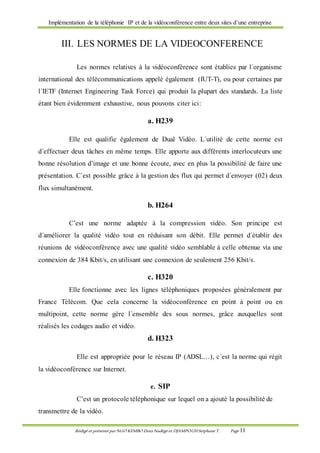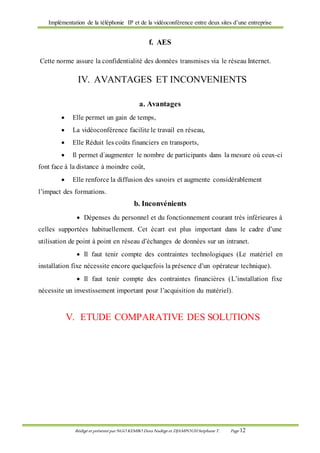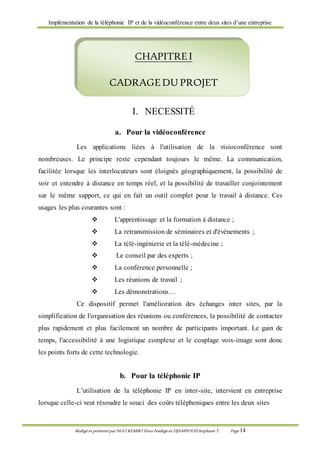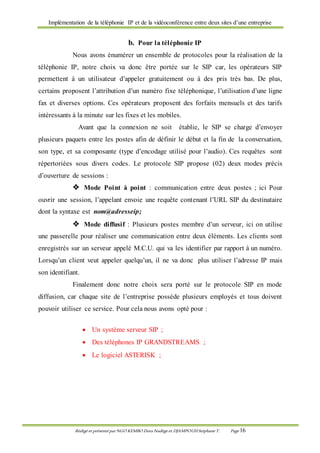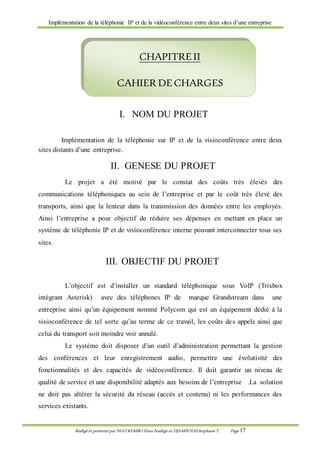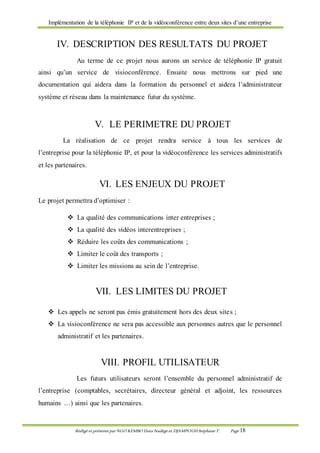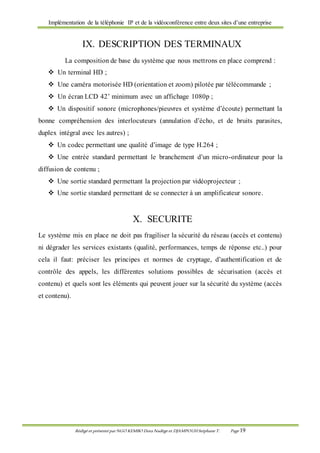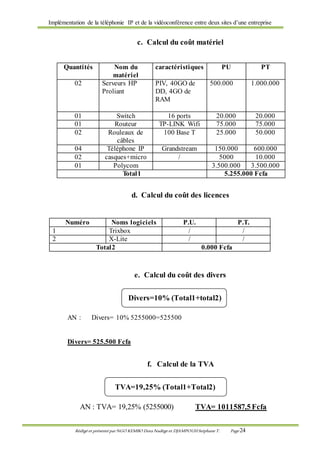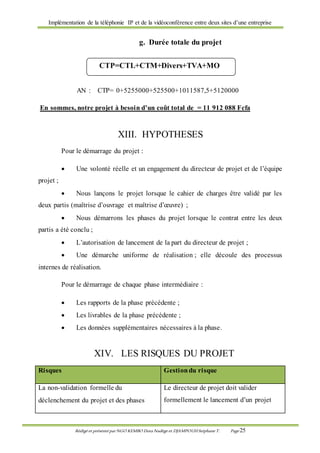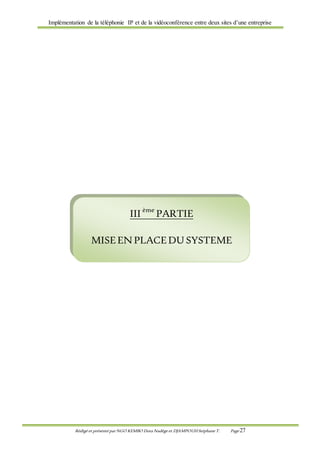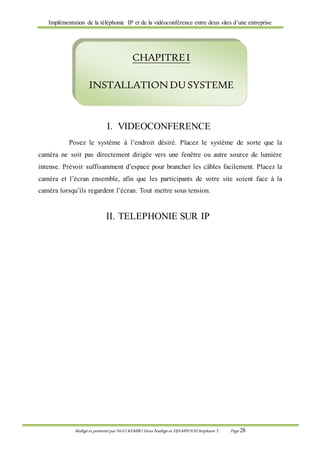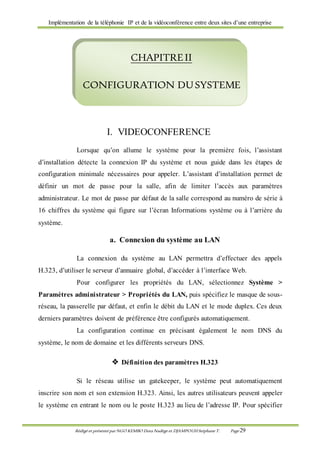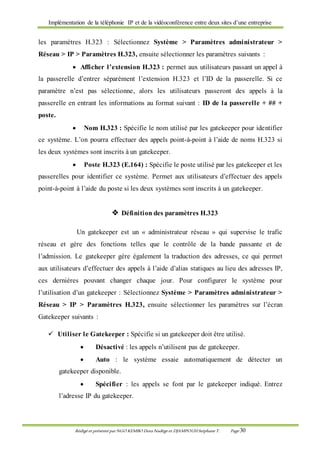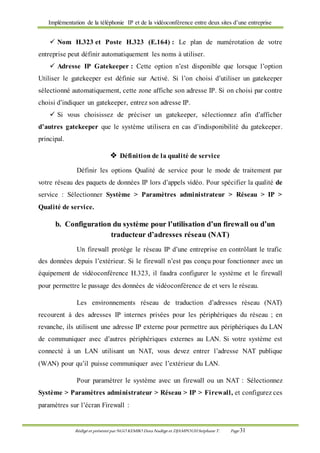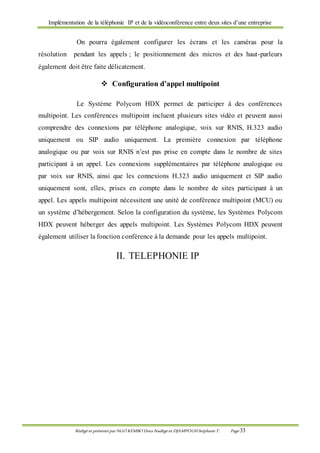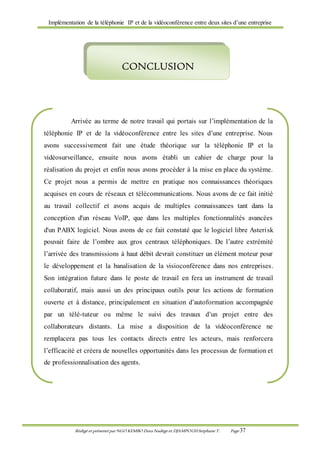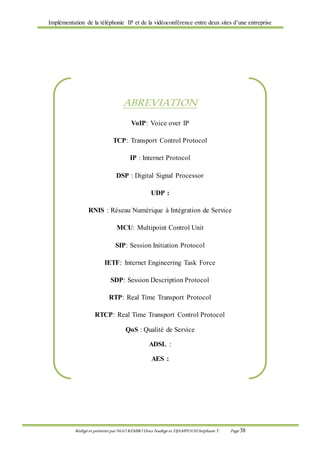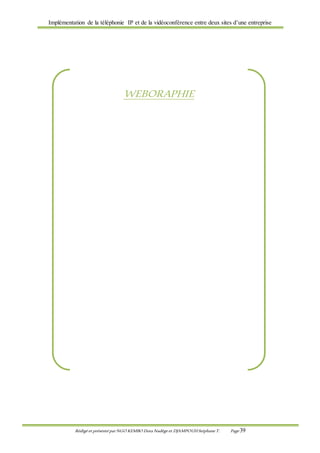Ce document présente l'implémentation de la téléphonie IP et de la vidéoconférence entre deux sites d'une entreprise, en mettant en lumière l'importance croissante de l'informatique pour le traitement de l'information et la communication. Il décrypte les mécanismes de fonctionnement de la téléphonie IP, sa structure, ses protocoles, ainsi que les enjeux de sécurité liés à son utilisation, tout en abordant les objectifs et le fonctionnement de la vidéoconférence. En somme, il traite des outils et des méthodes nécessaires pour améliorer les communications inter-sites tout en réduisant les coûts associés aux déplacements.