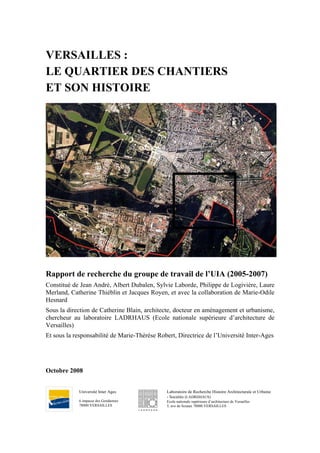
Uia rapport final_chantiers_2008
- 1. VERSAILLES : LE QUARTIER DES CHANTIERS ET SON HISTOIRE Rapport de recherche du groupe de travail de l’UIA (2005-2007) Constitué de Jean André, Albert Dubalen, Sylvie Laborde, Philippe de Logivière, Laure Merland, Catherine Thiéblin et Jacques Royen, et avec la collaboration de Marie-Odile Hesnard Sous la direction de Catherine Blain, architecte, docteur en aménagement et urbanisme, chercheur au laboratoire LADRHAUS (Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles) Et sous la responsabilité de Marie-Thérèse Robert, Directrice de l’Université Inter-Ages Octobre 2008 Université Inter Ages Laboratoire de Recherche Histoire Architecturale et Urbaine - Sociétés (LADRHHAUS) 6 impasse des Gendarmes Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles 78000 VERSAILLES 5, ave de Sceaux 78000 VERSAILLES
- 2. Note liminaire Lancé à l’automne en 2005, à l’initiative de Marie-Thérèse Robert (directrice de l’UIA), ce séminaire avait pour objectif de constituer un groupe de recherche d’étudiants s’interrogeant sur une question d’actualité : la transformation du quartier de la gare Versailles-Chantiers, avec la mise en œuvre de l’opération de la « ZAC des Chantiers » (Zone d’Aménagement Concerté, prise en compte dans le cadre du PLU- Plan Local d’Urbanisme). Avec ce projet, qui prévoit à la fois la transformation de la gare édifiée en 1932 par André Ventre en « pôle multimodal » et l’urbanisation des terrains limitrophes, Versailles, ville historique relativement figée autour de son Château, va redéfinir son image. L’enjeu du séminaire était, en prise avec l’actualité de ce projet, de conduire des travaux permettant d’enrichir le savoir sur ce terrain d’étude en approfondissant des questions telles que : les ambitions de ce projet de ZAC et ses modalités de mise en œuvre (programme, acteurs, projet architectural et urbain, processus de décision/ concertation, etc.) ; les réalités du terrain d’étude et ses enjeux patrimoniaux, envisagés dans leurs dimensions géographique, sociale et bâtie. Les travaux, développés sur une période de deux ans, ont permis d’expérimenter l’approche historienne, ayant comme source principale l’archive (ville de Versailles, Service des Archives et Direction de l’Aménagement de la Cité, service du cadastre, Archives départementales des Yvelines, etc.), dont les informations furent confrontés aux réalités du terrain et aux enquêtes auprès de différents interlocuteurs compétents. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la bonne conduite de ces recherches, et notamment : à la ville de Versailles, Messieurs Mezzadri (maire-adjoint), Larché (ingénieur), Le Grain (directeur général adjoint) et Morlon (service d’urbanisme) ; le personnel des Archives municipales, les directeurs du Centre 8 et du collège Raymond-Poincaré, Les Sœurs Augustines et Madame Boton (rue de Vergennes). CB, octobre 2008
- 3. Sommaire Avant-propos par Marie-Thérèse Robert ......................................................................................................................... 5 Introduction. Versailles, ville territoire, par Catherine Blain et Jean Castex......................................................................................................... 7 Chapitre 1. Le renouveau du quartier des Chantiers sous la responsabilité d’Albert Dubalen, Philippe de Logivière et Marie-Odile Hesnard ....................................... 13 1.1 Elaboration du projet, 1997-2002............................................................................................................14 1.2 Création de la ZAC des Chantiers, 2003-2004........................................................................................19 1.3 Approfondissements des études, 2005-2007 ...........................................................................................20 1.4 Un premier pas : le franchissement des étangs Gobert............................................................................25 Chapitre 2. La constitution d’un quartier sous la responsabilité de Jacques Royen .................................................................................................... 27 2.1 Aux portes de Versailles, Porchefontaine et Montreuil...........................................................................28 2.2 Règles et réalisations d’un nouveau quartier ...........................................................................................35 Chapitre 3. Une ville, trois gares sous la responsabilité de Philippe de Logivière et Albert Dubalen ................................................................... 43 3.1 Le train, une chance pour Versailles .......................................................................................................43 3.3 Une gare régionale : Versailles-Chantiers ...............................................................................................51 Chapitre 4. Trois sites remarquables jouxtant la gare des Chantiers sous la responsabilité de Jean André, Philippe de Logivière, Laure Merland et Jacques Royen .............................. 59 4.1 Les Réservoirs Gobert .............................................................................................................................59 4.2 Le domaine des Sœurs Augustines, une maison de retraite.....................................................................63 4.3 Le domaine des Diaconesses de Reuilly, un centre de vie et de soins.....................................................67 Chapitre 5. Les bombardements de la seconde guerre et la reconstruction sous la responsabilité de Jacques Royen .............................................................................................. 81 5.1 Pluie de bombes sur le quartier................................................................................................................82 5.2 Repérage des immeubles totalement ou partiellement détruits................................................................84 5.3 La reconstruction en France et à Versailles.............................................................................................88 5.4 Le nouveau visage de Versailles Chantiers .............................................................................................94 Chapitre 6. Des logements et des équipements sous la responsabilité de Sylvie Laborde et Catherine Thiéblin ...................................................................... 97 6.1 Des philanthropes à l’Office public d’Habitation à Bon Marché ............................................................97 6.2 Hector Caignart de Mailly, architecte de son époque............................................................................103 6.3 Deux ensembles d’habitations à bon marché (1928-1932)....................................................................104 6.4 L’école primaire de jeunes filles (1934)................................................................................................113 Chapitre 7. Les sites et rues remarquables du quartier sous la responsabilité Jacques Royen ..................................................................................................... 121 7.1 Grandes propriétés et hôtels particuliers ...............................................................................................121 7.2 Casernes et édifices publics...................................................................................................................132 7.3 Eglises ...................................................................................................................................................143 7.4 Etablissements particuliers ....................................................................................................................146 7.5 Sites urbains ..........................................................................................................................................150 7.6 Avenues, places, impasses et rues .........................................................................................................153 Epilogue. Un histoire en devenir, ou l’esprit d’un lieu sous la responsabilité de Jacques Royen .................................................................................................. 157 Glossaire ...................................................................................................................................... 161 Bibliographie et sources ............................................................................................................. 162 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 3
- 4. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, juin 2008 — p. 4
- 5. Avant-propos Avant-propos Marie-Thérèse Robert, directrice de l’UIA L’Université inter-âges de Versailles a accueilli en 1993 les VIIe Assises nationales de l’Union française des universités tous âges dont le sujet était « Les apports de l’histoire des provinces et des régions à l’histoire nationale ». Un travail scientifique a été conduit au cours de ces journées d’étude dont le but était de mieux connaître notre patrimoine historique. L’histoire, la mémoire, la transmission des savoirs sont des préoccupations constantes des universités tous âges. Ainsi en 2006 lors des XIII° Assises nationales à Amiens tous les travaux présentés avaient pour thème « Mémoire-Tradition(s)- Patrimoine » C’est dans ce registre que s’inscrit ce travail de recherche, engagé en 2005. Comment comprendre un quartier ? Le quartier des Chantiers de Versailles n’ayant jamais été l’objet de publications ou de travaux de recherche, c’est donc un travail inédit qu’ont réalisé les étudiants de l’Université inter-âges sous la direction scientifique de Catherine Blain, architecte et chercheur en histoire de la ville et de l’architecture. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont participé à ce travail. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 5
- 6. A gauche : Croissance de Versailles en 1685, 1746, 1810, 1907, d’après la Chalcographie, le plan de l’Abbé de la Grive, la carte des Chasses et le plan de Bieuville [extrait de: J. Castex et ali, Versailles, lecture d’une ville, Paris, Ed. du Moniteur, 1979, p. 20] A droite, en haut : Versailles, plan de 1813 dit « cadastre Napoléonien », échelle 1:10000 [Archives départementales des Yvelines, cote 3P 2/302/01, section T ] A droite, en bas : Versailles, plan de 1975, échelle 1:5000, avec en encadré le secteur d’étude (quartier des Chantiers) Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 6
- 7. Introduction. Versailles, ville territoire Introduction. Versailles, ville territoire Jean Castex et Catherine Blain L'histoire du quartier des Chantiers se comprend au regard de celle de la Ville Nouvelle de Versailles, élaborée dès 1660 dans le cadre d’un projet idéal comportant le château et son parc. Edifiée en marge de ces fastueux travaux, la ville en tant que telle met plus de trois siècles à advenir. Elle est aujourd’hui constituée de différents quartiers dont le temps, plus que le projet idéal, s’est chargé de préciser les formes urbaines et éléments constituants. Le quartier des Chantiers, comme les autres quartiers, témoigne de cette longue durée du développement, qui confère rapidement à cette ville la dimension d’une ville- territoire. Au tournant des années 2000, ce quartier est concerné par un ambitieux projet de renouvellement urbain qui, prévoyant un complet remodelage des abords de la gare des Chantiers, repose différemment cette question de l’inscription territoriale de Versailles. Car, avec ce projet, qui prévoit à la fois la transformation de la gare édifiée en 1932 par André Ventre en « pôle multimodal » et l’urbanisation des terrains limitrophes en lien avec l’avenue de Sceaux, Versailles, ville historique relativement figée autour de son château, va radicalement transformer sa réalité urbaine. En jetant un coup de projecteur sans précédent sur ce quartier plutôt excentré de la ville, souvent méconnu et curieusement mal aimé, ce projet incite à retracer les fils de son histoire particulière. C’est la mission que s’est donnée la présente étude. S’interrogeant d’abord sur les ambitions de ce projet et ses modalités de mise en œuvre (chapitre 1), celle-ci apporte de nombreux éclairages sur l’histoire de ce quartier, en faisant finement le point sur sa genèse, des origines au 20e siècle (chapitre 2), sur l’histoire de la gare des Chantiers, envisagée à la lumière de l’avènement des chemins de fer à Versailles (chapitre 3), sur l’histoire de trois grandes emprises urbaines jouxtant cette gare, les Réservoirs Gobert, les domaines des Sœurs Augustines et des Diaconesses (chapitre 4), sur l’incidence des bombardements de la seconde guerre sur le quartier et ses modalités de reconstruction (chapitre 5), sur la question des logements et des équipements, en partant d’une interrogation sur le lycée Raymond Poincaré conçu dans les années 30 par Caignart de Mailly (chapitre 6) et, enfin, en proposant un repérage des sites et rues remarquables du quartier (chapitre 7). Les habitants de Versailles, les responsables municipaux, les amoureux de cette ville et de son château aussi bien que les visiteurs néophytes trouveront dans ces pages une matière d’une grande richesse, fruit de deux ans de travail assidu en archives. Grâce à cette recherche, un large pan de l’histoire du quartier est dévoilé. Pour introduire sa lecture, il est utile de revenir sur la grande histoire de Versailles, de sa fondation au 20e siècle, ayant modelé le paysage urbain que l’on se propose aujourd’hui de redéfinir. Un projet de ville idéale Dès le départ, le projet de Versailles est des plus ambitieux. C’est le lieu de la géométrie pratique, basée sur le quadrillage des allées ou leur éclatement en étoiles, et sur le tracé de plans simples sur lesquels s'exerce la compréhension du territoire. Son périmètre, décrété en 1660, couvre plus de 10 kilomètres sur l’axe est-ouest, de Vélizy à Villepreux et 5 entre le plateau de Satory au midi et la forêt de Marly au nord. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 7
- 8. Introduction. Versailles, ville territoire La Ville Nouvelle est structurée par une patte d'oie de trois avenues : au centre, l'avenue de Paris (2437 m de long par 93,60 m de large), et de part et d’autre l'avenue de Saint- Cloud (1025 m par 78 m) et l'avenue de Sceaux (753 m par 70 m). Par les allées d'arbres qui les bordent, flanquées elles-mêmes de contre-allées, ces avenues diversifient les usages : carrosses, chevaux, transport de marchandises, promenade. Indifférentes au relief que continuent de suivre les contre-allées pour la desserte des maisons, les voies suivent le profil rectiligne basé sur les critères cartésiens de l'étendue, sachant surplomber le sol ou être établies en tranchée. Ce projet d’urbanisation fait appel à des techniques d'ingénieurs agronomes et de forestiers, mais aussi, en parallèle, à celles du « remuement des terres » développées par l'art militaire. L'ingénieur du sol, l'hydraulicien savent niveler les collines, faire transporter la terre et le sable, drainer des marécages et creuser des lacs. Le paysage de Versailles en est bouleversé : des hauteurs sont écrêtées (butte de Montbauron en 1685), les irrégularités nivelées (place d’Armes), les pentes adoucies (avenue de Sceaux), pendant que le château s’étend au prix d’énormes travaux de terrassement. Les règles de fabrication urbaine sont par ailleurs édictées dans La logique de Port- Royal, d'Antoine Arnauld et Pierre Nicole (1663), qui organise le passage du simple, le pavillon aristocratique, au composé, les pavillons jointifs formant l’alignement. Un grand module, correspondant à celui des bosquets du jardin, mesure 110 toises (114,3 m), et admet une division de 50 pieds (soit 16,20 m), s'applique à chaque type de bâtiment, ou à deux maisons d'artisans. Le grand module associe dans une même unité les rues, les places, le bâti, les cours et les jardins. Une fois ces voies tracées et cette grammaire urbaine édictée et dotée de dimensions, le plan de la ville s'adapte au territoire et à l'énoncé simple des règles. Versailles dissocie notamment ses quartiers selon le rang des habitants, passant d'une ville noble en périphérie, offerte à la vue du roi, à une ville bourgeoise en arrière, et à la composition plus compliquée de la ville artisanale et commerçante, sur le côté le plus éloigné au château. Une ville territoire Mais malgré ces règles, la distance s'accroît entre le projet de la Ville Nouvelle et son exécution. L’ordre du projet primitif cède notamment devant la virulence des pratiques concrètes des habitants, enrayant le système de répartition sociale. En outre, des constructions adventices surgissent de partout, dénaturant les figures imposées par l'ordre monumental. À la cité-jardin aérée succède donc le tissu ordinaire d’une ville où la rareté des terrains induit d’ailleurs la recherche d’une plus grande densité de constructions. Il faut alors gérer leur mise en œuvre, ce à quoi s'emploie le règlement dit de Robert de Cotte dont la première rédaction connue date de janvier 1715. Les transformations initiées à la fin du 18e siècle vont manifester non pas la fin du plan idéal, classique, mais son accomplissement dans le concept novateur d'une ville- territoire. Un premier plan d'aménagement du territoire, en 1768, propose trois tracés directs de Paris à Versailles. L'Abbé Terray, directeur général des Bâtiments du roi pour une année (juillet 1773 à juillet 1774) fait pour sa part compléter le plan des avenues de Versailles, en ouvrant les boulevards de la Reine (1773-1778), du Roi, Saint-Antoine. Le 29 juin 1786, son successeur, le comte d'Angiviller, propose un plan d'extension et d'embellissement avant la lettre, créant un boulevard ceinturant la ville et repoussant les octrois — qui incorporent à Versailles le Grand et le Petit Montreuil à compter du 1er janvier 1787. Ces trois plans, dont seul le second a été suivi d'effet, poursuivent le même but. Ils tissent le réseau d'allées et d'avenues commencé par Le Nôtre, dans un but très clair de baser la prospérité économique sur la facilité du transport. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 8
- 9. Introduction. Versailles, ville territoire Reconnaissant la valeur de Versailles comme place économique, leur ambition est de la relier commodément à la capitale, et de renforcer sa fonction de plaque tournante. Mais plus encore, ils reconnaissent à Versailles un caractère multiple, comprenant le château et les édifices gouvernementaux, deux villes complémentaires (Notre-Dame et Saint- Louis), une banlieue où la résidence se dissocie du travail (quartier des Prés), des villages (Montreuil), des jardins, des forêts et des zones agricoles. Habiter Versailles Avec la croissance du 18e siècle, Versailles, comme tout autre ville, se pare d’immeubles chics mais se voit également débordée par le développement incertain de faubourgs qui échappent à l’octroi jusqu’en 1787. Après une période de relative anarchie, l’administration de Louis XVI s’attache donc à remettre de l’ordre dans l’urbanisme versaillais. La déclaration du 12 juillet 1779 consacre le permis de construire comme outil de contrôle. Rompant avec les critères architecturaux qui gouvernaient la ville de Louis XIV, Angiviller s’attache au bien construire d’une ville haute de trois étages, avec une corniche réglée à 8 toises (16 m) et une forme de toiture à la française, en pente de 30 %, réservant les mansardes aux petits bâtiments pour augmenter leur ampleur. L’amélioration du Versailles de Louis XVI repose sur ce contrôle des Bâtiments. Le nombre des permis de construire déposés de 1779 à 1789 prouve l’ampleur du décollage urbain. La provenance des matériaux, dans une ville qui ne disposait que de sable, explique à la fois les choix : meulière extraite des plateaux environnants, zinc importé d’Angleterre et arrivant par bateaux, pierre hissée depuis la Seine provenant des carrières de l’Oise, bois devenu rare, plâtre parisien pour les revêtements. La différenciation sociale fait apparaître, plus tôt sans doute qu’à Paris, un type nouveau d’habitation : l’immeuble par appartements (appelé autrefois maison à loyer), qui s’impose rapidement et donne aux nouveaux quartiers des pratiques novatrices. Leur architecture, peu bavarde, d’aspect néo-classique, procure une grande tenue. Les ressources financières des propriétaires justifient l’accroissement de la taille des parcelles : les façades de la rue des Réservoirs comptent de cinq à six et même neuf travées de fenêtres ; celles de l’Avenue de Saint-Cloud montent souvent à onze et même vingt et une baies, à charge pour les architectes de créer des avant et des arrière-corps qui animent la façade. Avec la croissance démographique du 19e et début 20e siècle, Versailles se refait une jeunesse, gagnant alors ses limites au pied des bois au nord et à l'est. Des quartiers de villas et des ‘villages’, de vastes propriétés et des terrains horticoles se prêtent à un processus de remplissage pour abriter des ensembles de logements. L'homogénéité du tissu de Versailles, le lien traditionnel des habitations aux voies publiques, font place à un changement d'échelle de la forme qui dissocie des blocs d'habitation ou de longues barres des rues ou avenues. A ce développement résidentiel répond la construction d’édifices publics, dont un chef-lieu de département doit également se doter. Tribunal, marché, abattoirs, prison, temple protestant, préfecture, écoles, mairie, tout doit être créé. A travers plusieurs bâtiments remarquables, qui figurent en bonne place dans l'histoire de l'architecture, Versailles prend parti pour la modernité. Penser la ville Ce rapide rappel de l’histoire urbaine de Versailles montre combien le caractère multiple est une donnée intrinsèque de cette ville – le projet idéal d’une cité-jardin aérée et rigoureusement ordonnancée ayant été rapidement contredit par des pratiques constructives, elles-mêmes en constante évolution. N’en déplaise aux tenants de Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 9
- 10. Introduction. Versailles, ville territoire représentations simples, la ville de Versailles n’est donc pas une entité homogène mais, comme d’autres villes, un patchwork de formes différentes élaborées dans le temps. Tout semble donc porter à croire que c’est en tenant compte de cette réalité urbaine qu’il faut l’apprécier et réfléchir à son avenir. En n’oubliant pas, par ailleurs, que la véritable force de cette ville relève de cette ambition, énoncée dès le 18e siècle, d’être une plaque tournante dans le territoire. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 10
- 11. Le secteur d’étude : plan détaillé En haut : Détail du plan de cadastre actuel révélant, en poché, le tissu urbain existant (C. Blain 2005) En bas : Détail du plan précédent, centré sur le secteur d’étude avec, en surimposition, le plan des étangs Gobert (1813) [extrait du plan conservé aux Archives départementales des Yvelines, cote 3P 2/302/21, section S] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 11
- 12. Le secteur de la gare des chantiers : repérage des éléments significatifs du patrimoine architectural, urbain et paysager. Clichés C. Blain, octobre 2005 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 12
- 13. Chapitre 1. Les Chantiers à l’étude Chapitre 1. Les chantiers à l’étude (Responsables : Philippe de Logivière, Albert Dubalen et Marie-Odile Hesnard) Aujourd’hui, la gare des Chantiers est un véritable nœud ferroviaire, le plus important en dehors de Paris. S’y croisent en effet chaque jour plus de 50 000 voyageurs, et l’on en attend entre 75 et 80 000 en 2015. Par ailleurs, sur plus de 800 trains qui y circulent chaque jour, 80% concernent le réseau Ile-de-France et TER, 10% les réseaux Grandes Lignes, et 10% le fret. Depuis cette gare, on peut en effet atteindre celles de Paris- Montparnasse (desserte de la France de l’ouest et du sud par les TGV), Paris-Invalides (et au-delà, par la ligne C du RER), la Défense, Massy (par la suite la tangentielle Nord- Sud qui reliera Cergy à Massy et ultérieurement Evry et Melun-Sénart, permettra le contournement de Paris), Rouen et Lyon (et au-delà par le TGV). Conçues en 1932 par l’architecte André Ventre, les installations actuelles de cette gare ne sont pas adaptées à un tel trafic, avec ses flux croisés d’entrées et sorties sans cesse croissants. Conscients de ces problèmes, la SNCF et le Réseau Ferré de France (RFF), mettent à l’étude, dès 1994, un projet de réaménagement de la gare et de ses abords ; celui-ci prévoit à la fois l’agrandissement la gare (par le biais d’un nouveau bâtiment voyageurs), la restructuration de ses quais et de leur desserte (par de nouveaux ascenseurs et escaliers mécaniques) et le remaniement de ses abords (afin de faciliter les liaisons avec les réseaux piétonniers et routiers : voitures, autobus) (1). A Versailles, ce projet de réaménagement a rapidement suscité une réflexion plus élargie, portant sur le réaménagement urbain de l’ensemble du site de la gare, comportant une ancienne gare de marchandises, d’une superficie de 3,2 hectares, désaffectée depuis un certain temps et que le RFF serait prêt à céder. Pour la ville de Versailles, cette friche industrielle est une ressource foncière estimable. Car il est utile de rappeler que le terrain y est plutôt rare : le territoire communal, d’une superficie globale de 2618 hectares, ne relève qu’au tiers de la gestion de la ville (978 hectares) puisque 1640 hectares sont la propriété d’autres institutions (Domaine national du Château: 830 hectares; Ministère de la défense : 460 hectares; Office National des Forêts: 350 hectares; SNCF; INRA). Ainsi, la mise à disposition de ce vaste terrain offre à la ville l’opportunité de repenser ce lieu dans sa globalité, pour y créer un nouveau centre de quartier. En raison de ce contexte spécifique, le projet de restructuration de la gare des Chantiers est rapidement envisagé dans le cadre d’un vaste projet urbain qui, « important à la fois pour le quartier, pour la ville, et les communes avoisinantes » (2), ambitionne de « réinventer la ville » (3). Ce projet — le plus important à Versailles depuis la fin du 18e siècle — est une occasion unique de désenclaver le quartier et, dans un même temps, de doter la ville d’équipements et de constructions publics et privés dont elle a besoin (et particulièrement dans le secteur des Chantiers). C’est, en revanche, une opération complexe puisqu’il associe deux programmes différents, à la fois à l’échelle de Versailles, de la Commune et de la Région : d’une part, la création d’un important pôle multimodal (la gare) et, d’autre part, un projet d’urbanisation nouvelle (ses abords). D’où la difficulté de concevoir et monter les opérations, liée notamment au nombre 1 Dossier de création de la ZAC 2003, page 2; Versailles Magazine, oct. 2007, p. 16-17. 2 Entretien avec Monsieur LARCHE, chargé de la coordination du projet auprès de la Mairie, 2005. 3 Versailles Magazine, Ville de Versailles, décembre 2006; octobre 2007; janvier 2008. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 13
- 14. Chapitre 1. Les Chantiers à l’étude d’acteurs en présence, au nombre de schémas et de plans départementaux, régionaux, nationaux et de règlements à respecter et, aussi, aux modalités de mise en œuvre. Différentes étapes ont marqué l’évolution de ce projet depuis 1994. Nous en rappelons ci-après les événements marquants. 1.1 Elaboration du projet (1997-2002) En 1997, au projet de la gare, étendue et modernisée, est associée l’idée d’un « pôle d’échanges » entre les divers moyens de transports et une zone de développement économique. Le projet comporte ainsi deux volets distincts : 1e Volet gare. L’amélioration de l’accès aux quais est prévue grâce à un pont galerie jeté au-dessus des voies ainsi qu’un deuxième pont, plus à l’ouest, réservé aux correspondances, et relié à la gare par une « galerie confortable et attractive ». Un nouveau poste d’aiguillage, très moderne est également prévu. 2e Volet économique. Afin de valoriser les terrains de l’ancienne gare des marchandises désaffectée, une convention VILLE-RFF-SNCF est signée, prévoyant un cahier des charges des réalisations à entreprendre. Dès 1998, une réflexion globale est engagée par la ville de Versailles, le RFF et la SNCF afin de préciser les conditions de faisabilité de la rénovation de la gare et de la création du « pôle d’échanges multimodal ». Un plan d’aménagement global du site, sous forme d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté), est également mis à l’étude. Suite à l’entrée en vigueur de la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable (juin 1999), et prévoyant celle de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain, décembre 2000) et la nécessité d’élaborer un nouveau Plan de Développement Urbain (PDU), une concertation préalable sur l’aménagement du site est engagée. A ce stade, le projet met en avant deux objectifs : 1. adapter la gare au volume et à la nature du trafic et l’ouvrir du côté de la rue de la Porte de Buc ; 2. créer, sur les terrains de l’ancienne gare de marchandises (dont le RFF est prêt à se départir), une nouvelle gare routière et un nouveau parc de stationnement et, surtout, une opération d’urbanisation qui, confiée à un aménageur choisi par la ville, constitue un « nouveau quartier », en relation avec l’éventuelle urbanisation du plateau de Satory (« nouvelle frontière» à l’ouest de Versailles »). La mise en œuvre du projet est envisagée dans le cadre d’un montage financier associant la ville, la SNCF, la Région, le Département et l’Etat. Inscrit au Contrat Plan Etat-Région 2000-2006, son coût estimé est de 76,22 millions d’euros dont 46 millions d’euros pour le projet de la gare et ses abords. Elle devrait par ailleurs bénéficier de financements complémentaires, accordés au titre de la procédure du Plan de placements urbains (3,05 millions d’euros) et apportés, en outre, par la SNCF, RFF, le STIF (Syndicat des Transports d'Ile-de-France), la Région, la Ville et les promoteurs immobiliers. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 14
- 15. Spécificités du foncier à Versailles [Dossier de création de la ZAc des Chantiers] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 15
- 16. Les différents quartiers de Versailles et la législation [dossier de création de la ZAc des chantiers] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 16
- 17. La ZAC des Chantiers: périmètre et hauteur des constructions [dossier de création de la ZAC des chantiers] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 17
- 18. La ZAC des Chantiers: périmètre et réglementation [dossier de création de la ZAc des chantiers] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 18
- 19. Chapitre 1. Les Chantiers à l’étude 1.2 Création de la ZAC des Chantiers (2003-2004) Le dossier de la « Zone d’aménagement concerté Versailles-Chantiers » est publié en 2003. D’une superficie de 14,8 hectares et régie par un Plan d’Aménagement de la Zone (PAZ), cette ZAC se superpose à l’ancienne zone NA du Plan d’Occupation des Sols (POS) et intègre un fragment du secteur sauvegardé : l’extrémité sud de l’avenue de Sceaux et les étangs Gobert. Elle comporte trois volets distincts : 1. création d’un « pôle d’échange multimodal » (train-route) ; 2. programme immobilier (sur le site de l’ancienne gare de marchandises); 3. aménagements et infrastructures : construction d’une passerelle pour les piétons entre la gare et la rue de la Porte de Buc, franchissement des réservoirs Gobert par le prolongement de l’avenue de Sceaux jusqu’à la gare afin de désenclaver le site, raccordement aux grandes rocades régionales (RN 286) (4). L’objectif du projet d’aménagement est de donner une nouvelle dynamique au quartier et de relier ce nouveau pôle aux secteurs historiques, notamment au quartier Saint Louis grâce au franchissement par l’avenue de Sceaux du site des étangs Gobert (propriété de l’Etat), affectés au ministère de l’équipement et protégé au titre des Monuments Historiques. La mise en œuvre devra ainsi se conformer aux directives énoncées dans le cadre des nouveaux Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville et aussi à celles du Plan de Déplacements Urbains en Ile-de-France (PDUIF). Il devra également tenir compte des règles édictées dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé (PSMSS) (5) ainsi que celles des Monuments Historiques concernant la protection des abords de la gare des Chantiers (inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques), qui incitent ensemble à : 1. conserver aux réservoirs Gobert le caractère d’espace public privilégié ; 2. conserver les perspectives de l’Avenue de Sceaux ; 3. respecter certains gabarits et hauteurs pour les constructions. En février 2002, un protocole d’accord est signé entre RFF, SNCF, Ville de Versailles et l’aménageur NEXITY, prévoyant la réalisation d’études conjointes pour la réalisation du projet d’ensemble. De mars à septembre 2002 se déroulent les réunions publiques de concertation, à l’issue desquelles se tiennent, au sein du Conseil municipal, des séances de travail et de discussion sur la création de la ZAC et l’adoption du projet de PADD (septembre 2002). En mars 2003 sont lancées les enquêtes publiques sur le PLU et la ZAC. Les rapports des commissions d’enquête seront publiés en avril 2004, le PLU et le projet d’aménagement approuvés par le conseil municipal le 12 juillet 2004. 4 Dossier de création de la ZAC 2003, page 2 5 Quelque 250 hectares de Versailles sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Approuvé en 1993, il englobe notamment les deux quartiers historiques de Saint-Louis et de Notre-Dame (les premiers protégés, par arrêté ministériel du 6 mars 1973). Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 19
- 20. Chapitre 1. Les Chantiers à l’étude Durant cette période, les Associations de Sauvegarde des quartiers suivent de très près l’élaboration de ces nouveaux documents d’urbanisme. Ainsi, en ce qui concerne la ZAC, lors de la réunion publique organisée le 5 février 2003 par le Député-maire Etienne Pinte, leurs principaux sujets de préoccupation concernent entre autres les nuisances liées à l’augmentation prévisible de la circulation, le type de logements et de commerces construits, le type d’espaces verts et ludiques créés, et l’éventuelle remise en eau des réservoirs Gobert, les retombées du projet sur les autres quartiers... Afin de tenir compte des observations formulées lors des enquêtes publiques, le projet de la ZAC prévoit d'implanter le programme de logements et de résidence de tourisme du côté place Raymond Poincaré, alors que les bureaux sont situés du côté des voies ferrées. Un projet de voie reliant le site de Satory est par ailleurs arrêté dans son principe, mais non dans son tracé. Les maîtres d’ouvrage appelés à intervenir sur le site sont par ailleurs confirmés : la SNCF, pour l’aménagement de la gare et son accès depuis la rue de la Porte de Buc ; le promoteur NEXITY, pour le nouvel ensemble immobilier et ses voiries ; la Ville de Versailles pour tous les travaux d’accessibilité. 1.3 Approfondissements des études (2005-2007) En 2005-2006, en concertation avec le Ministère de la Culture et des Bâtiments de France, la ville élaborent les principes du franchissement des étangs Gobert. Par ailleurs, un programme d’urbanisation des terrains de l’ancienne gare de marchandises se précise. Développé par NEXITY (avec le cabinet d’architecture ARTE- CHARPENTIER), il prévoit environ 54 000 m2 de constructions neuves, comportant des bureaux (17 300 m2), des logements sociaux (3 700 m2), des résidences pour tourisme et étudiants (6 400 m2), des commerces (17 600 m2), des cinémas (2 000 places), une maison de quartier (1 300 m2) et un gymnase (1 200 m2) (6). Il est prévu la réalisation par l’aménageur des espaces publics du nouveau secteur (voirie et place) et leur remise à la ville qui, pour sa part, prend à sa charge : - en maîtrise d’ouvrage, les travaux de franchissement des étangs Gobert (et du prolongement de l’avenue de Sceaux) et d’aménagements viaires et paysagers (place des Francine et Carrefour des Francine, carrefour Raymond Poincaré, rue des Chantiers, rue de l’Abbé Rousseaux, rue de la Porte de Buc, Place du 8 Mai, parvis et rampe d’accès à la gare) ; - en Vente en l’Etat de Futur Achèvement (VEFA), les volumes correspondant au Programme Social de Relogement (PSR), au local à vélos, à la gare routière, au gymnase et à la maison de quartier. Les grands principes du projet de la nouvelle gare (pôle d’échanges multimodal) sont, pour leur part, confirmés dans le 20 avril 2005 par le comité de pilotage et de suivi, placé sous l’égide du STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France). Il prévoit trois lots de travaux distincts: 1- restructuration et agrandissement de la gare, construction d’un nouveau bâtiment regroupant tous les services (Place Raymond Poincaré), aménagement des accès depuis la rue de la Porte de Buc ; 2- parking de 1100 places, dont le PSR de 385 places et un garage deux roues de 300 places ; 6 NEXITY obtient le 4 mai 2005 un agrément pour la création des bureaux et, le 2 juin 2005, pour la réalisation d’un complexe de cinémas (la validité de cet accord sera prorogée jusqu’au 31 décembre 2007, par avenant en date du 19 janvier 2006). Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 20
- 21. Chapitre 1. Les Chantiers à l’étude 3- accès au site: Avenue de Sceaux au niveau de la place des Francine (par bus et voiture : seuls les bus auront accès à la place centrale), Place Raymond Poincaré (par voiture), rue de la Porte de Buc (à pied : cette route sera aménagée pour que les autobus puissent stationner pour prendre ou laisser les passagers, soit à la montée, soit à la descente de cette voie), et un rond-point à la hauteur de l’entrée du cimetière des Gonards (à réaliser ultérieurement). Pour la mise en œuvre de ce pôle d’échanges, une convention de financement à hauteur de 53 millions d’euros est signée en septembre 2006 entre l’Etat, la Région, le Département, le STIF, la SNCF, le RFF, et la ville. Les travaux sont alors envisagés en deux phases. Durant la première sont prévus : - la rénovation et réaménagement de la gare existante ; - la construction d’un nouvel immeuble à proximité de la place Raymond Poincaré accueillant les services de la SNCF et de Réseau Ferré de France (RFF) ; - la création d’une passerelle piétonne entre l’actuel bâtiment voyageurs SNCF et la rue de la porte de Buc ; - la création d’une nouvelle passerelle d’accès aux quais ; - la création d’une gare routière de 14 quais ; - la création d’un parking de stationnement régional de 385 places (la totalité sera de 1100 places disponibles) et d’un garage pour les deux roues de 300 places; l’aménagement de six quais pour les autobus, rue de la Porte de Buc ; - l’aménagement des voiries nécessaires pour un transport en commun en site propre, entre la place des Francine et la rue de l’Abbé Rousseaux; l’amélioration de l’accessibilité et la réorganisation des circulations routières (place des Francine, place Raymond Poincaré, rue des Chantiers, rue de l’Abbé Rousseaux). La seconde phase, financée ultérieurement, comprendrait : - la création d’une galerie de services aux voyageurs entre les deux halls de la gare ; - la mise en place d’ascenseurs entre la nouvelle passerelle et les quais ; - la reconstitution de l’éclairage zénithal dans le hall de la gare actuelle et le prolongement de la couverture des quais. Est également envisagée, à plus long terme, la création d’un transport en site propre (transport en mode léger sur pneus, sur près de 70 % du trajet), autonome et répondant aux normes Très Haute Qualité de Service. Il partirait du Pont Colbert, emprunterait la rue des Chantiers, passerait par la place Raymond Poincaré puis la rue de l’Abbé Rousseaux, la gare routière, pour ressortir Avenue de Sceaux et se dirigerait ensuite vers l’hôpital Mignot. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 21
- 22. La ZAC des Chantiers: évolution des orientations urbaines 2000-2002 [dossier de création de la ZAc des chantiers] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 22
- 23. La ZAC des Chantiers: une première image du projet [dossier de création de la ZAc des chantiers] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 23
- 24. Un premier concours pour la traversée des étangs Gobert: le projet lauréat [exposition publique, service d’urbanisme] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 24
- 25. Chapitre 1. Les Chantiers à l’étude 1.4 Un premier pas : le franchissement des étangs Gobert (2006) Le coup d’envoi de cet ambitieux projet a été donné par le lancement, à la fin de l’année 2005, d’un concours international afin de sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre pour la traversée des étangs Gobert. Le projet de l’agence d’architecture et de paysage OBRAS a été retenu à l’issue de cette consultation (Conseil Municipal du 30 mars 2006). Prévoyant la remise en eau de l’abreuvoir des Francine, ce projet envisage le franchissement du site par un double système de voies pour les voitures et les piétons : une montante et une descendante, situées dans le prolongement des contre-allées de l’avenue de Sceaux et traitées dans l’esprit de l’architecture en pierre, avec, dans chaque sens, une voie réservée pour les bus. Chaque voie comprendrait, en complément des trottoirs et de deux alignements d’arbres, une voie de circulation affectée aux transports en commun et une autre à la circulation générale. Le fond du réservoir carré, en végétation naturelle, serait en outre rendu accessible par des sentiers. La mise en œuvre de ce projet, qui placera le site de la gare des Chantiers en relation avec le château par l’avenue de Sceaux, transformera radicalement le mode de vie du quartier, demeuré jusqu’alors coupé du reste de la ville. Le programme de logements, bureaux et équipements implanté à proximité de cette gare dotera en outre ce quartier d’un nouveau centre moderne. Aujourd’hui, cette mutation urbaine, qui sera un moment important dans l’histoire de Versailles, en est encore au stade d’étude. Il appartiendra à l’avenir de confirmer sa réalisation. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 25
- 26. Nicolas de Grandmaison, Plan légendé de Versailles, du jardin et des environs (vers 1710) [Huile sur toile, Archives nationales de Pari,] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 26
- 27. Chapitre 2. La constitution d’un quartier Chapitre 2. La constitution d’un quartier (Responsable : Jacques Royen) Actuellement, Versailles compte huit quartiers: Notre-Dame, Saint-Louis, Montreuil, Chantiers, Clagny-Glatigny, Jussieu-Petits Bois-Picardie, Porchefontaine, et Satory. La partie historique de la ville est une création de la royauté française à son apogée. Au début du 17e siècle, le site de Versailles se limite à une butte étroite portant un château féodal transformé en ferme, un village au pied et, alentour, des marécages et des bois giboyeux. Louis XIII vient souvent chasser en ces lieux. En 1624, il achète un terrain sur la butte et y fait construire un petit pavillon de chasse. En 1631, il acquiert de Gondi, archevêque de Paris, la seigneurie de Versailles. Le pavillon de chasse est agrandi et devient un petit château de brique, pierre et ardoise, œuvre de Philibert Le Roy. Louis XIV commence son règne personnel en 1661, à la fin de la régence assurée par Anne d'Autriche et Mazarin. Grand chasseur et attaché à Versailles par d'agréables souvenirs de ses séjours d'enfance, il n'aura de cesse de métamorphoser le modeste château de son père dans le magnifique édifice que nous connaissons aujourd'hui, et de lui adjoindre une ville digne de sa majesté et destinée à abriter la population de plus en plus nombreuse, titrée ou non, vivant autour de la Cour. Dès 1671, pour faciliter le développement de la ville, il octroie des terrains à tous ceux qui en font la demande, moyennant un impôt de 5 sous par arpent (3 194 m2), et à condition de respecter dans les constructions les consignes strictes données par le Service des Bâtiments du Roi pour assurer l'unité architecturale de la ville; le vieux village de Versailles est rasé. Afin que le château se détache de toute sa masse au-dessus de la ville, le toit des immeubles ne doit pas excéder le niveau de la Cour de Marbre. Le premier quartier de Versailles à être construit est le quartier Notre-Dame, suivi quelques années plus tard par le quartier Saint-Louis (Cf. plan de Versailles vers 1710). A cette époque, la ville est peu étendue puisqu'elle n'occupe qu'une portion des actuels quartiers Notre-Dame et Saint-Louis. Montreuil est un village près de Versailles. Il forme une paroisse totalement distincte et n'est donc pas une création royale comme les deux quartiers mentionnés. Seule une très petite fraction de l'actuelle rue des Etats- Généraux fait partie de la ville de Versailles sous Louis XIV. Le quartier des Chantiers n'existe pas encore, ni d'ailleurs les autres quartiers que compte la Versailles moderne. Avant la Révolution de 1789, la cité royale ne s'étend pas au-delà de la rue de Noailles où se trouve la barrière de Versailles, ainsi que le montrent les plans du 18e siècle. C'est le 1er janvier 1787 que les faubourgs de Montreuil et Porchefontaine sont réunis à Versailles. La barrière est alors reculée jusqu'à la grille du Pont Colbert, à l'extrémité de la rue des Chantiers actuelle (1). Entre-temps, le quartier des Chantiers a commencé à se développer, modestement et de manière très hétérogène, sans bénéficier de plans tracés à l'avance ni d'avantages incitatifs à la construction. Dans sa partie nord-ouest, appelée à cette époque le Petit Montreuil, et le long de la nouvelle rue des Chantiers, mise en service vers 1735, s'érigent des hangars, des entrepôts, des baraques, des masures, des cours boueuses où logent des bûcherons, des maraîchers, des horticulteurs, des ouvriers de tous les corps d'état, des valets de chiens, palefreniers, postillons et cochers qui travaillent au Château, 1 Sources croisées : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127; Carcy, 1981, p. 43; Chaplot et Dutrou, 1988, p. 67; Coll., 1950, p. 3; Evrard, 1935, p. 23; Houth, 1980, p. 388; Lemoine, 1955, p. 265; Levron, 1981, p. 116; Maroteaux, 2000, p. 34; Villard, 2003, p. 36 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 27
- 28. Chapitre 2. La constitution d’un quartier des gardes des bâtiments, des gens de maison, pas mal de marginaux et un certain nombre de malfaiteurs. Vers la fin du 18e siècle, de hauts personnages et des grands bourgeois se font construire au Petit Montreuil des résidences d'été et des maisons de plaisance entourées de grands jardins. Cependant, à l'approche de la Révolution, le quartier des Chantiers est dans son ensemble une partie du Domaine Royal marginale et négligée, composée essentiellement de vergers, de cultures maraîchères, de fabriques artisanales et de tanneries. A la limite entre les Chantiers et le quartier Saint-Louis se trouvent nombre de casernes (par exemple, la caserne des Gardes du Corps du Roi située avenue de Sceaux), d'écuries de la garnison de Versailles et d'écuries des princes du sang (les écuries de la comtesse de Provence se situent rue d'Anjou, celles du comte d'Artois rue Edouard-Lefebvre, auparavant appelée rue d'Artois) (2). L'histoire du quartier des Chantiers ne peut être dissociée de celle des quartiers de Montreuil et de Porchefontaine, brièvement exposée dans les pages suivantes. 2.1 Aux portes de Versailles, Porchefontaine et Montreuil Porchefontaine et Montreuil avant 1748 L’origine de Porchefontaine et Montreuil se perd dans la nuit des temps. Le nom de Montreuil vient peut-être du latin "monasteriolum", diminutif de "monasterium", monastère, rappelant l'existence d'un lieu de culte fondé sous le vocable de Saint Symphorien d'Autun par Saint Germain, évêque de Paris (3). L'origine du nom de Porchefontaine est quant à elle très controversée (4). Au 14e siècle, la seigneurie de Porchefontaine appartient à la famille de Jean de la Marche, écuyer. A cette époque, le domaine est cédé à Jean Prévost, vendeur de poissons de mer aux Halles de Paris, avant de revenir, en 1364 ou peu après, au Roi Charles V qui en donne, avant 1368, une partie à Jean de Dormans, alors évêque de Beauvais, et une autre partie à Philippe des Essarts. Celui-ci, devenu seul propriétaire de Porchefontaine sans doute à la suite d'une opération immobilière, revend le domaine à Siquart Raoul, épicier et bourgeois de Paris. En 1373, le domaine passe aux mains de Pierre Bournaseau (Pierre de Bournasel après son anoblissement), qui fait raser l'ancien manoir pour édifier à sa place un château couvert d'ardoise, avec neuf tours et fossés à fond de cuve (dont on aurait retrouvé un mur de fondation près de la ferme de Porchefontaine). En 1386, ses héritiers le cèdent à Simon de Cramault (parfois orthographié Cramaud, ou Gramand), évêque de Poitiers et patriarche d'Alexandrie, futur archevêque de Reims et cardinal, qui, la même année, achète également la seigneurie de Montreuil à Guillaume de Viroflay, et d'autres terres à l'entour. Presque immédiatement, dès 1386, Simon de Cramault vend l’ensemble de ses terres à Pierre de Craon, seigneur de la Ferté-Bernard, de Sablé, de Brunnetel et de Rosoy, « écuyer d'honneur » du frère du Roi Charles VI, Louis d'Orléans. Pierre de Craon est en effet depuis longtemps l'un des favoris du duc d'Orléans et profite de ses largesses. Mais, reconnu coupable d'indélicatesses, il tombe en disgrâce. Persuadé que cette disgrâce est due au Connétable de Clisson, il décide de le faire assassiner. Le soir du 14 juin 1392, avec des hommes à sa solde, il monte un guet-apens 2 Sources croisées : Carcy, 1981, p. 38 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999 ; Versailles Magazine, jan. 1982, p. 8 3 Sources : Cafin-Carcy et Villard, 1991, p. 127 ; Houth, 1980, p. 42 4 Sources: : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 6; Dietschy-Picard, 1990, p. 5, 6; Houth, 1980, p. 46; Le Roi, 1868 T. 1, p. 440; Levron, 1981, p. 22; Mercet, 1929, p. 70, 74, 75 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 28
- 29. Chapitre 2. La constitution d’un quartier et tente de tuer Clisson à sa sortie de l'hôtel Saint-Pol, résidence de Charles VI à Paris. Il ne réussit qu'à le blesser légèrement; quinze jours plus tard le Connétable est rétabli. Ayant été reconnu au cours de l'action, Pierre de Craon est immédiatement banni par Charles VI. Alors qu’il s'enfuit en Espagne, tous ses biens sont confisqués, sur ordre du Roi : le château de Porchefontaine est rasé, les revenus du domaine donnés au duc d'Orléans. L'année suivante, le Roi et son frère font don aux Célestins de Paris d’une partie de ces revenus (cent livres parisis de rente, soit environ 1000 euros). En 1395, ces religieux deviennent les seigneurs de Porchefontaine et des bois qui en dépendent, et le resteront pendant plus de 350 ans (5). Les Célestins de Paris acquièrent ainsi "une maison des champs", et créent à la fois une exploitation rurale et un lieu de repos. Ils n'y résident que peu nombreux à la fois, rarement en hiver, plus volontiers à la belle saison. Les moines administrent soigneusement leur domaine, qu'ils baillent à ferme. Ils exploitent leurs bois, dont ils baillent parfois une partie à cens. Ils logent dans leur domaine un Procureur qui, sur les biens de mainmorte, a droit de haute et basse Justice (6). Tout en jouissant des bénéfices de leur exploitation rurale et de leurs bois, les Célestins entretiennent avec les habitants de Montreuil les meilleurs rapports. En revanche, ils ont souvent maille à partir avec les Versaillais, qui prétendent avoir le droit d'y couper le bois à leur usage et d'y mener paître leurs bestiaux. Sans doute, quelque ancienne tolérance leur avait-elle été accordée à ce sujet mais les moines entendent être maîtres chez eux. Le 10 juillet 1414, le Prévôt de Châteaufort publie une sentence contre « aucun des habitants de Versailles pour le dommage » causé par l'usage abusif des terres et bois de Porchefontaine. La sentence est répétée en 1482. Le petit peuple versaillais n'en continue pas moins au cours des siècles à s'approvisionner en bois de construction et de chauffage à la sauvette, ne respectant, par superstition, que les chênes (7). La première partie du 18e siècle semble avoir connu en Ile-de-France une période de froid particulièrement rigoureux. Les constats de vol de bois de chauffage dans les forêts domaniales sont fréquents. Au début de 1740, Porchefontaine voit le pillage systématique de ses bois par les habitants de Versailles. Les Célestins possèdent mille deux cents arpents de forêt et ont finalement permis, depuis très longtemps, aux habitants du village de Montreuil d'abord, à ceux de Versailles ensuite, d'aller y faire des fagots. Au début de janvier de cette année-là règne un froid extrêmement rigoureux. Les pauvres gens ont vite épuisé leur récolte de bois mort, faite sur la propriété des moines. Et voici qu'à eux se joignent par bandes de deux à trois cents personnes, encouragées par l'impunité apparente, des femmes, des ouvriers sans emploi, des valets de grands seigneurs. Presque tous les Célestins résident à Paris. Ils n'exercent aucune répression, peut-être par esprit de charité. Les bûcherons improvisés ne s'en tiennent pas longtemps aux fagots. On assiste bientôt à un véritable pillage organisé. Tout y passe, jusqu'aux plus gros chênes. Le 6 février, on compte dans les bois « quatre à cinq mille personnes de toute condition ». De bons bourgeois organisent l'abattage des arbres et la vente du bois à des habitants de Versailles, et en tirent de gros bénéfices. Le Bailli de Versailles est disposé à mettre un 5 Sources croisées : Caffin-Carcy, 1981, p. 43; Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127 ; Carcy, 1981, p. 43; Chaplot et Dutrou, 1998, p. 6-10 ; Dietschy-Picard, 1990, p. 7-11, 13 ; Houth, 1980, p. 44-48, 338 : Le Roi, 1868, T. 1, p. 440-443 ; Levron, 1981, p. 22-23 ; Maroteaux, 2000, p. 132; Mercet, 1929, p. 70, 74, 75, 94 à 98; Rojat-Lefèvre,Nuit du Patrimoine, 1999; Versailles Magazine, juin 2005 p. 33. 6 Sources croisées : Dietschy-Picard, 1990, p. 13 ; Houth, 1980, p. 48-49 ; Le Roi, 1868 T. 1, p. 444 ; Mercet, 1929, p. 70 7 Sources croisées : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 8 ; Dietschy-Picard, 1990, p. 13-14 ; Houth, 1980, p. 49 ; Le Roi, 1868 T. 1, p. 443- 444 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 29
- 30. Chapitre 2. La constitution d’un quartier terme à des déprédations aussi considérables mais il n'a point d'autorité sur la terre de Porchefontaine puisque seuls les Célestins possèdent sur leurs terres un droit de haute et basse Justice. Il en avertit le Procureur du Roi. Ce n'est qu'au bout de plusieurs jours que le Roi, alors à Marly avec le Maréchal duc de Noailles, Gouverneur de Versailles, donne ordre aux Gardes-françaises de marcher sur Porchefontaine, de cerner la forêt, et d'arrêter les perturbateurs. Le même jour est publié à son de trompe la défense aux habitants de Versailles d'aller chercher du bois à Porchefontaine. Le lendemain, toutes les barrières de la ville fermées afin que personne n'en sorte, les arrestations se multiplient. Des visites domiciliaires ont lieu chez les acheteurs versaillais, considérés comme receleurs. Ceux-ci, n'ayant pas le temps de brûler tout leur bois (provoquant ainsi plusieurs incendies), se hâtent de s'en débarrasser en le jetant par les fenêtres. Toute circulation est impossible dans les rues de Versailles, ainsi encombrées, le dimanche 12 février 1740. On rend aux Célestins le bois récupéré; environ cent arpents (32 hectares) de leur forêt ont été dévastés (8). Montreuil (appelé également Montreuil-hors-Viroflay) était autrefois très étendu et composé de deux villages distincts, séparés par l'avenue de Paris et visibles sur les cartes du 18ème siècle, notamment la "carte des chasses du Roi" levée et dressée de 1764 à 1773 : au nord, le Grand Montreuil (de la rue de Montbauron à la rue des Petits-Bois) et, au sud, le Petit Montreuil (de l'actuelle rue de l'Assemblée-Nationale jusqu'au domaine de la ferme de Porchefontaine) (9). Il n'est pas encore fait mention à cette époque du quartier des Chantiers. Longtemps, le Grand Montreuil est peu peuplé - 1200 habitants vers 1717 - et pauvre, abritant d’abord des bûcherons puis des blanchisseurs, maraîchers et horticulteurs qui fournissent la Cour et la ville de Versailles (en seigle, foin, légumes, un peu de vin), ainsi que des commerçants (boulangers, charcutiers, barbiers) et quelques petits artisans (maçons, charpentiers, maréchaux, voituriers, serruriers, menuisiers, tisserands, tonneliers), des manouvriers et des journaliers, et des marginaux attirés par l'animation de Versailles. En 1727, il garde un aspect rural, avec des vignes sur la côte de Picardie (déjà disparues à la veille de la Révolution de 1789). Pendant la belle saison, les Versaillais vont le dimanche s'amuser et s'encanailler dans les nombreux cabarets et guinguettes de cette campagne toute proche, où s'élèvent déjà quelques maisons bourgeoises (10). Le village du Petit Montreuil est, lui, constitué de hangars, d'entrepôts, de baraques, de masures, de cours boueuses où logent les ouvriers de tous les corps d'état, charpentiers, maçons, terrassiers, mais aussi valets de chiens, palefreniers, postillons, cochers qui travaillent au Château, gardes des bâtiments et gens de maison (11). 8 Sources croisées : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 17 ; Dietschy-Picard, 1990, p. 18-19 ; Evrard, 1935, p. 129 ; Helle, 1969 T. 1, p. 148-149 ; Houth, 1980, p. 333 ; Le Roi, 1868 T. 1, p. 444-450; Mercet, 1929, p. 71. 9 L'emplacement actuel de la rue Edme-Frémy et de la rue Jean-Mermoz (anciennement rue de la Patte-d'Oie) était occupé par l'étang de Porchefontaine. L'estang Pierray (orthographié au 18e siècle ‘Etang Pierré’) faisait partie du territoire de Porchefontaine. Sources : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 5, 12, 13, 16, 18-24,26 ; Coll., 1950, p. 3: Dietschy-Picard, 1990, p. 7 ; Levron, 1981, p. 116 ; Maroteaux, 2000, p. 87 ; Villard, 2003, p. 36 10 Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127; Carcy, 1981, p. 43; Evrard, 1935, p. 23-25; Houth, 1980, p. 388; Lemoine, 1955, p. 266; Levron, 1981, p. 116; Rapport de Présentation du PLU, 2004, p. 35-36; Villard, 2003, p. 36 11 Sources : Carcy, 1981, p. 38; Rojat-Lefèvre, Nuit du Patrimoine, 1999; Versailles Magazine, jan. 1982, p. 8 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 30
- 31. Plan de commodité 1786, prévoyant l’extension de l’avenue de Sceaux par delà les étangs Gobert [archives municipales] Nouveau plan de Versailles, 1787 [archives municipales] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 31
- 32. Les villages jouxtant Versailles: Montreuil et Porchefontaine, au début 18e s. En haut: “Le grand Montreuil proche de Versailles« ; au centre et en bas à g.: “L’étang de Porchefontaine et l’avenue de Paris”, gravures in Alain Manesson Mallet, La géométrie pratique (1702) [Bibliothèque municipale de Versailles] En bas, à droite: Vue de l’abreuvoir de Marly (1724), de Pierre-Denis Martin (1663-1972) [détail de la peinture, Musée du château de Versailles] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 32
- 33. Chapitre 2. La constitution d’un quartier L'accroissement rapide de Versailles au 18ème siècle a pour conséquence de laisser les agglomérations voisines à moitié vides d'habitants. A cette époque les bourgeois et les officiers du Roi hésitent à se fixer dans ces annexes quasi désertes, sans sécurité ni commodités. Il y a peu d'éclairage, et peu de police: les vagabonds attaquent les passants dès la tombée de la nuit (12). Annexion de Porchefontaine et Montreuil au Domaine Royal (1748) Porchefontaine et Montreuil sont annexés au Domaine Royal par lettres patentes le 1er janvier 1748, à la suite d'un échange conclu entre Louis XV et les Célestins de Paris le 11 novembre 1747. Celui-ci prévoit, en compensation de l’annexion des terres de Porchefontaine, du Grand et du Petit Montreuil, des Metz et de La Boulie, de céder aux religieux les Grand et Petit Villetain (aujourd'hui orthographié Viltain), terres situées au sud du Val de Gallie (orthographié aujourd'hui, Gally), ainsi que la seigneurie et terre de Jaillac-Duplessis et autres lieux faisant partie du domaine et comté de Nogent (13). Par cet accord, Porchefontaine et Montreuil deviennent d’abord terre des chasses royales. Chasseur invétéré, le roi, lorsqu'il n'est pas à Compiègne, Fontainebleau, Saint- Hubert plus tard, porte en effet ses pas dans la zone dite des « grands environs » (jusqu'aux Alluets, Port-Royal), ou vers Fausses-Reposes et Verrières. Ce besoin de nouveaux espaces de chasse explique sans doute en partie qu'il ait requis l'extension du Domaine Royal à l'est de Versailles, extension à laquelle Louis XIV avait renoncé après 1683. Cette opération permet également de faire la jonction avec le domaine de Meudon, revenu au Roi depuis l'avènement de Louis XV, et apporte un revenu non négligeable. Enfin en 1787, Louis XVI annexe ces terres à Versailles dont elles forment la troisième paroisse. Montreuil compte alors environ 3000 habitants (14). L’annexion de Montreuil à Versailles avait été envisagée dès 1723, et ce pour deux autres raisons. D’abord pour conforter la sécurité du Domaine Royal. Car Montreuil sert depuis longtemps de refuge aux vagabonds, malfaiteurs et gens sans aveu qui, ayant fait un mauvais coup à Versailles, s'y réfugient, sûrs d'échapper à la justice (15). La seconde raison est d’ordre fiscal. En s'incorporant les 3000 habitants de Montreuil, le Domaine Royal peut compter sur une augmentation des droits féodaux, lots et ventes, gabelles, octrois, etc. Il s'agit en outre de « faire cesser les difficultés qui surviennent entre les commis du Domaine de Versailles et ceux de la Ferme Générale établie à Montreuil, de diminuer les moyens de contrebande qui existent par les entrepôts frauduleux qui sont formés dans la paroisse de Montreuil » (16). 12 Damien et Lagny, 1980 p. 17 13 Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127; Carcy, 1981, p. 43; Chaplot et Dutrou, 1988, p. 21; Damien et Lagny, 1980, p. 16; Dietschy-Picard, 1990, p. 20; Houth, 1980, p. 42, 388; Maroteaux, 2000, p. 134 14 Sources : Caffin-Carcy, 1981, p. 43 ; Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127 ; Chaplot et Dutrou, 1998, p. 8-10 ; Dietschy-Picard, 1990, p. 7, 8, 13 ; Houth, 1980, p. 42-46, 388 ; Le Roi, 1868, T. 1, p. 440-443 ; Levron, 1981, p. 22-23 ; Maroteaux, 2000, p. 132 ; Mercet, 1929, p. 74, 75, 94-98 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999 ; Versailles Magazine, juin 2005, p. 33 15 Sources: Damien et Lagny, 1980, p. 16 ; Houth, 1980, p. 388 ; Levron, 1981, p. 116 ; Maroteaux, 2000, p. 133 16 Par l'édit d'août 1786 qui avait annexé Montreuil à la ville royale, les habitants de ce village furent exonérés de la taille et de la milice mais furent soumis aux mêmes droits d'aides et d'entrées que les Versaillais. On continua bien sûr à percevoir les anciens impôts, et la capitation. Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127; Damien et Lagny, 1980, p. 16; Evrard, 1935, p. 18-19, 355-383; Houth, 1980, p. 388-389; Lemoine, 1955, p. 266; Maroteaux, 2000, p. 133, 219; Rojat-Lefèvre, Nuit du Patrimoine, 1999. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 33
- 34. Plan de la ville, du château et du parc de Versailles, 1835: plan d’ensemble et détail aux abords du futur quartier des chantiers, comportant un certain nombre de casernes [archives municipales] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 34
- 35. Chapitre 2. La constitution d’un quartier Annexion de Porchefontaine et Montreuil à Versailles (1787) Louis XVI intègre définitivement Montreuil et Porchefontaine au territoire de Versailles par un édit pris au mois d'août 1786, doublant la superficie de la ville (17). Effectives au 1er janvier 1787, ces annexions impliquent la construction de nouvelles barrières d’octrois - l’un des bureaux d’octrois sera situé au Pont Colbert, à l'extrémité de l’actuelle rue des Chantiers (18). Ces annexions ont pour incidence quelques travaux d’embellissement. Pour des raisons de salubrité publique, les cimetières sont supprimés et reportés à la périphérie (19). Montreuil, qui avait déjà mauvais renom au début du 18e siècle, passe encore, à la veille de la Révolution, pour un lieu de débauche populaire. Néanmoins, durant le dernier quart du siècle, de grands personnages s'y font construire des résidences d'été et des maisons de plaisance entourées de grands jardins (20). La Révolution de 1789 arrête l'extension de la ville vers l'est (21). Dès 1795, le Domaine Royal est mis en vente sous l'appellation « Liste civile du Roi » et Porchefontaine, loti en parcelles de petite superficie, est ainsi ouvert à l’urbanisation (22). 2.2 Règles et réalisations d’un nouveau quartier Aux origines d’un nom : les forêts domaniales Avant le 19e siècle, le bois est la seule ressource pour le chauffage et la cuisine. Il représente pour tous, riches ou pauvres, une lourde charge financière. Le bois de charpente et de menuiserie est, par ailleurs, un matériau de construction essentiel, en forte demande à Versailles. Pour ces deux raisons, Colbert édicte entre 1661 et 1669 des Ordonnances des Forêts du Domaine Royal, visant à mettre en ordre les forêts royales, à réorganiser et réglementer l'exploitation sylvicole, et à en assurer la pérennité. L'essentiel de ces Ordonnances est demeuré en vigueur jusqu'à nos jours, sous la forme du Code forestier (23). Pendant tout le 18e siècle, mis à part les droits d'aide et d'entrée à Versailles, les forêts constituent la première des ressources du Domaine Royal. Leur importance relative ne cesse de croître par rapport aux fermes : de 103 000 livres (730 000 euros de 2005) en moyenne entre 1723 et 1732, le produit des coupes passe à 422 000 livres (3 000 000 euros) pour la dernière décennie de l'Ancien Régime, soit un revenu à l'hectare d'environ 40 livres (280 euros) pour la première période, 75 livres (530 euros) pour la seconde. C'est alors près du triple du revenu brut d'un hectare de ferme du Domaine, et beaucoup plus que pour les autres forêts royales de l'Ile-de-France. 17 Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127 ; Carcy, 1981, p. 43 ; Chaplot et Dutrou, 1988, p. 21 et 67 ; Coll., 1950, p. 3 ; Damien et Lagny, 1980, p. 16 ; Dietschy-Picard, 1990, p. 20 ; Evrard, 1935, p. 23 ; Houth, 1980, p. 388 ; Lemoine, 1955, p. 265 ; Levron, 1981, p. 116 ; Maroteaux, 2000 p. 134 ; Villard, 2003 p. 36. 18 Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127 ; Carcy, 1981, p. 43 ; Chaplot et Dutrou, 1988, p. 67 ; Coll., 1950, p. 3 ; Evrard, 1935, p. 23 ; Houth, 1980, p. 388 ; Lemoine, 1955, p. 265 ; Levron, 1981, p. 116 ; Maroteaux, 2000 p. 34 ; Villard, 2003 p. 36. 19 Levron, 1981, p. 116 20 Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127; Carcy, 1981, p. 43; Evrard, 1935, 23-25; Houth, 1980, p. 388; Lemoine, 1955, p. 266; Levron, 1981, p. 116; Rapport de Présentation du PLU, 2004, p. 35-36; Villard, 2003, p. 36 21 Sources : Caffin-Carcy et Villard, 1991, p. 127 ; Damien et Lagny, 1980, p. 16 ; Evrard, 1935 p. 18-19, 355-383 ; Houth, 1980, p. 388, 389 ; Lemoine, 1955 p. 266 ; Maroteaux, 2000, p. 133 et 219 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999. 22 Chaplot et Dutrou, 1998, p. 21 ; Dietschy-Picard, 1990, p. 22 ; Mercet, 1929, p. 72 23 Sources croisées : Dietschy-Picard, 1990, p. 15 ; Evrard, 1935, p. 440-447 ; Helle, 1969 T. 1, p. 148 ; Maroteaux, 2000, p. 215 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 35
- 36. Chapitre 2. La constitution d’un quartier Ce haut revenu favorise l'émergence à Versailles d'un puissant groupe de marchands de bois, mettant à profit une demande locale sans cesse accrue. Il reflète aussi l'attention portée par le Domaine, après 1723, à l'exploitation des forêts. Elle se manifeste notamment par son souci d'élargir et d'espacer les coupes. L'extension de la surface des coupes, que ce soit par acquisition ou par replantation, permet une meilleure protection du bois, en même temps qu'elle facilite le passage des chasses (24). Cet excellent rapport des bois, en même temps que l'intérêt des chasses qui pour cette fois va de pair, explique la politique massive de reboisement menée par le Domaine sur les terrains les moins productifs. En 1770, on fait valoir au Roi l'augmentation du prix du bois, qui constitue une part essentielle du revenu domanial au moindre coût. Il est donc de son intérêt de multiplier les plantations, sans toutefois dégrader les corps de ferme. Il ne faut négliger aucune partie de terrain susceptible d'être cultivée ou plantée. Ainsi disparaissent des zones de friches, comme celle des Gonards en 1777 et 1781, ou d'anciennes carrières, comme celles de l'Etang de Satory en 1776, ou celle des trous de Jardy en 1778 (25). Malgré l'augmentation de la production, les chantiers devaient être insuffisants ou le bois trop coûteux car les constats de vol sont fréquents dans les forêts domaniales (26). Le quartier des Chantiers tire son nom de cette activité économique. Le dictionnaire de Jean Nicot, Thresor de la Langue Françoyse, de 1606 donne du mot « chantier » la définition suivante : « la boutique ou magazin où les marchans de bois d'œuvre, comme poultres, solives, chevrons et autres telles grosses pièces tiennent leur marchandise, et le bois de destail pour brusler, et vient de ce mot Latin Cantherius, qui signifie ores un eschalat à soustenir les maillots de la vigne, et ores le magazin où les marchans de bois tiennent toutes sortes de pieces de bois à vendre, Lignaria apotheca, Asserum tignorumque vanalium conditorium. Il se prend aussi pour l'assemblée de bois à brusler, Lignorum strues, coaceruatio, et pour le lieu auquel il est entassé, Lignarium, Le buscher » (27). Au fil des siècles, le terme acquiert des sens différents, comme le montrent notamment le Dictionnaire de l'Académie Française de 1762 et le Dictionnaire de Jean-François Féraud (1787-1788), qui en proposent deux (28) : - « Grande place où l'on arrange, où l'on entasse des piles de gros bois à brûler, ou de charpente, ou de charronnage ». - « Chantier d'attelier (note de l’auteur : orthographe du 18e siècle), lieu où l'on décharge le bois ou la pierre, pour les travailler, afin qu'on puisse les employer à un bâtiment ». La plupart des auteurs s'accordent en effet à dire que le nom du quartier des Chantiers évoque les chantiers de bois à brûler qui permettaient l'entretien des bois à la lisière de Versailles (bois des Gonards et bois du Cerf Volant). Dès 1724, les marchands de bois, très nombreux pour fournir la Cour en bois de chauffage, sont contraints d'établir leurs chantiers dans le quartier du Parc-aux-Cerfs. Ce quartier s'étant peuplé, ils s'installent au Petit Montreuil. C'est ainsi que naquit le nom de « quartier des Chantiers ». La rue des 24 Sources croisées pour ces paragraphes : Evrard, 1935, p. 440-447 ; Maroteaux, 2000, p. 215 25 Maroteaux, 2000, p. 216 26 Source : Helle, 1969 T. 1, p. 148 27 Nicot, 1606, p. 112 28 Source : Dictionnaire de l'Académie, 1762, p. 276 ; Féraud, 1787-1788, p. A409a Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 36
- 37. Chapitre 2. La constitution d’un quartier Chantiers était la rue des fagoteurs, des bûcherons, des marchands de bois et des entreprises de charpente, tout comme la rue au Pain était celle des boulangers (29). Selon d’autres auteurs, le quartier des Chantiers doit plutôt son nom aux lieux d'entrepôt qu'utilisèrent les bâtisseurs du Château et de la ville de Versailles. Ces lieux d'entrepôt étaient alloués par le Roi aux entrepreneurs, qui pouvaient y installer leurs ateliers. En fait, comme le montrent les dictionnaires anciens, les deux origines se renforcent mutuellement et il semble bien que la première attribution est la plus vraisemblable. La langue française telle qu’elle est parlée au Québec aujourd’hui a gardé des liens profonds avec la langue parlée en France autrefois. Le Dictionnaire des Expressions Québecoises de Pierre DesRuisseaux (Bibliothèque québécoise 2003, p. 93) et le Multidictionnaire de la Langue Française de Marie-Eva de Villers (Québec Amérique, 2007, p. 261) font tous les deux référence, au mot chantier, à une exploitation forestière, outre le sens de travaux de construction. De manière encore plus explicite, le Dictionnaire de la Langue Québecquoise de Léandre Bergeron (TYPO Dictionnaire 1997, p. 121) donne les deux sens suivants au mot chantier : « 1. Lieu où l’on pratique la coupe de bois dans une forêt ; 2. Chemin d’accès à la coupe de bois », et il propose comme exemple : « Faire chantier : faire de la coupe de bois ». L’origine forestière du nom du quartier des Chantiers semble bien la plus plausible. La constitution d’un tissu urbain Cf. page suivante : Vue générale du quartier des Chantiers au début du 20e siècle Dans le quartier des Chantiers, on a beaucoup bâti, démoli, reconstruit au 18e siècle, grignotant peu à peu les terrains libres. De nobles demeures sont édifiées, principalement entre l'actuelle rue des Etats-Généraux et l'avenue de Paris: maison de Talleyrand rue de Vergennes, Chenil du Roi, Hôtel des Gendarmes. Cependant, le quartier demeure longtemps une partie marginale et négligée du Domaine Royal, composée essentiellement de vergers, de cultures maraîchères, de fabriques artisanales et de tanneries. Il ne semble pas que le quartier des Chantiers ait bénéficié de plans tracés à l'avance ni d'avantages incitatifs accordés à ceux qui y construisaient (30). La réglementation architecturale de Versailles (1715) A Versailles est codifié en 1715 un règlement, dit de Jules-Robert de Cotte (neveu de Mansart, et Premier Architecte du Roi de 1709 à 1735), prescrivant que les toits devaient être couverts d'ardoise, que les façades devaient être de briques et de pierre, et que les constructions devaient respecter « la symétrie réglée par Sa Majesté » (31). Il ne s'est manifestement appliqué que très rarement dans le quartier des Chantiers. Plus généralement, l'aspect de l'ensemble des quartiers de Versailles se modifie singulièrement au cours du 18e siècle. Dès que la Cour quitte la ville après le décès de Louis XIV (en 1715), les ordonnances relatives à la construction ne sont plus respectées, 29 Sources croisées : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 67 ; Coll., 1950, p. 4; Helle, 1969 T. 1, p. 148 ; Le Roi, 1868 T. 2, p. 398 ; Neuf, oct. 1991, p. 6 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999 ; Versailles Magazine, jan.-fév. 2000, p. 19 30 Sources : Versailles Magazine, jan. 1982, p. 3; Versailles Magazine, nov.-déc. 1995, p. 24 31 Un rapport harmonieux devait régner entre les parties de l'édifice: hauteur des maisons réduite à un rez-de-chaussée et un premier étage, avec des combles brisés "à la Mansart". Outre la couverture des toits, les matériaux des façades et la hauteur des maisons, le règlement codifiait les enseignes, et interdisait aux particuliers de changer les "faces des maisons" sans autorisation. Louis XIV exigeait que, de son Château, la perspective de verdure ne fût rompue par aucune construction visible. [Breillat, 1973, p. 28 ; Castex et al., 1980, p. 88 ; Damien et Lagny, 1980, p. 17 ; Evrard, 1935, p. 150-157 ; Houth, 1980, p. 266-268] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 37
- 38. Le quartier des chantiers. Vue au début du 20e siècle [archives municipales, 1Fi639] La rue des Chantiers et la rue des Etats-Généraux. Vues du début du 20e siècle: l'entrée de la rue des Chantiers sur l’avenue de Paris, descente vers la gare et vue générale [archives municipales, 1Fi597, 1Fi600 et 1Fi601] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 38
- 39. Chapitre 2. La constitution d’un quartier le désaccord s'accentuant de plus en plus entre les plans du fondateur, de l'urbaniste du 17e siècle et les nécessités vitales des habitants. Cette absence de contraintes engendre une certaine hétérogénéité architecturale. Versailles est envahie - le quartier des Chantiers ne fait évidemment pas exception - par toute une série de bâtiments qui prolifèrent sans retenue, notamment par des baraques édifiées en une nuit mais destinées à subsister des décennies. Les immeubles s'élèvent à toutes les hauteurs et sont souvent couverts de tuiles. Le laisser-aller général, caractéristique du règne de Louis XV (1710-1774), n'est pas affecté par le retour de la Cour le 15 juin 1722 juste avant la fin de la régence exercée par Philippe d'Orléans. Ce retour s'accompagne d'un important développement économique. Versailles devient une capitale administrative. Outre la Cour, elle accueille les ministères, un tribunal, une juridiction propre à la Cour et la Prévôté. De nouvelles administrations et des casernes s'installent autour du Château. Autour de ces administrations se développe une ville des affaires. Les anciennes prescriptions en matière d'urbanisme sont moins respectées que jamais. Les maisons bâties après 1744 ont presque toujours trois étages et un étage de mansardes. Les parements de briques sont abandonnés ou badigeonnés d'un enduit grisâtre sans attrait. Les arbres des allées sont sacrifiés, quand ce n'est pas l'allée elle-même, comme c'est le cas de l'allée de Montbauron (32). Entre 1722 et 1750, Versailles connaît une forte augmentation démographique : de 24 000, la ville passe à 37 000 habitants (1744) puis à plus 50 000 habitants, ce qui en fait la dixième ville de France. Le passage d'une cité royale à une ville bourgeoise provoque un amoindrissement de l'intérêt porté à l'espace public et, au contraire, une affirmation des individualités au travers de la construction privée. Le réseau viaire de la ville n'est plus entretenu. Ce n'est pas avant le règne de Louis XVI (1754-1793) qu'est entrepris par un Directeur général des Bâtiments énergique, le comte d'Angiviller, un nouvel effort pour réglementer la grande et petite voirie à Versailles (déclaration du 12 juillet 1779), malgré l'étiolement de l'autorité royale et l'opposition violente du Parlement criant à l'attentat contre le droit de propriété. Il est ainsi institué une sorte de permis de construire et l'on fixe sévèrement l'élévation des maisons nouvelles à huit toises (15,60 mètres). Le départ de la famille royale, le 5 octobre 1789, et la Révolution plongent Versailles dans une époque de désarroi. Quand Bonaparte prend le pouvoir en 1800, la ville ne compte plus que 27 000 habitants (33). Structuration et essor du quartier des Chantiers au 19e siècle L'isolement du quartier des Chantiers fut accentué par deux circonstances aggravantes. La première est l'abandon progressif, entre 1700 et 1740, de la large allée de Montbauron, qui prive la ville d'une voie de communication directe entre les avenues de Saint-Cloud, de Paris et de Sceaux. La seconde est l'abandon du projet de boulevard de ceinture de Versailles, élaboré en 1786, qui prévoyait explicitement de réunir les Grand 32 La partie méridionale de la large allée de Montbauron, allée bordée d'arbres joignant l'avenue de Saint-Cloud, l'avenue de Paris et l'avenue de Sceaux et marquant la limite de Versailles sous Louis XIV, a été lotie vers 1740 par les soins de Mallet, l'un des entrepreneurs du Château de Versailles. [Houth, 1980, p. 340] L'Hôtel des Menus Plaisirs au sud de l'avenue de Paris et les écuries de Madame du Barry (ensuite du comte de Provence), remplacées de nos jours par l'hôtel de police au nord de l'avenue de Paris, furent construits sur l'emprise de l'allée de Montbauron, mais pas du même côté de l'allée. Ceci explique le déhanchement que l'on observe entre l'actuelle rue de Montbauron et la rue de l'Assemblée Nationale. 33 Sources croisées pour les paragraphes précédents et le suivant : Breillat, 1973, p. 15, 28, 31, 57, 63 ; Castex et al., 1980, p. 88, 177, 184 ; Castex, Nuit du Patrimoine, 1999 ; Damien et Lagny, 1980, p. 17-18 ; Dossier de Création de la ZAC, 2003, p. 21 ; Evrard, 1935, p. 150 à 157 ; Gaxotte, 1974, p. 84 ; Houth, 1980, p. 266-269 ; Lemoine, 1955, p. 266 ; Levron, 1981, p. 89-90 ; Maroteaux, 2000, p. 19, 140, 149, 165 ; Versailles Magazine, jan. 1982, p. 2, 3 ; Versailles Magazine, nov.-déc. 1995, p. 24 ; Versailles Magazine, jan.-fév. 2000, p. 16 ] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 39
- 40. Chapitre 2. La constitution d’un quartier et Petit Montreuil à Versailles par une nouvelle enceinte bordée d'un boulevard et de nouvelles avenues, qui seraient tracées pour la commodité et pour l'embellissement des abords de la ville. Il aurait donné à la ville l'unité qui lui manquait. Hélas, le délabrement des finances royales ne permet pas d'y donner suite. La seule voie de communication directe entre le Petit et le Grand Montreuil demeure donc la rue de Vergennes (appelée à cette époque rue du Petit-Montreuil). En 1783, elle est décrite comme impraticable par temps de pluie et pendant tout l'hiver; elle sera pavée cette année-là avec l'aide financière du Domaine (34). Aussi le développement du quartier s’organise-t-il tant bien que mal, principalement le long de la rue des Chantiers, créée en 1734 (ou en 1736, selon les sources) et qui mène de Versailles à Sceaux et, au-delà, à Fontainebleau. Le tracé de cette rue emprunte un ancien chemin qui existait à l'époque de Louis XIV, appelé chemin ou route de Versailles à Sceaux ou chemin de Fontainebleau, qui menait à des entrepôts et débits de bois de chauffage mais ne débouchait pas sur l'avenue de Paris. Cette nouvelle rue ne tarde pas à faire partie des grandes voies de communication du Royaume (35). Dès 1773, elle est pavée et éclairée, d'abord par des lanternes pendant au centre d'une chaîne tendue entre deux murailles dans le sens de sa largeur, puis par des réverbères accolés aux maisons et portant ces lanternes au bout d'un bras à angle droit (36). Elle s'appelle déjà rue des Chantiers avant la Révolution de 1789. Au milieu du 19e siècle, le tissu urbain du quartier des Chantiers est bouleversé par la tranchée du réseau de chemin de fer menant à l'actuelle gare de Versailles-Rive-Gauche, inaugurée en 1840. Pour franchir cette tranchée, la rue de Vergennes est partiellement surélevée. Un autre bouleversement est la création de la gare Versailles-Chantiers. Les années 1850 marquent un tournant dans l'évolution du quartier. Comme tous les faubourgs, il est façonné par la civilisation industrielle. De petits entrepreneurs s'installent dans les discontinuités et les arrière-cours, attirant une population laborieuse. La création du chemin de fer ne transforme pas Versailles en ville industrielle mais elle est à l'origine de l'essor du quartier des Chantiers, amplifié après 1860, et encore plus après 1875 (37). Le train amène des foules de bourgeois parisiens fortunés et aisés le dimanche au Château et aux hippodromes de Satory et de Porchefontaine (ouverts en 1836 et 1864). Des milliers de visiteurs viennent assister aux Grandes Eaux et au feu d'artifice qui couronne les fêtes (38) A partir de 1850, les pressions politiques se multiplient pour ouvrir la banlieue aux couches populaires. Concentrées dans les quartiers de l'est parisien et près des « barrières », celles-ci ont des conditions de logement souvent insalubres, qui s'aggravent de plus en plus en raison de la constante densification de la capitale où, par ailleurs, les loyers ne cessent d'augmenter. 34 A cette époque, le pavage était partagé entre le Domaine Royal et les particuliers, d'où une source constante de conflits. [Lemoine, 1955, p. 267]. Sources croisées : Maroteaux, 2000, p. 189 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999 ; Versailles Magazine, jan. 1982, p. 3 ; Versailles Magazine, nov.-déc. 1995, p. 24 35 Sources croisées pour les paragraphes précédents : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 20, 22, 66- 67 ; Helle, 1969 T. 1, p. 147 ; Le Roi, 1868 T. 2, p. 398, 451 ; Neuf, oct. 1991, p. 6 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999 ; Versailles Magazine, jan.-fév. 2000, p. 19 36 Helle, 1969 T. 1, p. 147 ; Le Roi, 1868 T. 2, p. 398 37 Versailles s'était endormie avec le départ du Roi et la fin de la monarchie. Outre l'arrivée du chemin de fer, la guerre de 1870 et la Commune de 1871 jouèrent un rôle décisif dans son réveil. Le transfert du Gouvernement et des Assemblées à Versailles - elles y siégèrent jusqu'en 1879 - redonna à la ville une importance qu'elle avait perdue. [Castex et al., 1980, p. 190] 38 Un Guide de 1821 précise que Versailles attire, dès cette époque, "plus de dix à douze mille personnes tous les jours", et "lorsqu'on fait jouer les Eaux du Parc, plus de 150 000 viennent à Versailles". [cité par Breillat, 1973, p. 114] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 40
- 41. Plan de Versailles en 1900, transformée par l’arrivée des réseaux de chemin de fer [archives municipales] Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 41
- 42. Chapitre 2. La constitution d’un quartier De 1855 à 1866, la population de Versailles passe de 35 000 habitants à 44 000 habitants. Artisans, petits commerçants, ouvriers dont beaucoup venus de Bretagne, s'installent à proximité de la gare des Chantiers, qui est agrandie en 1880 (39). Dans le quartier, on continue à construire comme on peut, sans ordre ni plan, des pavillons, des immeubles modestes, des entrepôts, des hangars. Des équipements publics sont édifiés dans un esprit charitable pour venir en aide aux populations démunies: construction et plus tard agrandissement de l'église Sainte-Elisabeth de Hongrie, une école de garçons, une école de filles, et un asile. Après la misère, et l'abandon dont il sort peu à peu, le quartier des Chantiers connaît plus que d’autres les transformations de la vie moderne. Comme il dispose encore de terrains, on y construit ce qu'on ne sait où placer : logements ouvriers, casernes, cimetière, stade, école professionnelle, hospices, etc. Au début du 20e siècle, le trafic ferroviaire s'intensifie. On construit de nouvelles voies, on allonge et multiplie les quais de la gare des Chantiers en 1919. Puis, en 1932, on reconstruit la gare (40). En 1935, la partie de la rue des Chantiers comprise entre l'avenue de Paris et l'actuelle place Raymond-Poincaré est débaptisée et renommée rue des Etats-Généraux (ceci provoque évidemment un changement de numérotation dans la partie subsistante de la rue des Chantiers). La nouvelle rue des Etats-Généraux est précisément la seule partie de la longue artère aboutissant au Pont Colbert qui a porté le nom de rue des Chantiers au 18e siècle. Elle allait alors de l'avenue de Paris à la croix de Noailles. Elle prenait ensuite le nom de « rue du Chenil-Dauphin » jusqu' environ l'actuelle place Raymond- Poincaré. En 1793, réunie à cette seconde partie où se trouvaient les bâtiments de la vénerie (41) de Louis XV, elle est rebaptisée « rue du Contrat Social » mais reprend son ancien nom dès 1804. La barrière de Versailles qui se trouvait au droit de la rue de Noailles est reportée au bas de la butte du Pont Colbert lors du rattachement de Montreuil à Versailles le 1er janvier 1787. C'est à cet endroit qu'avaient lieu les exécutions capitales après la Révolution (42). 39 Sources : Dossier de Création de la ZAC, 2003, p. 21 ; Levron, 1981, p. 154, 157 ; Mille-Feuilles de la Mémoire, 2005, p. 167 ; Rapport de Présentation du PLU, 2004, p. 38 ; Versailles Magazine, jan. 1982, p. 3 ; Versailles Magazine, fév.-mars 1998, p. 10 à 13 40 Source pour les paragraphes précédents : Versailles Magazine, jan. 1982, p. 3 41 Autrefois, la vénerie était l'administration des officiers des chasses, et aussi le lieu où on logeait les officiers et l'équipage de chasse. 42 Sources croisées : Chaplot et Dutrou, 1998, p. 67 ; Coll., 1950, p. 4 ; Helle, 1969 T. 1, p. 147-148 ; Houth, 1980, p. 388 ; Le Roi, 1868 T. 2, p. 398, 451 ; Neuf, oct. 1991, p. 6 ; Rojat-Lefèbvre, Nuit du Patrimoine, 1999 Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 42
- 43. Chapitre 3. Une ville, trois gares Chapitre 3. Une ville, trois gares (Responsables: Philippe de Logivière, Albert Dubalen et Jacques Royen) Versailles a toujours été « l’enfant chéri du train ». Dès 1849, alors que la population était retombée à 25000 habitants, la ville dispose de trois gares: Versailles-Rive-Droite (1839), Versailles-Rive-Gauche (1840) et, enfin, Versailles-Chantiers (1849). La création de ces trois gares s’inscrit dans l’histoire, plus large, de la construction des réseaux de chemin de fer en France. Chacune de ces gares a ses particularités et notamment celle des Chantiers, dont nous retracerons ici plus précisément l’historique. 3.1 Le train, une chance pour Versailles Les chemins de fer apparaissent en France dans la région de Saint-Etienne, entre 1821 et 1830. En 1855 les grandes lignes étaient bien ébauchées et reliaient Paris aux principales villes (Cf. page suivante : Plan des réseaux de chemins de fer en 1851). Jusqu’en 1832, seules étaient transportées des marchandises par chemins de fer; puis sont venus les transports de personnes, succédant aux déplacements par diligences. Au début, les chevaux tiraient les wagons; en effet, la conception du train comme nouveau moyen de transport a germé chez les ingénieurs bien avant que des locomotives efficaces aient pu être mises au point. Les principaux états d’Europe se sont équipés simultanément, ainsi que les Etats-Unis. Le mouvement, assimilé à une révolution pacifique, a été gigantesque. Les travaux nécessités par la mise en place des voies et des gares furent à la mesure de ce qu’annonçait la civilisation industrielle en voie de croissance. A titre d’exemple, l’édification de la voie de Saint-Étienne à Lyon a nécessité l’édification des tunnels de Terrenoire, Rive-de-Gier et Lyon. Les industries du bois (wagons), du béton (ponts, tunnels), et de l’acier (rails, locomotives), ont pris un essor vigoureux, compte tenu notamment que les locomotives à vapeur ont commencé à apparaître fin 1829. Avant l’avènement de ces réseaux de chemin de fer, les transports de personnes ou de marchandises se faisaient par la route, donc par petites unités. Le train a généré de vives réactions, en raison: - des conséquences sur les transports traditionnels et des emplois correspondants; - des expropriations nécessaires; - des conséquences supposées, et non connues en fait, sur la santé des personnes; - des modifications du paysages par la construction des gares, des lignes de chemins de fer, des ponts, des tunnels (non éclairés) et de tous les terrassements nécessaires (1). La majeure part de ces aspects a été largement exposée au moment des débats qui ont précédé les prises de décisions relatives, notamment, à la construction de la première gare de Versailles-Chantiers et des lignes correspondantes. Dans ce vaste débat Versailles a eu un sort particulier, puisque hors Paris, elle a été ville royale. Son urbanisme a eu donc un aspect spécifique, qui la marque encore au plus haut point. 1 A cette époque, le pavage était partagé entre le domaine et les particuliers, d’où une source constante de conflits (Lemoine, 1955, p. 267). Sources croisées : Maroteaux, 2000, p. 189 ; Rojat-Lefèbvre, Nuits du Patrimoine, 1999 ; Versailles Magazine, nov.- dec.1995, p. 24. Versailles, le quartier des chantiers et son histoire. Rapport de recherche UIA, octobre 2008 / 43
