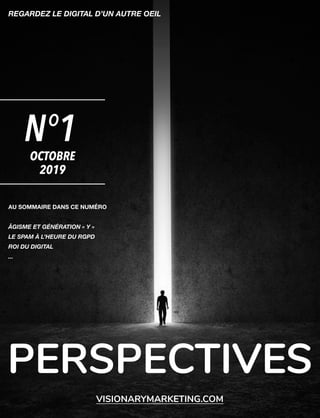
Perspectives - livre blanc - numero 1 - un autre regard sur le digital
- 1. VISIONARYMARKETING.COM REGARDEZ LE DIGITAL D’UN AUTRE OEIL N°1 OCTOBRE 2019 AU SOMMAIRE DANS CE NUMÉRO ÂGISME ET GÉNÉRATION « Y » LE SPAM À L’HEURE DU RGPD ROI DU DIGITAL ... PERSPECTIVES
- 2. i PERSPECTIVES JETER UN REGARD NEUF SUR LATECHNOLOGIE DEPUIS 2004 NOUS AVONS POUR AMBITION DE JETER UN REGARD AVISÉ SUR LA TECHNOLOGIE, SANS LA DÉIFIER NI LA DIABOLISER. NOTRE BUT EST DE VOUS DONNER LES CLÉS POUR DÉCODER L’INNOVATION AVEC UN MAXIMUM DE DONNÉES TANGIBLES ET DE RÉFÉRENCES PRÉCISES. RETROUVEZ-NOS ANALYSES SUR VISIONARYMARKETING.COM/BLOG PARCE QUE LE MONDE DE LA TECH A BESOIN DE POINTS DE VUE UNE NOUVELLE SÉRIE PAR VISIONARY MARKETING
- 3. Autopsie d’un SPAM du social selling à l’heure du RGPD 3 Data Science - Ethique et Science des données sont indissociables 6 Éthique des données - ne pas laisser IA et Big Data aux mains des experts 10 Paradoxe de Solow - le ROI du digital est-il vraiment en question ? 14 Innovation : on ne change que quand il y a des enjeux de survie 18 PERSPECTIVES VISIONARYMARKETING.COM
- 4. 01 AUTOPSIE D’UN SPAM DU SOCIAL SELLING À L’HEURE DU RGPD 3 PAR YANN GOURVENNEC @YGOURVEN
- 5. SPAM ? VOUS AVEZ BIEN DIT SPAM ?! Spam, spam spam ! Disait un certain sketch ( réalisé par Spam Michael Spam Palin et Spam John Spam Cleese). Cela fait un moment que je râle contre les social casse-pieds. Mais voilà : je viens de recevoir le mail de trop, le smiley qui fait déborder le vase. C’est la dernière relance de John Doe*, qui est peut-être, sans doute même, un robot, même si son n° de téléphone est bien réel. Dans l’exemple suivant, j’ai changé volontairement le nom de la société et du casse pied en question. Il est bien possible que si j’avais laissé le numéro de téléphone et son e-mail, cela lui aurait servi de leçon et qu’il s’en serait souvenu un bon moment. Mais on ne se change pas, l’éthique est très importante pour moi. Il n’en est pas de même pour tout le monde. En 2019, il n’est même plus question d’éthique, vu qu’il s’agit d’un règlement. Le règlement dit RGPD, pour lequel la moitié de la terre vous a déjà cassé les pieds jour et nuit depuis le mois de mai 2018 en vous répétant que, jamais au grand jamais, les choses ne seraient plus comme avant. Mais c’était sans compter sur les social casse-pieds qui ne sont ni en manque d’outils ni de ressources. Je me suis donc livré à une petite analyse à chaud d’un message que j’ai ponctué de mes commentaires en italic. *selon la formule consacrée les noms ont été changés Autopsie d’un message non sollicité issu du social selling Voici donc le spam incriminé.Il commence bien,avec un accès de familiarité qui ne sied guère de ce côté-ci de la Manche où on aime bien garder ses distances.Autant cela ne me choque pas en anglais car au RU on a l’habitude de se faire appeler par son prénom y compris au téléphone,ici cela ne se fait pas vraiment. Bonjour Yann, Dernière tentative pour rentrer en contact avec vous :-) Alors là le smiley est vraiment de trop d’ailleurs je ne me souviens absolument pas de ce message qui de toute façon a dû basculer dans la boîte à spam,endroit dont il n’aurait jamais dû sortir.Mais la bonne nouvelle c’est que c’est bientôt fini. 4
- 6. Êtes-vous intéressé d’échanger rapidement pour discuter de vos challenges et vous montrer comment notre logiciel, basé sur les données, peut vous aider à surpasser vos performances marketing ? une question ouverte par e-mail, encore une erreur Je serai très heureux de savoir si nous pouvons vous apportez une réelle valeur ajoutée. erreur de temps (conditionnel) et je suis heureux de savoir qu’il sera heureux Cordialement, John Doe — John Doe Business Development Manager Annoying Company GMBH même si j’ai masqué le nom de l’entreprise, il s’agit d’une entreprise allemande. Oui ! Vous avez bien lu une entreprise d’outre-Rhin, pays où la conscience relative à la propriété des données personnelles est particulièrement élevée pour des raisons historiques que l’on comprend très bien. Mais voilà que soit sa filiale française est beaucoup moins à cheval sur les principes, soit que la posture germanique n’est en fait qu’une posture. Some place in France +33 6 XX XX XX XX annoying.ai Vous remarquerez que l’extension de nom de domaine de notre casse-pieds est .ai car notre homme est très à la mode.En outre,il utilise son propre viatique pour nous casser les pieds. Problème, ce qu’il appelle intelligence artificielle n’est que de la bêtise naturelle. Nous avons collecté vos informations depuis LinkedIn et les avons utilisé sur la base d’intérêt légitime. Etant donnée la valeur que nous avons apporté à d’autres entreprises similaires dans le passé, je suis convaincu que notre offre est bénéficiaire pour vous car vous représentez notre profil client type. Si vous pensez que notre logiciel ne vous apportes pas de valeur et que vous ne voulez plus recevoir d’emails de ma part, tenez moi informé et je vous retirerai de la base de donnée. Oublions la faute de grammaire sur l’accord du participe passé. Au moins les choses sont claires, mes données ont été volées de LinkedIn (« scraping »). Conclusion de l’affaire, je sais que je peux retirer ce casse-pieds de mon réseau. Là où ça devient plus drôle, c’est qu’on me précise qu’il s’agit d’une « base d’intérêt légitime ». Expression bizarre et en outre je l’aurais mise au pluriel. Mais bon, ce sont des Allemands, soyons bons princes. Et par ailleurs, comme tout le monde le sait,le RGPD se préoccupe beaucoup de l’« intérêt légitime »(probablement une mauvaise traduction) des clients finals. Quand je vous dis que le respect de ce règlement est pour le moins folklorique, je ne mens pas, en voici la preuve en exemple. Suit une flopée de mails plus énervants les uns que les autres que je vous laisse en pâture afin de vous amuser. Vous remarquerez que le robot, à la différence des hommes, ne se lasse jamais d’envoyer et de renvoyer et de casser et de recasser les pieds.Avant d’utiliser ce type de solution, je vous conseille de réfléchir trois fois au moment de cliquer. En tout cas, cette solution de marketing automation ne s’est pas vendue d’elle- même,même sur un« profil type à intérêt légitime ».Il s’agit d’un vulgaire canon à spam qu’il convient immédiatement de mettre hors d’usage car, RGPD ou non, il n’est de toute façon d’aucune efficacité commerciale. 5
- 7. ` 02 DATA SCIENCE - ETHIQUE ET SCIENCE DES DONNÉES SONT INDISSOCIABLES 6 PAR LEE SCHLENKER @LEESCHLENKER
- 8. La force combinée des données et des technologies de l’information fait progresser l’innovation dans presque tous les domaines de l’entreprise humaine. De la même manière, la Data Science [NDT: je garderai ici le terme anglais de Data Science que je ne peux traduire par l’expression littérale « Science des Données », même si le sens en est exact] influence aujourd’hui profondément la manière dont le monde des affaires évolue dans des domaines aussi divers que les sciences de la vie, les Smart Cities et les transports. Aussi convaincantes que soient devenues ces avancées, les dangers de la Data Science sans considérations éthiques sont tout aussi évidents – qu’il s’agisse de la protection de données personnellement identifiables, de la partialité implicite dans la prise de décision automatisée, de l’illusion du libre choix dans le rapport à la segmentation démographique, des impacts sociaux de l’automatisation ou du divorce évident entre confiance et réalité dans la communication virtuelle. Justifier la nécessité de mettre l’accent sur l’éthique de la Data Science va au-delà d’une simple observation de ces opportunités et de ces défis, car la pratique de la Data Science remet en question notre perception de ce que signifie d’être humain. Cette contribution a été inspirée par la remarquable contribution de Julie Compagny dans un article qu’elle a écrit pour Digital Me Up. Digital Me up est le blog de nos étudiants du Master Spécialisé international en Stratégie Numérique (Digital Business Strategy) de Grenoble Ecole de Management, où j’enseigne. Julie en est l’une des étudiantes de l’année académique 2018-2019. La Data Science influence les pratiques commerciales d’aujourd’hui Si l'éthique est définie comme des valeurs partagées qui aident l'humanité à différencier le bien du mal, la numérisation croissante de l'activité humaine façonne les définitions mêmes de la façon dont nous évaluons le monde qui nous entoure Margo Boenig-Liptsin souligne que notre recours croissant à la technologie de l’information a fondamentalement transformé les concepts traditionnels de « confidentialité », « équité » et de « représentation », sans oublier celui de « Libre choix », « vérité » et « confiance » . Ces mutations soulignent l’empreinte et les responsabilités croissantes de la Data Science — et pas seulement en termes de 0 et de 1 — car la Data Science ébranle les fondements perceptuels de la valeur, de la communauté et de l’équité. Si les universités ont rapidement mis en place des programmes de Data Science axés sur les statistiques, le calcul et le génie logiciel, peu de programmes répondent aux préoccupations sociétales plus vastes de la Data Science. Moins nombreux encore sont ceux qui analysent la façon dont les pratiques responsables en matière de données peuvent être conditionnées et même encouragées. Décrivons en grandes lignes ce défi qui se présente à nous. Citoyens au royaume de la Data Science Peut-être aucun des domaines de l’éthique liés à Data Science n’a retenu plus d’attention que la protection des données personnelles. La transformation numérique de nos interactions avec les communautés sociales et économiques révèle qui nous sommes, ce que nous pensons et ce que nous faisons. L’ introduction récente de la législation en Europe (RGPD), en Inde (loi sur la protection des données personnelles de 2018 – « Personal Data Protection Act »), et en Californie (« California Consumer Privacy Act » de 2018) reconnaissent spécifiquement les droits des citoyens numériques et abordent implicitement les dangers de l’utilisation commerciale de données personnelles et personnellement identifiables. Ces cadres juridiques tentent de rééquilibrer les relations inégales en termes de pouvoir et d’influence entre les organisations et les individus au travers de la codification de critères éthiques, notamment le droit à l’information, le droit de s’opposer, le droit d’accès, le droit de rectification et le droit à l’oubli. L’attention accordée à cette législation va bien au-delà des préoccupations liées à la protection des données. Ces tentatives de définition de pratiques appropriées et illicites en matière de données répondent à un certain nombre de questions éthiques. À mesure que les données deviennent la nouvelle monnaie d’échange de l’économie mondiale, les frontières entre public et privé, entre individus et société, et entre riches et pauvres sont en train d’être redessinées. Qui est propriétaire des données personnelles et quels droits peuvent être attribués avec un consentement explicite ou implicite ? Dans quelle mesure les organisations publiques et privées devraient-elles être capables de collecter et de contrôler les vastes archives de nos interactions humaines ? 7
- 9. Dans quelle mesure ceux responsables du contrôle et du traitement des données devraient-ils être tenus pour responsables de la perte ou de la mauvaise utilisation de nos données ? Prise de décision automatisée La capacité à prendre des décisions en toute conscience entre différentes possibilités a longtemps été considérée comme une condition qui sépare l’homme (ou du moins le vivant) des machines. À mesure que les innovations en science des données progressent dans le commerce algorithmique, les voitures autonomes et la robotique, la distinction entre intelligence humaine et intelligence artificielle devient de plus en plus difficile à distinguer. Les applications actuelles de l’apprentissage automatique franchissent le seuil des systèmes d’aide à la décision et entrent dans le domaine de l’intelligence artificielle où des algorithmes sophistiqués sont conçus pour remplacer la prise de décision humaine. Le franchissement de ce seuil introduit plusieurs considérations éthiques. Les organisations économiques et/ou sociales peuvent-elles s’appuyer sur des méthodologies de plus en plus complexes dans lesquelles beaucoup ne comprennent ni les hypothèses ni les limites des modèles sous-jacents ? Sommes-nous disposés à accepter le fait que ces applications, qui de par leur nature même, tirent les leçons de notre expérience – nous rendent prisonniers de notre passé et limitent notre potentiel de croissance et de diversité ? Comprenons-nous que la logique inhérente à ces plateformes peut être mise en jeu – ce qui crée des opportunités pour «tricher» avec le système ? Enfin et surtout, qui est légalement responsable du biais implicite inhérent à la prise de décision automatisée ? Micro-ciblage et Data Science Ethique John Battelle a suggéré il y a plusieurs années que nos empreintes numériques vont fournir des feuilles de route indélébiles à travers la base de données de nos intentions. Le leitmotiv de la Data Science a été d’aider les organisations à comprendre les objectifs, les motivations et les actions des individus et des communautés. Les travaux de Michal Kosinski et David Stillwell ont été encore plus prometteurs en suggérant que la pertinence de l’analyse prescriptive peut être grandement améliorée e n s e c o n c e n t r a n t s u r l e s m o d è l e s d e comportement (traits de personnalité, croyances, valeurs, attitudes, intérêts ou modes de vie) plutôt que des grappes de données démographiques. Les applications du micro-ciblage ont depuis été présentées comme de puissants outils d’influence dans les domaines du marketing, de la politique et de l’économie. 8
- 10. Même si la capacité d’un individu à exercer le «libre choix» a longtemps fait l’objet de débats, la pratique consistant à ne fournir aux consommateurs que des informations avec lesquelles ils seront d’accord pousse le bouchon encore plus loin. De plus, les techniques de micro-ciblage permettent aux chercheurs d’extrapoler des informations sensibles et les préférences personnelles des individus même lorsque ces données ne sont pas capturées de manière spécifique. Enfin, lorsque le «client devient le produit», il existe un risque réel que la Data Science soit moins utilisée pour améliorer l’offre de produits ou de services d’une entreprise que pour transformer les consommateurs en objets de manipulation. Registres distribués éthique et Data Science Les technologies de l’information ont longtemps eu pour objectif de fournir une version unique de la vérité afin de faciliter les échanges de produits, de services et d’idées. Pour un certain nombre de raisons liées à l’évolution de l’économie mondiale et des marchés nationaux, un fossé de perception s’est creusé entre cette vérité du terrain et la confiance des consommateurs dans les intermédiaires (comme l’État, les banques et les entreprises) qui captent, collectent et monétisent ces données. Les mécanismes sociaux du World Wide Web déforment encore plus la relation en mettant sur un pied d’égalité la réalité et la fiction, favorisant les extrêmes au point de leur donner l’apparence banale de la normalité. En principe, les technologies de registre distribué, et les technologies de Blockchain en particulier, sont une lueur d’espoir en vue de la mise à nu d’une plus grande transparence et d’une meilleure traçabilité dans les sources d’informations. Pourtant, cette vision d’un Internet amélioré est partiellement assombrie par les défis sociétaux potentiels de technologies largement non testées. La technologie en soi peut-elle être la norme en matière de vérité et de confiance ? Dans quelle mesure les personnes et les organisations accepteront-elles la primauté de la transparence ? Sur quelle base les valeurs sociales — comme le droit à l’oubli — peuvent-elles être conciliées avec les exigences techniques des registres publics ? Libérée des conventions et de la logique du capitalisme financier, la nature humaine peut-elle accepter une base radicalement différente pour la répartition de la richesse ? Intelligence humaine et machine Bien que l’impact des technologies de l’information sur l’organisation des entreprises privées et publiques a été largement débattu au cours des quatre dernières décennies, l’impact de la Data Science sur la gestion des entreprises a fait l’objet de beaucoup moins d’attentions. Dans la presse spécialisée, la technologie est souvent considérée comme éthiquement neutre, constituant un miroir numérique des paradigmes de gestion dominants à tout moment. Dans le monde universitaire, les relations sont soumises à un examen plus approfondi. Des auteurs tels que Latour, Callon et Law ont montré comment différentes technologies influent sur la manière dont les gestionnaires, les employés et les clients perçoivent la réalité des échanges sociaux et économiques, des marchés et des secteurs économiques. En se concentrant sur la Data Science, ces préoccupations relatives au contexte mettent en lumière leurs propres considérations éthiques. Si les données ne sont jamais objectives, dans quelle mesure la direction doit-elle comprendre le contexte dans lequel les données ont été collectées, analysées et transmises ? De même, les algorithmes étant de plus en plus répandus et complexes, dans quelle mesure les gestionnaires doivent-ils appréhender leurs propres hypothèses et leurs limites ? Comme les applications assument des rôles de plus en plus importants dans les processus métier clés, dans quelle mesure faut-il définir la gestion en fonction de la coordination des agents humains et virtuels ? Vu sous un autre angle, à mesure que l’intelligence artificielle évolue, quelles fonctions de gestion devraient être déléguées aux robots et lesquelles devraient être réservées aux humains ? 9
- 11. ` 03 ÉTHIQUE DES DONNÉES - NE PAS LAISSER IA ET BIG DATAAUX MAINS DES EXPERTS 10 PAR LEE SCHLENKER @LEESCHLENKER
- 12. La plupart des universités du monde proposent des cours sur la science des données, le machine learning et l’intelligence artificielle. N’est-il pas temps d’ajouter l’éthique des données à l’ordre du jour, à une époque où des géants de la technologie comme Facebook et Google – pour n’en nommer que quelques-uns – sont devenus des cibles familières pour le manque de respect envers les données de leurs utilisateurs ? Ou du moins pour leur incapacité à empêcher que de telles données ne soient volées par des acteurs externes comme le tristement célèbre Cambridge Analytica. Quelle est l’importance de l’éthique des données Quelles questions doivent être abordées,quels thèmes doivent être explorés et comment la matière peut-elle être enseignée efficacement ? L’éthique des données implique l’étude et l’adoption de pratiques, d’algorithmes et d’applications qui respectent les droits fondamentaux des personnes et les valeurs de la société. L’importance des données dans les économies modernes se fait chaque jour plus évidente. Toutefois le succès, non seulement dans le domaine scientifique mais aussi dans le monde des affaires et pour la société en général, dépend de la connaissance des données existantes et de ce qu’elles représentent. Il n’est pas étonnant que les universités du monde entier proposent aujourd’hui des spécialisations en data science, en machine learning et en intelligence artificielle. Pourtant, laisser la data science aux seules mains des experts serait faire preuve à la fois de myopie et d’ignorance des dangers, tant les entreprises publiques et privées s’appuient de plus en plus sur l’analyse des données pour surveiller et évaluer presque tous les aspects de notre vie quotidienne. L’éthique des données se limite-t-elle aux préoccupations concernant les escroqueries par courriel,l’utilisation abusive du microciblage et l’immoralité des fermes de trolls ? Les universitaires de Cambridge ont monétisé leur recherche de données psychométriques pour prédire et influencer les préférences comportementales. Facebook a ainsi délibérément influé sur les timelines de sept cent mille de ses utilisateurs sans leur consentement. Amazon a continué à commercialiser agressivement son outil de reconnaissance faciale Rekognition en dépit des interrogations sur la vie privée et les biais d’usage. Les tribunaux recourent à des algorithmes pour établir le profilage des condamnés en termes de « risque » en fonction de la couleur de leur peau à chaque étape de la procédure judiciaire. Les employeurs recrutent à l’aide d’algorithmes qui, par nature, favorisent certains groupes socioéconomiques. Les applications de la science des données ne peuvent pas être rejetées comme étant simplement “business as usual” , car leurs conséquences éthiques conditionnent l’avenir des entreprises et de la société. Quels types de problèmes essayons-nous de résoudre… Lorsque l’on met en œuvre les techniques de la science des données pour automatiser des processus, interpréter des données sensorielles, maîtriser des relations c o n c e p t u e l l e s o u i n flu e n c e r l a d y n a m i q u e environnementale ? L’intelligence artificielle (IA) peut être distinguée de l’apprentissage automatique ou Machine Learning (ML) en comparant ses objectifs, ses méthodes et ses applications. De par sa nature même, l’apprentissage automatique s’est historiquement concentré sur la production de nouvelles connaissances, alors que l’IA vise à remplacer l’intelligence humaine. L’apprentissage par la machine utilise des algorithmes pour améliorer l’apprentissage supervisé, non supervisé ou renforcé, et l’IA utilise des algorithmes pour reproduire le comportement humain. Les scientifiques des données déploient l’apprentissage machine pour mieux comprendre les tendances des données, ils espèrent que l’intelligence artificielle apportera la réponse à des problèmes complexes. Si l’objectif du Machine Learning est d’améliorer notre capacité à prendre de meilleures décisions, celui de l’IA est de fournir la solution optimale. Les implications éthiques de la science des données dépendent des objectifs, des pratiques et des applications de chaque organisation. 11
- 13. L’éthique des données est-elle un sujet plus vaste que l’intelligence artificielle elle-même ? Si la portée de l’intelligence artificielle est difficile à mesurer, son impact sociétal s’étend bien au-delà de la simple tentative de “faire quelque chose d’utile avec le marécage croissant de données” à notre disposition. Les données ne sont-elles que de la technologie, l’IA peut-elle être réduite à une forme de logique expérimentale conçue pour guérir les maux de la vie moderne ? Parce que l’intelligence artificielle reflète les visions, les préjugés et la logique de la prise de décision humaine, nous devons examiner dans quelle mesure l’intelligence artificielle peut être isolée des grands défis économiques et sociaux pour la résolution desquels elle a été conçue. De nouveaux enjeux comme la protection de la vie privée, l’engagement du public à l’égard des données, les paramètres pertinents pour évaluer le progrès humain et la relation entre les données et la gouvernance suggèrent que les données conditionnent la façon dont nous voyons et évaluons le monde qui nous entoure. Si les données ont peu de valeur tant qu’elles ne sont pas utilisées pour comprendre les actions décisives, l’éthique des données doit se concentrer moins sur les données et sur les algorithmes qui ont un impact sur la rationalité limitée qui définit les décisions humaines. En somme, comme le suggèrent les partisans de la science ouverte, il n’y a pas d’opposition binaire entre données et action, seulement des interactions entre interventions et contextes. Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous suivons la voie de l’éthique des données, soit nous choisissons l’autre voie qui nous conduit à plus de vols de données et à moins de respect pour les utilisateurs. Cette question est vitale pour le monde numérique. Quelles sont les matières qui doivent être abordées dans un programme d’études sur l’éthique des données ? Comme l’illustrent les initiatives prises en Europe, au Brésil, en Inde, à Singapour et en Californie, les questions relatives aux renseignements personnels identifiables, au consentement explicite, ainsi qu’aux droits d’accès, de rectification et d’oubli doivent toutes être examinées. 12
- 14. Les biais implicites devraient aussi figurer dans les priorités ainsi que la compréhension de la manière dont les attitudes et les préjugés influencent notre compréhension des données, de la cognition, de la logique et de l’éthique. Les questions de gouvernance entourant la transformation numérique pourraient être analysées, y compris la manière dont les managers et les organisations auxquelles ils appartiennent, s’emparent des données et en sont responsables. L’impact de la technologie sur les processus de décision devrait également être discuté, car notre recours aux données a modifié en profondeur les définitions traditionnelles de “liberté de choix”, “vie privée”, “véracité” et “confiance”. Enfin, la compatibilité entre intelligence artificielle et innovation peut être examinée : notre recours au scientisme déprécie d’autres formes d’intelligence humaine, notamment l’intelligence émotionnelle (interpersonnelle), linguistique (intelligence des mots), intrapersonnelle (connaissance de soi) et spirituelle (existentielle). Enfin,comment et où enseigner l’éthique des données ? Comme point de départ, Rob Reich suggère que tous ceux qui sont formés pour devenir technologues devraient posséder un cadre éthique et social leur permettant de réfléchir aux implications de leur travail. Pourtant, comme le démontrent les auditions parlementaires sur l’IA en France et en Allemagne, les étudiants qui se préparent à une carrière en politique publique et dans d’autres domaines gagneraient à mieux comprendre l’impact sociétal des sciences des données. Plutôt que de proposer une liste de choses à « faire et ne pas faire » sur l’éthique des données, il serait préférable de s’inspirer des conséquences éthiques de la résolution de problèmes à partir des données. En l’absence de cette liste universelle des choses à “faire et ne pas faire”, Shannon Vallor soutient que les étudiants doivent acquérir une “sagesse pratique” pour relever les défis éthiques que posent les générations successives de technologies. Si l’éthique des données ne peut sans doute être entièrement appréhendée à l’intérieur d’un seul cours, il est néanmoins possible de mieux l’analyser dans un cadre appliqué à l’étude universitaire et à la recherche dans son ensemble. 13
- 15. ` 04 PARADOXE DE SOLOW - LE ROI DU DIGITAL EST-IL VRAIMENT EN QUESTION ? 14 PAR YANN GOURVENNEC @YGOURVEN
- 16. Le paradoxe de Solow est un incontournable de l’économie de la technologie et de l’innovation et pourtant il est largement ignoré des évangélistes de la modernité technologique. C’est dommage, passons un peu de temps pour voir pourquoi il faut s’y intéresser et se pencher à nouveau sur le sempiternel ROI des innovations technologiques et voir que les choses les plus apparemment évidentes le sont souvent le moins. La mesure du ROI des innovations est une sorte de marronnier, surtout dans le domaine académique. Combien de fois n’ai-je pas entendu, dans les classes des écoles les plus prestigieuses, l’explication toute faite : « l’innovation xxx (remplacez par ce que vous voulez) a échoué du fait d’un manque de ROI ». Souvent d’ailleurs, c’est le cas de la littérature académique, on parlera plutôt de productivité que de ROI. Une preuve que l’on mélange beaucoup de concepts, mais que finalement, il est très peu de véritables métriques qui permettraient de tirer des conclusions crédibles de cette réflexion sur l’impact de la transformation digitale. Paradoxe de Solow : le retour Mc Kinsey a titré sur le paradoxe de Solow, le sous-titre est évocateur : « modernisation digitale (digitization) : pas encore d’impact sur l’augmentation de la productivité ». Tout est dans le « encore ». Dans une récente enquête auprès des spécialistes du marketing, on indique que 16 % seulement des spécialistes du marketing ont déclaré être capables de prouver l’impact quantitatif des médias sociaux sur l’entreprise. Il s’agit là des médias sociaux, mais il est possible d’étendre cette remarque à tout autre type d’innovation. Il est en effet très difficile d’identifier l’impact de ces innovations technologiques, surtout à court terme. Il faut du temps pour cela et même parfois beaucoup de temps. Prenons par exemple le fameux paradoxe de Solow, du nom d’un économiste spécialiste du sujet. Grâce au professeur Yoram Bauman; on sait que le fameux aphorisme de Solow est sorti d’une phrase perdue au milieu d’un article écrit en 1987 dans le NY Book Review. « Ce que cela signifie [NDLR En parlant des auteurs qui estiment qu’il n’y a pas besoin de prouver la véracité de la révolution technologique produite par l’informatique],c’est qu’ils sont quelque peu embarrassés par le fait que ce que tout le monde prend pour une révolution technologique, un changement radical dans nos vies professionnelles,a été accompagné partout, y compris au Japon,par un ralentissement de la croissance de la productivité,et non une augmentation. On peut observer l’ère de l’ordinateur partout sauf dans les statistiques de productivité. » Pourtant, prétendre que l’informatique depuis son avènement (rappelons que l’invention des ordinateurs date des années 40), dans les 70 ans qui nous ont précédés# , n’a rien changé au mode de travail mis à notre productivité seraient une grossière ânerie. Le seul souci, c’est qu’il est très difficile de mettre des chiffres sur cette augmentation de productivité, même avec un changement aussi énorme que celui de l’informatisation de la société. A propos du paradoxe de Solow ou paradoxe de la productivité Poursuivons avec quelques explications tirées du site de l’université de Stanford et traduites par Visionary Marketing : « Le paradoxe de productivité (également appelé paradoxe informatique de Solow) est une observation particulière faite dans l’analyse des processus de gestion: à mesure que l’investissement dans les technologies de l’information augmente, la productivité des travailleurs peut baisser au lieu d’augmenter. Cette observation a été fermement étayée par des preuves empiriques des années 1970 au début des années 1990. Ceci est fortement contre-intuitif. Avant que les investissements informatiques ne se généralisent, le retour sur investissement attendu en termes de productivité était de 3 à 4%. Ce taux moyen découle de la mécanisation / automatisation des secteurs agricole et industriel. Avec l’informatique, le retour sur investissement normal n’était que de 1% entre les années 1970 et le début des années 1990. Un certain nombre de théories proposées ont expliqué le paradoxe de la productivité. Elles vont de l’idée d’une mesure inadéquate de la productivité à la période de latence nécessaire avant que l’on puisse constater des gains de productivité. Jusqu’à récemment, ces explications n’étaient guère plus que des théories, mais bon nombre d’entre elles ont maintenant des preuves irréfutables, en raison d’études démontrant une forte augmentation de la productivité dans les entreprises qui investissent massivement dans l’informatique ». 15
- 17. Ouf, nous voici sauvés, et pourtant le débat fait encore rage parmi les analystes avec le débat entre les sceptiques de l’apport de ROI et les évangélistes, « techno optimistes » contre « techno pessimistes » en quelque sorte. Un certain nombre de points, évoqués dans l’article de Stanford, viennent appuyer l’analyse. Notons les points principaux : D’abord, la définition elle-même du sujet d’analyse. Dans le cadre de l’article de Stanford on parle de l’informatique, dans le cadre de la transformation on parle du « digital ». Si le vocable de « digital » et dans son acception informatique intégrée au dictionnaire français depuis 1961, la définition même du domaine concerné par le digital reste un sujet de discussion. Pour mesurer correctement une « transformation digitale », encore faudrait-il savoir de quel « digital » l’on parle : informatique, informatique connectée, ou même « tout ce qui est fait de zéros et de uns et qui n’est pas de l’informatique » selon la définition d’Hervé Kabla. DIGITAL,ALE,AUX,adj. Qui est exprimé par un nombre,qui utilise un système d’informations,de mesures à caractère numérique. Système digital. (Quasi-)synon. binaire, numérique; (quasi-)anton. analogique. Le traitement des quantités,est effectué,dans un ordinateur digital,par un organe appelé l’unité arithmétique (JOLLEY, Trait.inform., 1968,p.207). Étymol.et Hist. 1961 (Lar.encyclop.).Adj.angl. digital notamment dans digital computer «ordinateur digital »(du subst. digit «doigt»mais aussi«chiffre,[primitivement« compté sur les doigts»]»)«ordinateur employant des nombres exprimés directement en chiffres dans un système décimal, binaire ou autre»d’apr. Webster’s. Fréq.abs.littér.: 6. Par ailleurs, les secteurs auquel s’appliquent ces transformations ne sont pas tous égaux. Entre l’informatisation de l’industrie et celle du tertiaire, un fossé énorme se creuse qui ne pourra jamais être comblé. Comment comparer en effet l’augmentation de productivité due à l’informatique sur une chaîne de production à l’utilisation de l’informatique dans le travail d’un consultant. Quiconque a fait du conseil avant la généralisation de l’informatique personnelle sait de quoi je parle : il s’agit d’un monde entre les deux périodes, et là on ne peut même plus parler de productivité mais de transfiguration du métier. 16
- 18. Comment et au bout de combien de temps dégager un vrai ROI ? Tout business man bien constitué attend un retour sur investissement de ses opérations de transformation digitale. Mais s’il est essentiel de mesurer et de fixer des délais pour ce retour, l’exercice n’est pas simple. Pour Chuck Donnelly, CEO RockStep Solutions « il est essentiel de définir une valeur commerciale claire avec des indicateurs de performance clés pour mesurer vos progrès ». Or, mesurer est difficile et long et chacun doit trouver ses propres critères. Rentabilité à court terme et transformation digitale ne font pas bon ménage. Ce ROI est évidemment différent pour chaque entreprise ou chaque Business Unit. Cap Gemini consulting y a même consacré une étude pour clarifier la méthode : Measure for Measure: The Difficult Art of Quantifying Return on Digital Investments. Dans cette étude, la société de conseil observe que de nombreuses entreprises ont du mal à calculer le ROI pour les investissements numériques. Par exemple, prouver la valeur des initiatives dans les médias sociaux est notoirement difficile même si les organisations font de leur mieux pour trouver un lien entre des mesures telles que le sentiment des clients et la croissance des revenus. Elle précise également qu’une récente enquête auprès des spécialistes du marketing fournit une preuve flagrante de cela. Seulement 16% des spécialistes du marketing ont déclaré avoir été capable de prouver l’impact quantitatif des médias sociaux sur leur entreprise. 17
- 19. 05 INNOVATION : “ON NE CHANGE QUE QUAND ILYA DES ENJEUX DE SURVIE” PAR YANN GOURVENNEC @YGOURVEN
- 20. J’ai assisté le 15 mai au cercle de réflexion des Rencontres Capitales à l’initiative de Laurent Collin de Stonepower partenaire et co-organisateur de ce colloque. Un moment privilégié et enrichissant, qui m'a interpellé, non seulement pour ce qui est des compétences d'orateur et de manager du président de la grande société pétrolière, mais aussi en tant que point de départ sur une réflexion plus globale sur l'innovation, la Société et le futur de l'humanité (rien que ça). Voici mes réflexions, livrées en toute candeur, moi qui ne revendique aucune compétence politique au-delà de celle qui consiste à mettre son bulletin dans l'urne, notamment le 26 mai 2019. Le cercle de réflexion Rencontres Capitales a pour mission de reposer la notion de « progrès » car pour citer les propos d’une des organisatrices, « on pourrait croire que la société aurait le temps de prendre du recul, car nous sommes débarrassés des contraintes matérielles de nos ancêtres, mais il n’en est rien ». Et c’est pour cela que les Rencontres Capitales ont pour but de réfléchir au progrès technologique et à son acceptation. Et l’organisatrice de poursuivre « une Société qui douterait de la Science, est une Société qui douterait d'elle-même ». Avec cette réunion-débat organisée par Rencontres Capitales à l’Académie des Sciences, le provincial que je suis a non seulement découvert cette honorable institution, il a aussi appris que Think Tank se traduisait en français par "Cercle de Réflexion". Encore qu’un cercle aurait plutôt tendance à tourner en rond et que Rencontres Capitales a au contraire pour ambition de nous faire avancer. Prendre du recul par rapport à l'innovation Il s’agissait de la première Rencontre Capitale préparatoire des débats de 2020, nous a-t-on dit, et je remercie Laurent Collin de Stonepower de m’avoir convié à cette réunion prestigieuse qui m’a permis, comme l’a promis l’organisatrice, de prendre du recul sur l’innovation, un exercice trop rare, mais bien utile. Patrick Pouyanné a la modestie des gens d'exception qui sont en haut de l'échelle et semblent s'excuser en se présentant. Polytechnicien et ancien élève de l'Ecole des Mines, il était directeur de cabinet d'un ministre à 32 ans, la voie royale au pays de Colbert. Sa "philosophie reste simple" a-t-il confié à l'assemblée, il s'agit de "regarder la réalité en face et de trouver des solutions". Pour lui, ce parcours semble presque normal, ce qui peut paraître surréaliste à ceux qui, comme votre serviteur, sont toujours restés loin des institutions, même dans une République qui, à cette époque, "faisait encore marcher l'ascenseur social" car ses origines sont modestes. Il est devenu PDG de TOTAL en 2014, à l'issue de la disparition accidentelle de Christophe de Margerie, surnommé affectueusement "Big Moustache" par ses employés. Première leçon d'innovation : "on change plus facilement face à des enjeux de survie" Arrivé à la tête de cette énorme entreprise, fleuron de l'économie française, mais aussi marque décriée et sous les feux roulants des activistes environnementaux et altermondialistes, il a dû immédiatement faire face à un mur d'économies à réaliser. On lui présenta alors une planche PowerPoint avec le nombre des licenciements qu'il fallait effectuer. Cela aurait dû être sa première action en tant que Président de Total. Sa réaction fut tout autre : il jeta la planche à la poubelle, expliqua à ses conseillers que c'était l'ensemble de la société qui devait changer et que faire des coupes sombres dans les effectifs n'allait rien faire pour la transition énergétique. Plusieurs années plus tard, ce pari-là était gagné, plus besoin de faire des plans de départs massifs. Première compagnie à revenir en Iran (un choix qui sera sans doute plus difficile à tenir avec les sanctions américaines), Total se tourne vers l'énergie verte et bizarrement, ce sont les difficultés qui ont rendu cela possible : "Réformer l'entreprise, c'est plus facile quand il y a des enjeux de survie" a dit en substance Patrick Pouyanné. Les Gaulois — et les autres — réfractaires au changement Car même si certains on fustigé les paroles maladroites sur les Gaulois réfractaires, le constat de M. Pouyanné est le même : "Les gens n'aiment pas changer" nous a-t-il confié, un précepte qui va au-delà de la France et des Français soit dit en passant. "Pour être un leader, il faut être courageux". Des paroles que ne renierait pas Nicolas Hulot, pour les idées duquel il me faut dire par transparence, que j'ai des sympathies. En effet, "il y [avait] des décisions qui traînaient depuis des dizaines d'années", il fallait faire quelque chose car "on attend des groupes majeurs comme Total de contribuer à la Société et notamment sur l'insertion professionnelle" a ajouté le PDG de Total. 19
- 21. Un ancien conseiller sur l'environnement pour mener la transition énergétique d'un grand pétrolier Patrick Pouyanné a été conseiller d'Edouard Balladur sur l'environnement et "Total a reconnu le dérèglement climatique dès Thierry Desmaret" a-t-il concédé avant d'avouer "[qu']on a une responsabilité". Mais voilà toute l'équation, d'ailleurs remarquablement mise en contexte par Hulot dans la vidéo ci-dessous : en même temps l'énergie est essentielle au développement économique et qui plus est, "c'est un monde qui évolue constamment". Cette énergie a, selon Patrick Pouyanné, 3 caractéristiques principales : •# Être disponible car encore aujourd'hui, "1 milliard de personnes n'y a pas accès" (certains avancent que c'est peut-être ce qui donne un léger répit à cette pauvre planète) ; •# Être abordable, sinon … nous voyons le résultat depuis 6 mois tous les samedis dans nos rues et sur nos ronds-points (encore un problème selon le point de vue) ; •# Et enfin elle doit être (plus) propre car "on n'a plus le choix" (pour une fois, tout le monde sera d'accord, même si c'est moins une question de propreté que d'impact). En fait, "le pétrole à 100$ a creusé sa tombe" selon le PDG de Total, il a permis de développer des alternatives qui sont rentables. Hallelujah, enfin une bonne nouvelle. "Le problème insoluble de l'espace temps" Le problème c'est qu'on ne sait toujours pas stocker l'électricité. C'est ce que j'avais appris en CM2, force est de constater que quelques décennies plus tard, l'innovation promise n'est pas arrivée. Nous n'arrivons toujours pas à stocker l'électricité. Même mon ordinateur s'essouffle assez vite quand j'écris des billets aussi grands. Il y aurait bien une solution, c'est de changer nos modes de vie, de travail, de déplacement etc. Mais ce serait sans doute trop radical. Quoiqu'il en soit, ces freins au stockage de l'électricité ont un bon côté, selon le PDG de Total, puisque ce sont eux qui vont nous permettre de tenir les 2° de l'accord de Paris. Si tant est que 2° soient suffisants. Mais en fin de compte, "ce qui sera possible ce sont les consommateurs qui vont le dire, pas les gouvernements" nous dit Patrick Pouyanné et là on craint le pire, car les 20
- 22. consommateurs sont les même Gaulois réfractaires sus-cités, ceux qui ne veulent pas, ou dans certains cas, qui ne peuvent pas changer. Et ils sont nombreux. "75% des français doivent utiliser un véhicule pour travailler" nous a expliqué le patron de Total, et — c'est là que le bât blesse et qu'il s'agit d'enlever ses lunettes de bobo du 9ème arrondissement — "Tous n'ont pas accès aux transports parisiens ; ils n'ont pas le choix". Un écho à une émission fort bien faite de France Culture, sur les mobilités et l'analyse de la future loi par des experts dont l'excellent Frédéric Héran, auteur de "Le retour de la bicyclette" aux éditions La Découverte. Devenir la Major de l'énergie responsable Et de développer les changements en cours chez Total qui sont considérables si on les compare aux concurrents (hormis Shell), quasiment tous addicts aux énergies fossiles. Même les détracteurs pourront reconnaître cet effort : Total a déjà "près de 6 millions de clients à qui [ils vendent] de l'électricité" et leur "premier objectif est de faire baisser la proportion carbone de 15% et [ils sont] bien sur cette trajectoire" affirme le patron de Total. La première mission [de Total] est l'énergie (disponible etc.) mais il y a des changements à mener, "et le rôle majeur du PDG est d'assurer la cohérence entre ce que les diverses équipes veulent faire avec les ambitions de l'entreprise". C'est un rôle d'impulsion, nous dit-il, le plus important est cette impulsion à donner. Mais la logique économique n'a pas été changée pour Total, sommée de faire des résultats : "On investit 2 milliards d’euros par an sur l'innovation, mais les actionnaires apprécieront uniquement si on fait des résultats !" nous confirme le patron de la grande société. Un monde du pétrole divisé en deux Au-delà des discours tonitruants, souvent suivis de peu d'effets ("notre maison brûle" une envolée lyrique remarquable qui date quand même de 17 ans et suivie de peu de mesures concrètes et efficaces), c'est à "un monde du pétrole divisé en 2" que nous sommes confrontés nous dit Patrick Pouyanné. Il y a, d'une part, ceux qui s'orientent vers l'électricité (Shell et Total principalement) et ceux qui, tout à l'envers, s'appuient exclusivement sur les ressources fossiles (les Américains et tous les autres). "Mais quel est le futur de ces entreprises ?" s'interroge le grand patron français. J'aurais envie de rajouter, quel est l'avenir de la planète ? Voire même, comme le rajoute à juste titre Hulot, de l'humanité (car selon lui, ce n'est pas la planète que nous chercherons à sauver, elle se sauvera bien toute seule, mais bien la vie — et la qualité de cette vie — des hommes qui la peuple). Le climat "un point de conflit entre les élites et le peuple" Le sujet du climat devient en France (mais pas seulement) "un point de conflit entre les élites et le peuple" et selon Patrick Pouyanné, "il faut éviter cela absolument" et "dire que la "taxe carbone est un mal nécessaire ne fonctionne pas, on ne va pas motiver les gens sur une taxe". Pourtant, Frédéric Héran, dans l'émission citée plus haut, n'hésite pas à qualifier la fin de l'écotaxe comme erreur la plus énorme jamais commise contre le climat en France. L'innovation en panne d'innovation Au-delà des compétences d'orateurs et des capacités de leader de notre prestigieux intervenant, je me suis posé des questions quant au but et à la nature de l'innovation proprement dite, ce qui semble légitime pour l'auteur d'un blog sur l'innovation. En somme, si je comprends bien, il n'y a plus de discussions sur la nécessité de changer. Patrick Pouyanné l'a précisé plusieurs fois et a démontré les efforts méritoires de sa société et de ses équipes pour réaliser ce changement dans l'intérêt général (et non l'intérêt des équipes pour reprendre en substance ses propos). Jusque là tout va bien. Là où ça se complique, c'est que Total, et son confrère anglo-batave, semblent être parmi les seuls à avoir amorcé, du moins aussi profondément, ces changements radicaux. Or, plongée dans une concurrence rude, l'entreprise est aux mains des logiques économiques, qui créent des forces contradictoires. En conclusion, à la fois à l'issue des résistances internes, mais surtout des résistances externes et concurrentielles, sans oublier les développements majeurs dans les pays en voie de développement où les questions de disponibilité et de progrès priment tout le 21
- 23. reste, les forces en présence font que le changement en question sera lent, partiel, et pourrait même venir menacer les acteurs vertueux du changement comme Total (surtout maintenant que le prix du baril est redescendu à 62$ au 16 mai 2019) A cela on rajoute les logiques de guerre économique décrites par le PDG de Total qui nous prédit un "bain de sang pour l'Occident" sur le véhicule électrique avec "la Chine qui est déjà responsable de 50% des énergies renouvelables du monde", on se fait un peu du souci pour l'avenir de l'humanité. Cerise sur le gâteau, les "citoyens" voient surtout midi à leur porte — sans qu'on puisse vraiment les blâmer car la vie est difficile, il faudrait être idiot pour prétendre l'inverse — et s'opposent aux mesures, certainement maladroites, qui sont timidement tentées. Bref, l'heure n'est pas à la réjouissance, je rejoins Hulot sur ce point même si comme lui je suis un optimiste déçu, et il ne reste plus à espérer que quelques issues possibles : •# Les catastrophes prédites ne se passent pas comme prévu, les océans ne montent pas d'un mètre, la calotte glaciaire ne fond pas complètement, les animaux gambadent et se reproduisent… bon, OK on va arrêter là ; •# L'innovation technologique nous sort du pétrin, et on combat la pollution par autre chose que la pollution. Mais là Patrick Pouyanné ne nous a pas vendu la voiture électrique. Car l'électricité n'est pas neutre ; •# On remplace le pétrole par le gaz (qui est toujours une énergie fossile, mais un poil plus propre), c'est ce que Total semble faire avec des rachats de centrales au gaz car "bientôt on en aura tous besoin", mais est-ce une véritable solution ? ; •# Ou encore, au lieu de changer le mode d'énergie du transport, on pourrait réfléchir un cran plus haut et réinventer la vie, le travail, les déplacements et repenser l'organisation des sociétés. Pourquoi en effet concentrer tout dans les centre-villes ? Pourquoi aller au travail tous les jours et se détruire le moral et/ou la santé dans les transports ? Pourquoi toujours construire plus de routes qui aboutissent à y mettre toujours davantage de voitures ? Pourquoi arrêter les trains et notamment tuer les "petites lignes" au moment où au contraire le train affirme sa modernité en termes de transport propre et citoyen en matière d'occupation de l'espace public? etc. L'innovation est à un autre niveau En d'autres termes, et j'admets ce que cette question peut avoir de dérangeant, l'innovation n'est-elle pas ailleurs, et n'appelle-t-elle pas un travail à un autre niveau ? Préoccupations de riches me direz-vous, à une heure où "en Inde ou en Afrique, la préoccupation principale est de sortir les gens de la pauvreté et non de perfectionner l'environnement". Il ne reste plus qu'à espérer que les experts du GIEC soient à côté de la plaque — cela est certainement en partie vrai car les effets de l'évolution du climat sont difficiles à modéliser avec certitude — et que nous soyons plus résistants que nous en avons l'air. En tout état de cause, Patrick Pouyanné a raison, "les gens n'aiment pas changer sauf "quand il y a des enjeux de survie". Ce qui est valable pour Total l'est aussi pour la Société au service de laquelle sont les grandes entreprises, et il n'y a plus qu'à attendre la preuve de la menace sur notre survie pour que quelque chose de concret se passe enfin. Souhaitons qu'il ne soit pas trop tard. 22
- 24. 23
- 25. PERSPECTIVES 17-21 RUE SAINT FIACRE 75002 - PARIS - FRANCE +33 1 40 18 78 34 CONTACT@VISIONARYMARKETING.COM VISIONARYMARKETING.COM @VISMKTG VISIONARY MARKETING, CC 2019.TOUTES LES MARQUES SONT PROPRIÉTÉ DE LEURS AUTEURS RESPECTIFS.VISIONARY MARKETING EST UNE AGENCE MARKETING EUROPÉENPAR NE BASÉE À PARIS, FRANCE. LES IMAGES SONT DE ANTIMUSEUM.COM SAUF LA COUVERTURE PAR GRAPHIC NODE - 2018 MARKETING & INNOVATION
