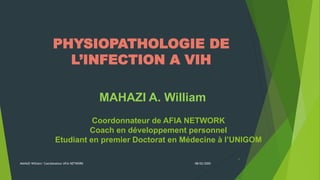
MECANISME PHYSIOPATHOLOGIE DE L'INFECTION A VIH ET PERSPECTIVE THERAPEUTIQUE
- 1. MAHAZI A. William PHYSIOPATHOLOGIE DE L’INFECTION A VIH Coordonnateur de AFIA NETWORK Coach en développement personnel Etudiant en premier Doctorat en Médecine à l’UNIGOM 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 1
- 2. PHYSIOPATHOLOGIE DE L’INFECTION A VIH 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 2
- 3. Préface Dans l’infectiologie, il existe un ensemble des symptômes qui sont dus à la déficience du système immunitaire,cette dernière étant causée par un virus, on l’a baptisé le nom du SYNDROME DE L’IMMUNODEFIECIENCE ACQUISE depuis 1986 et sa cause est connue depuis 1981 par l’Institut Pasteur grâce au Prix Nobel Luc Montagnier. Depuis lors, la médecine actuelle n’est jamais parvenu à éradiquer cette maladie monstrueuse sans compter les prouesses des chercheurs à ce fait. Ainsi, dans ce module, nous allons expliquer le mécanisme par lequel, l’agent en cause, le VIH, agit dans l’organisme pour aboutir à l’éfondrement des lymphocytes T CD4+ MAHAZI William 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 3
- 4. REFERENCES Vinay KUMAR, Abul ABBAS et Jon ASTER; Robbins Basic Pathology, 10ème Edition Canada, Elsevier , 2018, 910p James WHITE, et al; KAPLAN Medical, USMLE- Step 1 Lecture Notes 2017, New York, KAPLAN Inc., 2017, 2714p Prof. Pierre YASSA, Cours d’Anatomie Pathologique Générale, UNIGOM, Inédit, 2018-2019, 230p. Lee Goldman et Andrew Schäfer, Goldman’s Cecile Medecine, New York, 20ème Edition, Elsevier; 2017; 3034p Kasper Hauser et Braunwald Longo; Harrison’s Principles of Internal Medecine; 16ème Edition, Chicago, Medical Publishing Edition, 2015, 2783p Anthony Mescher, Junqueira’s Basic Histology Text and Atlas, Washington,10ème Edition, MacGraw Hill, 2018, 556p
- 5. L’histoire et source Seulement épidemiologie Naturellement immunisé Division cellulaire Particularité des prises en charge Action des integrases Syndrome inflammatoire de restoration immunitaire Prise en charge Pourquoi les maladies touchent les plus souvent les seropositifs Anti-proteases troubles la repartition lipidique 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 5
- 6. INTRODUCTION Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme sida, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Le sida est le dernier stade de l'infection au VIH, lorsque l'immunodépression est sévère. Il conduit à la mort des suites de maladies opportunistes. Une personne malade du sida est désignée par le terme « sidéen » ou plus rarement « sidatique » 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 6
- 7. Trois voies de transmission du VIH ont été observées : La voie sexuelle, qui est le principal moyen de contagion ; La voie sanguine : qui concerne particulièrement les utilisateurs de drogues injectables et les professionnels de la santé (jusqu'à la fin des années 1980, les transfusés, en particulier les hémophiles, ont également été à risque, voir affaire du sang contaminé) ; De la mère à l'enfant : qui peut survenir in utero dans les dernières semaines de la grossesse, au moment de l'accouchement et de l'allaitement. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 7
- 8. INTRODUCTION La prévention, telle que l'usage du préservatif, constitue de loin la meilleure option, car il n'existe actuellement aucun vaccin permettant de se protéger du virus, et les traitements antiviraux disponibles actuellement ne permettent aucune guérison. Bien qu'ayant une certaine efficacité, ils ne peuvent que stopper la prolifération du VIH au sein de l'organisme et non l'éradiquer. De plus, ces thérapeutiques, coûteuses, ne sont facilement accessibles que dans les pays développés qui peuvent assurer la charge financière ; dans les pays en développement, plus de 95 % des patients ne bénéficient aujourd'hui d'aucun traitement efficace. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 8
- 9. LE SYNDROME DE L’IMMUNODEFICIENCE ACQUISE Le sida est une maladie causée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) rétrovirus. Il se caractérise par une profonde immunosuppression conduisant à des troubles opportunistes : infections, néoplasmes secondaires et manifestations neurologiques. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 9
- 10. Bien que le sida ait été reconnu pour la première fois comme une entité distincte dans les années 1980, il est devenu l’une des maladies les plus dévastatrices de l’histoire. Sur les 36 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde, environ 70% se trouvent en Afrique et 20% en Asie. Plus de 25 millions de décès sont imputables au VIH / sida, avec 1 à 2 millions de décès par an. Des médicaments antirétroviraux efficaces ont été mis au point, mais l’infection continue de se propager dans des régions du monde où ces traitements ne sont pas largement disponibles et, dans certains pays africains, plus de 30% de la population est infectée par le VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 10
- 11. Malgré les progrès remarquables réalisés dans le traitement médicamenteux du SIDA, la guérison est encore un objectif lointain. L’avènement de ces médicaments soulève également sa propre préoccupation tragique; comme davantage de personnes vivent avec le VIH, le risque de propagation de l’infection augmentera si la vigilance est relâchée. L'énorme fardeau médical et social du SIDA a entraîné une explosion des recherches visant à comprendre ce fléau moderne et sa capacité remarquable à paralyser les défenses de l'hôte. La littérature sur le VIH/SIDA est vaste. Nous résumons ici les données actuellement disponibles sur l’épidémiologie, la pathogenèse et les caractéristiques cliniques de l’infection à VIH. 08/02/2020 MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 11
- 12. Épidémiologie Des études épidémiologiques menées aux États-Unis ont permis d'identifier cinq groupes d'adultes présentant un risque élevé de développer le sida. Les hommes homosexuels ou bisexuels constituent le groupe le plus important, représentant environ 50% des cas signalés. Cela inclut environ 5% des toxicomanes par voie intraveineuse. Les contacts hétérosexuels de membres d'autres groupes à haut risque constituaient environ 20% des infections entre 2001 et 2004. En Afrique et en Asie, il s'agit de loin du groupe le plus important de patients présentant de nouvelles infections, dont la plupart se produisent chez les femmes infectées par le virus des partenaires masculins. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 12
- 13. Épidémiologie Les toxicomanes par voie intraveineuse sans antécédents d’homosexualité représentaient environ 20% des personnes infectées et 9% des nouveaux cas en 2009. Les hémophiles survivants, en particulier ceux qui ont reçu de grandes quantités de concentrés en facteur VIII ou facteur IX avant 1985, représentent environ 0,5% de tous les cas. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 13
- 14. Épidémiologie Autres receveurs de sang total ou de composants infectés par le VIH (par exemple: plaquettes, plasma) représentent environ 1% des patients. Infection à VIH du nouveau-né: Près de 2% de tous les cas de sida surviennent dans cette population pédiatrique. La grande majorité contracte l'infection par la transmission du virus de la mère à l'enfant (voir plus loin). Dans environ 5% des cas, les facteurs de risque ne peuvent être déterminés. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 14
- 15. Il ressort clairement de ce qui précède que la transmission du VIH se produit dans des conditions facilitant l’échange de sang ou de liquides organiques contenant le virus ou les cellules infectées par le virus. Les trois principales voies de transmission sont : le contact sexuel, l'inoculation parentérale et le passage du virus d'une mère infectée à son nouveau-né. 08/02/2020 MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 15
- 16. Le virus est transporté dans le sperme et pénètre dans le corps du destinataire par abrasions de la muqueuse rectale ou orale ou par contact direct avec des cellules de la muqueuse. Une transmission parentérale du VIH s'est produite chez des drogués par voie intraveineuse, des hémophiles ayant reçu des concentrés de facteur VIII et de facteur IX contaminés et d'autres receveurs de produits sanguins contaminés. Aux États-Unis, à l'heure actuelle, la transmission parentérale n'est courante que chez les toxicomanes par voie intraveineuse. La transmission se produit par le partage d'aiguilles, de seringues et d'autres accessoires contaminés par du sang contenant du VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 16
- 17. La propagation virale se produit de deux manières: l'inoculation directe dans les vaisseaux sanguins rompus par un traumatisme et l'infection de cellules dendritiques ou de cellules CD4 + dans la muqueuse. La transmission sexuelle du VIH est renforcée par la coexistence de maladies sexuellement transmissibles, en particulier celles associées à une ulcération génitale. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 17
- 18. La transmission du VIH par transfusion de sang ou de produits sanguins, tels que les facteurs VIII et IX lyophilisés concentrés, a été pratiquement éliminé par des mesures de santé publique, notamment le dépistage des anticorps anti-VIH dans le sang et le plasma donnés, les critères de pureté rigoureux applicables aux préparations de facteur VIII et de facteur IX et le dépistage des donneurs sur la base des antécédents. Un risque extrêmement faible de contracter le SIDA par transfusion de sang séronégatif persiste, car un individu récemment infecté peut être séronégatif. Actuellement, ce risque est estimé à 1 sur plus de 2 millions d'unités de sang transfusé. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 18
- 19. Comme évoqué précédemment, la transmission mère-enfant est la principale cause du SIDA pédiatrique. Les mères infectées peuvent transmettre l'infection à leur progéniture par trois voies: 1. in utero par propagation transplacentaire; 2. pendant l'accouchement par un canal de naissance infecté; et 3. après la naissance par ingestion de lait maternel. Parmi ceux-ci, la transmission pendant la naissance (intrapartum) et dans la période qui suit (peripartum) est considérée comme le mode le plus courant aux États-Unis. 08/02/2020 MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 19
- 20. Les taux de transmission signalés varient de 7% à 49% dans différentes parties du monde. Un risque plus élevé de transmission est associé à une charge virale élevée chez la mère, à un faible nombre de lymphocytes T CD4 + et à une chorioamnionite. Heureusement, la thérapie antirétrovirale administrée aux femmes enceintes infectées aux États-Unis a pratiquement éliminé la transmission mère-enfant, mais celle-ci reste une source majeure d'infection dans les zones où ces traitements ne sont pas disponibles. Le grand public et les professionnels de la santé s'inquiètent de la propagation de l'infection par le VIH en dehors des groupes à haut risque. Des études approfondies indiquent que l’infection à VIH ne peut pas être transmise par des contacts personnels occasionnels à la maison, sur le lieu de travail ou à l’école. 08/02/2020 MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 20
- 21. La propagation par les piqûres d'insectes est pratiquement impossible. En ce qui concerne la transmission de l’infection par le VIH aux travailleurs de la santé, le risque est extrêmement faible, mais certain. Une séroconversion a été documentée après une blessure accidentelle par piqûre d'aiguille ou l'exposition d'une peau non intacte à du sang infecté lors d'accidents de laboratoire. Après un accident de piqûre d'aiguille, le risque de séroconversion serait d'environ 0,3%, et un traitement antirétroviral administré dans les 24 à 48 heures suivant une piqûre d'aiguille peut considérablement réduire le risque d'infection. En comparaison, environ 30% des personnes exposées accidentellement à du sang infecté par l'hépatite B deviennent séropositives. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 21
- 22. Propriétés du VIH Le VIH est un rétrovirus humain non transformant appartenant à la famille des lentivirus. Sont inclus dans ce groupe : le virus de l’immunodéficience féline, le virus de l’immunodéficience simienne, le virus Visna du mouton, le virus de l’immunodéficience bovine et le virus de l’anémie infectieuse équine. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 22
- 23. Deux formes de VIH génétiquement différentes mais liées, appelées VIH-1 et VIH-2, ont été isolées chez des patients. Le VIH-1 est le type le plus couramment associé au sida aux États-Unis, en Europe et en Afrique centrale, alors que le VIH-2 provoque une maladie similaire principalement en Afrique de l'Ouest et en Inde. La discussion qui a suivi concerne principalement le VIH-1, mais s’applique également au VIH-2. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 23
- 24. La structure du VIH est semblable à la plupart des rétrovirus, le virion VIH-1 est sphérique et contient un noyau dense en électrons, en forme de cône, entouré d'une enveloppe lipidique dérivée de la membrane de la cellule hôte (Fig. 1.1). 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 24
- 25. Figure 1.1 : la structure du virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1) virion. La particule virale est recouverte d'une bicouche lipidique dérivée de la cellule hôte et parsemée de glycoprotéines virales gp41 et gp120 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 25
- 26. Le noyau viral contient : la principale protéine p24 de la capside; la protéine de nucléocapside p7 / p9; deux copies d'ARN génomique viral; et les trois enzymes virales (protéase, transcriptase inverse et intégrase). p24 est l'antigène viral le plus abondant et est l'antigène détecté par un test largement utilisé pour diagnostiquer une infection par le VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 26
- 27. Le noyau viral contient Le noyau viral est entouré d'une protéine matricielle appelée p17, située sous l'enveloppe du virion. Deux glycoprotéines virales, la gp120 et la gp41, sont essentielles à l’infection par le VIH des cellules. Le génome de l'ARN du VIH-1 contient les gènes gag, pol et env, typiques des rétrovirus. Les produits des gènes gag et pol sont de grosses protéines précurseurs qui sont clivées par la protéase virale pour donner les protéines matures. Outre ces trois gènes rétroviraux standard, le VIH contient plusieurs gènes accessoires, notamment tat, rev, vif, nef, vpr et vpu, qui régulent la synthèse et l’assemblage des particules virales infectieuses et la pathogénicité du virus. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 27
- 28. L'analyse moléculaire de différents isolats de VIH-1 a révélé une variabilité considérable dans certaines parties du génome viral, principalement au sein de séquences codant pour des régions particulières des glycoprotéines de l'enveloppe. Comme la réponse en anticorps contre le VIH-1 est dirigée contre son enveloppe, cette variabilité pose des problèmes pour le développement d'un vaccin à antigène unique. Sur la base de la variation génétique, le VIH-1 peut être divisé en trois sous-groupes; désignés par M (majeur), O (aberrant) et N (n’est ni M ni O). Les virus du groupe M sont la forme la plus répandue dans le monde et sont ensuite divisés en plusieurs sous-types, ou clades, désignés A à K. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 28
- 29. Différents sous-types diffèrent par leur distribution géographique; par exemple, le sous-type B est la forme la plus commune en Europe occidentale et aux États-Unis, alors que le sous-type E est le clade le plus commun en Thaïlande. Actuellement, le clade C est le clade à la propagation la plus rapide au monde, étant présent en Inde, en Éthiopie et en Afrique australe. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 29
- 30. Pathogenèse de l'infection à VIH et du sida Alors que le VIH peut infecter de nombreux tissus, la principale cible de l’infection par le VIH est le système immunitaire. Les effets de l'infection à VIH sur chacun de ces deux systèmes sont discutés séparément. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 30
- 31. Nous décrivons d’abord les mécanismes impliqués dans l’entrée virale dans les cellules T et les macrophages; et dans le cycle de réplication du virus dans les cellules qui suit une analyse plus détaillée de l’interaction entre le VIH et ses cibles cellulaires. Le déficit immunitaire profond, touchant principalement les cellules de l'immunité, est la marque du SIDA. Ceci résulte principalement de l'infection et de la perte de cellules T CD4 +, ainsi que de la fonction altérée des cellules T auxiliaires survivantes et d'autres cellules immunitaires. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 31
- 32. RAPPEL SUR LA STRUCTURE DE LA MEMBRANE PLASMIQUE D’UNE CELLULE TYPE Les membranes limitantes qui enveloppent toutes les cellules eucaryotes sont constituées : des phospholipides, de cholestérol, des protéines et des chaînes oligosaccharidiques liées de manière covalente à des molécules des phospholipides et des protéines. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 32
- 33. FONCTIONS La membrane plasmique (membrane cellulaire) agit comme: o une barrière sélective régulant le passage des matériaux dans et hors de la cellule et facilitant le transport de molecules spécifiques. o Un role important de la membrane cellulaire est de maintenir constante la teneur en ions du cytoplasme, qui diffère de celle du fluide extracellulaire. o Elle exerce également un certain nombre de fonctions spécifiques de reconnaissance et de signalisation, jouant un role clé dans les interactions de la cellule avec son environnement. 33
- 34. DIMENSIONS La membrane plasmique a une épaisseur de 7,5 à 10 nm et n’est par consequent visibles qu'au microscope électronique. La ligne entre les cellules adjacentes, parfois vu faiblement avec le microscope optique, est formée par des proteines membranaires plasmatiques plus un matériau extracellulaire, qui ensemble peuvent atteindre une dimension visible par microscopie optique. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 34
- 35. 1. LES PHOSPHOLIPIDES Les phospholipides membranaires sont amphipathiques. a. Constitution: Ils sont constitués - de deux acides gras à longue chaîne non polaires (hydrophobes ou hydrofuges) - liés à une tête polaire chargée (hydrophile ou absorbant l'eau) qui porte un groupe phosphate. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 35
- 36. 1. LES PHOSPHOLIPIDES b. Caracteristiques: Les phospholipides sont plus stables lorsqu'ils sont organisés en une double couche (bicouche) avec les chaînes d'acides gras hydrophobes dirigés vers le milieu loin de l'eau et les groupes de tête polaires hydrophiles face à l'eau. Les molecules du cholestérol, un lipide de stérol, insèrent à des densités variables parmi les acides gras de phospholipides étroitement serrés, limitant leur mouvement, et modulant la fluidité et le mouvement de tous les composants membranaires. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 36
- 37. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 37
- 38. Les phospholipides dans chaque moitié de la bicouche sont différents. Par exemple, dans les membranes bien étudiées des globules rouges, la phosphatidylcholine et la sphingomyéline sont plus abondantes dans la moitié externe, alors que la phosphatidylsérine et la phosphatidyléthanolamine sont plus concentrées dans la couche interne. Certains des lipides externes, connus sous le nom de glycolipides, comprennent des chaînes d'oligosaccharides qui s'étendent vers l'extérieur de la surface cellulaire et contribuent à un revêtement de surface cellulaire délicat appelé le glycocalyx. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 38
- 39. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 39
- 40. Avec le microscope électronique à transmission (TEM ou MET), la membrane cellulaire – et toutes les autres membranes organelles - peut présenter un aspect trilaminaire après fixation dans le tétroxyde d'osmium; l'osmium liant les têtes polaires des phospholipides, les chaînes de sucre externes, et les protéines membranaires associées produit les deux lignes externes sombres entourant la bande de lumière des acides gras sans osmium. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 40
- 41. 2. LES PROTEINES a. Constitution Les protéines sont des constituants majeurs des membranes (~ 50% en poids dans la membrane plasmique). Les proteins intégrales sont directement incorporées dans la bicouche lipidique elle- même, tandis que les proteins périphériques présentent une association plus lâche avec l'une des deux surfaces de la membrane, en particulier l'intérieur. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 41
- 42. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 42
- 43. b. Caractéristiques: Les protéines périphériques faiblement liées peuvent être facilement extraites des membranes cellulaires avec des solutions salines, tandis que les protéines integrales peuvent être extraites uniquement en utilisant des détergents pour perturber les lipides. Les chaînes polypeptidiques de nombreuses proteines intégrales traversent la membrane plusieurs fois, d'un côté à l'autre, et sont par conséquent appelées proteines transmembranaires à passages multiples.08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 43
- 44. b. Caractéristiques: L'intégration des proteines dans la bicouche lipidique est principalement le résultat d'interactions hydrophobes entre les lipides et les acides aminés non polaires présents sur la region externe des protéines. Des études au microscope électronique par congelation (fracture des membranes) montrent que des parties de nombreuses proteines intégrales font saillie de la surface de la membrane externe ou interne. Comme ceux des glycolipides, les fragments hydrates de carbone des glycoprotéines se projettent de la surface externe de la membrane plasmique et contribuent au glycocalyx. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 44
- 45. Ce sont des composants importants des protéines agissant comme récepteurs, qui participent à des interactions importantes telles que l'adhésion cellulaire, la reconnaissance cellulaire et la réponse aux hormones protéiques. Comme pour les lipides, la distribution des polypeptides membranaires est différente dans les deux surfaces des membranes cellulaires. Par conséquent, toutes les membranes de la cellule sont asymétriques. Des études avec des proteines membranaires marquées de cellules cultivées révèlent que de nombreuses protéines de ce type ne sont pas liées rigidement en place et sont capables de se déplacer latéralement. De telles observations ainsi que des données issues d'études biochimiques, microscopiques électroniques et autres ont montré que les proteines membranaires comprennent une mosaïque mobile dans la bicouche lipidique fluide, le modèle de mosaïque fluide bien établi pour la structure membranaire. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 45
- 46. Cependant, contrairement aux lipides, de nombreuses protéines membranaires sont restreintes dans leur diffusion latérale par attachement aux composants du cytosquelette. Dans la plupart des cellules épithéliales, des jonctions serrées entre les cellules limitent également la diffusion latérale des proteines transmembranaires non attachées et des lipides de la couche externe, produisant des domaines membranaires spécifiques. Les proteines membranaires fonctionnant comme des composants de grands complexes enzymatiques sont également moins mobiles, en particulier celles impliquées dans la transduction de signaux provenant de l'extérieur de la cellule. Ces complexes protéiques sont situés dans des patchs membranaires spécialisés appelés radeaux lipidiques ayant des concentrations plus élevées de cholestérol et d'acides gras saturés qui réduisent la fluidité des lipides. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 46
- 47. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 47
- 48. Cycle de vie du VIH Le cycle de vie du VIH comprend : a. l’infection de cellules, b. l’intégration du provirus dans le génome de la cellule hôte, c. l’activation de la réplication virale, d. ainsi que la production et la libération de virus infectieux (Fig. 1.2). Les molécules et les mécanismes de chacune de ces étapes sont bien compris en détail. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 48
- 49. Fig. 1.2: le cycle de vie du VIH 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 49
- 50. Infection des cellules par le VIH Le VIH infecte les cellules en utilisant la molécule CD4 comme récepteur et divers récepteurs de chimiokines comme corécepteurs (voir Fig. 1.3). La liaison de gp120 du VIH au CD4 est essentielle pour l’infection et explique le tropisme du virus pour les lymphocytes T CD4 + et pour les monocytes / macrophages CD4 + et les PDC. Cependant, la liaison à CD4 n'est pas suffisante pour l'infection, car la gp120 du VIH doit également se lier à d'autres molécules de surface cellulaire (corécepteurs) pour pouvoir pénétrer dans la cellule. Les récepteurs de chimiokines, en particulier CCR5 et CXCR4, remplissent ce rôle. Les isolats du VIH peuvent être distingués par l'utilisation de ces corécepteurs: les souches R5 utilisent les souches CCR5, X4, CXCR4 et certaines souches (R5X4) sont duales. Les souches R5 infectent préférentiellement les cellules de la lignée monocyte / macrophage et sont donc appelées M-tropiques, alors que les souches X4 sont des cellules T-tropiques, infectant préférentiellement les cellules T, mais ces distinctions ne sont pas absolues. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 50
- 51. Fig.1.3.Méchanisme de l’infection à VIH 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 51
- 52. Les polymorphismes du gène codant pour CCR5 sont associés à une sensibilité altérée à l’infection par le VIH. Environ 1% des Américains blancs héritent de deux copies mutées du gène CCR5 et sont résistants aux isolats de VIH R5. Environ 20% des individus sont hétérozygotes pour cet allèle protecteur CCR5; ces personnes ne sont pas protégées contre le SIDA, mais l'apparition de leur maladie après l'infection est retardée. Seuls des homozygotes rares pour la mutation ont été trouvés dans des populations africaines et asiatiques orientales. Les détails moléculaires de la poignée de main mortelle entre les glycoprotéines du VIH et leurs récepteurs à la surface des cellules ont été élucidés. L'enveloppe du VIH contient deux glycoprotéines associées de manière non covalente, la gp120 de surface et la protéine transmembranaire gp41. L'étape initiale de l'infection est la liaison de la glycoprotéine d'enveloppe de la gp120 aux molécules de CD4, ce qui entraîne un changement de conformation qui crée un nouveau site de reconnaissance sur la gp120 pour les corécepteurs CCR5 ou CXCR4. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 52
- 53. La liaison aux corécepteurs induit des changements conformationnels dans la gp41 qui expose une région hydrophobe appelée peptide de fusion à la pointe de la gp41. Ce peptide s'insère dans la membrane cellulaire des cellules cibles (par exemple des cellules T ou des macrophages), conduisant à la fusion du virus avec la cellule hôte. Après la fusion, le noyau du virus contenant le génome du VIH entre dans le cytoplasme de la cellule. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 53
- 54. Réplication virale Une fois internalisé, le génome à ARN du virus subit une transcription inverse menant à la synthèse d'ADN complémentaire à double marquage (ADNc; ADN proviral) (voir Fig. 1.2). Dans les cellules T au repos, l'ADNc du VIH peut rester dans le cytoplasme sous une forme épisomique linéaire. . Dans les cellules T en division, l'ADNc se circularise, entre dans le noyau et est ensuite intégré dans le génome de l'hôte. Après l'intégration, le provirus peut rester silencieux pendant des mois ou des années, une forme d'infection latente. Alternativement, l'ADN proviral peut être transcrit, conduisant à l'expression des protéines virales nécessaires à la formation de particules virales complètes. Le VIH infecte les cellules de mémoire et les cellules T activées, mais ne parvient pas à infecter de manière productive les cellules T naïves (au repos). 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 54
- 55. Achèvement du cycle de vie viral chez les personnes infectées de manière latente cellules ne survient qu’après l’activation des cellules, et dans le cas de l'activation du virus entraîne la mort de la plupart des cellules T CD4 + cellules infectées. L'activation des cellules T par des antigènes ou des cytokines régule à la hausse plusieurs facteurs de transcription, y compris le NF-KB, qui passe du cytosol au noyau. Dans le noyau, NF-KB se lie à des séquences régulatrices de plusieurs gènes, y compris des gènes de cytokines et d'autres médiateurs immunitaires, favorisant leur transcription. . Les séquences répétées à long terminal qui bordent le génome du VIH contiennent également des sites de liaison à NF-KB, de sorte que la liaison du facteur de transcription active l'expression du gène viral. Imaginez maintenant une cellule CD4 + infectée de manière latente qui rencontre un antigène de l'environnement. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 55
- 56. L'induction de NF-KB dans une telle cellule (une réponse physiologique) active la transcription de l'ADN proviral du VIH (un résultat pathologique) et conduit finalement à la production de virions et à la mort cellulaire. En outre, le TNF et d'autres cytokines produites par des macrophages activés stimulent également l'activité de NF-κB et conduisent ainsi à la production d'ARN du VIH. . Ainsi, il semble que le VIH se développe lorsque les cellules T et les macrophages de l'hôte sont activés physiologiquement, ce qui peut être décrit comme une «subversion de l'intérieur». » Une telle activation in vivo peut résulter d'une stimulation antigénique par le VIH lui-même ou par d'autres microorganismes infectants. Les personnes séropositives présentent un risque accru d'infections récurrentes, ce qui entraîne une activation accrue des lymphocytes et la production de cytokines pro-inflammatoires. Celles-ci, à leur tour, stimulent davantage la production de VIH, la perte de cellules T CD4 + supplémentaires et davantage d'infections. Ainsi, il est facile de voir comment l’infection par le VIH crée un cercle vicieux qui aboutit à une destruction inexorable du système immunitaire. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 56
- 57. Mécanisme d'épuisement des lymphocytes T dans l'infection à VIH La perte de cellules T CD4 + est principalement causée par le cytopathogène direct effets du virus en cours de réplication. Chez les individus infectés, environ 100 milliards de nouvelles particules virales sont produites et 1 à 2 milliards de cellules T CD4 + meurent chaque jour. La mort de ces cellules est une cause majeure de l'immunodéficience des cellules T implacable, et finalement profonde. Jusqu'à un certain point, le système immunitaire peut remplacer les cellules T mourantes, mais à mesure que la maladie progresse, le renouvellement des cellules T CD4 + ne peut pas suivre leur perte. Parmi les mécanismes possibles par lesquels le virus tue directement les cellules infectées, on peut citer une augmentation de la perméabilité de la membrane plasmique associée au bourgeonnement des particules virales et des anomalies de la synthèse protéique résultant de l’interférence de protéines virales impliquées dans la réplication virale. Outre la destruction directe des cellules par le virus, d’autres mécanismes peuvent contribuer à la perte ou fonctionnelle altération des cellules T.08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 57
- 58. Ceux-ci inclus: Activation chronique de cellules non infectées, répondant au VIH même ou à des infections courantes chez les personnes atteintes du SIDA, conduisant à l'apoptose de ces cellules. Infection par le VIH de cellules dans les organes lymphoïdes (rate, ganglions lymphatiques, amygdales) entraînant la destruction progressive de l'architecture et de la composition cellulaire des tissus lymphoïdes. Fusion de cellules infectées et non infectées, entraînant la formation de syncytia (cellules géantes). En culture tissulaire, la gp120 exprimée sur les cellules infectées de manière productive se lie aux molécules de CD4 sur les lymphocytes T non infectés, suivie de la fusion cellulaire. Les cellules fusionnées meurent généralement en quelques heures. Défauts qualitatifs dans la fonction des cellules T. Même chez des individus asymptomatiques infectés par le VIH, des anomalies ont été rapportées, notamment une réduction de la prolifération des cellules T induite par l’antigène, une diminution des réponses de type TH1 par rapport au type TH2, des anomalies de la signalisation intracellulaire, et bien d’autres encore. La perte de réponses TH1 entraîne une déficience profonde de l'immunité à médiation cellulaire. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 58
- 59. Il y a aussi une perte sélective du sous-ensemble de mémoire des lymphocytes T auxiliaires CD4 + au début de l'évolution de la maladie, ce qui explique les faibles réponses de rappel aux antigènes précédemment rencontrés. L’infection chronique ou latente des lymphocytes T est une caractéristique importante de l’infection par le VIH. Le provirus intégré, sans expression de gène viral (infection latente), peut persister dans les cellules pendant des mois, voire des années. Même avec un traitement antiviral puissant, qui stérilise pratiquement le sang périphérique, le virus latent se cache dans les cellules CD4 + (cellules T et macrophages) dans les ganglions lymphatiques. Selon certaines estimations, 0,05% des cellules T CD4 + dans les ganglions lymphatiques sont infectés de manière latente. Étant donné que la plupart de ces cellules T CD4 + sont des cellules mémoire, elles ont une longue durée de vie, allant de quelques mois à plusieurs années, et constituent donc un réservoir persistant de virus. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 59
- 60. Infection par le VIH de cellules immunitaires non-T Outre l'infection et la perte de cellules T CD4 +, l'infection des macrophages et des CD est également importante dans la pathogénie de l'infection par le VIH. Les macrophages Comme les cellules T, la plupart des macrophages infectés par le VIH se trouvent dans les tissus et dans certains tissus, tels que les poumons et le cerveau, 10 à 50% des macrophages sont infectés. Bien que la division cellulaire soit nécessaire à l'entrée nucléaire et à la réplication de la plupart des rétrovirus, le VIH-1 peut infecter et se multiplier dans des macrophages non diviseurs à différenciation terminale, pouvant contenir un grand nombre de particules virales. Bien que les macrophages permettent la réplication virale, ils sont plutôt résistants aux effets cytopathiques du VIH, contrairement aux cellules T CD4 + . Ainsi, les macrophages peuvent être des réservoirs d'infection et, aux stades avancés de l'infection par le VIH, lorsque le nombre de lymphocytes T CD4 + diminue considérablement, les macrophages peuvent constituer un site important de réplication virale continue. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 60
- 61. Cellules dendritiques. Les CD des muqueuses peuvent être infectés par le virus et être transportés dans les ganglions lymphatiques régionaux, où le virus est transmis aux lymphocytes T CD4 +. Les CD folliculaires dans les centres germinaux des ganglions lymphatiques sont également des réservoirs potentiels du VIH. Bien que certains PED folliculaires soient susceptibles d’être infectés par le VIH, la plupart des particules virales se retrouvent à la surface de leurs processus dendritiques. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 61
- 62. Fonction des cellules B dans l’infection à VIH. Bien que les cellules B ne puissent pas être infectées par le VIH, elles peuvent présenter de profondes anomalies. Paradoxalement, il existe une activation spontanée des cellules B et une hypergammaglobulinémie en association avec une incapacité à générer des réponses anticorps aux antigènes nouvellement rencontrés. Les réponses anticorps défectueuses peuvent être dues à un manque d'aide des lymphocytes T ainsi qu'à des défauts acquis dans les lymphocytes B. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 62
- 63. Pathogenèse de l'implication du système nerveux central Comme le système lymphoïde, le système nerveux est une cible de l’infection par le VIH. Les macrophages et les microglies, cellules du système nerveux central appartenant à la lignée des macrophages, sont les types de cellules prédominants du cerveau infectés par le VIH. On pense que le VIH est transporté dans le cerveau par des monocytes infectés. De ce fait, les isolements du cerveau à partir du VIH sont presque exclusivement du M-tropic. Le mécanisme des lésions cérébrales induites par le VIH reste toutefois obscur. Comme les neurones ne sont pas infectés et que l'ampleur des modifications neuropathologiques est souvent inférieure à la gravité des symptômes neurologiques, la plupart des cliniciens pensent que le déficit neurologique est provoqué indirectement par des produits viraux et par des facteurs solubles produits par des microglies infectées, telles que cytokines IL-1, TNF et IL-6.08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 63
- 64. RÉSUMÉ CYCLE DE VIE DU VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE ET LA PATHOGENÈSE DU SIDA Entrée du virus dans les cellules: nécessite CD4 et des corécepteurs, récepteurs des chimiokines; implique la liaison de la gp120 virale et la fusion avec la cellule médiée par la protéine gp41 virale; principales cibles cellulaires: lymphocytes T auxiliaires CD4 +, macrophages, DC réplication virale: intégration du génome du provirus dans l'ADN de la cellule hôte; déclenchement de l'expression des gènes viraux par des stimuli activant les cellules infectées (par exemple, microbes infectieux, cytokines produites au cours d'une réponse immunitaire normale) Progression de l’infection: infection aiguë des cellules T muqueuses et DCs, virémie avec dissémination du virus; infection latente des cellules dans le tissu lymphoïde; poursuite de la réplication virale et perte progressive de lymphocytes T CD4 + 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 64
- 65. Mécanismes d'immunodéficience: Perte de cellules T CD4 +: mort des cellules T au cours de la réplication virale et du bourgeonnement (semblable à d'autres infections cytopathiques); l'apoptose résultant d'une stimulation chronique; diminution de la production thymique; défauts fonctionnels Fonctions macrophages et DC défectueuses Destruction de l'architecture des tissus lymphoïdes (tardive) 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 65
- 66. Histoire naturelle et évolution de l'infection à VIH La maladie à VIH commence par une infection aiguë, qui n'est que partiellement contrôlée par la réponse immunitaire de l'hôte, et progresse vers une infection progressive chronique des tissus lymphoïdes périphériques. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 66
- 67. Phase aigüe. Le virus pénètre généralement par les surfaces muqueuses et l'infection aiguë (précoce) est caractérisée par l'infection des lymphocytes T CD4 + à mémoire (qui expriment CCR5) dans les tissus lymphoïdes muqueux et par la mort de nombreuses de ces cellules infectées. Étant donné que les tissus muqueux constituent le plus grand réservoir de lymphocytes T dans le corps et un site majeur de résidence des lymphocytes T mémoire, cette perte locale entraîne un appauvrissement considérable en lymphocytes. A ce stade, peu de cellules infectées sont détectables dans le sang et dans d'autres tissus. L’infection muqueuse est suivie de la dissémination du virus et du développement de maladies et des réponses immunitaires chez l’hôte. Les CD dans les épithéliums des sites d'entrée du virus capturent le virus puis migrent dans les ganglions lymphatiques. Une fois dans les tissus lymphoïdes, les CD transmettent le VIH aux cellules T CD4 + par contact direct cellule par cellule. Quelques jours après la première exposition au VIH, la réplication virale peut être détectée dans les ganglions lymphatiques. Cette réplication conduit à une virémie, au cours de laquelle de nombreuses particules de VIH sont présentes dans le sang du patient. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 67
- 68. Le virus se dissémine dans tout le corps et infecte les cellules T auxiliaires, les macrophages et les CD dans les tissus lymphoïdes périphériques. Dans les 3 à 6 semaines suivant l'infection initiale, 40 à 90% des personnes infectées développent un syndrome aigu d'infection par le VIH, qui est déclenché par la propagation initiale du virus et par la réponse de l'hôte. Cette phase est associée à une maladie aiguë auto-limitée avec des symptômes non spécifiques, notamment un mal de gorge, des myalgies, de la fièvre, une perte de poids et de la fatigue, ressemblant à un syndrome de flulike. Des éruptions cutanées, une adénopathie, une diarrhée et des vomissements peuvent également survenir. Cela résout généralement spontanément en 2 à 4 semaines. Au fur et à mesure que l'infection se propage, l'individu construit des réponses immunitaires antivirales humorales et à médiation cellulaire. Ces réponses sont mises en évidence par une séroconversion (généralement dans les 3 à 7 semaines suivant une exposition présumée) et par l'apparition de lymphocytes T cytotoxiques CD8 + spécifiques du virus. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 68
- 69. Les cellules T CD8 + spécifiques du VIH sont détectées dans le sang vers le moment de la chute des titres viraux et sont probablement responsables du confinement initial de l'infection par le VIH. Ces réponses immunitaires contrôlent partiellement l'infection et la production virale, et ce contrôle se traduit par une chute de la virémie à des niveaux faibles mais détectables environ 12 semaines après la première exposition. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 69
- 70. Phase chronique Dans la phase suivante de la maladie, les ganglions lymphatiques et la rate sont des sites de réplication continue du VIH et de destruction cellulaire. Au cours de cette période de la maladie, peu ou pas de manifestations cliniques de l’infection par le VIH sont présentes. Par conséquent, cette phase de la maladie à VIH s'appelle la période de latence clinique. Bien que peu de lymphocytes T du sang périphérique abritent le virus, la destruction des lymphocytes T CD4 + dans les tissus lymphoïdes (dont 10% au maximum peuvent être infectés) se poursuit au cours de cette phase, et le nombre de lymphocytes T sanguins CD4 + en circulation diminue progressivement. Finalement, au fil des années, le cycle continu d'infection virale, la mort des lymphocytes T et la nouvelle infection entraînent une diminution constante du nombre de lymphocytes T CD4 + dans les tissus lymphoïdes et la circulation. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 70
- 71. SIDA. La phase finale est la progression vers le SIDA, caractérisée par une défaillance de la défense de l'hôte, une augmentation spectaculaire du virus plasmatique et une maladie clinique grave mettant la vie en danger. En général, le patient présente une fièvre persistante (> 1 mois), de la fatigue, une perte de poids et une diarrhée. Après une période variable, des infections opportunistes graves, des néoplasmes secondaires ou une maladie neurologique clinique (regroupés sous la rubrique Maladies indicatrices du SIDA ou maladies définissant le SIDA, abordées plus loin) apparaissent et le patient est réputé avoir développé le SIDA. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 71
- 72. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 72
- 73. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 73
- 74. L'ampleur de la virémie, mesurée en tant que taux d'ARN du VIH-1 dans le sang, est un marqueur utile de la progression de l'infection par le VIH et est utile dans la gestion des personnes infectées par le VIH. La charge virale à la fin de la phase aiguë reflète l'équilibre atteint entre le virus et la réponse de l'hôte et, chez un patient donné, elle peut rester assez stable pendant plusieurs années. Ce niveau de virémie à l'état d'équilibre, appelé point de consigne viral, est un facteur prédictif du taux de déclin des lymphocytes T CD4 + et, par conséquent, de la progression de l'infection par le VIH. Étant donné que la perte de contrôle immunitaire est associée à une diminution du nombre de cellules T CD4 +, la classification de l'infection par le VIH du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) divise les patients en trois groupes en fonction du nombre de cellules CD4 +: supérieur ou égal à 500 cellules / μL, 200 à 499 cellules / µL et moins de 200 cellules / µL (Tableau 5.15). En l'absence de traitement, la plupart des patients infectés par le VIH évoluent vers le sida après une phase chronique de 7 à 10 ans, mais il y a des exceptions. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 74
- 75. . Chez les progresseurs rapides, la phase intermédiaire médiane est télescopée 2 à 3 ans après la primo-infection. Environ 5% à 15% des individus infectés sont des non-progresseurs à long terme, définis comme des individus infectés par le VIH-1 non traités qui restent asymptomatiques pendant 10 ans ou plus, avec un nombre de cellules T CD4 + stable et de faibles niveaux de virémie plasmatique (généralement <500 ARN viral) copies / mL). De manière remarquable, environ 1% des individus infectés ont un virus plasmatique indétectable (<50 à 75 copies d'ARN / mL); ceux-ci ont été appelés contrôleurs d'élite. Les personnes dont l'évolution clinique est si rare ont attiré l'attention, dans l'espoir que leur étude permettrait de mieux comprendre les facteurs de l'hôte et du virus qui influent sur la progression de la maladie. Les études à ce jour indiquent que ce groupe est hétérogène en ce qui concerne les variables qui influencent l'évolution de la maladie. Dans la plupart des cas, les isolats viraux ne présentent pas d'anomalies qualitatives, ce qui suggère que l'évolution sans incident ne peut pas être attribuée à un virus «wimpy». 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 75
- 76. Dans tous les cas, il existe des preuves d’une immunitaire anti-VIH vigoureuse réponse, mais les corrélats immunitaires de la protection sont encore inconnus. Certaines de ces personnes présentent des taux élevés de réponses des lymphocytes T CD4 + et CD8 + spécifiques du VIH, et ces taux sont maintenus tout au long de l'infection. L'hérédité de certains allèles HLA semble être en corrélation avec la résistance à la progression de la maladie, reflétant peut-être la capacité de générer des réponses de cellules T anti-virales. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 76
- 77. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 77
- 78. Caractéristiques cliniques du SIDA Dans la section suivante, nous résumons les manifestations cliniques de la phase terminale de la maladie, le SIDA déclaré. Aux États-Unis, le patient adulte atteint du SIDA présente de la fièvre, une perte de poids, une diarrhée, une adénopathie généralisée, de multiples infections opportunistes, une maladie neurologique et, dans de nombreux cas, des néoplasmes secondaires. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 78
- 79. Infections opportunistes Les infections opportunistes représentent la majorité des décès chez les patients non traités atteints du SIDA. Un grand nombre de ces infections représentent la réactivation d'infections latentes, qui sont normalement maîtrisées par un système immunitaire robuste mais ne sont pas complètement éradiquées, car les agents infectieux ont évolué pour coexister avec leurs hôtes. La fréquence réelle des infections varie selon les régions du monde et a été considérablement réduite par l’avènement du traitement antirétroviral hautement actif (appelé multithérapie antirétrovirale ou multithérapie), qui repose sur une combinaison de trois ou quatre médicaments bloquant différentes étapes de la maladie. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 79
- 80. Le cycle de vie du VIH. Environ 15% à 30% des personnes infectées par le VIH non traitées développent une pneumonie causée par le champignon Pneumocystis jiroveci à un moment donné au cours de l'évolution de la maladie. Avant l’avènement de la multithérapie, cette infection était le symptôme présenté dans environ 20% des cas, mais son incidence était bien moindre chez les patients qui répondaient à la multithérapie. La candidose est l’infection fongique la plus répandue chez les patients atteints du sida. Les manifestations cliniques les plus courantes sont l’infection de la cavité buccale, du vagin et de l’œsophage. Chez les individus infectés par le VIH, la candidose orale est un signe de décompensation immunologique et annonce souvent la transition vers le sida. . La candidose invasive est peu fréquente chez les patients atteints du SIDA et survient généralement en cas de neutropénie induite par un médicament ou d'utilisation de cathéters à demeure. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 80
- 81. . Le cytomégalovirus (CMV) peut provoquer une maladie disséminée, mais affecte plus souvent les yeux et le tractus gastro-intestinal. La choriorétinite était habituellement observée chez environ 25% des patients, mais a considérablement diminué après le début du traitement HAART. La rétinite à CMV survient presque exclusivement chez les patients présentant un nombre de cellules T CD4 + inférieur à 50 par microlitre. L'infection gastro-intestinale à CMV, observée dans 5% à 10% des cas, se manifeste par une œsophagite et une colite, cette dernière étant associée à de multiples ulcérations muqueuses. Une infection bactérienne disséminée par des mycobactéries non tuberculeuses ou atypiques (principalement Mycobacterium aviumintracellulare) survient également tardivement, en cas d'immunosuppression sévère. . Parallèlement à l’épidémie de sida, l’incidence de la tuberculose a considérablement augmenté. Dans le monde, près d'un tiers des décès chez les patients atteints du sida sont imputables à la tuberculose, mais cette complication reste rare aux États-Unis. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 81
- 82. La réactivation de la maladie pulmonaire latente et la nouvelle infection primaire contribuent à ce bilan. Comme avec la tuberculose dans d'autres contextes, l'infection peut être confinée aux poumons ou peut impliquer plusieurs organes. Les rapports les plus inquiétants sont ceux qui indiquent qu'un nombre croissant d'isolats résistent à plusieurs médicaments anti-mycobactériens. La cryptococcose survient chez environ 10% des patients atteints du sida. Comme dans d'autres contextes d'immunosuppression, la méningite est la principale manifestation clinique de la cryptococcose. Le Toxoplasma gondii, un autre envahisseur fréquent du SNC dans le SIDA, provoque une encéphalite et est responsable de 50% de toutes les lésions de masse dans le SNC. Le virus JC, un papovavirus humain, est une autre cause importante d'infections du SNC chez les patients infectés par le VIH-Il entraîne une leucoencéphalopathie multifocale progressive (chapitre 23). L'infection par le virus de l'herpès simplex se manifeste par des ulcérations cutanéo- muqueuses impliquant la bouche, l'œsophage, les organes génitaux externes et la région périanale. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 82
- 83. La diarrhée persistante, fréquente chez les patients non traités atteints de SIDA avancé, est souvent causée par des infections à protozoaires ou à bactéries entériques. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 83
- 84. Tumeurs Les patients atteints du SIDA présentent une incidence élevée de certaines tumeurs, notamment le sarcome de Kaposi, le lymphome à cellules B, le cancer du col utérin chez la femme et le cancer de l'anus chez l'homme. Ces tumeurs sont souvent considérées comme des tumeurs malignes définissant le SIDA. On estime que 25% à 40% des personnes infectées par le VIH non traitées développeront éventuellement une tumeur maligne. Un grand nombre de ces tumeurs sont causées par des virus à ADN oncogéniques, notamment l'herpèsvirus du sarcome de Kaposi (sarcome de Kaposi), le virus EBV (lymphome à cellules B) et le virus du papillome humain (carcinome cervical et anal). Ces virus établissent des infections latentes qui sont contrôlées chez des personnes en bonne santé par un système immunitaire compétent. L'augmentation du risque de malignité chez les patients atteints du SIDA est principalement due à l'incapacité de contenir l'infection après la réactivation des virus et à une diminution de l'immunité cellulaire contre les cellules infectées par le virus subissant une transformation maligne. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 84
- 85. . L’incidence de beaucoup de ces tumeurs, en particulier le sarcome de Kaposi, est diminuant au fur et à mesure que le traitement s’améliorait et que les patients présentaient un déficit immunitaire moindre. Néanmoins, les personnes infectées par le VIH restent plus susceptibles aux tumeurs présentes dans la population générale, telles que les cancers du poumon et de la peau et certaines formes de lymphome. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 85
- 86. Sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi (KS), une tumeur vasculaire rare ailleurs aux États-Unis, est considéré comme une tumeur maligne définissant le sida. La morphologie de la SK et sa survenue chez des patients non infectés par le VIH sont abordées au chapitre 10. Au début de l'épidémie de SIDA, jusqu'à 30% des hommes homosexuels ou bisexuels infectés étaient atteints de SK, mais l'utilisation de la multithérapie a été dramatique, baisse de son incidence ces dernières années. En revanche, dans les régions d’Afrique subsaharienne où l’infection à VIH est à la fois fréquente et en grande partie non traité, le sarcome de Kaposi est l’une des tumeurs les plus courantes. Les lésions de KS sont caractérisées par une prolifération de cellules en forme de fuseau qui expriment des marqueurs des cellules endothéliales (vasculaires ou lymphatiques) et des cellules musculaires lisses. De plus, les lésions KS contiennent des infiltrats inflammatoires chroniques de cellules. Plusieurs caractéristiques de KS suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une tumeur maligne (malgré son nom inquiétant). 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 86
- 87. Il existe des preuves convaincantes que KS est provoqué par le virus de l'herpès KS (KSHV), également appelé virus de l'herpès humain 8 (HHV8). On ne sait toujours pas exactement comment l’infection par le KSHV conduit au KS. À l'instar d'autres virus de l'herpès, le virus KSHV établit l'infection latente au cours de laquelle plusieurs protéines sont produites et peuvent jouer un rôle dans la stimulation de la prolifération des cellules fusiformes et la prévention de l'apoptose. Ceux-ci comprennent un homologue viral de la cycline D, un régulateur du cycle cellulaire (un oncogène), et plusieurs inhibiteurs de p53 (un gène suppresseur de tumeur essentiel), tous deux impliqués dans le développement de la tumeur (chapitre 6). ). Les cellules du fuseau produisent des facteurs proinflammatoires et angiogéniques, qui recrutent les composants inflammatoires et néovasculaires de la lésion, ces derniers fournissant des signaux qui aident à la survie et à la croissance des cellules du fuseau. Cependant, l'infection par le KSHV, bien que nécessaire au développement du KS, n'est pas suffisante et des cofacteurs supplémentaires sont nécessaires. . Dans la forme liée au sida, ce cofacteur est clairement le VIH. La suppression immunitaire induite par le VIH peut contribuer à la dissémination étendue du KSHV chez l'hôte. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 87
- 88. Cliniquement, le SK associé au SIDA est assez différent de la forme sporadique (chapitre 10). Chez les personnes infectées par le VIH, la tumeur est généralement étendue et touche la peau, les muqueuses, le tractus gastro- intestinal, les ganglions lymphatiques et les poumons. Ces tumeurs ont également tendance à être plus agressives que le SK sporadique. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 88
- 89. Les lymphomes. Le lymphome survient à un taux nettement accru chez les personnes atteintes du SIDA, ce qui en fait une autre tumeur définissant le SIDA. Environ 5% des patients atteints du SIDA présentent un lymphome et environ 5% développent un lymphome au cours de leur évolution ultérieure. Même à l'ère du traitement antirétroviral, le lymphome persiste chez les personnes infectées par le VIH à une incidence au moins 10 fois supérieure à la moyenne de la population. Sur la base de la caractérisation moléculaire des lymphomes associés au VIH et des considérations épidémiologiques susmentionnées, au moins deux mécanismes semblent sous-tendre le risque accru de tumeur à cellules B chez les personnes infectées par le VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 89
- 90. Tumeurs induites par des virus oncogènes. L'immunité des lymphocytes T est nécessaire pour limiter la prolifération des lymphocytes B infectés de manière latente par des virus oncogènes tels que EBV et KSHV. Avec l'apparition d'une grave déplétion de lymphocytes T au cours de l'infection par le VIH, ce contrôle est perdu et les lymphocytes B infectés subissent une prolifération non contrôlée qui prédispose aux mutations et au développement de tumeurs à lymphocytes B. En conséquence, les patients atteints du SIDA courent un risque élevé de développer des lymphomes à cellules B agressifs composés de cellules tumorales infectées par des virus oncogènes, en particulier EBV. Les tumeurs se produisent souvent dans des sites extranodaux, tels que le SNC, les intestins, les orbites et les poumons, et ailleurs. Les patients atteints du sida sont également sujets à des lymphomes rares se présentant sous la forme d'épanchements malins (appelés «lymphomes à épanchement primaire»), qui se caractérisent par le fait que les cellules tumorales sont généralement co-infectées à la fois par EBV et par KSHV, un exemple très inhabituel de coopération entre deux cellules oncogènes, les virus. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 90
- 91. Hyperplasie des lymphocytes B germinaux. La majorité des lymphomes apparaissant chez les patients dont le nombre de lymphocytes T CD4 est préservé ne sont pas associés à l’EBV ou au KSHV. L’augmentation du risque de lymphome chez ces patients peut être liée à l’hyperplasie profonde des cellules B du centre germinatif qui se produit lors de l’infection par le VIH. Le niveau élevé de prolifération et les mutations somatiques qui se produisent dans les cellules B du centre germinatif ouvrent la voie à des translocations chromosomiques et à des mutations impliquant des gènes provoquant une tumeur. En fait, les tumeurs à cellules B agressives qui surviennent en dehors du contexte de déplétion sévère des cellules T chez les individus infectés par le VIH, telles que le lymphome de Burkitt et le lymphome diffus à grandes cellules B, sont souvent associées à des mutations d'oncogènes tels que MYC et BCL6 qui portent les marques moléculaires des «erreurs» lors de la tentative de diversification des gènes d'immunoglobuline dans les cellules B du centre germinal. Plusieurs autres proliférations liées à l'EBV méritent également d'être mentionnées. Lymphome de Hodgkin, une tumeur inhabituelle à cellules B associée à une réponse inflammatoire tissulaire prononcée (chapitre 12), est également plus fréquente chez les individus infectés par le VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 91
- 92. nombreux patients séropositifs (mais pas tous) atteints Les lymphomes de Hodgkin ont un faible nombre de CD4 au moment de la présentation de la maladie. L'infection à EBV est également responsable de la leucoplasie pileuse de la bouche (projections blanches sur la langue), qui résulte de la prolifération de cellules muqueuses de la muqueuse buccale induite par l'EBV (chapitre 15). Autres tumeurs. En plus du SK et des lymphomes, les patients atteints du SIDA ont également une incidence accrue de carcinome du col utérin et de cancer de l'anus. Ces deux tumeurs sont fortement associées à l'infection par le virus du papillome humain, qui est mal contrôlée dans le contexte de l'immunosuppression. lymphome de Hodgkin associé au VIH, les cellules tumorales caractéristiques (cellules de Reed-Sternberg) sont infectées par le virus EBV. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 92
- 93. Maladie du système nerveux central L’implication du SNC est une manifestation commune et importante du SIDA. Quatre-vingt-dix pour cent des patients présentent une forme quelconque d’atteinte neurologique à l’autopsie et 40 à 60% présentent un dysfonctionnement neurologique cliniquement apparent. Il est important de noter que chez certains patients, les manifestations neurologiques peuvent être la caractéristique unique ou la plus précoce de l’infection par le VIH. Les lésions comprennent une méningo-encéphalite ou méningite aseptique présumée auto-limitée, une myélopathie vacuolaire, des neuropathies périphériques et, le plus souvent, une encéphalopathie progressive appelée trouble neurocognitif associé au VIH (chapitre 23). 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 93
- 94. Effet de la pharmacothérapie anti-rétrovirale sur l'évolution de l'infection à VIH L'avènement de nouveaux médicaments ciblant les enzymes transcriptase inverse, protéase et intégrase virales a changé le visage clinique du sida. Lorsqu'une combinaison d'au moins trois médicaments efficaces est utilisée chez un patient motivé et docile, la réplication du VIH est réduite au-dessous du seuil de détection (<50 copies d’ARN / ml) et y reste aussi longtemps que le patient adhère au traitement. Une fois le virus supprimé, la perte progressive de lymphocytes T CD4 + est arrêtée et le nombre de lymphocytes T CD4 + périphériques augmente lentement, revenant souvent à un niveau normal. Avec l'utilisation de ces médicaments, le taux de mortalité annuel dû au sida aux États-Unis est passé d'un sommet de 16 à 18 pour 100 000 personnes en 1995-1996 à moins de 4 pour 100 000. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 94
- 95. . De nombreux troubles associés au sida, tels que les infections opportunistes à P. jiroveci et le sarcome de Kaposi, sont maintenant rares. Un traitement antirétroviral efficace a également réduit la transmission du virus, en particulier des mères infectées aux nouveau-nés. Malgré ces améliorations spectaculaires, plusieurs nouvelles complications associées à l’infection à VIH et à ses les traitements ont émergé. Certains patients à un stade avancé de la maladie traités par antirétroviraux développent une détérioration clinique paradoxale au cours de la période de rétablissement du système immunitaire malgré l’augmentation du nombre de cellules T CD4 + et la diminution de la charge virale. Ce trouble, appelé syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire, n’est pas compris, mais il est supposé être une réponse mal régulée de l’hôte au fardeau antigénique élevé des microbes persistants. . Une complication plus importante du traitement antirétroviral à long terme concerne peut- être les effets secondaires indésirables des médicaments. Lipoatrophie (perte de graisse faciale), lipoaccumulation (dépôt de graisse excessif au centre), lipides élevés, résistance à l'insuline, neuropathie périphérique, et maladies cardiovasculaires, rénales et hépatiques prématurées. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 95
- 96. . Enfin, la morbidité non liée au sida est beaucoup plus répandue que la morbidité classique liée au sida chez les patients traités au long cours par HAART. Les principales causes de morbidité sont le cancer et les maladies cardiovasculaires accélérées. Le mécanisme de ces complications non liées au SIDA n'est pas connu, mais une inflammation persistante et un dysfonctionnement des lymphocytes T pourraient jouer un rôle. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 96
- 97. MORPHOLOGIE Les modifications dans les tissus (à l'exception du cerveau) ne sont ni spécifiques ni diagnostiques. Parmi les caractéristiques pathologiques courantes du SIDA figurent les infections opportunistes, le sarcome de Kaposi et les lymphomes à cellules B. La plupart de ces lésions sont discutées ailleurs, car elles se produisent également chez des personnes non infectées par le VIH. Les lésions du système nerveux central sont décrites au chapitre 23. Les échantillons de biopsie prélevés sur des ganglions lymphatiques hypertrophiés au début de l'infection par le VIH révèlent une hyperplasie marquée des follicules à cellules B, qui prennent souvent des formes inhabituelles et serpigineuses. Les zones du manteau qui entourent les follicules sont atténués et les centres germinaux empiètent sur les zones de cellules T interfolliculaires. Cette hyperplasie des cellules B est le reflet morphologique de l'activation des cellules B polyclonale et de l'hypergammaglobulinémie observée chez les individus infectés par le VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 97
- 98. . Avec la progression de la maladie, la frénésie de prolifération des cellules B s’apaise et cède la place à un schéma d’involution lymphoïde sévère. Les ganglions lymphatiques sont épuisés en lymphocytes et le réseau organisé de cellules dendritiques folliculaires est perturbé. Les centres germinaux peuvent même devenir hyalinisés. Au cours de ce stade avancé, la charge virale dans les nœuds est réduite, en partie à cause de la perturbation des cellules dendritiques folliculaires. Ces "épuisés" les ganglions lymphatiques sont atrophiques et petits et peuvent héberger de nombreux pathogènes opportunistes, souvent dans les macrophages. En raison de immunosuppression profonde, la réponse inflammatoire à Les infections des ganglions lymphatiques et des sites extranodaux peuvent être clairsemé ou atypique. Par exemple, les mycobactéries ne parviennent souvent pas à évoquer la formation de granulomes car les cellules CD4 + sont déficientes, et la présence de ces agents infectieux et d'autres peut ne pas être apparente sans taches spéciales. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 98
- 99. Comme on pouvait s'y attendre, l'involution lymphoïde ne se limite pas aux nœuds; Aux stades ultérieurs du SIDA, la rate et le thymus sont également convertis en «terrains incultes» pratiquement dépourvus de lymphocytes. Malgré des progrès impressionnants dans notre compréhension et notre traitement de l’infection par le VIH, le pronostic à long terme des patients atteints du sida reste une préoccupation. Bien qu'avec un traitement médicamenteux efficace, le taux de mortalité ait diminué aux États-Unis, les patients traités sont toujours porteurs de l'ADN viral dans leurs tissus lymphoïdes. Une thérapie véritablement curative reste insaisissable. De même, bien que des efforts considérables aient été déployés pour mettre au point un vaccin protecteur, de nombreux obstacles doivent encore être surmontés avant que cela ne devienne réalité . Les analyses moléculaires ont révélé un degré alarmant de variation des isolats de virus provenant de patients; cela rend la tâche de production d'un vaccin extrêmement difficile. . Les efforts récents se sont concentrés sur la production d’anticorps largement neutralisants contre des portions relativement invariantes de protéines du VIH La prévention, les mesures de santé publique et les médicaments antirétroviraux restent donc actuellement les piliers de la lutte contre le sida. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 99
- 100. RÉSUMÉ COURS CLINIQUE ET COMPLICATIONS DE L’INFECTION À VIH Progression de la maladie. L'infection à VIH progresse par phases. L’infection aiguë par le VIH. Manifestations de maladie virale aiguë La Phase chronique (latente). Dissémination du virus, réponse immunitaire de l'hôte, destruction progressive des cellules immunitaires. SIDA. Déficit immunitaire sévère. Caractéristiques cliniques. Le sida déclaré se manifeste par plusieurs complications, principalement dues à un déficit immunitaire. Infections opportunistes Tumeurs, en particulier des tumeurs causées par des virus oncogènes complications neurologiques de pathogenèse inconnue La thérapie antirétrovirale a considérablement réduit l'incidence des infections opportunistes et des tumeurs, mais comporte également de nombreuses complications. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 100
- 101. Diagnostic Le CDC recommande de procéder à des tests initiaux avec un dosage immunologique associant antigène / anticorps, suivi d’un dosage immunologique de confirmation différenciation des anticorps VIH-1 / VIH-2. Si le test de confirmation est négatif, le test avec un test d'acide nucléique VIH-1 est effectué. Le traitement varie et peut inclure une combinaison traitement antirétroviral, inhibiteurs de la transcriptase inverse, inhibiteurs de la protéase et prophylaxie des infections opportunistes sur la base du nombre de CD4. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 101
- 102. Les manifestations cliniques de l'infection à VIH varient dans le temps. La phase aiguë est caractérisée par une virémie avec réduction des CD4. lymphadénopathie, symptômes viraux de type mononucléose et séroconversion. La phase latente est caractérisée par une asymétrie généralisée persistante. adénopathie avec poursuite de la réplication virale dans les ganglions lymphatiques et la rate, faible taux de virus dans le sang et infections opportunistes mineures y compris le muguet (candidose) et le zona. La durée moyenne de la phase latente est de 10 ans. La progression vers le SIDA (troisième phase) se produit avec une réduction du nombre de CD4 à <200 cellules / mL, qui s'accompagne d'une réémergence de la virémie et du développement de maladies définissant le SIDA, pouvant entraîner la mort. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 102
- 103. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 103
- 104. Remarque Les macrophages et les cellules dendritiques folliculaires sont des réservoirs du virus. La numération des cellules CD4 + est utilisée pour déterminer la santé du système immunitaire et pour formuler des recommandations sur l’instauration d’une prophylaxie pour les maladies opportunistes. La charge virale est suivie pour évaluer l'efficacité du traitement. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 104
- 105. Maladies définissant le SIDA La leucoplasie poilue est une affection associée au virus d'Epstein-Barr (EBV) due à une infection de cellules squameuses. Des plaques blanches sont présentes sur la langue. Le sarcome de Kaposi est le néoplasme le plus répandu chez les patients atteints du SIDA. (Voir le chapitre sur la pathologie vasculaire.) 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 105
- 106. Figure 7-4. Sarcome de Kaposi chez un patient atteint du sida 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 106
- 107. Les lymphomes non hodgkiniens tendent à être des lymphomes à cellules B de haut grade; Les lymphomes extranodaux du SNC sont fréquents. Le cancer du col de l’utérus, le syndrome d’émaciation par le VIH, la néphropathie du sida et le complexe de la démence du sida sont d’autres maladies caractéristiques du sida. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 107
- 108. IMMUNOLOGIE DU REJET DES TRANSPLANTES Le rejet est principalement dû aux différences d'allèles HLA entre donneur et receveur. Les agents immunosuppresseurs sont utilisés pour prévenir et atténuer les rejets. Le rejet hyperactif se produit dans les minutes ou les heures qui suivent en raison de la présence d’anticorps préformés chez le receveur. La compatibilité croisée des lymphocytes a presque éliminé ce problème. Le rejet aigu se produit au cours des six premiers mois et peut être cellulaire (les lymphocytes T CD8 + détruisent les cellules du greffon) ou à médiation anticorps. Le rejet chronique survient après des mois ou des années et peut être à médiation cellulaire ou à médiation anticorps. Les composants vasculaires sont ciblés et les modifications histopathologiques dépendent de l'organe impliqué. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 108
- 109. Résumé (suite) Les syndromes d'immunodéficience secondaire peuvent être causés par des maladies systémiques telles que le diabète sucré, une maladie vasculaire du collagène (c'est-à-dire, le LES) et l'alcoolisme chronique. On dit que le SIDA est présent lorsqu'un patient est séropositif avec un nombre de CD4 <200 cellules / mL ou séropositif avec une maladie définissant le SIDA. Le VIH peut se transmettre par contact sexuel, transmission parentérale ou verticale. Le virus est un rétrovirus à ARN avec transcriptase inverse et prédilection pour infecter les cellules CD4 +. L'infection à VIH produit une phase aiguë ressemblant à la mononucléose, une phase latente asymptomatique, puis une progression vers le sida. Le SIDA clinique se caractérise par une susceptibilité à une grande variété d’infections opportunistes.08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 109
- 110. Le rejet consécutif à une greffe de tissu peut se produire de 3 manières différentes: Rejet hyperactif, en raison d'anticorps préformés Rejet aigu, provoqué par les lymphocytes T et les anticorps Rejet chronique, provoqué par les cellules T et les anticorps ciblant le système vasculaire 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 110
- 111. LE SAVIEZ-VOUS? Depuis 2013, les scientifiques ont commencé utiliser la moelle osseuse greffer chez les patients porteurs du gène CCR5, le résultat s’avère très prometteurs vu que déjà deux cas ont été déclarés définitivement guéris avec une charge virale indétectable tel qu’énoncé par le Dr Eckhard THIEL pour son patient baptisée Delta 32 suite à la mutation Delta 32 observée chez ce patient. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 111
- 112. LE SAVIEZ-VOUS? Dans leurs collimateurs, les scientifiques sont déjà entrain d’étudier d’autres gènes comme Apobec3 ou TRIMM22; Un traitement révolutionnaire qui pourrait éliminé le virus VIH chez les animaux est aussi en étude, il s’agit de l’édition génomique (CRISPR- Cas9) associé à un traitement antirétroviral CRISPR-Cas9: Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats ou Courtes Répetitions Palindromiques groupées et régulièrement espacées. 112
- 113. Conclusion Le système immunitaire humain, étant l’armée chargée de la défense des tous les autres système dans le sens le plus complexe possible, se détériore à chaque instant qu’il est exposé aux agents pathogènes, parmi les quels le Virus de l’immunodéficience humaine constitue le plus grand défis à la médecine humaine. Ainsi, il altère l’immunité humaine et conduit à une suite des réactions immunopathologique connue sous le nom de l’immunodéficience acquise et plus spécialement le SIDA qui a fait l’objet de notre travail. Dans ce module, nous avons retracer les mécanismes par lesquels ce Virus, le VIH, entraine cette défaillance du système immunitaire jusqu’à son épuisement. Nous avons aussi donnés un aperçu sur la tri-thérapie antirétrovirale et un focus sur l’écolution des découvertes scientifiques dans la thérapie contre le VIH. 08/02/2020MAHAZI William/ Coordonateur AFIA NETWORK 113