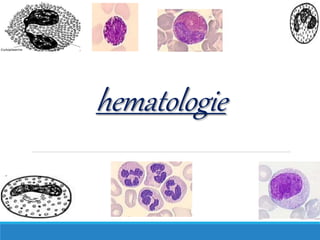
cours d'hématologie
- 1. hematologie
- 2. LE POLYNUCLÉAIRE NEUTROPHILE En nombre absolu il y a donc en théorie de 1700 à 7000 polynucléaires par mm3 chez l’homme et ces chiffres seuls ont un intérêt pratique.
- 3. Fonctions du polynucléaire neutrophile Sa fonction essentielle est la phagocytose de corps étrangers et surtout de bactéries. Le polynucléaire a donc essentiellement une activité antibactérienne qu’il assure grâce à une série de propriétés caractéristiques. Mobilité Chimiotactisme Phagocytose Bactéricide Digestion
- 6. Destin du PN, durée de vie Le PN ne séjourne que très peu dans le sang qui n’est pour lui qu’un lieu de passage. En 12 heures environ, 50% des PN du sang l’ont déjà quitté pour passer dans les tissus. De là, les PN ne retournent jamais vers le sang : ils effectuent leurs fonctions de phagocytose et sont détruits par les cellules macrophages, sur place ou dans les ganglions.
- 7. LES POLYNUCLÉOSES NEUTROPHILES L’augmentation pathologique du nombre de polynucléaires neutrophiles, au-dessus de la limite de 7000 par mm3, peut relever de deux situations : la polynucléose réactionnelle bénigne, transitoire et spontanément résolutive, et la polynucléose dans le cadre d’une prolifération maligne ou « syndrome myéloprolifératif »
- 10. LES NEUTROPÉNIES ET LES AGRANULOCYTOSES Neutropénies par insuffisance de production médullaire (centrales) • La neutropénie survenant dans le cadre d’une insuffisance médullaire globale accompagne une thrombopénie et une anémie normochrome arégénérative, mais la neutropénie peut parfois être la première manifestation Neutropénies par disparition des cellules circulantes (périphériques) ◦ Par auto-immunisation anti-polynucléaires neutrophiles isolée ou dans le cadre du lupus érythémateux ◦ Par hypersplénisme, la neutropénie est due à la séquestration dans le secteur marginal de la rate. Elle est constamment associée à une thrombopénie ◦ Par trouble de répartition : la plus grande partie des PN est alors marginée au lieu d’être circulante. Les PN ne sont pas comptés à la numé- ration mais ils existent et sont disponibles en cas d’infection. Il n’y a donc pas de risque infectieux. C’est la cause la plus fréquente des « neutropénies mineures », sans conséquence pathologique.
- 12. Diagnostic d’une neutropénie profonde ou d’une agranulocytose.
- 13. ANOMALIES QUALITATIVES DES GRANULOCYTES Anomalies morphologiques Les moins rares sont l’anomalie de Pelger-Huet (hyposegmentation des PN), l’anomalie de Undritz (hypersegmentation des PN) et celle de May-Hegglin avec inclusions basophiles (corps de Döhle) dans le cytoplasme. Elles sont familiales et parfaitement bénignes. L’exceptionnelle anomalie de Chediak avec granulations géantes évolue en revanche vers une insuffisance médullaire ou un lymphome.
- 14. LE POLYNUCLÉAIRE ÉOSINOPHILE Propriétés et fonctions • Les grains du polynucléaire éosinophile, comme ceux du polynucléaire neutrophile, sont des lysosomes et comme le polynucléaire neutrophile, le polynucléaire éosinophile est doué de mobilité et de phagocytose • il phagocyterait spécialement les complexes antigène-anticorps et peut- être plus spécialement les réagines des réactions allergiques. Il porte un récepteur à haute affinité pour les IgE et synthétise de nombreuses cytokines pro inflammatoires. Il joue un rôle dans la destruction de certaines larves de parasites sensibilisées par des anticorps, en libérant des protéines cathioniques très cytotoxiques qui désorganisent les membranes des parasites
- 15. On ne peut parler d’hyperéosinophilie que lorsqu’il existe plus de 500 éosinophiles par mm3 Causes des hyperéosinophilies. Les affections allergiques Asthme Eczéma et réactions allergiques chroniques Sensibilisation médicamenteuse Les parasitoses, surtout par les helminthes Certains cancers et hémopathies malignes. Le syndrome hyperéosinophilique L’hyperéosinophilie se rencontre dans : la maladie de Hodgkin, des lymphones T, certains cancers (foie, ovaires), la leucémie à éosinophile est extrêmement rare.
- 17. LE POLYNUCLÉAIRE BASOPHILE Il est caractérisé par de grosses granulations basophiles noirâtres qui ont une structure spéciale au microscope électronique : inégale avec figures myéliniques ou gros grains internes. Sur le plan cytochimique ces cellules (comme les mastocytes) ont une réaction métachromasique avec les colorants basiques, comme le bleu de Toluidine qui colore leurs grains en rouge.
- 18. Propriétés et fonctions* Cellule riche en histamine et porteuse d’un récepteur à haute affinité pour les IgE le polynucléaire basophile passe dans les tissus en cas de réaction inflammatoire. Les mêmes facteurs de croissance que ceux actifs sur l’éosinophile règlent sa production, particulièrement l’IL3.
- 19. BASOCYTOSES Ce sont des anomalies rares et d’intérêt diagnostique limité. On peut parler de basocytose lorsqu’en nombre absolu le taux de basophiles supérieur à 100 par mm3. En pratique étant donné la rareté de cette cellule ce chiffre est difficile à apprécier avec précision. Les basocytoses se rencontrent dans les maladies suivantes : – leucémies myéloïdes chroniques et autres syndromes myéloprolifératifs, grandes hyperlipémies, hypothyroïdie
- 20. LE MONOCYTE Le monocyte est la plus grande des cellules circulantes; il est caractérisé par un noyau encoché (mais non polylobé). Son cytoplasme contient de fines granulations azurophiles. L’aspect en microscopie électronique n’a rien de caractéristique. La cytochimie en revanche montre une activité phosphatase alcaline faible, une activité peroxydasique franche mais labile, et une intense activité estérasique, qui distingue cette cellule des granulocytes.
- 21. Fonctions Comme le polynucléaire neutrophile, le monocyte est capable de phagocyter et d’éliminer les bactéries grâce à des granulations lysosomales dont le contenu est proche de celui des polynucléaires neutrophiles. Cependant, c’est au niveau des tissus, où il se transforme en macrophage (dont la durée de vie peut être de plusieurs mois) ou en cellule dendritique, que le monocyte exerce ses principales fonctions : élimination des cellules âgées, des « déchets », des substances étrangères par le macrophage, et rôle dans la genèse de la réaction immunitaire, la cellule dendritique présentant les antigènes aux lymphocytes T, à la phase initiale de la réponse immunologique.
- 22. MONOCYTOSES Elles sont définies par un nombre de monocytes sanguins supérieur à 1000/mm3. Monocytoses réactionnelles Ce sont des anomalies relativement fréquentes mais de signification diagnostique limitée. Elles s’observent au cours de maladies infectieuses et, contrairement aux notions classiques, pas spécialement au cours de la maladie d’Osler ou de la tuberculose, mais en réponse à diverses infections : bactériennes, virales ou parasitaires. Des monocytoses réactionnelles au cours d’états inflammatoires non spécifiques sont également fréquentes. La monocytose qui survient au début de la phase de correction d’une agranulocytose est intéressante à connaître, car elle témoigne de la récupération des fonctions médullaires, les monocytes qui ont une synthèse médullaire rapide sortant avant les polynucléaires et annonçant ceux-ci.
- 23. Monocytoses malignes Elles surviennent soit dans le cadre de leucémies aiguës monocytaires, soit dans le cadre de leucémies chroniques myélomonocytaires , Monocytoses chroniques isolées Elles sont rares mais elles représentent en général le premier symptôme d’une maladie médullaire maligne telle que la leucémie myélomonocytaire chronique ou une dysmyélopoïèse acquise.
- 24. MONOCYTOPÉNIES C’est un problème qui se pose rarement en pathologie, ou en association avec une neutropénie. Il existe cependant dans le cas particulier des leucémies à tricholeucocytes
- 25. Plaquette Les plaquettes résultent de la fragmentation programmée du cytoplasme des mégacaryocytes. Données quantitatives • Chez le sujet normal la concentration des plaquettes est de 150 à 500.103 par millilitre de sang.
- 26. Fonctions des plaquettes Ce sont principalement des fonctions liées à l’hémostase. Elles jouent également un rôle dans la réponse inflammatoire, par l’activation des facteurs chimiotactiques, et par la sécrétion d’amines vasopressives qu’elles transportent et dont elles se chargent dans la circulation. Elles auraient aussi un rôle de phagocytose, pouvant éliminer de petites particules et des bactéries.
- 27. Thrombopoïèse Les plaquettes proviennent de la fragmentation du cytoplasme des mégacaryocytes localisés dans la moelle osseuse. Ceux-ci proviennent eux-mêmes de la différenciation d’une cellule souche, puis de progéniteurs particuliers, selon un mode de division et de maturation unique, marquée par l’endomitose. La thrombopoïèse est régulée par la thrombopoïétine.
- 29. LES THROMBOCYTOSES Les thrombocytoses permanentes sont, en règle générale, dues à une hyperproduction médullaire. Leur conséquence essentielle est le risque de thrombose, dû à la formation d’agrégats plaquettaires dans la circulation.
- 30. Syndromes myélodysplasiques Les syndromes myélodysplasiques sont des hémopathies clonales. fréquentes chez l'adulte au-delà de 60 ans, découvertes devant un tableau d'anémie ou fortuitement devant une ou plusieurs cytopénies sanguines. Le plus souvent idiopathiques, 15 % des cas surviennent cependant dans les années suivant une chimiothérapie ou une radiothérapie pour un autre cancer, mais aussi après exposition à des radiations ionisantes ou au benzène. hématopoïèse inefficace par avortement intramédullaire