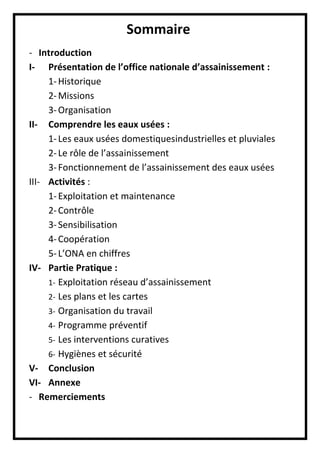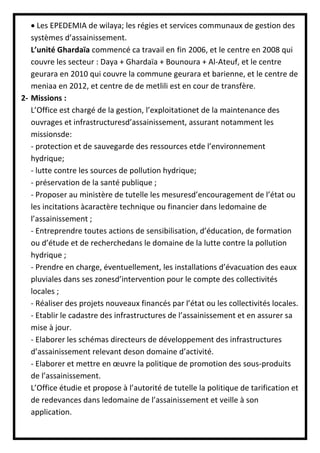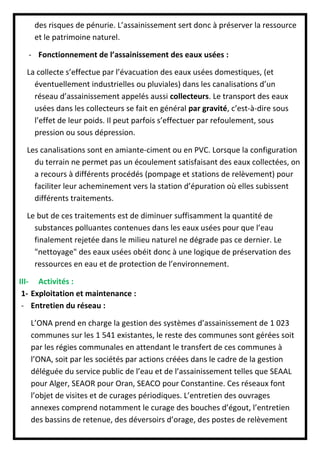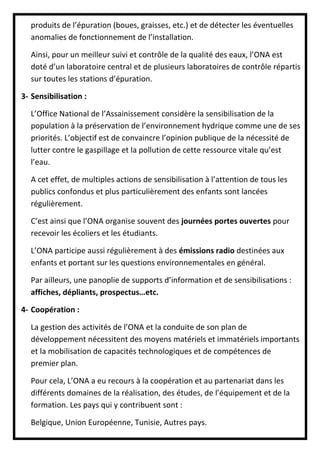Le document présente un rapport de stage sur l'exploitation des réseaux d'assainissement en Algérie, mettant en lumière les missions et l'organisation de l'Office National d'Assainissement (ONA). Il traite également des types d'eaux usées, de leur pollution, et des activités de l'ONA telles que l'exploitation, la maintenance, le contrôle et la sensibilisation du public. Enfin, le rapport inclut des données chiffrées illustrant l'ampleur des opérations gérées par l'ONA.