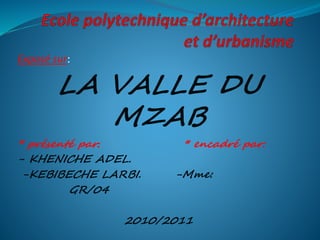
Maison traditionelle à mzab 5
- 1. Exposé sur: LA VALLE DU MZAB * présenté par: * encadré par: - KHENICHE ADEL. -KEBIBECHE LARBI. -Mme: GR/04 2010/2011
- 2. -Plan de travail: 1-situation et historique. 2-plan de fonction des espaces. 3-plan de dénomination. 4-plan des usages des espaces. 5-personnes qui vivre dans ces espaces. 6-orientation de l’habitation. 7-les différences entre les habitation.
- 3. 1-situation et historique: Le paysage de la vallée du M’Zab, créé au Xe siècle par les Ibadites autour de leurs cinq ksour, ou villages fortifiés, semble être resté intact. Simple, fonctionnelle et parfaitement adaptée à l’environnement, l’architecture du M’Zab a été conçue pour la vie en communauté, tout en respectant les structures familiales. C’est une source d’inspiration pour les urbanistes d’aujourd’hui. La vallée du M'Zab, qui se trouve dans le désert du Sahara, 600 km au sud d'Alger, a été occupée par un peuple bien spécifique, et ceci dans une zone très petite. Le plateau et les pentes rocheuses bordant cette vallée, qui a été ravagée par de rares mais dévastatrices crues de son wadi, présentent les traces d'une occupation humaine très ancienne. Toutefois, l'occupation capillaire du territoire et l'adaptation d'une architecture profondément originale à un site semi-désertique remontent au début du XIe siècle, et sont le fait d'un groupe humain clairement défini par ses idéaux religieux, sociaux et moraux.
- 5. Les Ibadites, dont la doctrine procédait du purisme intransigeant du kharidjisme, ont dominé une partie du Maghreb au cours du Xe siècle. Ils fondèrent un État dont la capitale, Tahert, a été détruite par un incendie en 909 ; ils recherchèrent alors de nouvelles bases territoriales, d'abord Sedrata, puis la vallée du M'Zab. Le site témoigne, de manière tout à fait exceptionnelle, de l'apogée de la culture ibadite. La première raison qui les poussa à choisir cette vallée, qui n'avait jusqu'alors été habitée que par des groupes nomades, fut certainement qu'elle offrait des possibilités défensives importantes pour une communauté préoccupée au premier chef par sa protection, et profondément soucieuse de la conservation de son identité, fût-ce au prix de l'isolement. L'occupation du territoire et l'organisation de l'espace ont été régies par des principes extrêmement stricts, remarquables tant par leur précision que par leur détail. Un groupe de cinq ksour (villages fortifiés) - El-Atteuf, Bou Noura, Beni Isguen, Melika et Ghardia - construits sur des affleurements rocheux regroupait une population sédentaire, et fondamentalement urbaine. Chacune de ces citadelles en miniature, enfermée dans une muraille, est dominée par une mosquée dont le minaret fonctionnait comme une tour de guet. Trois éléments récurrents - le ksar, le cimetière, la palmeraie avec sa citadelle d'été - se retrouvent dans ces cinq villages. Ils illustrent ainsi un exemple d'habitat humain traditionnel tout à fait représentatif d'une culture qui a survécu jusqu'au XXe siècle.
- 6. La mosquée, avec son arsenal et ses greniers, était conçue comme une forteresse, le dernier bastion de résistance en cas de siège. Autour de cet édifice, essentiel pour la vie communautaire, les maisons sont implantées en cercles concentriques jusqu'au mur d'enceinte. Chaque maison, formée d'un espace cubique standardisé, illustre un idéal égalitaire ; de même, dans le cimetière, l'attention n'est attirée que par les tombes des sages et par de petites mosquées. La vie dans la vallée du M'Zab impliquait une migration saisonnière : chaque été, la population se déplaçait dans les palmeraies, où les « villes d'été » étaient organisées de manière plus lâche, avec des maisons soigneusement défendues, des tours de guet et une mosquée sans minaret, comparable à celles des cimetières.
- 8. 2-plan de fonction des espaces: Les maisons du ksar, la ville historique: l’entrée se fait par une ouverture en général unique qui se présent comme un trou rectangulaire dans le mur façade , en particulier a cause de seuil maconé.ci le percement est bas environ 1.70m de hauteur ,il est par contre assez large 1.10/1.20m ,la porte est été tout au moins le plus souvent ouverte. la chicane (skifa /taskift)intrepose ses écrans a la pénétration du regard au cœur de la maison . Parfois la skifa donne directement sur un salon pour les hommes ou sur un escalier qui conduit a ce même salon mais situé a l’étage (le laali).
- 9. dans l’ongle droite par rapport a l’entrée un autre percement conduit a un vestibule plus lumineux qui prolonge la skifa ,pièce rectangulaire qui sert de passage et est en général affecté a l’installation du métier a tisser a lisses verticales. il situe dans un endroit bien aérée permet de travailler dans l’aire fraiche. a cause des épaisseurs des murs ils ont creusée des niches dans la maçonnerie a environ 0.50m du sol. elles tiennent le mobilier et les objets qui ne reste pas au sol. parfois il y’a des meurtrières (Chouf) qui sont situé a un faible hauteur.
- 10. Ces lieux de transitions conduit a la pièce la plus vaste de rez de chaussé qui est aussi la plus éclairée ; West eddar (amesentidar), espace centrée et passage obligatoire ,il apparait comme rangement , emplacement pour un métier a tisser , patio , cheminé , étagères …etc. ,c’est la seul pièce qui joue un rôle de distribution sur les autres pièces. elle reçoive la une ouverture vaste sur l’éxterieur autre que la porte ,un percement dans le plafond, forme rectangulaire ,éclairage zénithal , elle est appelée c pour une pièce qui rassemble les activités dourines sa surface dépend de la taille de maison (10-25m2). Avec la présence des poteaux maçonnés qui prennent les portés insuffisantes des solives en bois de palmier.
- 11. Le tizefri profite bien la lumière de west eddar ,l’espace y est assez aménagée , des niches trouvent place sur les murs faisant face a l’entrée toujours a un hauteur accessible de la main quand les hommes sont amenés a pénétrés dans la maison c’est la que les femmes se regroupent. Sa donne une naissance d’un nouvel espace (le salon des femmes) le temps qu'elles peuvent surprendre les visages par un chouf. les espaces qui sont occupées les angles de la maison sont plus interchangeable et modèlent, leur forme en fonction de l’implantation de la maison dans le tissue urbain; ils sont appelés sont des pièces obscures , fermés ou non selon la nature de leur destination. (tazkaa) ou (bit)
- 12. les plus petites servent de dépôt a proximité de la cuisine.(réserve d’eau , palme sèche , bois pour le feux , nourriture , légumes , dattes …etc.). les autres sont plus vastes (4-6m2) , 1 ou2 au RDC avec un seuil et une porte en bois qui l’isolent de West eddar ,une de ces chambres abrite souvent une personne âgée. La dispositif consacrés a l’hygiene sont importants, les lieux d’ablution sont reliées au salles de prières , les cabinets d’aisance (ajmir) se présentent sous forme d’un volume réduit a l’entrée étroite souvent en chicane aucun porte ne les fermées. Un trou rectangulaire découpée dans le sol est placée au dessus d’une fosse ou les matières sèchent , aucun eau n’y jetée ,elle est vidée périodiquement , les matières sèches sont utilisée comme angaries.
- 13. le dernier élément qui nous conduira a l’étage c’est l’escalier qui situe dans un angle les volées sont courtes , les marches sont hautes 20 a 25 cm . l’escalier est un volume indépendant qui ne se développe pas dans le volume d’une piéceparticuliere c’est un goulet cocue pour gestualité théâtrale. On accède a l’étage par une volé de 8 a 10 marche. on trouve 2 escaliers ; l’un est en relation avec la skifa ,évite la vue sur west eddar , on obtient 2 circuit a l’interieur de la maison l’un féminin et familiale et l’autre masculin et réservée aux hôtes. La pièce plus souvent en cul de sac dont l’aménagement reçoit beaucoup de soin, le laali c’est plus vaste en étage que le RDC.
- 14. *a l’étage: L’étage on trouve une organisation des espaces qui apparait similaire a celle de RDC autour d’un espace central des pièces de dimensions plus petites , cette organisation a une logique constructif qui fait correspondre a l’ensemble des murs et poteaux de l’étage les élément porteur de rdc qui en sont les descentes de charge. l’escalier familial débouche de façon systématique sous un portique qui se développe sur un ou deux cotés de la maison , il s’appel c) ouvre a travers deux ou trois arcs sur l’espace central , on n’est pas dehors et on n’est pas dedans aussi . L’ikoumar ouvre sur une cours a ciel couvert qui peut se trouve au centre ou sur un coté de l’étage et qui est dénommée ( tigharghart ) qui situe au dessus de west eddar avec la présence de chebek qui reprendra la lumière.
- 15. C’est une terrasse protégée par 4 murs et baignée du soleil.il est découvert de l’ikoumar. WC et toilette contribuent a assurer une indépendance a ce niveau.par rapport au RDC. Les plus vastes pièces sont les chambres ,en particulier d’un fils marie. Les autres sont pour les réserve de nourriture , des vêtements …etc. Quelque marches conduit au dernier niveau de la maison.les limites de maison deviennent imprécises a ce niveau certain cotés s’arreter sur les murs d’acrotéres et les autres ont maçonnerie qui prolonge en hauteur les murs. Il y’a une porte qui permet d’acceder au terrasses des Autres maisons.
- 16. 2-plan de dénomination : Quand les Mzab sont des berbères –musulmans ils ont des dénominations spéciaux tels que : - la chicane : (skifa /taskift) - l’étage : ( ennedj ). - des meurtrières : (Chouf) - West eddar : ( amesentidar) - L’ikoumar - ( tigharghart - (tazkaa) ou (bit) : les chambres. - Ennedj amakrame : terrasse .
- 17. 3-plans des usages des espaces : Totalement il y’a deux grands principes qui semblent présider a l’usage de l’espace : 1-lié aux saisons : par exemple en hiver les soirées et les nuits se déroulent au RDC , le mieux protège des rigueurs du froid par contre le début de la journée se déroulera sur les terrasses ou sous l’ikoumar. -en été les terrasses devienderont inconfortable dans la journée a cause de chaleur et de la luminosité,dans la nuit il faut profiter des bienfaits des écartes de température. -en été le RDC aura été raffraichi par les courants d’airs de la nuit .
- 18. 2- liée au sexe : l’homme et la femme ne fréquentent pas la maison de même façon , ce qui peut être transparent dans l’espace bâti c’est l’occupation itinérante a laquelle il se prête en fonction des monuments du jour et de l’année . -a travers son utilisation féminine et masculine la maison apparait comme le lieu de passage symbolique entre le monde de l’homme et celle de la femme -la ou s’arrete le monde de la femme , commence le monde de l’homme et sa continue comme sa . -donc la maison c’est le lieux special de la famille ou les gens négosient , racontent , rencontrent …etc.
- 19. • A travers cette description en distingue deux types d’espaces : 1-ceux commandés qui sont en cul et sac. 2-qui constituent une modalité d’accés .
- 20. 5-orientation des espaces : ce qui est important c’est que l’ouverture du tizefri et west eddar se fait selon une orientation qui EST , dans les ksour toujours sensiblement la même vers le SUD –EST , soleil levant mais aussi direction de la Mecque pour les musulmans du Mzab , quelque soit la situation du maison dans la ville , pour chacun d’elles , l’axe TIZEFRI / WEST EDDAR apparaitra sur le plan comme l’aigouille d’une boussole. la partie sud / sud est ne reçoit jamais la lumière (l’ensemble des pièces sont obscures). Au nord en trouve le tizefri s’il est ne reçoit pas toujours la lumière directement il est toujours bien éclairé par la flexion des rayons sur le sol.
- 21. 6- les differences entre les espaces: Ces differences sont défini par l’importance de chaque espace dans la maison parmi lesquelles on situe : 1-le west eddar prend une position stratégique dans la maison , c’est le foyer de famille c’est le lieu de passage obligatoire , il contrôle tous les mouvements , il sépare les espaces et les rassemble en même temps. 2-par contre les espaces de stockage de nourriture et autre produits sont plus petits et a coté de la cuisine , donc ils ont une relation avec la cuisine , c’est pour sa les Mzab distribuent les espace par rapport a leur importance .