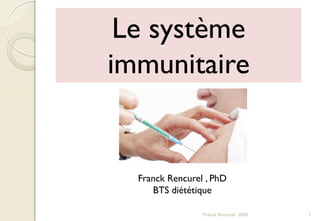
Bts diététique systeme immunitaire
- 1. 1Franck Rencurel 2020 Le système immunitaire Franck Rencurel , PhD BTS diététique
- 2. Franck Rencurel 2020 2 Immunologie Définition: Etude des défenses physiologique où l’organisme (l’«hote ») distingue le soi du non-soi (« matériel étranger ») Au cours de ce processus il (l’organisme) neutralise les substances étrangères.
- 3. 3Franck Rencurel 2020 Objectifs pédagogiques Etre capable de décrire l’organisation du système immunitaire De connaitre la terminologie spécifique à ce système D’expliquer la différence entre immunité innée et acquise, médiation cellulaire et humorale
- 4. IMMUNOLOGIE - Sommaire Introduction Les lignes de défense I. Première ligne : les barrières superficielles I.1 Peau I.2Voie respiratoire I.3 Muqueuse digestive 4Franck Rencurel 2020
- 5. IMMUNOLOGIE - Sommaire II. La résistance II.1 La réaction inflammatoire II.1.1 Généralités II.1.2 Inflammation aigue/chronique II.1.3 Les phases de l’inflammation II.1.4 Les médiateurs de l’inflammation II.2 Les phagocytes II.3 Les cellules tueuses II.4 Les granulocytes éosinophiles II.5 Les protéines antimicrobiennes II.6 La fièvre 5Franck Rencurel 2020
- 6. IMMUNOLOGIE - Sommaire III. L’immunité III.1 Généralités III.1.1 Les cellules de l’immunité III.1.2 Les sites de l’immunité III.1.3 Reconnaissance du Soi / non-Soi III.1.4 Spécificité des Lymphocytes III.2 Immunité humorale III.2.1 Mécanismes III.2.2 Les anticorps III.3 Immunité à médiation cellulaire III.4 Résumé III.5 Immunité passive / active III.6 Anomalies du système immunitaire 6Franck Rencurel 2020
- 7. Introduction Barrières physiques et système de défense contre des éléments étranger: microorganismes, et éléments solides. Barrière physique: Peau / muqueuses (barrière cellulaire et chimique cf mucus) Défenses Défenses non spécifiques : Macrophages / monocytes / granulocytes Défenses spécifiques : Met en jeux les Lymphocytes Spécifiques contre une structure macromoléculaire de l’adversaire : l’antigène Médiation cellulaire ou humorale 7Franck Rencurel 2020
- 8. 8Franck Rencurel 2020 Agresseur Réaction immunitaire Réponse Non spécifique Indépendante de la nature de l’agresseur Réponse Spécifique dépendante de la nature de l’agresseur Cellules immunocompétentes Médiation cellulaireMédiation humorale LymphocytesT Cytolyse Lymphocytes B Anticorps Destruction amplification
- 9. Définitions Système immunitaire : Ensemble des réactions spécifiques et non spécifiques mises en œuvre par l’organisme pour réagir contre tout corps étranger identifié comme « non-soi ». ANTIGENE : Toute substance qui entraîne une réponse immunitaire lors de son introduction dans le corps et qui induit la production d’anticorps dirigés contre elle. ANTICORPS : Protéine spécifique dirigée contre un antigène, produite par le plasmocyte après exposition d’1 Lymphocyte B à un antigène 5 classes d’anticorps : Ig G / Ig E / Ig A / Ig M / Ig D 9Franck Rencurel 2020
- 10. 10Franck Rencurel 2020 3 lignes de défense 1 barrières 2 Résistance 3 Immunité
- 11. I-LES BARRIÈRES 11Franck Rencurel 2020
- 12. 12Franck Rencurel 2020 La peau et les muqueuses Barrières physiques Barrières chimiques Kératine Epithélium Mucus Desquamation Sébum, transpiration Acidité gastrique/vaginale Lysozyme (Salive, larmes, transpiration)
- 13. Franck Rencurel 2020 13 La peau: Organe de défense. barrière bloquant l’entrée des micro-organismes La peau: organe immunitaire.
- 14. 14 • La kératine (barrière physique) • La sueur (lysozyme) et le sébum (graisses et acidité) sont bactéricides Et fongistatiques Si par lésion, le corps étranger pénètre l’épiderme: Kératinocytes et cellules de Langerhans (dentritiques) Sécrètent des médiateurs chimiques interleukines (Il-1) Qui attirent et activent les lymphocytesT sur le site d’agression. Franck Rencurel 2020 I.1 La peau :
- 15. 15 I.2 Les voies respiratoires: • Epithélium cilié • Cellules à mucus • Macrophages alvéolaires (phagocytose des poussières) I.3 La muqueuse digestive : • Salive : IgA, lysozyme, glycoprotéines bactéricides • Estomac : HCl antiseptique (acidité gastrique, 1,5<pH <5 • Intestin : Flore microbienne Plaques de Peyer Lymphocytes intraépithéliaux Franck Rencurel 2020
- 16. Franck Rencurel 2020 16 Epithélium cilié
- 17. II-LA RÉSISTANCE 17Franck Rencurel 2020
- 18. Franck Rencurel 2020 18 La résistance constitue la seconde ligne de défense Réaction inflammatoire Phagocytes et cellules tueuses Agents antimicrobiens Fièvre phagocytose
- 19. II.1 l’inflammation II.1.1 Généralités Définition : Réponse des tissus vivants, vascularisés à une agression Objectif : Défendre le corps et réparer les dégâts causés par l’agression Lieu : Tissu conjonctif vascularisé Etiologie : • Infection • Agents physiques • Agents chimiques • Corps étrangers • Défaut de vascularisation • Système immunitaire défaillant Agression Destruction tissulaire Débris cellulaires + germes Nettoyage+ réparation 19Franck Rencurel 2020
- 20. II.1 L’inflammation II.1.2 Inflammation aigueVS inflammation chronique: Inflammation aigue • Réponse immédiate à une agression • Courte durée : jours - semaines • Guérison spontanée ou avec traitement Inflammation chronique • Inflammation sans aucune tendance vers la guérison • Persistante avec +/- aggravation • Longue durée : Mois - années 20Franck Rencurel 2020
- 21. 21Franck Rencurel 2020 Les 5 signes de l’inflammation Chaleur Rougeur gonflement douleur Perte de fonction
- 22. Franck Rencurel 2020 22 Lésion Phase vasculaire et inflammatoire Amorce 2 à 4 jours Phase de prolifération Réparation 10 à 15 jours Phase de Remodellage Maturation 2 mois à 2 ans Apoptose Différentiation cellulaire (épiderme) Réorganisation de la matrice extracellulaire Cicatrisation Cellules lésées remplacées Cellules vasculaires
- 23. II.1.3 Les différentes phases de l’inflammation: II.1.3.1 phase vasculaire • 4 signes spécifiques : Chaleur Rougeur Gonflement de la zone agressée/ œdème Douleur • La libération de médiateurs chimiques suite à l’agression induit : Vasodilatation des capillaires Augmentation de la perméabilité capillaire = fuite de liquides dans le milieu extracellulaire Œdème inflammatoire (fuite d’exsuda avec protéines dans le tissu = compression des tissus = DOULEUR) Phénomène de chimiotactisme (recrutement de cellules immunitaires) 23Franck Rencurel 2020
- 24. II.1.3.2 La Phase cellulaire • Leucocytose augmentation du nombre de leucocytes dans le sang • Arrivée massive des cellules immunitaires au niveau de la lésion • Diapédèse leucocytaires (polynucléaires et monocytes) (les cellules traversent l’endothélium vasculaire) • Phagocytose des agents pathogènes par neutrophiles • Différenciation des monocytes en macrophages • Phagocytose massive par les macrophages 24Franck Rencurel 2020
- 25. II.1.3.2 Réaction cellulaire 25Franck Rencurel 2020 http://dev.maxicours.com:9041/se/fiche/7/8/395887. html/ts
- 26. II.1.3.3 Détersion ou nettoyage • Simultanément à la phase cellulaire • Elimination des débris et tissus nécrosés par phagocytose Drainage de l’exsuda via le système lymphatique Évacuation du pus via la peau ou conduit bronchique/urinaire/intestinal 26Franck Rencurel 2020
- 27. II.1.3.4 Réparation et cicatrisation • A lieu seulement si le nettoyage est complet (par l’organisme ou par action externe) • Implique facteurs de croissance + interactions cellules-MEC • Présence d’un tissu de remplacement ou « bourgeon charnu » • Constitution d’une cicatrice si aucune possibilité de régénération (TC fibreux +++ en remplacement des tissus fonctionnels) • Réparation épithéliale 27Franck Rencurel 2020
- 28. Franck Rencurel 2020 28
- 29. Franck Rencurel 2020 29 II.I.4 Les médiateurs de l’inflammation Histamine Basophiles Mastocytes Prostaglandines Globules blancs Cellules du tissu endommagéL’histamine augmente la perméabilité vasculaire et permet la contraction des muscles lisses localement. Au niveau de système nerveux, elle déclenche la douleur Dérivés des phospholipides membranaires Acide arachidonique le père des prostaglandines (dérivé des w-6)
- 30. Franck Rencurel 2020 30 II.I.4 Les médiateurs de l’inflammation Vasodilatation NO,Activateur du plasminogène (PAF), Histamine, Prostaglandines**, Kinines* Perméabilité vasculaire (PAF),Histamine, BradyKinines*, Leucotriènes**(C4,D4,E4) Chimiotactisme Leucotriènes, produits bactériens, chimiokines,Thrombine, PDF Fièvre Douleur Destruction IL-1, IL-2,TNF, Prostaglandine E2 Bradykinine, Prostaglandines Radicaux libres, NO, Lysosomes, cytokines lymphocytaires
- 31. Franck Rencurel 2020 31 Homéostasie Inflammation http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/immunite-et- vaccination/thematiques/immunite-innee-barrieres-naturelles-et-reaction- inflammatoire/les-mediateurs-de-l2019inflammation
- 32. 32Franck Rencurel 2020 II. 2. Les Phagocytes Les Neutrophiles Les Macrophages (macrophagocytes)
- 33. Franck Rencurel 2020 33 II.2. Les phagocytes Linéage cellulaire Leucocytes Granulocytes Agranulocytes Basophiles Eosinophiles Neutrophiles Lymphocytes Monocytes Macrophages
- 34. Franck Rencurel 2020 34 Neutrophiles et Macrophages Neutrophiles Abondants en début d’infection. Aspect polynucléé mais 1 SEUL NOYAU! Rôle de nettoyage Phagocytose des agents étrangers. Très riches en lysosomes (granulation cytoplamsiques) Macrophages Actifs après qqs heures Phagocytose Cellules présentatrices d’antigène
- 35. 35Franck Rencurel 2020 II.3. Les cellules NK, tueuses Naturelles Ce sont de très gros lymphocytes avec nombreuses granulations. Issues de la lignée lymphocytaire, produites dans la moelle osseuse. Les cellules NK se distinguent des lymphocytes T et B par l’absence d’Ig et de CD3. (caractérisées par la présence de CD56) La spécificité de ces cellules est d’être capable de lyser des cellules malades sans nécessiter d’activation préalable et sans rentrer en contact avec l’agent pathogène.
- 36. Franck Rencurel 2020 36 II.3. Les CellulesTueuses naturelles (Natural Killer) Représentent 5 à 15 % des lymphocytes Elles sont présentes dans le sang, les organes lymphoïdes (rate, amygdales, ganglions périphériques) et dans certains tissus (foie, poumons, placenta) Eliminent les cellules tumorales, infectées/parasitées sans immunisation préalable. Ils provoquent la lyse cellulaire Ils Font partie de l’immunité innée Sont capables d’activité immunomodulatrice en recrutant et activant d’autres cellules du système immunitaire par la libération de cytokines.
- 37. 37Franck Rencurel 2020 Reconnaissance des cellules pathologiques via des récepteurs membranaires dirigés contre des protéines, lipides, sucres à la surface des cellules
- 38. Franck Rencurel 2020 38 II. 4. Granulocytes éosinophiles Concentration sanguine augmente lors d’infections (parasites)et allergies, asthme, urticaire et certains cancers.(éosinophilie) Libèrent de l’histamine S’attaquent aux « grosses proies » comme des vers parasites Faible pouvoir de phagocytose, agit plutôt sur la destruction enzymatique (enzymes contenues dans les granulations)
- 39. II.5 Les protéines antimicrobiennes 39 Le complément : • Le complément est un système de protéines sériques qui comporte une trentaine de constituants, solubles et membranaires. Il est impliqué dans la réponse innée aux infections, dans l’élimination des complexes immuns et dans la régulation de la réponse spécifique. Ce sont des enzymes • Activation selon une réaction en cascade (type coagulation) : Via la réponse spécifique ou Classique: Fixation d’un complexe Ag-Ac Via la réponse innée non spécifique ou Alterne: Pas d’intervention d’ immunoglobulines Franck Rencurel 2020
- 40. Activation du complément: Franck Rencurel 2020 40 Voie classique: activée par le complexe immun faisant intervenir la reconnaissance de ce complexe sur l’ Ig. Voie majoritaire d’activation du complément! Les fragments C4a, C3a et C5a, sont capables de déclencher une réaction inflammatoire en se liant à des récepteurs (monocytes, macrophages, polynucléaires, mastocytes, plaquettes) et sont appelés anaphylatoxines Nous verrons ceci dans la partie « immunité » Voie Alterne: Immunité innée, voie de défense antibactérienne. protéines B,D,C3, properdine
- 41. Activation Complément:Voie Alterne Franck Rencurel 2020 41 Le but est de former le « Complexe d’Attaque Membranaire » (MAC) constituant des pores dans la membrane de la bactérie pour la détruire (entrée d’eau et d’ion=choc osmotique) Aucune Ig n’intervient ici
- 42. « Opsonisation » Complément Franck Rencurel 2020 42 Définition: C’est l’activation de la phagocytose par liaison d’une protéine (opsonine) sur l’élément à phagocyter . Liaison de C3b sur la bactérie après activation CR1 sur le macrophage se lie à C3b sur la bactérie Phagocytose de la bactérie par le macrophage Formation du Phagosome par fusion de membrane Les lysosomes fusionnent avec le phagosome= phagolysosome
- 43. 43Franck Rencurel 2020 Le complément: Protéines antimicrobiennes Complément ++ réponse inflammatoire ++ efficacité macrophages ++ chimiotactique Macrophages ++ ++ efficacité destructrice des Ig
- 44. II.5 Les protéines antimicrobiennes 44 Les interférons : Définition : • Petites protéines produite par les cellules en réponse à une agression virale ou contre des cellules cancéreuses. Globules blancs mais aussi cellules dendritiques ou épithéliales. Actions : • Régulatrice et stimulatrice du système immunitaire • Participent à la réaction inflammatoire : Stimulent la production IL-1 => Activation des LymphocytesT Activent des cellules NK Augmentent l’activité phagocytaire des macrophages Franck Rencurel 2020
- 45. Franck Rencurel 2020 45 Les interférons Trois type d’interférons: Alpha (2a et 2b) ils sont utilisés contre l’hépatite B et hépatite C. Bloquent la réplication du virus, Stimulent les macrophages Bloque la division cellulaire (utilisée par les virus) Béta Mal connu, semble ralentir la progression de la sclérose en plaque. Gamma Actifs contre les cellules cancéreuses. NB: les interférons ne sont pas spécifiques d’un virus mais sont de puissants activateurs des macrophages
- 46. Franck Rencurel 2020 46 Les interférons Signal à la cellule voisine non infectée de détruire les ARN et de bloquer La synthèse protéique (utilisée pour la réplication du virus) Signal à la cellule voisine infectée de déclencher l’Apoptose (Mort cellulaire) Activation des cellules immunitaires Macrophages)
- 47. II.5 Les protéines antimicrobiennes 47 Les lysozymes : Définition : • Glycoprotéines présentes majoritairement dans les sécrétions et liquides biologiques (larmes, salives, lait maternel, plasma..) • Interviennent dans la digestion des produits de la phagocytose Actions : • Le lysozyme est une protéase capable d’ « attaquer » la paroi des bactéries.‘digestions des glucides de la paroi. • Action non spécifique (défense innée). • N.B ne pas confondre avec le Lysosome qui contient des hydrolases! Franck Rencurel 2020
- 48. 48Franck Rencurel 2020 II. 6. La Fièvre
- 49. Franck Rencurel 2020 49 Définition: La fièvre est une augmentation régulée de 1 à 4 degrés au dessus de la température corporelle normale. Sous le contrôle su SNC (hypothalamus) . Différent de l'hyperthermie (coup de chaleur) qui est un mécanisme non régulé par leSNC. Chez l'homme: 37°C +/- 0,5 II. 6. La Fièvre L'hypothalamus reçoit les infos afférentes qui proviennent soit de thermo-récepteurs périphériques (ex: peau) qui donnent des infos sur la température extérieure, soit des infos provenant du sang circulant.
- 50. 50Franck Rencurel 2020 II. 6. La Fièvre Pyrogènes Endogènes (cytokines) Exogènes (constituants de la paroi bactérienne) Causes ++ Efficacité des GB ++ Efficacité des cytokines Lysozyme … Dénature certaines protéines des microorganismes Effets Plus rarement: fatigue, coup de chaleur Fréquent lors de vaccination chez enfants
- 51. Franck Rencurel 2020 51 II. 6. La Fièvre Pyrogènes exogènes Pyrogènes endogènes RécepteursTLR (Phagocytes et toutes cellules) Récepteurs spécifiques Réponse inflammatoire Prostaglandine E2 Hypothalamus Fièvre •Les bactéries Gram – produisent des lipopolysaccharides. •Les bactéries Gram+ produisent des toxines •IL-1 β (c'est la plus importante) •TNF α (Tumor Necrosis Factor) •IL-6 •IFN α/β (Interféron)
- 52. Franck Rencurel 2020 52 II. 6. La Fièvre Les cas suivant nécessitent de consulter un médecin Toutes hausses deT° chez un nourrisson UneT° supérieure à 38,5 °C Chez un enfant la T° buccale ou auriculaire se situe entre 36 °C et 36,8°C Un enfant est fiévreux avec T° >38,2°C
- 53. II.7 La protéine C-réactive (C-RP) 53 Définition : • Produite par le foie (hépatocytes) • Élevée si infection bactérienne, inflammation, tumeur mais aussi surpoids et diabète (C-RP x3) Valeurs normale <2mg/l Actions : • Participe à la réaction inflammatoire, • joue le rôle d’opsonine Franck Rencurel 2020
- 54. T A viscéral 3x plus d’IL-6 Dépôts androïdes surtout viscéraux Augmentation des risques Cardiovasculaires Insuline résistance IL-6 CRP IL-6 CRP Adipocytes Hépatocyte Foie CRP bactéries Activation Phagocytes Inflammation Tissus Sécrétion insuline Cardiovasculaire Pancréas Opsonisation 54Franck Rencurel 2020
- 56. 56Franck Rencurel 2020 III.I Généralités Les défenses spécifiques se différencies de la défense innée par: Plus longues à se mettre en jeu Défenses plus efficaces Spécificité contre un antigène précis Systémique Défenses mémorisées nécessitant un apprentissage
- 57. Franck Rencurel 2020 57 III.I Généralités Deux voies Médiation humorale* Médiation Cellulaire Lymphocytes B produisent des anticorps (Immunoglobulines ou Ig) LymphocytesT attaquent les cellules identifiées comme étrangères *Humorale => via la circulation sanguine
- 58. Franck Rencurel 2020 58 III.I. I Les cellules de l’immunité Lymphocytes B LymphocytesT Macrophages Migrent en grand nombre dans Les ganglions lymphatiques Maturation dans le thymus. Migrent dans les ganglions lymphatiques Abondants dans les organes lymphoïdes et tissus conjonctifs
- 59. Franck Rencurel 2020 59 III.I. 2 Les sites de l’immunité Les organes lymphoïdes
- 60. Franck Rencurel 2020 60 Organes lymphoïdes primaires Le Thymus Base du cou sous le sternum 2 lobes Maturation des LymphocytesT sous l’action de 2 hormones: LaThymuline et la Thymopoïetine. Acquisition des récepteurs de reconnaissance des antigène et les co -récepteurs CD4 et CD8 Contrôle qualité dans leThymus (reconnaissance antigène, reconnaissance du soi) LeThymus s’atrophie à l’adolescence et laisse place à un tissu graisseux
- 61. Franck Rencurel 2020 61 Organes lymphoïdes primaires La Moelle osseuse Synthèse des éléments figurés du sang. Dans tous les os mais surtout thorax, rachis, épaules, bassin. Cellules souches produites sous l’action de facteurs de croissance. Différentiation en cellules mâtures.
- 62. Franck Rencurel 2020 62 Ontogenèse des lymphocytesT
- 63. Franck Rencurel 2020 63 Organes lymphoïdes secondaires Les ganglions lymphatiques
- 64. Franck Rencurel 2020 64 Organes lymphoïdes secondaires Les ganglions lymphatiques Filtrage de la lymphe, élimination des débris cellulaires, des bactéries Ils sont regroupés en chapelet au niveau de l’abdomen, du thorax, du cou, des aisselles et de l’aine. C’est dans ces trois dernières zones qu’ils peuvent devenir palpables lorsqu’ils gonflent. Le ganglion est le lieu de reconnaissance de l’antigène par un Lymphocytes qui se multipliera par la suite. •Différentiation en lymphocyteT qui migre dans le sang vers l’agresseur •Lymphocytes B devenant Plasmocytes produisant et libérant les anticorps spécifiques de l’agresseur.
- 65. 65Franck Rencurel 2020 Organes lymphoïdes secondaires La rate Hypocondre gauche, accolé derrière l’estomac (grande courbure) Organe mou d’environs 300g qui se compose de 2 parties : - La pulpe rouge qui filtre les globules rouges (hématies) et en stocke une partie. - La pulpe blanche qui sert à la défense immunitaire de l'organisme Vie Fœtale: Erythropoïese. Naissance et adulte: Stock et maturation des GR Elimination des débris cell et GR anormaux par les macrophages Maturation des lymphocytes (cf ganglions) mais ici les Ig libérées directement dans le sang et non dans la lymphe
- 66. 66Franck Rencurel 2020 III.I.3 Reconnaissance du soi/Non soi Pr Jean Dausset (1916-2009) Prix Nobel Médecine 1980 Complexe Majeur d’Histocompatibilité (CMH) ou Système HLA (Human Leucocyte Antigen) chez l’Homme
- 67. 67Franck Rencurel 2020 III.I.3 Reconnaissance du soi/Non soi Le CMH est un groupe de gènes sur le chromosome 6 codant pour des glycoprotéines membranaires à la surface des cellules. L’objectif: identifier l’intrus en se reconnaissant soi-même ! CMH de classe 1: 3 gènes HLA –A, HLA-B, HLA-C Présent dans toutes les cellules nuclées (donc pas les GR) ni la cornée (greffe sans typage HLA). ( la classe 3 code surtout pour des protéines solubles impliquées dans l’immunité commeTNFa..) 3 classes de gènes du CMH
- 68. 68Franck Rencurel 2020 III.I.3 Reconnaissance du soi/Non soi CMH de classe II : Expression constitutive, beaucoup plus restreinte, par une famille de cellules appelées «Cellules Présentatrices de l’Antigène» (les macrophages, lymphocytes B, LymphocytesT activés uniquement!, cellules dendritiques Famille complexe avec des sous régions. 3 types de protéines: HLA-DR: la chaine alpha codée par le gène DRA HLA-DQ: les chaines alpha et beta codée par DQA1 et DQB1 HLA-DP: codées par les gènes DPA1 et DPB1
- 69. 69Franck Rencurel 2020 III.I.3 Reconnaissance du soi/Non soi Rôle CMH : Présentation des antigènes . Classe I: Antigènes endogènes (virus, cellules cancéreuses) Les virus utilisent la cellule pour se multiplier. Classe II: Antigènes d’origine extracellulaire : bactéries, parasites, cellules infectées. Toutes ces molécules sont exprimées à la surface d’une cellule uniquement si elles ont fixé un peptide (pas stables sinon). Le système immunitaire surveille continuellement ce qui est exprimé à la surface de la cellule (du Soi : il ne se passe rien, si étranger : réaction immunitaire).
- 70. III.1.3 Reconnaissance du soi 70 NOTER: Il y a cytotoxicité des LT cytotoxiques s’il y a une double complémentarité entre : Antigène et récepteur antigénique du LTcytotoxique (TCR) Molécule HLA classe I et molécule CD8 du LTcytotoxique NB : CD4 ou CD8 sont des marqueurs antigéniques de surface des LT CD pour Cluster de différentiation Franck Rencurel 2020 Les lymphocytesT sont activés par présentation de l’antigène par le CMH
- 71. 71Franck Rencurel 2020 III.I.4 spécificités des lymphocytes B et T Chaque Lymphocyte B ouT possède sur sa surface membranaire un récepteur capable de se lier à un antigène donné (BCR ouTCR).
- 72. 72Franck Rencurel 2020 III.I.4 spécificités des lymphocytes B et T Des millions de lymphocytes produits. Chaque lymphocyte caractérisé par son récepteur membranaire donc par l’antigène qui peut s’y lier. Durant la vie fœtal, toutes sortes de lymphocytes sont produits Y compris certains dirigés contre soi mais ils sont rapidement éliminés par apoptose. Erreurs => Maladie auto-immunes
- 73. Franck Rencurel 2020 73 III.I.4 spécificités des lymphocytes B et T Bertrand Arnulf Immuno-hématologie Saint Louis L3 Physiopathologie du système immunitaire et immunothérapies CSH: Cellule Souche Hematopoïetique CSM: Cellule souche myeloïde CSL: Cellule Souche Lymphoïde
- 74. 74Franck Rencurel 2020 Les récepteurs antigéniques des lymphocytes : Mis en place durant la maturation des Lymphocytes • LymphocytesT : Présence d’un récepteur antigénique : le TCR avec 1 partie variable spécifique à un antigène donné. • Lymphocyte B : Présence d’un récepteur antigénique :Anticorps Ig M, avec 1 partie variable spécifique à un antigène donné.(voir suite cours) III.I.4 spécificités des lymphocytes B et T
- 75. 75Franck Rencurel 2020 III. 2 Immunité Humorale Production d’anticorps par les lymphocytes B sur la membrane. L’Ig membranaire est un récepteur antigénique
- 76. 76Franck Rencurel 2020 Immunité à médiation humorale 1-Liaison Ag-Ig, sélection clonale Les lymphocytes B reconnaissent directement l’Ag 2- Prolifération des clones 3- Différentiation 4- Diffusion des anticorps III.2.1 mécanisme
- 77. 77Franck Rencurel 2020 III.2.1 mécanisme Ontogenèse des lymphocytes B et T Vander 6è ed. Physiologie humaine
- 78. 78Franck Rencurel 2020 III.2.1 mécanisme Après élimination de l’agresseur les clones de Lymphocytes B meurent. Seuls les lymphocyes B « mémoire » subsistent Division clonale rapide grâce aux lymphocytes B « mémoire » Principe utilisé lors de la vaccination
- 79. 79Franck Rencurel 2020 III.4 Immunité Humorale Le macrophage phagocyte le corps étranger Macrophage devient une CPA* qui migre vers les organes lymphoïdes secondaires Un fragment peptidique (épitope) est fixé à la membrane par le CMH Dans les organes lymphoïdes secondaires les LymphocytesT immatures se lient spécifiquement à l’antigène par le TCR La liaison au TCR entraine l’activation de gène permettant l’expression de Cytokines, la division cellulaire et la différentiation Des lymphocytesT Helper. CPA=cellule présentatrice d’antigène
- 80. Franck Rencurel 2020 80 Présentation de l’antigène peptidique par le CMH II et liaison au TCR dans les organes lymphoïdes secondaires. Cellule présentatrice d’antigène
- 81. 81Franck Rencurel 2020 1) Les macrophages (présentatrices de l’antigène) 2)Les lymphocytesT auxiliaires (Helper) (TCD4+) La réponse immunitaire humorale nécessite 2 types de cellules et des interleukines: IL
- 82. Franck Rencurel 2020 82 L’interleukine 2 produite par le LymphocyteT auxiliaire stimule: •La multiplication des lymphocytes B et leur transformation en Plasmocytes •La différentiation des lymphocytesT (CD8) en lymphocytesT cytotoxiques
- 83. 83Franck Rencurel 2020 Les immunoglobulines (anticorps) Soit membranaires sur les lymphocytes B Soit circulants (anticorps) libérés par les plasmocytes Structure protéique 2 chaines lourdes 2 chaines légères Structure globale représentée enY
- 84. 84Franck Rencurel 2020 III.2.2 Les anticorps Neutralisation des toxines et virus en s’y fixant Agglutination des bactéries Lyse cellulaire Opsonisation
- 85. 85Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa
- 86. 86Franck Rencurel 2020 III.2.2 Les anticorps Les anticorps se ressemblent mais ont des régions différentes. Fonctions différentes Affinités différentes Spécificités différentes Portions bioactives différentes
- 87. 87 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 5 classes d’anticorps
- 88. 88 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa
- 89. 89 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa
- 90. 90 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa
- 91. 91 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa
- 92. 92 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa IgA
- 93. 93 III.2.2 Les anticorps Franck Rencurel 2020 Dr. Dominic Bergeron Professeur adjoint Département Biochimie, Microbiologie et Immunologie Faculté de médecine U. Ottawa
- 94. 94Franck Rencurel 2020 Immunité à médiation cellulaire
- 95. 95 III.3 Immunité médiation cellulaire Franck Rencurel 2020 Les lymphocytesT cytotoxiques se fixent sur l’antigène spécifique et libèrent des « perforines », Enzymes faisant des trous dans la membrane/paroi cellulaire
- 96. 96 III.3 Immunité médiation cellulaire Franck Rencurel 2020 Les lymphocytes T agissent contre: •Les cellules cancéreuses •Les parasites (nématodes) •Les cellules « non soi » (greffes) •Cellules infectées par virus
- 97. 97 III.3 Immunité médiation cellulaire Franck Rencurel 2020 LiaisonTCR antigène Sensibilisation du LT Activation par les LT auxiliaires (cytokines..) Division et différentiation en LT actifs et LT mémoire
- 98. 98 III.4 Résumé Franck Rencurel 2020 Cellules NK (Natural Killer) Appartiennent à l’immunité non spécifique. Se lient de façon non spécifique aux cellules cancéreuses ou infectées (virus) Lymphocytes B Appartiennent à l’immunité spécifique. Production d’anticorps LymphocytesT cytotoxiques Se fixent de façon spécifique sur des cellules exprimant des protéines « étrangères » à leur surface et les détruisent LymphocytesT Helper (auxiliaires) Deviennent actifs au contact des CPA Activent l’expansion clonale des lymphocytes B et T sensibilisés LymphocytesT suppresseurs Mettent fin à la réponse immunitaire
- 99. Franck Rencurel 2020 99 1Er contact antigène Anticorps 2Eme contact antigène Lymphocyte B LymphocyteT auxiliaire LymphocyteT cytotoxique Plasmocytes Cellules mémoires Cellules mémoires LymphocyteT Cytotoxique Activés Macrophage CPA Phagocytose Devient stimule stimulestimule Antigène libre Active directement Antigène présenté Par la cellule infectée (CMH) active Donne naissance à Donne naissance à stimule Médiation cellulaireMédiation Humorale Liaison antigène Opsonisation, neutralisation Destruction des cellules infectées ou cancéreuses
- 100. 100Franck Rencurel 2020 III.5 Immunité Active/Passive
- 101. 101Franck Rencurel 2020 III.5 Immunité Active/Passive Artificielle ou Naturelle Artificielle ou Naturelle
- 102. 102Franck Rencurel 2020 III.5 Immunité Active/Passive Immunité Passive C’est le transfert d’anticorps (Ig) de façon naturelle ou artificielle Naturelle Anticorps monoclonaux Immunothérapie (Cancer)
- 103. Franck Rencurel 2020 103 Un anticorps monoclonal est une Ig dirigée spécifiquement contre un épitope d’un antigène donné. Il est dit monoclonal car produit par un seul clone de plasmocytes Utilisation: Diagnostique Maladie auto-immune Immunothérapie cancer Production « InVitro » par génie génétique
- 104. 104Franck Rencurel 2020 Immunité Active Provoquer la réponse immunitaire par contact avec l’antigène •Infections tout au long de la vie •Acquisition d’immunité chez les enfants (plus souvent malades que les adultes) •Apprentissage de nouveaux antigène lors de voyages Naturelle: Artificielle: •Vaccination
- 105. 105Franck Rencurel 2020 III.5 Immunité Active/Passive La vaccination Microorganismes vivants virulents mais atténués (ex:BCG) Microorganismes morts (inactivé) (ex: Grippe) Toxines neutralisées(Toxoïdes) (Ex: tétatnos) Antigènes isolés produits par génie génétique (hépatite B) Les adjuvants permettent un relargage progressif de l'antigène, une meilleure prise en charge par les cellules présentatrices de l'antigène et une réponse immunitaire innée plus efficace. Adjuvant de Freund (émulsion huile/eau), dérivés d’Alun (sels d’aluminium), protéines améliorant la liaison antigène/TCR
- 106. 106Franck Rencurel 2020 III.5 Immunité Active/Passive La vaccination mime une première rencontre avec l'antigène et permet la mise en place d'une réponse mémoire qui sera plus efficace pour contrôler l'infection elle-même
- 107. 107Franck Rencurel 2020 III.6 Anomalies du système immunitaire
- 108. 108Franck Rencurel 2020 III.6 Anomalies du système immunitaire Maladies auto-immunes Polyarthrite rhumatoïde Sclérose en plaque (SEP) Diabète de type 1 Allergies Bénin si local Peut-être mortelle si systémique
- 109. 109Franck Rencurel 2020 III.6 Anomalies du système immunitaire Allergies Libération d’histamine Par les mastocytes Mastocytes Couverts D’IgE Liaison Ag/IgE Libération Massive d’histamine Histamine => Inflammation +++
- 110. Franck Rencurel 2020 110 III.6 Anomalies du système immunitaire https://sites.google.com/site/lesitedemmuller/pages-des-troisiemes/protection-de-l-organisme/allergies
- 111. 111Franck Rencurel 2020 Déséquilibres immunitaires
- 112. La maladie de Crohn Franck Rencurel 2020 112
- 113. Franck Rencurel 2020 113 La maladie de Crohn Découverte aux USA en 1932 par le Dr Burrill Bernard Crohn C’est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) Adolescents et jeunes adultes Diarrhées chroniques (jusqu’à plusieurs mois) Douleurs abdominales Fièvre et perte de poids
- 114. Franck Rencurel 2020 114 La maladie de Crohn Génétique Immunologie Microbiote Environnement Physiopathologie
- 115. Franck Rencurel 2020 115 La maladie de Crohn Physiopathologie Pays nordiques plus touchés que le sud (120000 personnes en France) Urbains plus que les ruraux Classes aisées plutôt que défavorisées Familles Crohn (8 à 40%) (concordance des sites anatomique lésés au sein d’une fratrie) Tabac ++ Incidence max 18-30 ans
- 116. Franck Rencurel 2020 116 La maladie de Crohn Lésions ulcéro- scléreuses pouvant toucher tout le tube digestif (bouche Anus). Colon Crohn Colon sain
- 117. Franck Rencurel 2020 117 Mucus + microbiote Barrière physique Cohésion des entérocytes Système immunitaire Représente 60-70% des cellules Immunitaires de L’organisme 3 barrières 1 2 3 Immunité du tube digestif Tissus conjonctif simple richement vascularisé (sang et lymphe) Le plus grand tissu exposé au milieu extérieur (300m2 vs peau 1,5 m2
- 118. Franck Rencurel 2020 118 Immunité du tube digestif Polynucléaires et monocytes première défense en cas d’intrusion de bactéries Corps étrangers. Réponse innée Contact d’une bactérie ou protéine alimentaire (ex gluten) avec les Cellules dendritiques: CPA migrent dans les plaques de Peyer (ganglions sous l’épithélium) où elles activent les lymphocytesT (Filtres à antigènes) (peptides antimicrobiens Contrôle du microbiote)
- 119. Franck Rencurel 2020 119 Tolérance immunitaire La diversification alimentaire dès le 4ème mois permet au système immunitaire de s’adapter aux nouveaux aliments (antigènes). Les bactéries aident aussi à l’apprentissage du système immunitaire. La flore Intestinale évolue au cours de la diversification alimentaire. Les cellules épithéliales participent aussi à l’immunité. Les TLR (Toll like receptor) présents sur la membrane lient les antigènes bactériens. Synthèse d’IL-8 chimiotactique attirant les neutrophiles.
- 120. Franck Rencurel 2020 120
- 121. Franck Rencurel 2020 121
- 122. Franck Rencurel 2020 122 1er contact 2ème contact
- 123. Franck Rencurel 2020 123 En situation normale, d’homéostasie, les antigènes commensaux n’induisent pas de réponse immune forte. Barrière physique (mucus, renouvellement rapide des entérocytes) Production de cytokines immunosuppressives activant les lymphocytesT régulateurs (Il-10,TGF-b) Les cellules dendritiques produisent de l’IL-10 et TGF-b inducteurs des lymphocytesT régulateurs
- 124. Franck Rencurel 2020 124 Rupture de l’homéostasie intestinale Les MICI sont une rupture de l’homéostasie intestinale, les évènement initiateurs sont encore mal connus Réponse inappropriée du SI Surexpression du récepteurTLR4 dans le cas de la maladie de Crohn. Surproduction de cytokines (IFNg, IL-6,TGF..) dans le cas de la maladie de Crohn Augmentation de la perméabilité pericellulaire responsable d’inflammation (épithélium non cohésif)
- 125. Franck Rencurel 2020 125 Rupture de l’homéostasie intestinale
- 126. Franck Rencurel 2020 126 Thérapies Base des traitements: cibler la réponse immunitaire intestinale Dérivés aminosalicylés (sulfasalazine, mesalazine) Anti-inflammatoires En première intension, bien tolérés, peu d’effets secondaires Corticoïdes Anti-inflammatoires, très efficaces, en deuxième intension ou lors des poussées. Effets secondaires Immunosuppresseurs En cas de corticodépendance. Biothérapies Molécules générées et modifiées par génie génétique (anticorps) Modulation de l’activité des cytokines Inhibition des lymphocytesT Blocage du recrutement cellulaire
- 127. 127Franck Rencurel 2020 La dermatite Atopique
- 128. 128Franck Rencurel 2020 Immunité de la peau Barrière Rupture de La barrière Activation des cellules de L’immunité Innée (signal défense) Inflammation Migration des Cellules dendritiques Activation des lymphocytesT et B naïf (ganglions)s Activation des lymphocytes T CD8 cytotoxiques Infection Inflammation Activation Réponse I. Innée I. acquise
- 129. Franck Rencurel 2020 129 •MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE •Maladie Fréquente chez l’enfant (10% des enfants) •Physiopathologie de la Dermatite Atopique associée à l’Asthme, •Prédisposition génétique (50% des personnes atteintes ont un parents atopique) •Hyper production d’IgE et d’eosinophiles •Présence de lésions cutanées due à l’activation dans la peau des LymphocytesT cytotoxiques (CD8+) La dermatite Atopique
- 130. Franck Rencurel 2020 130 La dermatite Atopique Les causes ? Une part génétique : diminution d’expression de certains gènes de protéines de la peau affaiblissant la résistance cutanée. Facteurs environnementaux: Lavages trop fréquents , excès d’hygiène (microbiote cutané?) Habitat mal aéré favorisant les acariens Animaux domestiques Pollution atmosphérique Stress
- 131. Franck Rencurel 2020 131 La dermatite Atopique PHYSIOPATHOLOGIE Les mécanismes à l’origine des lésions de la DA impliquent trois partenaires : l’antigène, les cellules présentatrices d’antigène (cellules dendritriques) les lymphocytesT (LT) spécifiques. Les allergènes protéiques de grosses tailles sont capables de pénétrer dans les couches superficielles de l’épiderme des patients atopiques en raison de l’altération de la barrière cutanée. Deux phases : sensibilisation et révélation
- 132. Franck Rencurel 2020 132 La dermatite Atopique Phase 1 Sensibilisation Premier contact avec un allergène protéique Production de lymphocytesT mémoire Phase 2 Expression Nouveau contact avec l’allergène Stimulation des lymphocytesT mémoire/ Activation des LymphocytesT CD8 cytotoxiques
- 133. Franck Rencurel 2020 133 La dermatite Atopique Macrophage LymphocytesT auxiliaires Activation des macrophages Activation des éosinophiles Cytotoxicité
- 134. Franck Rencurel 2020 134 La dermatite Atopique Sensibilisation
- 135. Franck Rencurel 2020 135 La dermatite Atopique Sensibilisation •Cliniquement silencieuse: Aboutit à la génération de LT spécifiques à des allergènes ayant pénétrés la peau. • Pénétration cutanée favorisée par un déséquilibre de la barrière présent chez les patients atopiques. •Lésions d’eczéma de la DA impliquent une présentation de l’allergène aux LT Par les cellules dendritiques dans les ganglions. •Il y a production de lymphocytesT mémoires qui migreront au niveau cutanée prêts à répondre à la prochaine rencontre avec l’allergène.
- 136. Franck Rencurel 2020 136 La dermatite Atopique Phase d’expression (2ème rencontre avec l’allergène) *LT CD8 cytotoxiques *
- 137. Franck Rencurel 2020 137 La dermatite Atopique Phase d’expression (2ème rencontre avec l’allergène) Lors de la deuxième rencontre avec l’allergène les cellules dendritiques le présentent aux lymphocytesT mémoires. L’inflammation est causée par l’activation des LT CD8 au niveau de la peau (derme épiderme). Une fois la sensibilisation faite, les nouveaux contacts avec l’allergène entrainent de l’eczéma. L’inflammation entraine aussi l’activation des kératinocytes. L’inflammation induit l’apoptose des kératinocytes et cellules endothéliales.
- 138. Franck Rencurel 2020 138 La dermatite Atopique
- 139. Franck Rencurel 2020 139 La dermatite Atopique
- 140. Franck Rencurel 2020 140 La dermatite Atopique Traitements Objectifs • Restaurer la barrière cutanée avec des émollients (hydrate la peau) •Agir sur l’inflammation (Antiinflammatoires type corticoïdes) •Antihistaminiques oraux pour diminuer les démangeaisons •Eviter ou traiter une infection (antibactériens)
- 141. Franck Rencurel 2020 141 Fin du cours ici Merci!