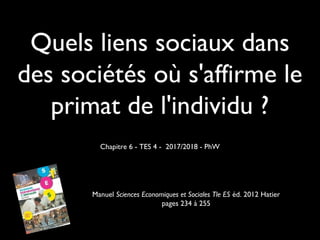
Diapo chap 6 integration_individualisme_2018
- 1. Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de l'individu ? Chapitre 6 - TES 4 - 2017/2018 - PhW Manuel Sciences Economiques et Sociales Tle ES éd. 2012 Hatier pages 234 à 255
- 3. Thèmes et questionnements Notions Indications complémentaires 2.1 Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de l'individu ? Solidarité mécanique/organique, cohésion sociale ---------------- Après avoir présenté l'évolution des formes de solidarité selon Durkheim, on montrera que les liens nouveaux liés à la complémentarité des fonctions sociales n'ont pas fait pour autant disparaître ceux qui reposent sur le partage de croyances et de valeurs communes. On traitera plus particulièrement de l'évolution du rôle des instances d'intégration (famille, école, travail, État) dans les sociétés contemporaines et on se demandera si cette évolution ne remet pas en cause l'intégration sociale. 2. Intégration, conflit, changement social Acquis de première : socialisation, capital social, sociabilité, anomie, désaffiliation, disqualification, réseaux sociaux
- 8. Problématiques • Comment une société tient-elle ? •L’individualisme peut-il être considéré comme un phénomène positif ? •Y a t-il une remise en cause des solidarités? •Le travail joue t-il toujours un rôle intégrateur ? •Peut-on parler d’une crise de l’État Providence ? •Le lien social est-il rompu dans les sociétés contemporaines?
- 9. Introduction Sur quoi repose la cohésion sociale ? Comment une société tient elle ?
- 10. À 3 ou 4 élaborez une affiche répondant à la question “comment une société tient-elle ?” (sur quoi repose la cohésion sociale ?) Vous pouvez faire un schéma, un dessin, un texte (court)… Dans cette affiche, vous devez mobiliser le vocabulaire vu en classe de 1ere (socialisation, culture, etc…)
- 11. Des élèves au travail C’est rare et ça mérite d’être photographié !
- 17. Vos productions…
- 26. IntégrationIntégration socialesociale les membres du groupe ont une conscience commune et partagent les mêmes sentiments sont en interaction les uns avec les autres se sentent voués à des buts communs (D'après Durkheim)
- 27. Retour sur quelques notions vues en 1ère…
- 28. Socialisation et Intégration La socialisation : un concept central en sociologie... La socialisationLa socialisation est un processus social par lequel les individus apprennent et intériorisent les traits culturels (les manières de penser, de sentir et d’agir) propres à la société dans laquelle ils vivent.
- 32. les agents de socialisation et d'intégration • La Famille • L'École • les médias • les églises • l'entreprise • les groupes de pairs • ...
- 33. De la socialisation à la régulation sociale Le processus de socialisation a pour finalité le consensus social. On veut aboutir à ce que les membres de la société acceptent et se conforment à un certain nombre de règles qui permettent de "vivre ensemble" Cohésion sociale
- 34. De la socialisation à la régulation sociale Le contrôle social (appelé aussi régulation sociale) prend le relais lorsqu’un membre de la société ne se conforme pas aux normes et aux modèles établis. Les sanctions (positives ou négatives) sont là pour orienter le comportement et faire en sorte que celui ci soit conforme aux normes en vigueur.
- 35. Contrôle social "On peut appeler contrôle social cette part de l'activité de la société qui consiste à assurer le maintien des règles et à lutter contre la déviance, que ce soit par le moyen des appareils institutionnels ou par la pression diffuse qu'exerce la réprobation ou les sanctions spontanées qu'elle provoque" J-D Reynaud "Les règles du jeu" A.Colin 1989
- 36. Comment se fait le contrôle social ? Le comportement désiré est d'abord obtenu par la pression sociale. On peut souhaiter éviter les désagréments causés par le non respect des règles et avoir peur des sanctions qui y sont liées. On peut également vouloir faire la preuve de sa volonté d'intégration au groupe. Mais on peut aussi accepter la régle car on juge qu'elle est juste et rationnelle. On parle alors d'intériorisation de la règle.d'intériorisation de la règle.
- 37. Les sanctions Les sanctions (positives ou négatives) sont là pour orienter le comportement et faire en sorte que celui ci soit conforme aux normes en vigueur. Il y a toute une panoplie de sanctions (Sanctions physiques, Sanctions économiques, Sanctions sociales, Sanctions surnaturelles). Les sanctions peuvent être formelles, c’est-à-dire prévue par la loi ou la coutume ou au contraire informelles c’est-à-dire être mises en œuvre par le groupe sans référence à une règle écrite.
- 38. Socialisation différentielle Les normes et les valeurs évoluent à travers le temps et la socialisation est donc variable selon les époques. Mais cela varie aussi en fonction des groupes sociaux, on parle alors de socialisation différentielle. Au sein d’une même société, il y a en effet des sous-cultures qui varient plus ou moins par rapport à la culture dominante.
- 39. 1° Qu'est-ce que le lien social ? I- L'évolution des liens sociaux A- Liens sociaux et solidarité
- 40. page 236
- 41. page 248
- 42. I- L'évolution des liens sociaux A- Liens sociaux et solidarité 2° Solidarités mécanique et organique
- 43. Émile Durkheim (1858-1917) De la division du travail social (1893) Les règles de la méthode sociologique (1895) Le suicide (1897)
- 44. page 236
- 46. Le Barn raising, un exemple de solidarité mécanique Witness Film de Peter Weir (1985) QuickTime™ et un décompresseur libx264 sont requis pour visionner cette image.
- 47. “Les maçons du coeur” QuickTime™ et un décompresseur h264 sont requis pour visionner cette image.
- 50. QuickTime™ et un décompresseur 'mp4v' sont requis pour visionner cette image. Vidéo de 2012 sur le Samu Social
- 51. Les sociétés traditionnelles sont soudées par une solidarité sociale de type mécanique. Il n’y a pas de division du travail, donc les individus sont identiques et interchangeables. C’est la croyance collective qui assure la cohésion sociale. Dans une société à solidarité mécanique, le lien social découle de la ressemblance entre les individus. Pour maintenir la cohésion sociale, il faut donc cultiver ce qu'ils ont en commun, ce qui les rend semblables. Il y aura donc une forte emprise de la culture et des valeurs communes, une certaine tendance au conformisme, même, car se différencier, c'est déjà s'exclure. L'individualisme est logiquement très faible dans les sociétés à solidarité mécanique. Pour désigner une collectivité unie par la similitude de ses membres, par ce qu'ils ont en commun, on parle de " communauté ".
- 52. Dans les sociétés modernes, la division du travail conduit à une solidarité organique : la division du travail permet la solidarité. Les individus sont différents et c’est la complémentarité et l’existence d’organes dont c’est la fonction qui permet la solidarité On passe d’une intégration par ressemblance à une intégration par complémentarité. Les activités exercées par les individus sont différentes les unes des autres, mais nécessaires les unes aux autres.
- 53. I- L'évolution des liens sociaux A- Liens sociaux et solidarité 3° Lien social et instances d'intégration
- 54. A partir de ce schéma détaillez la manière dont chacune de ces instances peut contribuer à l’intégration et à la solidarité
- 55. A partir de ce schéma détaillez la manière dont chacune de ces instances peut contribuer à l’intégration et à la solidarité
- 56. I- L'évolution des liens sociaux B- La montée de l'individualisme 1° Individualisme et modernité
- 57. page 237
- 58. Individualisme Autonomie et moindre contrôle social C’est l’individu qui prime sur le groupe
- 60. I- L'évolution des liens sociaux B- La montée de l'individualisme 2° L'Individualisme en questions...
- 61. Une autonomie toute relative... page 238
- 62. Dans les sociétés actuelles, l’autonomie individuelle est toute relative. Nous nous conformons à des usages, à des pratiques qui nous sont communes, comme dans l’exemple de la mode adolescente: il existe une diversité de modes et l’individu peut effectuer des choix, mais il est plus ou moins contraint par son appartenance à un groupe
- 64. Les liens sociaux reposent toujours sur le partage de croyances et de valeurs communes. Par la socialisation, l’individu intègre et partage les valeurs de la société, Par exemple, au sein d’associations, en participant aux activités, les individus partagent des valeurs et tissent des liens, L’autonomie acquise par les différentes personnes qui composent la société aujourd’hui n’empêche d’ailleurs pas la solidarité de demeurer une valeur partagée
- 66. II- Le lien social est-il menacé? A- L'affaiblissement des principales instances 1° Évolution de la famille
- 68. Faire le plan détaillé de la dissertation (Liban 2017)
- 74. Autre sujet possible …
- 75. Page 240
- 89. Page 240
- 90. Page 241
- 91. Page 241
- 92. Page 241
- 93. Faire le plan détaillé de la dissertation
- 94. La réduction de la taille des familles, conséquence des divorces et du plus petit nombre d'enfants, diminue de manière mécanique le nombre de personnes avec qui l'individu a des liens familiaux. Cela signifie aussi que la solidarité familiale sera limitée à un nombre réduit de personnes. La socialisation et le contrôle social qu'exerçait la famille, c'est-à -dire transmettre des normes et des valeurs et veiller à leur respect, sont plus difficiles à exercer, parce que, dans une société individualiste, la tolérance et l'épanouissement personnel sont devenus primordiaux.
- 95. Les situations d’exclusion montrent a contrario le rôle intégrateur de la famille. En effet, on constate que, bien souvent, l’exclusion se produit quand il y a rupture des liens familiaux. Dans une société où la protection sociale tend à se réduire, la solidarité familiale joue un rôle encore plus important et contribue à renforcer les inégalités.
- 96. Cependant, la famille reste un lieu d’entraide et de solidarité privilégié pour les individus. Les échanges se multiplient entre les générations du fait de l’allongement de la vie, et entre les membres de familles recomposées (où les liens familiaux sont de plus en plus choisis et de moins en moins subis). Ils se traduisent par des rencontres, par un soutien matériel et affectif. La famille n’est pas en crise, elle reste une valeur fondamentale de la société et le pilier de l’identité des individus. Mais elle se métamorphose avec des modèles multiples: de la famille “traditionnelle” à la famille monoparentale, recomposée, homoparentale ...
- 97. Faire le plan détaillé de la dissertation
- 98. Les évolutions de la famille remettent-elles en cause son rôle dans l’intégration sociale ? I – Des évolutions qui peuvent faire penser à une remise en cause de la famille traditionnelle A- Une baisse des mariages et une hausse des divorces B- L’émergence de nouveaux modèles familiaux plus précaires C- La réduction de la taille des familles peut remettre en cause la solidarité II – Il s’agit plus d’une mutation que d’une crise et celle ci conserve une fonction essentielle A – la famille “résiste” mais elle se transforme B – Elle continue à jouer un rôle majeur de solidarité et d’intégration
- 99. II- Le lien social est-il menacé? A- L'affaiblissement des principales instances 2° L'École permet-elle toujours de s'intégrer ?
- 100. Polycopié
- 101. Page 242
- 107. Ces dernières décennies, en France, le nombre d'élèves scolarisés a fortement augmenté et la part de ceux qui sont diplômés également. Aujourd’hui près de 65% sont bacheliers (20% en 1970). Or, le diplôme reste un sésame important pour l'entrée dans la vie professionnelle: aujourd’hui encore, cinq ans environ après leur sortie du système éducatif seulement 5 à 6%des jeunes diplômés bac + 2 sont au chômage, contre 27% pour les non diplômés
- 108. Un problème se pose donc au système éducatif français: l’échec scolaire. Chaque année en effet environ 150000 élèves quittent l’école sans qualification et vont donc rencontrer des difficultés pour leur insertion sur le marché du travail. Autre problème qui se pose à l’école, celui des fortes inégalités sociales : si certaines formations garantissent un accès à des statuts professionnels valorisants. l"accès à ces formations n'est pas égalitaire De plus, l’accès croissant à certains diplômes a conduit à leur dévaluation, ce qui ne favorise pas l’accès à l'emploi.
- 109. L'origine familiale joue un rôle majeur pour l'accès au diplôme (voir chapitre précédent) et donc pour l’insertion professionnelle. Mais si le diplôme joue un rôle clé dans cette insertion, le capital économique et le capital social détenus par la famille peut compenser et/ou renforcer cette inégalité d'accès à la qualification et à l'emploi. La reproduction sociale entre les générations risque d’être renforcée car les familles privilégiées sont mieux dotées dans les différents types de capitaux.
- 110. II- Le lien social est-il menacé? A- L'affaiblissement des principales instances 3° Le travail joue t-il toujours son rôle d'intégration ?
- 111. Polycopié
- 112. Polycopié
- 113. Page 244
- 114. Page 244
- 115. page 249
- 120. Le travail, par le revenu qu’il procure, favorise l’intégration. L’accès à l’emploi permet aussi d’avoir des relations professionnelles et sociales, de tisser des liens et d'avoir une place reconnue dans la société. Le travail participe donc à la construction de l’identité sociale de l’individu dans les sociétés modernes. C’est pourquoi la perte de l’emploi peut mener à un processus de marginalisation de l’individu dans la société par un processus de disqualification sociale, comme le nomme Serge Paugam.
- 121. Mais la montée du chômage et de la précarité du travail n’expliquent pas à elles seules l’exclusion, ou plutôt la désaffiliation, selon le terme employé par Robert Castel. Il faut qu’il y ait corrélativement une fragilisation des autres liens sociaux (familiaux par exemple) pour que l’individu se sente isolé, sans place assignée dans la société.
- 122. Page 235
- 123. Robert Castel (1933-2013) Robert Castel est sociologue et historien du travail. Il s'intéresse au travail, en relation avec les transformations de l'emploi, l'intervention sociale et les politiques sociales. Dans “Les métamorphoses de la question sociale”, il analyse la constitution de la société salariale, puis son effritement à partir du milieu des années 1970 et ses conséquences : l'exclusion (ou plutôt ce qu'il appelle la désaffiliation), la vulnérabilité et la fragilisation qui frappent les individus les plus faibles. Cette évolution du travail remet en question le lien social.
- 124. QuickTime™ et un décompresseur AVC Coding sont requis pour visionner cette image. Entretien avec Robert Castel (Lesite.tv)
- 125. Selon Castel, l’intégration à la vie sociale est fondée d’une part sur l’emploi occupé et d’autre part sur les relations sociales, donc il y a d’une part l’axe intégration par le travail et d’autre part l’axe intégration dans une sociabilité socio-familiale (famille, voisinage, amis…). Sa grille d'analyse de l'espace social combine deux dimensions : l'axe de la place dans la division du travail et celui de la participation aux réseaux de sociabilité. Cette combinaison, qui n'est pas une corrélation (la précarité peut être compensée par la densité des réseaux de sociabilité primaire), permet de distinguer plusieurs zones de cohésion sociale : – la zone d'intégration associe travail stable et insertion relationnelle solide ; – la vulnérabilité sociale est une zone intermédiaire, instable qui conjugue la précarité du travail et la fragilité des relations (à commencer par la fragilité du lien conjugal ou l’absence de ce lien). – la zone de désaffiliation associe l'absence de participation à toute activité productive et l'isolement relationnel.
- 126. II- Le lien social est-il menacé? A- L'affaiblissement des principales instances 4° La fin de l'État Providence ?
- 127. Qu’est-ce que l’État-Providence ? Avant l’État-Providence il y avait l’“État-Gendarme”
- 128. État “Gendarme” + certains biens collectifs (infrastructures…) Fonctions régaliennes Armée Police Justice Lois
- 129. Adam Smith Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) « Chaque individu s'efforce d'utiliser son capital de telle manière que la valeur de son rendement soit la plus grande possible. Généralement, il n'a pas du tout l'intention de promouvoir l'intérêt public, pas plus qu'il n'a l'idée de la mesure dans laquelle il est en train d'y contribuer. Ses seuls objectifs sont sa propre sécurité et son gain personnel. Et, dans cette affaire, il est conduit par une main invisible à poursuivre une fin, ce dont il n'avait absolument pas l'intention. Il arrive fréquemment, qu'en recherchant son intérêt propre, il favorise beaucoup plus celui de la société que lorsqu'il a réellement l'intention de la promouvoir. »
- 130. Crise de 1929
- 131. John Maynard Keynes (1884-1947) 1937 Théorie Générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie Il n’y a pas d’équilibre automatique L’État doit intervenir pour réguler l’économie Et en particulier soutenir la Demande…
- 132. Etat providence: conception du rôle des pouvoirs publics qui a commencé à se développer au début du XXe siècle, mais qui s'est imposée après la Seconde Guerre mondiale. Cette conception attribue à l'État une nécessité d'agir pour réduire les difficultés économiques que peuvent rencontrer les individus en organisant une protection collective des risques sociaux (maladie, maternité, vieillesse, absence de travail).
- 133. État providence régulation économique redistribution Protection sociale soutien à la croissance Production de services collectifs
- 134. Page 246
- 135. Page 246
- 136. Publicités parues dans la presse et sur des affiches en 2010
- 137. Publicités parues dans la presse et sur des affiches en 2010
- 138. Et vous, qu'en pensez vous ?
- 139. Page 247
- 140. La crise de l'"État Providence" et des systèmes de protection sociale fait courir le risque d'un désengagement de l'État au profit de la famille dans sa mission de protection des individus. Mais ces solidarités familiales sont profondément inégalitaires. Les échanges de services et les dons d'argent au sein de la famille sont évidemment proportionnels au niveau de vie des familles. Ceux qui souffrent d'une rupture ou d'une absence de liens familiaux sont alors ceux qui courent le plus le risque de l'exclusion.
- 141. Crise d'efficacité Crise de légitimité Crise d'adaptation financière Les crises de l'État Providence
- 142. Crise d'efficacité ? La première critique faite à l’État-Providence est son coût. Les économistes libéraux ont souvent condamné le poids excessif des prélèvements qui, selon eux, découragerait l’activité. La crise et le vieillissement de la population ont entraîné l'augmentation des “ayant-droits" et réduit le nombre de cotisants. L'État Providence est de plus en plus coûteux et de moins en moins efficace dans la mesure où il n'a pas empêché l'augmentation des inégalités.
- 144. Après 1945, l’État-Providence se construit autour de l’idée généralement partagée qu’il contribue à l’amélioration du bien-être (en anglais on parle de « Welfare state ») et à la réduction des inégalités. Cet objectif repose sur l’affirmation admise par tous d’une valeur de solidarité. Or, la crise va remettre en cause tout cela. On va dénoncer l’incapacité de l’État à corriger les inégalités alors que les prélèvements (impôts et cotisations) augmentent. Par ailleurs la valeur même de solidarité est remise en cause par l'individualisme. Crise de légitimité ?
- 145. Crise d'adaptation financière Cotisations x cotisants = Prestations x ayant-droits 3 pistes… -diminuer les prestations -augmenter les cotisations -retarder l’accès aux droits
- 146. L’État-Providence connaîtrait une crise d’adaptation dans la mesure où il n’arriverait plus à équilibrer ses comptes. La crise économique a conduit à une diminution des recettes (les chômeurs ne cotisent pas et paient peu ou pas d’impôts) et à une augmentation des dépenses (indemnisation du chômage et prise en compte de la pauvreté). De plus l’évolution démographique conduit à une augmentation des ayant-droits (le « papy boom ») et à une diminution des cotisations car ce sont les générations moins nombreuses qui sont appelées à financer les retraites. Crise d'adaptation financière
- 147. Synthèse Page 253
- 148. Synthèse page 254
- 149. II- Le lien social est-il menacé? B- Le lien social face à la crise et à l'individualisme 1° De la pauvreté à l'exclusion Traité dans le TD n° 14-15
- 150. L'exclusion sociale est la mise à l'écart (marginalisation) d’une personne ou d'un groupe en raison d'un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. Ce processus peut être volontaire ou subi.
- 151. L'exclusion est un terme difficile à définir et à mesurer. Il s'agit d'un processus cumulatif qui se situe à plusieurs niveaux (école, profession, famille, logement, santé…) et qui aboutit à une situation où un individu ou un groupe est rejeté hors de la société et ne peut plus participer normalement à son fonctionnement collectif. Il s'agit donc en fait d'une rupture du lien social. On peut tenter de le mesurer par des indicateurs tels que le niveau de pauvreté. On considère en général comme pauvre tous les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales à 60% du revenu médian. Mais la pauvreté ne conduit pas forcément à l'exclusion.
- 152. Synthèse page 255
- 153. II- Le lien social est-il menacé? B- Le lien social face à la crise et à l'individualisme 2° Anomie et déviance
- 156. Les situations « d’anomie » sont les situations d’affaiblissement des mécanismes d’intégration sociale. La société n’offre plus de repères stables. Cela conduit alors à des phénomènes d’individualisme, de déviance, de révolte ou de retrait. Ces phénomènes se sont accentués depuis une vingtaine d’années.
- 157. L'anomie selon E. Durkheim L'anomie est une notion développée par Emile Durkheim (1858-1917) pour désigner certaines situations de dérèglement social, d'absence, de confusion ou de contradiction des règles sociales. Pour lui, l'anomie est une conséquence de la division du travail qui isole les individus et fait régresser la solidarité ("De la division du travail social", 1883). L'incapacité des règles sociales à limiter les désirs individuels engendre une déception croissante et le sentiment d'aliénation et d'irrésolution ("Le suicide", 1897). L'anomie est aussi l'état d'une société ou d'un groupe sans règles, sans structures, sans organisation naturelle ou légale. L'anomie signifie alors désordre social et chaos.
- 158. R. K. Merton (1910-2003) analyse le cas de la déviance dans une relecture de la théorie de l'anomie. Pour lui, toute société propose des buts valorisés (l'enrichissement et le réussite sociale par exemple,...) et des moyens légitimes d'y parvenir (la promotion scolaire, le travail, voire la réussite au loto,...). Les membres de la société qui acceptent ces buts et ces moyens légitimes sont intégrés à la société. En revanche deux sortes de déviants apparaissent : • ceux qui, tout en acceptant les buts valorisés par la société n'en adoptent pas les moyens légitimes (c'est le cas des délinquants qui en acceptant l'enrichissement comme but valorisé utilisent des moyens illégaux). • D'autre part, d'autres personnes refusent à la fois les buts légitimés par la société et les moyens proposés (les révoltés, les rebelles, les contestataires,...). L'anomie selon Robert K. Merton
- 159. la montée de la déviance est-elle révélatrice d’une insuffisance d’intégration sociale ?
- 164. la montée de la déviance est-elle révélatrice d’une insuffisance d’intégration sociale ? La déviance et la délinquance peuvent être considérées comme un défaut d’intégration… … mais elles obéissent aussi à d’autres logiques.
- 165. La délinquance : manifestation d’un défaut d’intégration ? Quelle que soit l’approche de la déviance, on peut souligner avec de nombreux auteurs que les phénomènes de déviance et plus encore de délinquance peuvent être considérés comme des “pathologies” des sociétés modernes et les symptômes d’un défaut d’intégration. "Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune." (Emile Durkheim / 1858 - 1917 De la division du travail social)
- 166. II- Le lien social est-il menacé? B- Le lien social face à la crise et à l'individualisme 3° Individualisme et communautarisme
- 167. Polycopié
- 171. Un défi auquel doivent faire face les sociétés modernes est la montée du communautarisme : la nécessité du lien social ne semble plus aller de soi aujourd'hui, et il y a une tendance à se replier sur la communauté ethnique ou religieuse, la région, ou même sur la sphère privée (soi-même, la famille). Alexis de Tocqueville (1805-1859) avait déjà envisagé ce repli des individus sur des appartenances intermédiaires et le délitement du lien politique et social national dans les sociétés démocratiques modernes.
- 172. Du melting pot à la "mosaique"... Intégration ou communautarisme ?
- 173. Le communautarisme peut déboucher sur une remise en cause de la cohésion sociale. Le communautarisme menace le lien politique, car si on cultive les différences entre les groupes constituant la société, on met forcément à mal l'idée de citoyenneté qui se fonde justement sur les points communs et non les différences entre individus. Dans les cas extrêmes, on peut arriver à ce que les groupes aient des représentations politiques distinctes. Un autre danger du communautarisme est qu'il peut limiter l'ampleur de la solidarité en la réservant au groupe. Le communautarisme peut conduire à la xénophobie et au racisme...
- 175. Images polycopié
- 176. page 248
- 177. Crise d'efficacité Crise de légitimité Crise d'adaptation financière Les crises de l'État Providence L'État Providence est de plus en plus coûteux et de moins en moins efficace dans la mesure où il n'a pas empêché l'augmentation des inégalités. La crise et le vieillissement de la population ont entraîné l'augmentation des “ayant-droits" et réduit le nombre de cotisants. La valeur même de solidarité est remise en cause par l'individualisme.
- 178. Crise d'adaptation financière de l’État Providence Cotisations x cotisants = Prestations x ayant-droits 3 pistes… -diminuer les prestations -augmenter les cotisations -retarder l’accès aux droits
- 179. Synthèse page 255
