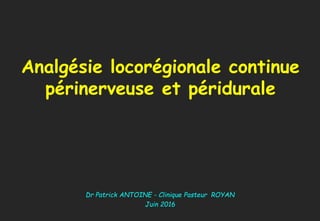
Analgésie locorégionale continue périnerveuse et péridurale
- 1. Analgésie locorégionale continue périnerveuse et péridurale Dr Patrick ANTOINE - Clinique Pasteur ROYAN Juin 2016
- 2. Bonjour ... On m’appelle Eva ! Aujourd’hui, nous allons parler de l’analgésie loco-régionale continue en dehors du bloc opératoire
- 3. Comment? Utiliser une technique d’anesthésie en dehors du bloc opératoire !!! Est-ce bien raisonnable? Mais, je ne suis pas anesthésiste moi!
- 5. Pourquoi? Code de la santé publique Article L1110-5 Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui- ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. ... Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. ... ?
- 6. Ai-je le droit? Code de la santé publique Article R4311-9 L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : ... 2e Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection. ... ?
- 7. Ai-je le droit? Arrêté du 26 avril 2012 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique Les dispositions prévues à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont applicables aux spécialités pharmaceutiques à base de ropivacaïne présentées sous forme de solution injectable pour perfusion en poche à la concentration de 2 mg/ml en application d'un protocole ayant pour but d'accompagner et d'encadrer la dispensation et l'administration de ces spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'analgésie postopératoire par cathéter périnerveux en ambulatoire .... ?
- 8. N’est-ce pas dangereux? Recommandations de la SFAR Utilisée en chirurgie ambulatoire pour l’analgésie postopératoire depuis 1998 Respect des posologies Respect des contre-indications Surveillance clinique quotidienne Protocoles et formation Réseaux de soins (SOS-Douleur à domicile, HAD...) ?
- 9. Bien, me voilà rassurée! voici le menu : - Les différentes techniques - les indications - les complications - en pratique - la surveillance et la gestion des incidents
- 10. - Les différentes techniques - les indications - les complications - en pratique - la surveillance et la gestion des incidents
- 11. Définition : technique d’analgésie consistant à administrer en continu des anesthésiques locaux à l’aide d’un cathéter placé au contact des structures nerveuses ou dans l’espace rachidien péridural
- 12. Le choix de la technique dépend de la localisation de la douleur pour l’analgésie des membres -> Cathéter périnerveux - interscalénique ou axillaire - fémoral ou sciatique pour l’analgésie du tronc -> Cathéter péridural - en position lombaire - en position thoracique
- 13. Injection des AL dans l’espace péridural
- 14. Territoire analgésié par une injection péridurale lombaire
- 15. Territoire analgésié par une injection péridurale thoracique
- 16. Territoire analgésié par une injection périnerveuse inter-scalénique
- 17. Territoire analgésié par une injection périnerveuse axillaire
- 18. Territoire analgésié par une injection périnerveuse fémorale ou saphène interne
- 19. Territoire analgésié par une injection périnerveuse sciatique
- 20. La tunnellisation du cathéter : qu’est-ce que c’est ? Structures nerveuses
- 21. Incision cutanéePonction nerveuse échoguidée Introduction du cathéter à travers l’aiguille de ponction Retrait de l’aiguille de ponction Nouvelle ponction à distance en direction du point de ponction initial Introduction rétrograde du catheter dans l’aiguille de ponction Retrait de l’aiguilleRetrait de l’excédent de cathéter Fermeture du point de ponction par stéristrip Structures nerveuses
- 22. La tunnellisation du cathéter : pourquoi ?
- 23. Risque infectieux sur cathéter non tunnellisé Structures nerveuses Surinfection profonde souvent occulte touchant les structures nobles
- 24. Risque infectieux sur cathéter tunnellisé Structures nerveuses Surinfection sous- cutanée rapidement diagnosticable
- 25. - Les différentes techniques - les indications - les complications - en pratique - la surveillance et la gestion des incidents
- 26. Artériopathie des membres inférieurs avant, après ou en dehors d’un acte chirurgical de revascularisation Analgésie postopératoire au décours d’un acte chirurgical Analgésie au long cours ou à visée palliative douleurs neuropathiques (SDRC, cancers)
- 27. Intérêt dans le cadre de l’analgésie post-opératoire • En chirurgie orthopédique (épaule, genou, pied) • Lors de la chirurgie thoracique • Lors de la chirurgie abdominale lourde • Analgésie multimodale ( analgésie, toxicité) • Epargne morphinique ( hyperalgésie morphinique) • Kinésithérapie respiratoire et mobilisatrice • Prévention douleurs chroniques post-chirurgicales
- 28. Intérêt dans le cadre du traitement des douleurs neuropathiques • Syndrome douloureux régional complexe : interrompre le cercle vicieux auto-entretenu de la douleur et permettre une reprogrammation du circuit de la douleur • Soins palliatifs : • Amélioration de la qualité de vie • Diminution des traitements morphiniques et de leurs effets secondaires néfastes (constipation, rétention urinaire, dépression respiratoire ...)
- 29. Intérêt dans le cadre de la maladie artéritique • Analgésie • douleurs artéritiques • lors des pansements • Revascularisation • amélioration de la cicatrisation du fait de la vasodilatation induite par les anesthésiques locaux • par l’exercice physique du fait de l’analgésie • Diminution de la durée d’hospitalisation • Amélioration de la qualité de vie
- 30. - Les différentes techniques - les indications - les complications - en pratique - la surveillance et la gestion des incidents
- 31. Complications spécifiques liées au type de bloc analgésique Toxicité générale systémique due à un surdosage en anesthésiques locaux Toxicité locale des anesthésisques locaux (Neuropathie)
- 32. Toxicité générale systémique due à un surdosage en anesthésiques locaux = injection intravasculaire accidentelle Toxicité immédiate dans les minutes qui suivent l’injection initiale ou le bolus
- 33. Impose une surveillance clinique rapprochée pendant 60mn après tout bolus important = résorption trop importante d’anesthésique local vraie ou relative Toxicité générale systémique due à un surdosage en anesthésiques locaux Toxicité retardée survenant 20 à 50 minutes après l’injection initiale ou le bolus
- 34. Facteurs favorisants la toxicité • Par augmentation de la fraction active plasmatique • Hypoxie, hypercapnie, acidose • Hypothermie • Hypoprotidémie, insuffisance hépatique • Par diminution du catabolisme • Insuffisances hépatique et rénale • Par potentialisation des effets anesthésiques • Hyponatrémie, hyperkaliémie • Interactions médicamenteuses
- 36. Toxicité neurologique précoce • Prodromes neurologiques • Crise d’épilepsie généralisée de type grand mal • Crises partielles • Etat de mal épileptique • Coma avec dépression cardio- respiratoire • Décès par arrêt ventilatoire
- 37. Prodromes neurologiques = signes prémonitoires • Dysesthésies péribuccales et linguales • Goût métallique dans la bouche • Somnolence, étourdissement, vertiges • Désorientation, logorrhée • Acouphènes, bourdonnements d’oreille • Confusion, bâillements, difficultés d’élocution • Troubles visuels, nystagmus • Tremblements • Secousses musculaires faciales ou des extrémités
- 38. Importance des prodromes +++ = signes prémonitoires annonciateurs de complications plus grâves - arrêt immédiat de toute administration d’anesthésique local - oxygénation - hyperventilation - réchauffement du patient - correction des désordres hydro- électrolytiques - ± midazolam IVD 2 à 5mg
- 39. Toxicité cardiaque plus tardive - moindre avec la ropivacaïne - sauf avec la bupivacaïne concomitante des signes neurologiques • hypotension (par chute du débit cardiaque) • bradycardie • troubles du rythme et de la conduction • collapsus cardio-vasculaire • arrêt cardiaque
- 40. Risque toxique systémique virtuellement nul en cas d’administration continue si débit <0,35mg/kg/h même en cas de passage intravasculaire Ex : pour un homme de 60kg Ropivacaïne 2mg/ml débit <10 ml/heure
- 41. Antidote Intra-lipides 20% 1,5 à 3 mg/kg en bolus puis perfusion de 0,25 à 0,5 mg/kg/mn en cas de convulsions ou de troubles cardiaques
- 42. Toxicité locale des anesthésisques locaux (Neuropathie) Favorisée par - concentrations importantes en AL (supérieures à 2mg/ml) - neuropathie pré-existante - diabète - éthylisme etc
- 43. Complications spécifiques liées au bloc péridural Surveillance Pression artérielle et Fréquence cardiaque •Toutes les 2 à 4h •Toutes les 15 mn pendant 1h après chaque bolus Liées au bloc sympathique • Hypotension • Bradycardie Liée au bloc parasympathique sacré • Rétention urinaire
- 44. Complications spécifiques liées au bloc inter-scalénique • Paralysie diaphragmatique • Hypoxie voire détresse respiratoire • Paralysie récurentielle •Troubles de la déglutition • Syndrome de Claude Bernard-Horner (myosis, ptosis, énophtalmie) Surveillance • SaO2 et Oxygénation si Sa02<=95% • Attention lors de la reprise de l’alimentation : eau puis solides
- 45. - Les différentes techniques - les indications - les complications - en pratique - la surveillance et la gestion des incidents
- 46. La pose
- 47. Pose du cathéter au bloc opératoire
- 49. Filtre anti-bactérien et dispositif de fixation Lockit PLUS Dispositif autocollant de fixation du cathéter à changer 1 fois par semaine Filtre anti-bactérien à changer 2 fois par semaine lors de la réfection du pansement
- 51. Insertion du cathéter à travers l’aiguille
- 52. Cathéter sciatique avant sa tunnellisation
- 56. Tunnellisation du cathéter point de fixation du cathéter point de fermeture du point de ponction points de fermeture du point de ponction actuellement fixation par stéristrips ou LockIt Plus
- 57. Fixation du cathéter fixation par stéristrips
- 60. Nécéssité de bolus : - Pompe PCA (bolus par le patient) - Pousse-seringue électrique avec bolus manuels effectués par l’infirmière Pas de nécéssité de bolus : - Pousse-seringue électrique - Diffuseur élastomérique Le mode d’administration des AL dépend de la nécéssité ou non de faire des bolus
- 62. Les posologies
- 63. Posologies maximales : (recommandations SFAR) 20 mg/h blisters de 10 et 20 ml poches de 100 et 200 ml Ropivacaïne (Naropeine®) à 1 ou 2mg/ml AMM en ambulatoire à domicile
- 64. Posologie maximale à domicile : 80 mg/4 heures y compris les bolus Bolus : 2 à 10 ml Période réfractaire entre 2 bolus : 30 à 45mn Débit continu : 2 à 10 ml/mn
- 65. • En cas d’analgésie insuffisante dans le territoire du bloc • Pour ré-imprégner le nerf Des bolus pour quoi faire ? Structures nerveuses
- 66. • Avant toute injection de bolus, vérifier l’absence de reflux sanguin dans le cathéter ou dans le filtre • Effectuer toujours une injection lente et fractionnée • Interrompre immédiatement l’injection en cas de survenue de prodromes (toxicité neurologique) traduisant une injection intravasculaire Les bolus : comment faire ?
- 67. • Pas de durée maximale conseillée • possible jusqu’à 6 mois à plus d’un an • Tant que le patient reste douloureux (fenêtres thérapeutiques) • Tant que le cathéter est fonctionnel • Tant que le cathéter n’est pas infecté Garder le cathéter pendant combien de temps?
- 68. - Les différentes techniques - les indications - les complications - en pratique - la surveillance et la gestion des incidents
- 69. La surveillance clinique Quand? •Rythme calqué sur la surveillance de l’analgésie •Toutes les 15mn pendant 1 heure après tout bolus • 1 heure après tout changement de débit • 1 fois par équipe en hospitalisation • 1 fois par jour, à domicile
- 70. La surveillance clinique Surveillance non spécifique • Qualité de l’analgésie évaluée dans le territoire sensitif du bloc (EVA, EN, Algo Plus) • Intensité du bloc sensitif (score) • Intensité du bloc moteur (score) • Recherche des signes de surdosage • Compressions vasculo-nerveuses, escarres aux points d’appui
- 71. Score sensitif de C0 à C3 C0 : Aucune altération de la sensibilité cutanée au toucher léger C1 : Hypoesthésie C2 : Dysesthésies C3 : Anesthésie ou dysesthésies intenses Bloc analgésique = score C0
- 72. Score moteur de M0 à M3 M0 : Aucune diminution de la force musculaire M1 : Diminution légère de la force musculaire mais mouvements possibles M2 : Diminution nette de la force musculaire et mouvements presques impossibles M3 : Mouvements impossibles Bloc analgésique = score M0
- 73. La surveillance clinique Surveillance spécifique • Analgésie péridurale Pression artérielle Fréquence Cardiaque • Bloc interscalénique fausses routes, Sa02 • Bloc sciatique et fémoral chutes,traumatismes, sub-luxations
- 74. La traçabilité
- 77. La gestion des incidents - Le reflux sanguin - Les fuites - L’occlusion - La déconnexion - L’inefficacité - La surinfection
- 78. Le reflux sanguin au niveau du filtre antibactérien • Avant toute injection, faire un test d’aspiration pour vérifier l’absence de reflux •Arrêter toute administration d’AL (bolus et débit continu) • Appeler le médecin pour vérifier la réalité de l’effraction vasculaire (test adrénaliné) • Traduit une effraction vasculaire lors de la pose ou survenant secondairement (érosion des vx par contact) • Plus fréquent en péridural
- 79. Les fuites Au niveau du connecteur ou du filtre • vérifier le connecteur • changer le filtre anti-bactérien • reconnecter le cathéter Au niveau du point de ponction • si analgésie efficace -> pansement occlusif • si analgésie inefficace -> avis médical -> augmenter le débit -> ablation du cathéter?
- 80. L’occlusion Un cathéter périnerveux ne se bouche jamais!
- 81. L’occlusion • vérifier l’occlusion en rincant le cathéter au sérum physiologique (seringue de 2 ou 5 ml) • purger le filtre avant la pose (++ si difffuseur) • changer le filtre anti-bactérien toutes les 48h • déconnecter et reconnecter le cathéter • ne pas “traire” le cathéter • obturation du filtre anti-bactérien • pincement du cathéter au niveau du connecteur à clip
- 82. L’occlusion : un passé révolu Utilisation de cathéters armés • coudure du cathéter • écrasement du cathéter • noeud sur le cathéter • un mythe ? : obturation par caillot sanguin
- 83. Alarme en occlusion ? souvent une affaire de pression • Réglage pression d’injection des PSE • Remplacer diffuseur par Pompe PCA • Utiliser une pompe PCA plutôt qu’un pousse seringue électrique • Limiter la longueur des tubulures • Changer le filtre anti-bactérien PRESSION = FORCE/SURFACE • Résistance à l’injection : fonction de la longueur et du diamètre du cathéter • Puissance d’injection : fonction du diamétre de la seringue (20cc/50cc) • Résistance augmentée par obturation du filtre
- 84. L’arrachement du cathéter • vérifier l’intégrité du cathéter (repère noir ou bleu à l’extrémité du cathéter) • ablation éventuelle des points de fixation • effectuer immédiatement un relais antalgique • envisager la repose
- 85. extrémité 5cm 10cm partie de 5cm sans graduations partie avec graduations tous les cm
- 86. La déconnexion : pourquoi? • arrachement accidentel du connecteur • glissement progressif du cathéter par hyperpression dans le diffuseur rempli au delà de sa capacité maximale (connecteur à clip) • dévissage du connecteur par inadvertance lors du changement du filtre anti-bactérien (connecteur à vis)
- 87. La déconnexion • si analgésie de courte durée : ablation du cathéter en cas de risque septique • si analgésie au long cours : protocole de reconnexion aprés avis médical • mettre en balance le bénéfice antalgique/risque septique
- 88. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux 2 cas de figure : • Déconnexion en amont du filtre anti- bactérien : entre le filtre et le système d’administration • Déconnexion en avant du filtre anti- bactérien : entre le filtre et le cathéter
- 89. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux • Changer tout le circuit • du systéme d’administration jusqu’au filtre anti-bactérien compris • Faire une cible et prévenir le médecin Déconnexion en amont du filtre
- 90. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux • Evaluer le rapport bénéfices/risques du maintien du cathéter et du risque de surinfection • risque septique plus important en cas de cathéter péridural (risque d’épidurite et/ou de méningite) Déconnexion en aval du filtre
- 91. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux • On ne dispose pas d’un connecteur de rechange : Récupérer le connecteur et le faire tremper pendant 10 mn dans une solution de Bétadine dermique non alcoolique. Le rincer abondamment et stérilement avec du sérum physiologique • Sinon changer le connecteur Déconnexion en aval du filtre
- 92. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux • désinfecter le cathéter avec de la Bétadine alcoolique • puis faire tremper l’extrémité du cathéter pendant 10 mn dans une solution de Bétadine dermique non alcoolique • couper stérilement avec une lame de bistouri l’extrémité du cathéter au delà de la partie imprégnée de Bétadine (sauf si cathéter armé) Déconnexion en aval du filtre
- 93. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux • reconnecter le cathéter • changer le filtre anti-bactérien • réadapter le système d’administration avec un prolongateur stérile • refaire le pansement en prenant soin de maintenir l’ensemble connecteur/filtre sous des compresses stériles pour éviter la contamination du cathéter en cas de désinsertion accidentelle Déconnexion en aval du filtre
- 94. Protocole de reconnexion du cathéter périnerveux • Faire une cible et avertir le médecin • Effectuer une surveillance accrue des signes locaux et généraux de surinfection pendant les quelques jours qui suivent la réadaptation du cathéter Déconnexion en aval du filtre
- 95. En premier lieu s’assurer que la douleur se trouve bien dans le territoire bloqué L’inefficacité
- 96. La douleur est-elle ressentie dans le territoire sensitif du bloc? territoire fémoral territoire sciatique
- 97. L’inefficacité • phénomène de tachyphylaxie = épuisement progressif de l’effet de l’anesthésique local -> augmenter le débit et/ou la concentration • diminution progressive du volume de diffusion -> effectuer un bolus pour réimprégner le nerf
- 98. L’inefficacité Déplacement du cathéter • noter les repères inscrits sur le cathéter : • graduations tous les cm • graduations 5, 10, 15, 20 et 25cm • ablation du cathéter • relais antalgique • envisager la repose
- 99. La surinfection • surveillance de signes inflammatoires ou infectieux locaux • rougeur au point de ponction • écoulement puriforme • la douleur peut être absente (présence de l’AL) • ± ablation du cathéter et mise en culture • ± antibiothérapie sur prescription
- 100. Ablation du cathéter péridural et anti-coagulants En cas de traitement anticoagulant par héparine de bas pois moléculaire (HBPM) à une injection par jour, • ablation du cathéter péridural 20 heures après l’injection précédente d’HBPM • 4 heures avant l’injection suivante d’HBPM • 12 heures avant l’injection suivante d’HBPM s’il existe un écoulement sanguin au point de ponction lors du retrait du cathéter
- 101. Ablation du cathéter péridural et anti-coagulants Dans les autres cas : • 2 injections journalières d’HBPM • traitement héparinique IV • traitement par anti-vitamine K • traitement par anti-agrégants • traitement par NACO l’heure d’ablation du cathéter doit être précisée par le médecin
- 102. En conclusion • Technique analgésique à démystifier à l’hôpital et à domicile • Interêt +++ dans la maladie artéritique • Nécessité d’une formation • Utilisation de protocoles • Repose sur un réseau de soins