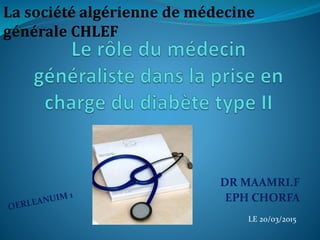
Le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge du diabète type II Dr MAAMRI fateh
- 1. DR MAAMRI.F EPH CHORFA LE 20/03/2015 La société algérienne de médecine générale CHLEF
- 2. Introduction: La découverte du diabète type 2 est fréquente en médecine ambulatoire l’épidémie croissante étant liée à l’augmentation de l’espérance de vie, de l’obésité, du manque d’activité physique, et du fait d’une alimentation déséquilibrée particulièrement riche en graisse et du sucre raffinés Cette pathologie comporte une importante prédisposition génétique et est fréquemment associe à la surcharge pondérale, l’obésité, l’hypertension artérielle aussi qu’aux dyslipidémie.
- 4. MEDECINE GENERALE : La médecine générale est une discipline scientifique et universitaire avec son contenu fondement scientifique, c’est une spécialité clinique orientée vers les soins primaires.
- 5. Diabète type 2: Le diabète de type 2 est une maladie métabolique caractérisée par une hyperglycémie chronique dont les éléments physiopathologiques comprennent une résistance accrue des tissus périphériques (foie, muscles) à l’action de l’insuline, une insuffisance de sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas, une sécrétion de glucagon inappropriée, ainsi qu’une diminution de l’effet des incrétines, hormones intestinales stimulant la sécrétion postprandiale de l’insuline
- 6. BUT : Dépistage du diabète type 2 Dépistage et prévention des complications Prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire Education thérapeutique du patient diabétique Quand adressé le patient diabétique aux spécialiste
- 7. Dépistage du diabète type 2
- 14. Comment dépister? Quatre moyens 1- glycémie capillaire 2-glycémie plasmatique 3-HGPO 4-hémoglobine glyquée
- 15. Message : pasteur disait : « écouter ----------toujours traiter ----------souvent guérir ----------parfois »
- 16. Bilan initial et examen du suivie du diabète type 2. Anamnèse: 1-Mode de vie : habitudes alimentaires Activité physique Tabagisme Consommation d’alcool Anamnèse psycho-sociale
- 17. 2-Antécédent personnels et familiaux: Diabète Hypertension artérielle Obésité Maladie cardio-vasculaire Autres maladies
- 18. 3-Signes fonctionnels : Signes cardinaux du diabète:( fatigue, polyurie, polydipsie, perte pondérale) Signes de macro et micro angiopathie:(rétinopathie, dysfonction érectile, neuropathie, dyspnée, angor….) claudication intermittente des membres inferieurs Signes digestifs (trouble de transite ) Autres signes fonctionnelles (urinaire….)
- 19. EXAMEN CLINIQUE Mesures staturo-pondérales: Chaque consultation poids Taille
- 20. POIDS ET TAILLE On observe tout d’abord les postures et démarche du patient. On débute par le poids et la taille du patient permettant le calcul de l’indice de masse corporelle (poids /taille2) dont la norme se situe entre 20 et 25 kg/m2.
- 22. TOUR DE TAILLE Chaque six mois le tour de taille est un facteur de risque plus important que l’excès du poids et le BMI
- 23. Seuil du Toure de Taille
- 24. Rapport tour de taille sur tour de hanche • Tour de taille (N: Hommes < 102 cm, Femmes: < 88 cm) • rapport tour de taille sur tour de hanche (N: Hommes <0.95, Femmes <0.8)
- 25. Mesure la tension artérielle Chaque visite Respecter les règles et les recommandations
- 26. Définition del’HTA:recommandations HTA publiées OMS: PA supérieure ou égale à 140/90 mm hg ANAES : PA supérieure ou égale à 140/80 mm hg JNC VI: PA supérieure ou égale à 130/85 mm hg JNC VII: PA supérieure ou égale à 130/80 mm hg pré-hypertension: 120-139/80-89 mm hg Objectifs tentionnels recommandés en 2013 ADA : PA inferieur ou égale à 140/90 mm hg SFHTA: PA inferieur ou égale à 140/90 mm hg Le seuil qualifiant le sujet d’hypertendu est considérez comme variable basé sur le RCV
- 27. prise de la PA
- 28. Prise de la PA Les conditions: 1. Malade dévêtu 2. Couché ou assis 3. Au repos depuis 5 min au moins ,dans une pièce normalement chauffée 4. A distance d’une prise de tabac, de café ou d’alcool, vessie vide 5. Brassard adapté à la taille de bras
- 29. Les méthodes la méthode de référence: sphygmomanomètre à mercure : avec un manomètre étalonné, valide L’auto mesure: règle des 03 3 mesures le matin 3 mesures le soir 3 jours consécutifs LA MAPA : l’avantage de cette technique est d’obtenir de nombreuse mesures reparties sur 24h ,elle est complémentaire de l’auto mesure de la PA ou quand l’auto mesure n’est pas réalisable
- 30. Seuils de la PA pour la définition de l’HTA EHS 2007-SFHTA 2011-ESH 2013 En consultation : 140/90 mm hg Auto mesure : 130-135/85 mm hg MAPA : 24h : 125-130/80 mm hg éveil : 130-135/85 mm hg sommeil: 120/70 mm hg
- 31. Status vasculaire Chaque trois mois Examen des pouls périphérique et souffles artérielles 1-prise du pouls pouls radial
- 32. Status vasculaire 2- palpation des artères: • Pouls carotidien • Pouls axillaire • Pouls huméral • Pouls fémoral • Pouls poplité • pouls Tibial postérieure • Pouls pédieux
- 33. Status vasculaire 3-auscultation artérielle : recherche d’un souffle Auscultation carotidiene
- 34. Examen des pieds C’est le carrefour des complications: Neurologique Artérielles Infectieuses Dermatologique
- 35. Dépister la neuropathie 1-Aspect du pied -Normal -Déformations 2-Signes fonctionnels -Paresthésies -Dysesthésies 3-Examen des sensibilités -Tactile superficielle (monofilament) -Vibratoire (diapason gradué, vibramètre) -Thermique (tube froid, tube chaud, thermode) 4-Réflexes myotatiques
- 36. Le test au monofilament
- 37. Le test au monofilament Monofilament de Semmes-Weinstein: créé1 force d’appui de 10 g. sur les zones testées Teste la sensibilité tactile superficielle Méthode simple en pratique clinique, non invasive, reproductible et pas chère! Test perturbé= risque important de troubles trophiques= mesures de prévention+++
- 38. Mode d’emploi du monofilament 1.Appliquer le MF sur les mains du patient (il doit savoir ce qu’il doit ressentir) 2.Examiner le pied, repérer les anomalies: hyperkératose, ulcérations, pré-ulcérations… 3.Appliquer le M.F. en dehors de ces anomalies! 4.Appliquer le M.F. perpendiculairement à la peau (de façon à arquer légèrement le filament) 5.Durée= 1 à2 secondes à chaque pression 6.Demander au patient de dire «oui je sens» ou «non je ne sens rien» avec les yeux fermés 7.Déplacer le M.F. sur tout le pied
- 39. Dépister l’artériopathie Recherche une AOMI: 1-Palpation des pouls périphériques palper une fois par an Pouls pédieux pouls tibial postérieur
- 40. Mesure de l’IPS Mesure de l’index cheville/bras ( IPS) au moins doute Répéter la mesure tous les 3 ans
- 41. Mesure de l’IPS L’IPS permet de quantifier la sévérité de l’artériopathie selon le tableau ci-dessous:
- 42. Echo-doppler Doppler artériel et veineux des membres inférieurs : Permet une exploration morphologique et hémodynamique complète • Exploration du capital veineux Systématique chez diabétique > 40 ans avec diabète > à 20 ans
- 43. Différence entre pied artériopathique et neuropathique Pied artériopathique: Claudication Pied froid diminution voir abolition des pouls périph. Peau fine, fragile, dépilé, pâle Ongles épaissis, fragiles Sensibilité conservée (voire hyperesthésie) Conservation des ROT Pied neuropathique: Pied sec et chaud Peau "rose« Diminution de la sensibilité Diminution des ROT Fonte des muscles interosseux Déformations pied, orteils Hyperkératose
- 44. Dépister une infection du pied diabétique L’infection= Facteur de gravité et non étiologique Aggrave la lésion artérielle ou neurologique et le risque d’amputation Diminution des capacités de bactéricidie des PNN si hyperglycémie Infection le plus souvent polymicrobiennes: -Streptocoques -Bacilles Gram négatifs -Anaérobies
- 45. Les signes clinique d’une plaie infecté Présence des signes systémiques d’une infection (fièvre, hyperleucocytose) Sécrétions purulentes Deux ou plusieurs des signes et symptômes locaux: rougeur, chaleur, induration, douleur, sensibilité
- 46. Le Mal Perforant plantaire •Lésion de neuropathie •Siège préférentiel: points de pression (tête du 1°,4°ou5°métatarse
- 47. Le Pied de Charcot Évolution ultime de l’ostéoarthropathie diabétique liée à la neuropathie Mécanisme: composante motrice et végétative de la neuropathie diabétique, microtraumatismes (Charcot, Volkman) Destruction de l’architecture du pied: pied cubique, élargi, raccourci et épais, affaissement de la voûte plantaire Terrain: diabète ancien, multicompliqué, mal équilibré
- 49. Examen de la plaie Dimensions -diamètres, décollement Aspect -propre, bourgeonnant, fibrineuse, suppurée, nécrotique, malodorante Berges -réguliers, rétractés, hyperkératose Existence d’un contact osseux -⇒ostéite La peau et les tissus périlésionnels: -sèche, inflammatoire, cellulite Prélèvements bactériologiques
- 50. Classification de Wagner Grade 0: Pied à haut risque, présence de lésions préulcéreuses possibles, pas de lésions ouvertes Grade 1 Ulcère superficiel Grade 2 Extension profonde vers tendons, os ou articulations Grade 3 Tendinite, ostéomyélite, abcès ou cellulite profonde Grade 4 Gangrène du pied ou de l’avant-pied Grade 5 Gangrène massive du pied avec des lésions nécrotiques et infection des tissus mous
- 51. Quelques appareils de décharge Barouk longue Barouk courte
- 52. Examen de la peau A la recherche de lipodystrophie : Palper la peau sous les sites d’injection d’insuline si épaississement ou induration en placard ; changer le site d’injection
- 53. EXAMENS PARACLINIQUES SUIVI GLYCÉMIQUE · un bon contrôle glycémique du diabète de type 2 est recommandé pour prévenir la survenue des complications cardio-vasculaires · le suivi du contrôle glycémique du diabète de type 2 doit reposer sur le dosage de l’HbA1c effectué tous les 3 à 4 mois ; · pour un patient donné, le dosage de l’HbA1c doit être pratiqué dans le même laboratoire, pour permettre de comparer les résultats successifs.
- 54. Objectifs glycémique les objectifs glycémiques se traduisent en objectifs d’HbA1c. Ils doivent être individualisés en fonction de l’âge du patient, des comorbidités et du contexte psychosocial. – l’objectif optimal à atteindre est une valeur d’HbA1c = 6,5 %, une autosurveillance glycémique régulière est nécessaire chez le diabétique de type 2 traité par l’insuline
- 55. HbA1c (suivi) : 2-4x/an de routine ; plus souvent en cas de changement de traitement ou contrôle sub-optimal 2x/an si HbA1c stable selon les objectifs individuels Schéma HbA1c strict : • HbA1c ≤ 6.5% ou ≤ 7% En tenant compte du risque lié à l’hypoglycémie ou limite inférieure HbA1c ≥ 6% • Critères pour un schéma « strict » : courte durée du diabète, longue espérance de vie, pas de pathologie cardiovasculaire significative Schéma HbA1c large : • HbA1c ≤ 8% ou si cible d’HbA1c non atteinte, informer que toute amélioration est bénéfique. • Critères pour un schéma « large » : histoire d'hypoglycémie sévère, impossibilité de reconnaître les symptômes d’hypoglycémie, espérance de vie à 10 ans limitée; complications diabétiques avancées, comorbidités importantes (haut risque ou antécédents CV; insuffisance rénale ou hépatique; troubles cognitifs), polymorbidité, longue histoire de diabète, grande dépendance fonctionnelle
- 56. bilan lipidique · un bilan lipidique à jeun doit être effectué une fois par an chez le diabétique detype 2. Il comporte la mesure du cholestérol total, du HDL- cholestérol et de triglycérides, la mesure ou le calcul (si triglycérides < 4,5 g/l) du LDL cholestérol ; · au terme de 6 mois d’une diététique appropriée et après obtention du meilleur contrôle glycémique possible, la valeur du LDL-cholestérol sert de référence pour instaurer un traitement médicamenteux hypolipidémiant.
- 57. Bilan rénale · un bon contrôle glycémique et tensionnel prévient le risque de survenue d’une néphropathie diabétique · mesurer une fois par an la créatininémie à jeun. Il est recommandé de calculer à partir de la créatininémie la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft : C (ml/min) = 140 - âge (année) x poids (kg) x K ______________________________ créatininémie (mmol/l) K = 1,25 pour l’homme et 1 pour la femme la présence d’une microalbuminurie chez un diabétique de type 2 est un marqueur de gravité générale
- 58. DÉPISTAGE DES COMPLICATIONS OCULAIRES (FO) Un bilan ophtalmologique, effectué par un ophtalmologiste, doit être pratiqué dès le diagnostic puis une fois par an chez le diabétique de type 2 non compliqué La rétinopathie diabétique est une manifestation oculaire de la micro angiopathie diabétique
- 59. DÉPISTAGE DES COMPLICATIONS CARDIO-VASCULAIRES Pratiquer une fois par an un ECG de repos (voir fmc ECG) ECG d’effort et /ou scintigraphie myocardique en cas des signes typiques ou atypiques d’angor ou en cas d’anomalies sur l’ECG de repos
- 60. DÉPISTAGE DU DYSFONCTION ÉRECTIL représente 20% des complications microvasculaires lors du diagnostique du diabète type 2
- 61. DÉPISTAGE DU DYSFONCTION ÉRECTIL La dysfonction érectile (DE) a une prévalence plus élevée chez les patients diabétiques puisqu’elle concerne au moins 30 % d’entre eux. La physiopathologie est complexe et d’origine multifactorielle, impliquant principalement les lésions de l’endothélium vasculaire ,la neuropathie diabétique et les facteurs psychologiques. La DE est aujourd’hui considérée comme un symptôme sentinelle d’une atteinte cardiovasculaire et doit faire rechercher une maladie coronarienne. Cet événement doit donc être détecté par le médecin qui prend en charge le patient diabétique. La DE est responsable d’une altération de la qualité de vie. La prise en charge thérapeutique repose sur des traitements spécifiques d’une part, la prévention et le traitement des complications de la maladie diabétique et l’accompagnement psychologique des patients, d’autre part.
- 62. Divers : • Cherche une infection cutanée ou génito-urinaire • Examen de la bouche et des dents Identification des patients à risque : • Co-morbidités psychiatriques • Difficultés socio-économiques Analyse de la situation du patient: • Compréhension et vécu de sa maladie et de son traitement • Contexte et habitude de vie • Difficultés et réussites à suivre son traitement ainsi que les conduites à tenir préconisées
- 63. La prise en charge thérapeutique Education thérapeutique: Les personnes diabétiques doivent parvenir à faire une place raisonnable dans leur vie au diabète et à sa prise en charge pour exercer un contrôle sur leur maladie et en même temps préserver leur qualité de vie. La prescription d’un traitement pharmacologique (antidiabétiques oraux ou insulinothérapie) et les conseils de modification des habitudes de vie doivent être associées à une éducation thérapeutique, cette approche faisant partie intégrale du traitement
- 64. Education thérapeutique: L’éducation thérapeutique tient compte de la personnalité et de la situation psychosociale du patient, de son stade d’acceptation de la maladie et de ses connaissances. C’est une démarche structurée et organisée qui nécessite une analyse de la situation, une formulation des besoins, la conception d’un projet individualisé, sa mise en œuvre et son évaluation. Cette éducation thérapeutique peut être proposée par un/e infirmier/ère spécialisée, en collaboration avec le médecin traitant. Selon l’analyse de la situation effectuée à chaque consultation et les besoins identifiés, les sujets suivants seront abordés et travaillés en priorité:
- 65. Compréhension de sa maladie
- 66. Compréhension de sa maladie Le patient sera capable de décrire ce qui se passe dans son corps du fait de la maladie et de s’expliquer la survenue de cette maladie dans sa vie. On veillera à ce que le patient puisse s’exprimer sur son vécu émotionnel et sur les répercussions de sa maladie sur sa vie familiale, sociale et professionnelle.
- 67. Autosurveillance glycémique (ASG) Au cours de l’éducation thérapeutique il faut: Apprendre au malade à bien utilisé le lecteur de glycémie . Précisé la fréquence, les horaires, les objectifs glycémiques fixés avec le médecin. Lui apprendre à ajuster son traitement ASG active « mesure la glycémie pour agir » L’identification des situations à risque (hypoglycémie; hyperglycémie).
- 68. Recommandations de la haute autorité de santé (HAS) mai 2006 La prescription de l’auto-surveillance glycémique ne doit pas être systématique chez le diabétique type 2 elle indiquée : Chez les patients insulinotraités Chez les patients chez qui l’insuline est envisagée a court po moyen terme et avant sa mise en route. Chez les patients traités par insulino-secriteures afin de rechercher ou confirmer une hypoglycémie, et adapter si besoin la posologie de ses médicaments. Comme instrument d’éducation lorsque l’objectif n’est pas atteint, permettant d’apprécier l’effet de l’activité physique, de l’alimentation et du traitement.
- 69. ASG
- 70. Conseils pratiques pour la réalisation de la glycémie capillaire Lavage des mains avec de l’eau tiède. Bien sécher les mains . Ne pas utilisé l’alcool. Vérifier le code des bandelettes. Importance de réglage de l’auto piqueur à faible force de pénétration afin d’atténuer la douleur .
- 71. Alimentation A l’aide de l’infirmière spécialisée et d’une diététicienne, le patient apprendra les bases d’une alimentation équilibrée : reconnaissance des aliments contenant des hydrates de carbone, importance de leur consommation régulière, établissement d’un plan précis des quantités, du contenu et des horaires des repas, adaptation du traitement en fonction de l’apport en hydrates de carbone. Pour schématiser, une assiette équilibrée est constituée d’ 1/4 d’hydrates de carbone, d’1/4 de protéines, et d’1/2 de légumes, à adapter en fonction des préférences culinaires et ressources du patient. On s’assurera particulièrement que le patient est en capacité de mettre en œuvre de façon pratique les recommandations dans sa vie quotidienne.
- 72. Activité physique Le patient connaîtra les bénéfices d’une activité physique régulière sur sa maladie. Il sera capable d’intégrer les recommandations dans sa vie quotidienne
- 73. Maladie intercurrente Le patient apprendra les mesures à prendre en cas de fièvre, de diarrhées, de grippe ou d’autre maladie intercurrente, car ces situations risquent d’entraîner une hypoglycémie ou une décompensation du diabète. Il sera donc capable de repérer les situations à risque, d’adapter le traitement d’insuline ou autre hypoglycémiant, d’assurer des apports alimentaires suffisants (avec éventuellement un fractionnement des repas), et de compenser des pertes hydro-sodées.
- 74. Prévention des lésions des pieds Le patient ayant une polyneuropathie des MI connaîtra son risque podologique (valeur de pallesthésie). Il sera conscient qu’une éventuelle perte de sensibilité à la douleur ou à la chaleur l’expose à un risque accru de développer des lésions qui pourraient passer inaperçues. Il connaîtra les mesures préventives à prendre, avec examen manuel des chaussures avant de les porter, et le port de souliers larges, particulièrement pour les patients avec pieds à risque
- 81. Technique d’injection Le patient apprendra les étapes de préparation des seringues ou des stylos prêts à l’emploi, connaîtra les techniques d’injection avec variation du site d’injection (la rapidité d’absorption dépend du site: abdomen > bras > cuisse).
- 82. Injection de l’insuline Pour obtenir une bonne absorption de l’insuline, il faut injecter dans la couche de gras entre la peau et le muscle.
- 83. Faites un pli cutané pour faire une injection avec une aiguille de 8 mm ou de 12,7 mm afin d’éviter d’injecter l’insuline dans le muscle. Utilisez le pouce, l’index et le majeur pour faire un bon pli cutané Il n’est peut-être pas nécessaire de faire un pli cutané si vous utilisez une aiguille courte, comme celle de 5 mm.
- 84. Sites d’injection Le taux d’absorption de l’insuline varie d’une région à l’autre du corps. La quantité d’insuline absorbée et la vitesse d’absorption varient d’une région à l’autre du corps, ce qui peut affecter votre glycémie. Essayez de toujours faire vos injections dans la même zone (comme l’abdomen) et suivez un programme d’injections en rotation pour ne pas faire vos injections toujours au même endroit.
- 85. Sites d’injection L’abdomen est la meilleure zone pour l’absorption de l’insuline. N’injectez pas à moins de deux pouces du nombril. L’avant-bras est la deuxième meilleure zone pour l’absorption de l’insuline. C’est un endroit plus difficile d’accès, et il est plus difficile de se faire soi-même une bonne injection.
- 86. Sites d’injection Les cuisses et les fesses n’absorbent pas l’insuline rapidement. L’exercice peut affecter le taux d’absorption dans ces zones. Il vaut mieux ne pas les utiliser trop souvent
- 87. Sites d’injection Le fait d’injecter toujours au même endroit peut entraîner la formation de nodules graisseux, lesquels sont causés par la lipodystrophie. Ces nodules peuvent être disgracieux et nuire à l’absorption d’insuline
- 89. Co-gestion de la maladie avec le patient La Fédération Internationale du Diabète (IDF, International Diabètes Fédération) a édité des guidelines de prise en charge du diabète de type 2. Celles-ci ont été regroupées par item,
- 90. Guidelines de la Fédération Internationale du Diabète
- 91. Quand le médecin généraliste doit il adresser un diabétique ? 1/ Doute diagnostic ou confirmation diagnostique 2/ Une fois par année 3/ Devant l’apparition d’une complication 4/ Devant un déséquilibre inexpliqué : éliminer d’abord : -Un écart de régime : fréquent - Un arrêt du traitement quelle que soit la raison - Une infection (urinaire, génitale, dentaire, tuberculose) 5/ un diabète gestationnelle 6/ Complications aiguës 7 / Une LTP est une urgence médicale
- 92. HOSPITALISATION : POUR QUI ? – Hypercosmolarité : hyperglycémie majeure, DH2O intraC, osmolarité plasmatique : • état de déshydratation: soif, plis cutané, hypotension, hypotonie des globes oculaires, état de choc, coma, Glycémie dépassant 3 g/l, – CU: glucosurie massive ± Acétonurie – Hypoglycémie – LTP grade 2 et plus – Femme enceinte
- 93. FMC
- 94. CONCLUSION • Le médecin généraliste est à la base de la prise en charge du diabète (DT2) • Participe au dépistage • Au diagnostic , prise en charge, suivi et traitement du diabétique • En insistant sur le volet éducation des patients • Associe la prise en charge des FRCV en prévention primaire et secondaire, soit à l’échelle individuelle ou collective • Doit se recycler (FMC) et faire partie d’un groupe de travail (réseau) dans le cadre de santé publique ou de recherche. .prévention du diabète
- 95. MERCI
Notes de l'éditeur
- LE 07/03/2015