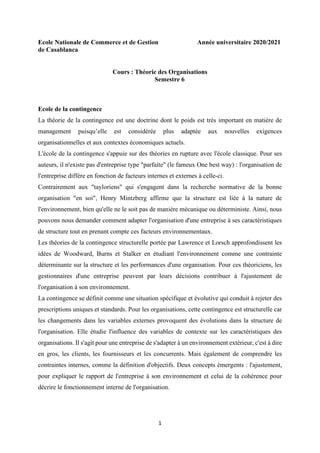
Cours 5 to
- 1. 1 Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Année universitaire 2020/2021 de Casablanca Cours : Théorie des Organisations Semestre 6 Ecole de la contingence La théorie de la contingence est une doctrine dont le poids est très important en matière de management puisqu’elle est considérée plus adaptée aux nouvelles exigences organisationnelles et aux contextes économiques actuels. L'école de la contingence s'appuie sur des théories en rupture avec l'école classique. Pour ses auteurs, il n'existe pas d'entreprise type "parfaite" (le fameux One best way) : l'organisation de l'entreprise diffère en fonction de facteurs internes et externes à celle-ci. Contrairement aux "tayloriens" qui s'engagent dans la recherche normative de la bonne organisation "en soi", Henry Mintzberg affirme que la structure est liée à la nature de l'environnement, bien qu'elle ne le soit pas de manière mécanique ou déterministe. Ainsi, nous pouvons nous demander comment adapter l'organisation d'une entreprise à ses caractéristiques de structure tout en prenant compte ces facteurs environnementaux. Les théories de la contingence structurelle portée par Lawrence et Lorsch approfondissent les idées de Woodward, Burns et Stalker en étudiant l'environnement comme une contrainte déterminante sur la structure et les performances d'une organisation. Pour ces théoriciens, les gestionnaires d'une entreprise peuvent par leurs décisions contribuer à l'ajustement de l'organisation à son environnement. La contingence se définit comme une situation spécifique et évolutive qui conduit à rejeter des prescriptions uniques et standards. Pour les organisations, cette contingence est structurelle car les changements dans les variables externes provoquent des évolutions dans la structure de l'organisation. Elle étudie l'influence des variables de contexte sur les caractéristiques des organisations. Il s'agit pour une entreprise de s'adapter à un environnement extérieur, c'est à dire en gros, les clients, les fournisseurs et les concurrents. Mais également de comprendre les contraintes internes, comme la définition d'objectifs. Deux concepts émergents : l'ajustement, pour expliquer le rapport de l'entreprise à son environnement et celui de la cohérence pour décrire le fonctionnement interne de l'organisation.
- 2. 2 Structure organisationnelle ? Les organisations différentes les uns des autres, en particulier par leur structure. Par structure organisationnelle, on entend l’ensemble des paramètres qui caractérisent la division, la coordination et le contrôle de l’activité au sein d’une organisation. Il s’agit d’une approche formelle de l’organisation qui s’appuie sur l’organigramme, trois principaux types de structures sont généralement distingués. Ils servent de références aux dirigeants qui les aménagent en fonction des spécificités de leur entreprise. Les structures formelles, représentées sous la forme d’un organigramme, reposent sur un mode de division des activités des organisations (par rapport aux fonctions principales ou encore aux types de produits ou de marchés). Elles font apparaître le découpage des responsabilités et les relations hiérarchiques. Si l’on exclut la structure simple articulée autour du chef d’entreprise et propre aux petites entreprises, trois structures fondamentales sont généralement distinguées : les structures fonctionnelles, divisionnelles et enfin matricielles. La structure fonctionnelle : repose sur le découpage de l’organisation par grandes fonctions ; le découpage des unités est donc horizontal et entraîne leur spécialisation ; La structure divisionnelle : opère un découpage de l’entreprise en unités autonomes spécialisées en fonction des domaines d’activités stratégiques. La structure matricielle : est une structure plus complexe que les précédentes. En effet, elle combine deux critères de segmentation des activités. Les couplages les plus courants sont les structures matricielles fonctions/produits. Les travaux de Burns et Stalker : Burns et Stalker ont étudié comment l'environnement influençait les structures organisationnelles à partir d'une enquête sur une vingtaine de compagnie industrielles anglaises de tous secteurs d'activité. Sur la base de l'appréciation de l'environnement par le taux de changement de technologie et du marché, ils sont parvenus à distinguer cinq types d'environnement : du plus stable (pas de changement dans la technologie et le marché) au moins prédictible (très grand changement à la fois dans la technologie et le marché). En guise de résultats, Burns et Stalker ont énoncé que la structure d'une organisation dépend des facteurs externes, qui sont rien d'autre que l'incertitude de l'environnement dont la mesure se fait à l'aide des taux de changement de la technologie et du marché :
- 3. 3 • Les organisations mécanistes (structure rigide pour un environnement dit stable) : elles sont caractérisées par : des tâches standardisées et spécialisées, des procédures formalisées, l’observation de directives, les décisions se prennent au sommet de la structure, l’importance de la position hiérarchique ; • Les organisations organiques (structure souple pour un environnement dit instable) : elles sont caractérisées par : des tâches moins définies, plus floues, la communication latérale, la reconnaissance de l’expertise, l’autorité décentralisée, la valorisation individuelle fondée sur la contribution personnelle Burns & Stalker manifestent qu’il n’y a pas un type d’organisation supérieur à l’autre, car la réalité oppose la théorie : il n’existe pas de structure purement mécaniste ou organique mais des structures partiellement mécanistes et organiques, l’important est que ces dernières ne soient pas figées. - Illustration d’environnement stable : Production automobile après la seconde guerre mondiale. - Illustration d’environnement instable : Start-up sur un marché exploitant une nouvelle technologie. Les travaux de Lawrence et Lorsch : Il s’agit d’une forme plus achevée aux travaux expérimentaux de Burns et Stalker. Ils ont essayé de répondre à la question suivante : Quelles sortes d'organisation sont nécessaire pour faire face aux différents environnements de l'entreprise ? Ils ont tiré leurs conclusions d'une étude expérimentale menée entre 1963 et 1966 de dix entreprises aux Etats Unis. Ces entreprises ont été choisies volontairement dans des secteurs différents car elles montraient ainsi des différences importantes sur les caractéristiques d'incertitude et de diversité de leur environnement respectif. Ils vont donc s’efforcer d’analyser l’incertitude de l’environnement d’une organisation et sa structure interne : plus fort est le degré de certitude d’un sous-environnement (technologique, concurrentiel, etc.), plus formalisée devra être la structure. La démarche de Lawrence et Lorsch est fondée sur deux concepts clés pour analyser les organisations :
- 4. 4 • La différenciation de l’organisation : l’organisation se segmente en sous-systèmes (plus l’environnement est instable, plus l’entreprise se différencie en adoptant une segmentation de l’organisation en sous-systèmes autonomes) ; • L’intégration dans l’organisation : collaboration entre les unités. Ils ont observé que : Plus les unités de travail sont différenciées, plus le besoin d’intégration est grand. En environnement stable, les unités de travail sont faiblement différenciées. En environnement instable, les unités de travail seront différenciées en départements, et l’entreprise aura recours à des mécanismes d’intégration pour les coordonner et assurer une cohésion d’ensemble. • Ces travaux montrent qu’une organisation est bien contingente à des variables externes et internes. Leurs conclusions sont proches des travaux de T. Burns et G. Stalker. Les travaux de Woodward Joan Woodward a pu observer différents types de structures d’entreprises (avec des organigrammes dissemblables) et elle a cherché à s’expliquer la raison de ces différences. Elle l’a expliqué par des différences technologiques : des entreprises peu évoluées technologiquement et dotées d’une main d’oeuvre peu qualifiée devraient avoir une structure différente des entreprises spécialisées dans les technologies. Joan Woodward donne naissance à la théorie de la contingence structurelle qui affirme qu’il n’existe pas de forme structurelle idéale mais que la structure à adopter pour une entreprise dépendra d’éléments et de facteurs qui lui sont propres. Pour elle, l’entreprise dans son évolution devra faire évoluer également sa structure en fonction de diverses contingences. Woodward remarqua que ni la taille, ni l'histoire de l'entreprise, ni la branche d'industrie n'expliquaient les différences constatées : les différences provenaient essentiellement de la technologie développée. Elle identifie trois formes de technologie de production, pour chaque mode, elle va définir une structure adéquate : La production en petites séries (très peu standardisée et flexible) : Système de contrôle direct ou par ajustement mutuel et les structures doivent être plus souples ; il faut s’adapter à la demande du client pour concevoir des produits très différents avec une
- 5. 5 main d’oeuvre très qualifiée qui connait bien son travail ; on choisira là une structure de type organique. La production de masse (standardisée et fabriquée en grande quantité) : les produits ne sont pas différenciés, l’organisation sera mécaniste, de type fordiste. La production en continu (processus automatique d’un seul produit) : c’est la compétence et l’expertise des salariés qui prime avec nécessité d’une très bonne communication horizontale, le rôle du manager sera très important. Les Travaux de Alfred Chandler La thèse qu’il développe est que la stratégie de l’organisation détermine sa structure puisqu’il montre que les entreprises qui offrent une gamme et une quantité limitée de produits étaient à l’origine des structures centralisées. Les stratégies de croissance et de diversification ont donné naissance aux structures divisionnalisées. Dans son ouvrage fondamental, Stratégie et Structure de l’entreprise (1962), il considère qu’il est important que les entreprises mettent en œuvre une logique de planification stratégique avant la construction de la structure organisationnelle. La théorie de Chandler a contribué à une restructuration générale des grandes entreprises américaines en organisation en départements, cette organisation devenant une norme de structure pour les firmes fabricant de nombreux produits pour des marchés multiples. Sa principale contribution à la théorie des organisations est d’avoir expliqué les relations entre la stratégie et la structure des entreprises. Il fut le premier théoricien à indiquer l’importance du principe de décentralisation dans une grande compagnie et pose l’idée de la nécessaire coordination de la planification stratégique pour favoriser la croissance, tout en donnant la possibilité aux unités opérationnelles et aux divisions d’appliquer des tactiques quotidiennement. L’approche de Chandler s’inscrit dans le courant de la contingence, car il part du principe que les évolutions de l’environnement des firmes conduisent les entreprises à se transformer en grandes organisations hiérarchisées et divisionnalisées. La stratégie est envisagée comme la détermination des buts et des objectifs à moyen et long termes à atteindre, les moyens d’action et les ressources allouées. La structure correspond à la façon dont l’organisation est assemblée pour appliquer la stratégie adoptée. Au total, son apport est de dire que la stratégie doit déterminer les choix structurels des dirigeants pour une plus grande efficacité et l’amélioration des performances à long terme.
- 6. 6 Comme cité auparavant, son analyse repose sur l'observation de plusieurs grandes sociétés américaines au cours des années 1850-1920 dont : General Motors, DuPont, Standard & Oil. Il met en évidence le processus qui va conduire une entreprise à modifier sa structure interne. Sur le long terme, l'entreprise mono produit se développe avec la croissance de son marché et l'augmentation de la demande, elle recherche de nouvelles ressources et se tourne vers des partenaires extérieurs. L'augmentation de la taille de l'entreprise la contraint à décentraliser son pouvoir de décision et formaliser sa structure (se dirige vers une structure fonctionnelle). Chandler constate que le développement de nouveaux marchés et l'élargissement de la gamme va rendre l'organisation progressivement inefficace. Pour remédier à cela, elles recherchent des mécanismes de coordination pour mieux accorder les différentes activités avec des organisations de plus en plus divisionnalisées. Alfred Chandler examine ainsi l’évolution des premières grandes sociétés américaines entre 1850 et 1920. C’est à cette période, selon lui qu’est né le capitalisme moderne marqué par des grandes entreprises constituées de plusieurs unités opérationnelles. Ces formes d’organisation remplacent progressivement les grandes entreprises traditionnelles spécialisées et centralisées. Ces nouvelles entreprises sont structurées de manière multidivisionnelle (M Form). Ainsi, à partir des années 1920, l’économie américaine va être marquée par l’émergence de ce type de structures. Les facteurs de contingence selon Henry Mintzberg Mintzberg, il est considéré comme l’un des plus grands théoriciens des organisations. L’École de Mintzberg date des années 1980. Il a donné une unité à la théorie de la contingence en synthétisant les différentes approches et en dressant une typologie d’organisation en fonction des différents types de contingence. Mintzberg Depuis la fin des années 70, Henry Mintzberg essaie d’élaborer une synthèse de tous ces facteurs de contingence et de les intégrer pour proposer des structures organisationnelles adéquates. Les principaux facteurs de contingence propres à l’organisation sont l’âge, la taille, la technologie utilisée, le style de pouvoir et l’environnement. L’âge et la taille Dire que l’âge (ancienneté) et la taille (dimension) d’une organisation ont des conséquences sur la structure d’une entreprise relève d’une évidence, mais encore faut-il l’expliciter. Le paramètre de l’âge, qui traduit l’expérience acquise, se caractérise :
- 7. 7 – Pour les grandes entreprises, par des structures très élaborées et complexes qui ont su codifier et formaliser leurs tâches et standardiser l’ensemble de leurs processus de réalisation ; – Pour les petites et moyennes entreprises, par un esprit « maison » qui a capitalisé au cours des années un « savoir-faire » et dont les connaissances reposent essentiellement sur des habitudes et des traditions. Le paramètre de la taille, qui traduit la dimension par des besoins de coordination plus ou moins importants et par une division du travail plus ou moins forte, se caractérise, selon Henry Mintzberg, ainsi : Plus une organisation est de grande taille, plus sa structure est élaborée : plus les tâches y sont spécialisées, plus les unités sont différenciées et plus sa composante administrative est développée. – La structure de l’organisation reflète l’âge de la fondation de son activité. » Le système technique L’organisation de l’entreprise est fonction des produits réalisés. Il y a un lien entre l’organisation et le système technique, lequel est caractérisé par le processus qui transforme les « inputs » en « outputs », en utilisant les moyens de l’organisation mise en œuvre. Selon Henry Mintzberg : – « Plus le système technique est régulé c’est-à-dire, plus le contrôle du travail des opérateurs est grand, plus le travail opérationnel est formalisé et plus la structure du centre opérationnel est bureaucratique. – Plus le système technique est complexe, plus les fonctions de support logistique sont élaborées et qualifiées. – L’automation du centre opérationnel transforme la structure administrative de bureaucratie en structure organique. » L’environnement L’organisation de l’entreprise ne peut être conçue en ignorant son environnement dit « dominant », celui qui influencera fortement l’entreprise. On peut citer la connaissance du marché et de ses particularités comme facteurs caractérisant l’environnement, mais aussi la connaissance de la culture qui est un facteur fondamental du fonctionnement d’une organisation. Selon Henry Mintzberg : – « Plus l’environnement est dynamique et plus la structure est organique. – Plus l’environnement est complexe, plus la structure est décentralisée.
- 8. 8 – Plus l’organisation a des marchés diversifiés, plus elle a tendance à se scinder en unités organisées sur la base de ses marchés, en divisions, dans la mesure où les économies d’échelle le permettent. » Le pouvoir Il existe un lien entre pouvoir et organisation, qui réside dans le choix même de l’organisation, laquelle permet d’exercer sur la structure une forme plus ou moins forte de contrôle et de centralisation. Ce qu’en dit Henry Mintzberg : – « Plus le contrôle externe qui s’exerce sur l’organisation est puissant, plus la structure d’organisation est centralisée et formalisée. – Une coalition externe divisée tendra à créer une coalition interne politisée et vice versa. – Il existe en matière de structure (et de culture) une mode qui pousse les organisations à se mettre au goût du jour, même si cela n’est pas approprié pour l’organisation » Dans le prolongement de l’école sociotechnique, l’école de la contingence a définitivement abandonné les courants de pensée normatifs classiques. Il n’y a pas de structure organisationnelle idéale ni de réponse universelle. Pour des situations différentes, il existera des modes d’organisations différents. L’organisation conçue comme un système ouvert doit adapter sa structure aux contraintes de son environnement.
