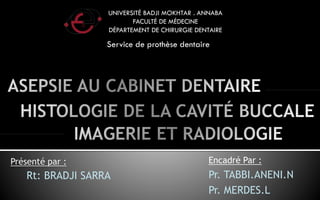
Asepsie ,histo, radio
- 1. Encadré Par : Pr. TABBI.ANENI.N Pr. MERDES.L Présenté par : Rt: BRADJI SARRA UNIVERSITÉ BADJI MOKHTAR . ANNABA FACULTÉ DE MÉDECINE DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE DENTAIRE Service de prothèse dentaire
- 3. INTRODUCTION 1- Définitions. 1-1 Asepsie. 1-2 Antisepsie. 1-3 Désinfection 1-4 Stérilisation. 2- La contamination au cabinet dentaire 3- Protection de l’équipe dentaire 4- La chaîne d’asepsie en cabinet dentaire 5-Moyens d’asepsie au cabinet dentaire.
- 4. 6- Asepsie en prothèse dentaire: 6-1 Potentiel infectieux en prothèse 6-2Evolution du concept d’asepsie en prothése 6-3 La chaine d’asepsie en prothése dentaire Elle comporte plusieurs maillons: 6- 3-1L’asepsie au cabinet. 6-3-2l’asepsie au laboratoire de prothèse. 6-3-3- La décontamination des empreintes . 6-3-4- La décontamination des matériaux de réplique. 6-3-5- La décontamination des pièces prothétique. CONCLUSION
- 5. Le cabinet dentaire est chaque jour contaminé par la dissémination anarchique de millions de germes pathogènes véhiculés par chaque patient . De nombreuses mesures d’hygiène de désinfection, de stérilisation et d’asepsie permettent actuellement de juguler ce risque ; en odontologie, praticien, laboratoire de prothèse et concepteurs sont tous intéressés.
- 6. Ensembles des techniques destinées à empêcher l’introduction des germes dans l’organisme. On obtient l’asepsie par l’antisepsie et la stérilisation. Ensemble des procédés utilisés pour combattre les germes septiques, les détruire et empêcher leur prolifération.
- 7. La destruction de tous les micro-organismes pathogènes a l’exception des spores. La destruction de tous les micro-organismes pathogènes compris les spores. La désinfection La stérilisation
- 8. « Le risque de contamination existe dans trois sens » Patient PraticienPatient
- 9. Voie sanguine - Contact avec des microlésions de la peau. - Piqure accidentelle par instrument souillés de sang -Infection HIV -Hépatite B et C Voie respiratoire - Inhalation d’aérosol infectés - Contact avec un patient infecté -Tuberculose -Grippe, méningite -Diphtérie Mode de transmission Circonstances Contamination infectieuse
- 10. Mode de transmission Circonstances Contamination infectieuse Voie oculaire - Projection de débris infectés sur l’œil exposé - Infection cornéenne, - Kérato-conjonctivites virales Voie manuportée - Contact avec la salive infectée des patients - Infection digestive et cutanée.
- 11. BUTS Protection vestimentaire Eviter dans le cabinet la contamination par des germes venant de l’extérieur. Eviter d’amener à domicile des germes venant du cabinet.
- 12. Hygiène vestimentaire Moyens Port de masque. Port de blouses. Port des gants. Port de lunettes.
- 13. Hygiène vestimentaire Moyens Port de masque: - Remplacés entre chaque patient, ils protègent les muqueuses nasales et buccales. Ces masques sont dits « de protection » ; le plus souvent, ils sont constitués de charbon actif. -Il est surtout recommandé en cas de tuberculose ou d’autres affections respiratoires tel le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)
- 14. Hygiène vestimentaire Moyens Port des lunettes: -Les lunettes devront présenter une protection latérale, et donc bien couvrir les yeux pour éviter toute aérosolisation ou projection de débris et gouttelettes. -Ces lunettes doivent répondre à des caractéristiques: Résistance et protection, Résistance à la rayure, Absence de reflet (scialytique) et de l’existence d’un effet antibuée.
- 15. Hygiène vestimentaire Moyens Port de blouses La tenue de protection a pour objectif d’assurer une protection au soignant comme au soigné. Les vêtements de travail doivent être changés régulièrement et chaque fois qu’ils sont visiblement souillés. Ils doivent remplacer ou recouvrir largement les vêtements civils et avoir des manches courtes ou semi-longues qui facilitent le lavage des mains.
- 16. Hygiène vestimentaire Moyens Port des gants Le port de gants doit être un geste « réflexe » dès qu’il y a contact avec la zone buccale . Les gants se différencient d’une part par leur matériau et d’autre part par leur destination. Ils doivent être à usage unique.
- 17. Hygiène vestimentaire Moyens Port des gants Le produit de référence reste le latex, polymère d’origine naturelle extrait d’Hevea brasiliensis. il en existe aussi: polymères de synthèse, soit en néoprène, soit en acrylonitrile, soit en chlorure de polyvinyle. Matériau
- 18. Hygiène vestimentaire Moyens Port des gants Gants d’examen: Destination: Ils seront présentés stériles ou non. Des gants stériles sont nécessaires lorsque les soins nécessitent un niveau de traitement aseptique. Gants chirurgicaux.
- 19. Hygiène vestimentaire Moyens Port des gants Gants d’examen: Destination: Ils seront présentés stériles ou non. Des gants stériles sont nécessaires lorsque les soins nécessitent un niveau de traitement aseptique. Gants chirurgicaux.
- 20. Hygiène vestimentaire Règles de base pour une bonne utilisation des gants : • se laver les mains avant le port des gants ; • ne mettre des gants que sur des mains sèches ; • rejeter les gants présentant des défauts ou des altérations ; • changer les gants de façon régulière ; • enlever les gants sans toucher la surface externe : principe sale – sale ; • se laver les mains après le port de gants ; • conserver les gants dans leur emballage d’origine ; • conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et des risques électriques.
- 21. Hygiène vestimentaire Tenue vestimentaire et barrières de protection portée par le praticien
- 22. Hygiene des mains But Elimination des germes pathogènes de la peau formant une flore transitoire. Conservation de l’intégrité de la peau, pas de blessures, pas de crevasses.
- 23. Hygiene des mains NB: La flore microbienne de la peau recouvrant les mains comprend des microorganismes résidents (colonisateurs) et transitoires (contaminants). La flore résidente est rarement responsable d’infections (exceptions : déficit immunitaire, greffe, etc.). Par contre, la flore transitoire, acquise du milieu buccal, de l’environnement, des instruments, etc., est parfois à l’origine d’infections.
- 24. Hygiene des mains Moyens -Ongles ni longues, ni laqués -Pas de bagues, ni bracelets -Avant et après chaque intervention, un lavage antiseptique des mains doit être fait. -Des gants neufs sont utilisés pour chaque patient. -Des brosse a ongles stérilisables placées dans une solution désinfectante
- 25. Hygiene des mains Moyens Lavage simple : Objectif : prévenir la transmission manuportée et éliminer la flore transitoire. Après tout geste de la vie courante et soin non invasif. Avec un savon liquide doux et dure au minimum 30 secondes et essuyage avec une serviette à usage unique. Lavage des mains
- 26. Hygiene des mains Moyens Lavage antiseptique : Objectif : éliminer la flore transitoire et diminuer la flore commensale. Avant tout geste invasif ou soin. Avec un savon liquide antiseptique pendant une minute (30 à 60 secondes selon le produit). Lavage des mains
- 27. Lavage antiseptique des mains 30 à 60 sec 1 Rincer les mains à l’eau courante tiède; 3 Faire mousser de 3 à 5 ml de savon, laver en frictionnant , les poignets et le pourtour des ongles, et insister sur les espaces interdigitaux 2 Appliquer du savon antiseptique
- 28. Lavage antiseptique des mains 5 Sécher les mains à fond avec une serviette de papier 4 Rincer les mains à l’eau courante tiède;
- 29. La vaccination Maladies Recommandations Diphtérie , Tétanos Elle est recommandée pour la protection personnelle (tétanos et diphtérie) et celle des usagers (diphtérie). Influenza Cette vaccination est recommandée pour la protection personnelle et pour celle des usagers. Hépatite B Les intervalles « réguliers » sont. Toute intervention est cessée dès qu’un taux supérieur ou égal à 10 UI/l est documenté. Tuberculose Si le résultat est négatif, le TCT ne doit être refait qu’en
- 30. Instruments contaminés Pré-désinfection Nettoyage Instruments prêts à l’emploi Séchage CINQ (05) OPERATIONS SIMPLES ET AISEES Rinçage Stérilisation/emballage hermétique
- 31. Pré-désinfection Objectifs C’est une étape primordiale qui répond aux objectifs suivants : -Limiter le risque de contamination du personnel soignant et de l’environnement -Diminuer la quantité des agents infectieux. -Faciliter les étapes suivantes de nettoyage et de stérilisation.
- 32. Prédésinfection Méthode: Le produit prédésinfectant se présente en poudre ou en liquide, contenant un détérgent fortement alcalin et un désinfectant de faible spectre anti-microbien Les instruments sont versés dans le bain de pré désinfection. Immersion totale des instruments
- 33. Nettoyage Objectifs: -Eliminer les salissures afin d’obtenir un matériel propre. -Obtenir un matériel propre puisqu’on ne stérilise que ce qui est propre. La stérilisation n’est valable que si elle est précédée d’un nettoyage efficace et rigoureux, car « on ne stérilise bien que ce qui est propre
- 34. Nettoyage Méthodes: Il doit être réservé au matériel ne supportant pas un nettoyage aux ultrasons ou automatique car il présente un risque augmenté de contamination du personnel et de l’air. Manuel : Nettoyage avec une brosse et rinçage sous l’eau courante des instruments
- 35. Nettoyage Méthodes: Ultrasonique : C’est un lavage semi-automatique. -Les instruments en 1 ou 2 couches, sont totalement immergé -Les ultrasons sont maintenus pendant 4 à 15 minutes selon le nombre et type d’instruments, et la puissance de l’appareil. -Les instruments sont ensuite rincés durant 5 minutes puis parfaitement séchés.
- 36. Nettoyage Méthodes: Automatique : Les autolaveurs présentent l’avantage de réaliser toutes les étapes, de la prédésinfection , rinçage au séchage de l’instrumentation
- 37. Rinçage et séchage Au cours de cette étape, les instruments sont vérifiés quant à la qualité du nettoyage et seront entretenus. Les instruments doivent être rincés à grande eau courante afin d’éliminer tous résidus ou taches de désinfectants. Les instruments doivent être placés sur des serviettes de tissu non pelucheux .
- 38. Désinfection Cette étape est effectuée sur des instruments propres. Elle est strictement réservée aux instruments thermosensibles ne pouvant être stérilisés », Les principales familles de désinfectants: -Dérivés chlorés, -oxydants, -dérivés phénoliques, -alcools, -aldéhydes.
- 39. Emballage ou conditionnement Il garantit, la protection du matériel propre avant la stérilisation et le maintien de l’état stérile du dispositif médical dans le temps, il assure la maîtrise de la chaîne d’asepsie. Conditionnemen ts rigides Emballages thermoscellés
- 40. Stérilisation La stérilisation selon le principe énoncé « on ne stérilise que ce qui est propre » vise trois (03) objectifs : -Destruction complète des micro-organismes. -Conservation de l’état de stérilité. -Respect du matériel dans son intégrité.
- 41. Stérilisation -Les mesures d’Asepsie, le contrôle de l’infection et la STERILISATION font désormais partie intégrante de notre exercice. -La plupart des instruments, appareils et matériels dentaires sont réutilisés. Ils doivent donc être traités de façon à éliminer tout risque de transmission de germes infectieux. But:
- 42. Stérilisation -On ne stérilise que ce qui est propre et sec. -La stérilisation à la vapeur reste la stérilisation de référence. -Toute stérilisation doit faire l’objet de contrôle. -Le conditionnement du matériel doit assurer l’état de stérilité jusqu’à son utilisation. -Le matériel doit être exempt d’humidité après la stérilisation. Principes:
- 43. Il existe essentiellement quatre modes de stérilisation : -Chaleur humide. (Autoclave). -Vapeurs chimiques. (Chemiclave). -Chaleur sèche. (Poupinel). -Stérilisation à froid.
- 44. Stérilisation à la chaleur sèche « Poupinel »: Pour tous les instruments en acier inoxydable: Le cycle de stérilisation comprend : 01 h de stérilisation à 170°C 02h30 à 160°C 30 min à 180°C 01 h de refroidissement30 à 45 mn de préchauffage
- 45. Stérilisation à la chaleur sèche « Poupinel »: Inconvénients: -Temps de traitement long -Température élevée et longue durée de la stérilisation détériorent le matériel Homogénéité de la température au sein de la charge difficile à réaliser -La porte peut s’ouvrir sans remise à zéro de la minuterie.
- 46. Stérilisation a la vapeur d’eau « autoclave » Le cycle de stérilisation est de 30 mn à 121° et de 20mn à 134° .
- 47. Stérilisation a la vapeur chimique Le cycle de stérilisation est de 20mn a 132°c a une pression de 02 bars. Ses avantages sont indéniables pour la stérilisation de matériel et instruments complexes ou ne résistant pas à la stérilisation par la chaleur sèche. Les inconvénients de cette méthode sont relatifs par rapport au coût d’achat et de fonctionnement élevés ainsi qu’au dégagement de vapeurs toxiques.
- 48. Stérilisation a la vapeur chimique Le cycle de stérilisation est de 20mn a 132°c a une pression de 02 bars. Ses avantages sont indéniables pour la stérilisation de matériel et instruments complexes ou ne résistant pas à la stérilisation par la chaleur sèche. Les inconvénients de cette méthode sont relatifs par rapport au coût d’achat et de fonctionnement élevés ainsi qu’au dégagement de vapeurs toxiques.
- 49. Stérilisation a froid Cette méthode consiste en une stérilisation au moyen d’oxyde d’éthylène pour les objets et instruments thermo-sensibles. On peut à défaut , utiliser une solution de glutaraldéhyde à 02% pendant 06 à 10 heures.
- 50. Potentiel infectieux -Des prélèvements réalisés sur des cires d’occlusion, des empreintes, des maîtres modèles et des prothèses permettent d’identifier, dans 67 % des cas : Staphylococcus aureus, streptocoques non groupables, Pseudomonas sp., Escherichia coli, Enterobacter sp., Corynebacterium sp., Neisseria sp., Bacillus sp., Klebsiella sp. ; la colonisation des prothèses adjointes par Candida sp. est également fréquente. L’identification virale n’a pas été réalisée au cours de ces études.-.
- 51. Evolution du concept de la désinfection en prothèse Les moyens physiques - La désinfection en prothèse a utilisé à la fin du dix-neuvième siècle , des moyens physiques, tels que les ultrasons . Cette technique s’est vue complétée par l’apport d’une solution désinfectante pour de meilleurs résultats. - Dans un deuxième temps, des traitements thermiques des répliques de plâtre, ont eu recours à la technique de technique de thermo-désinfection, en utilisant la chaleur comme moyen de désinfection.
- 52. Evolution du concept de la désinfection en prothèse Les moyens physiques -L’apport des radiations aux ultra-violets, a permis au vingtième siècles, d’avoir un début de solution au problème posé. Cependant, tous ces moyens physiques de désinfection, ont prouvé leur inefficacité dans le traitement des empreintes et des matériaux de réplique.
- 53. Evolution du concept de la désinfection en prothèse La désinfection chimiques -Elle utilise différentes solutions désinfectantes, comme les alcools, les aldéhydes, les hypochlorites, les phénoles. Ces produit chimique ont prouvés une efficacité supérieur aux moyens physiques
- 54. Décontamination des empreintes La chaine d’aepsie en prothése Elle comporte plusieurs maillons: 1- L’asepsie au cabinet. 2- l’asepsie au laboratoire de prothèse. 3- La décontamination des empreintes . 4- La décontamination des matériaux de réplique. 5- La décontamination des pièces prothétique avant leur acheminement au cabinet.
- 55. Décontamination des empreintes Conditions exigées pour les solutions désinfectantes: 1-L’efficacité et la conservation des qualités physico-chimique des matériaux d’empreintes; 2- La stabilité dimensionnelle du matériaux d’empreinte; 3- L’éfficacité de l’inactivité bactérienne; 4- L’absence de toxicité des produits désinfectants; 5- La compatibilité du matériaux du désinfectant, et du matériau de coulée. La chaine d’aepsie en prothése
- 56. Décontamination des empreintes Procédés de décontamination en fonction du matériau d'empreinte 1 Empreintes aux hydrocolloïdes A- Hydrocolloïdes irréversibles: (Alginate) : sont hydrophilie Certains préconisent la pulvérisation de solutions à base de glutaraldéhyde à 2 % ou d'hypochlorite de sodium à des concentrations variant de 0,5 à plus de 5 %. La plupart des auteurs déconseillent l'immersion de l'empreinte au-delà de 10 minutes, car cela provoquerait, malgré ce temps relativement court, des distorsions.
- 57. Décontamination des empreintes Procédés de décontamination en fonction du matériau d'empreinte 1 Empreintes aux hydrocolloïdes B- Hydrocolloïdes réversibles: Comme les alginates, il s'agit d'un gel colloïdal chargé d'eau, donc sensible aux phénomènes de synérèse et d'imbibition, ce qui complique leur décontamination.
- 58. Décontamination des empreintes Procédés de décontamination en fonction du matériau d'empreinte 2 Empreintes au silicone: Toutes les familles de silicones sont formées de matériaux d'empreinte hydrophobes. Ils retiennent de ce fait moins les micro-organismes. Leur décontamination est donc plus simple. La décontamination par immersion reste la méthode de choix, la technique de pulvérisation ayant été abandonnée par la plupart des auteurs.
- 59. Décontamination des empreintes Procédés de décontamination en fonction du matériau d'empreinte 2 Empreintes au silicone: L'immersion peut être faite avec des solutions à base de glutaraldéhyde, d'hypochlorite de sodium, de dérivés iodés, etc. Le temps de trempage varie, selon selon les études, de quelques minutes à plusieurs heures. Trente minutes semblent être un temps acceptable dans des solutions à base de glutaraldéhyde à 2 % ou d'hvpo-chlorite de sodium à 0,5 %.
- 60. Le rinçage des empreintes en silicone sous l'eau courante constitue un temps très important lors de leur décontamination. Immersion de l'empreinte en silicone pendant 30 minutes dans une solution décontaminante.
- 61. Décontamination des empreintes Procédés de décontamination en fonction du matériau d'empreinte 3 Empreintes aux polysulfures: Ces matériaux, de moins en moins utilisés, sont, comme les silicones, hydrophobes. Ils peuvent donc subir sans aucun danger la même méthode de traitement que les empreintes au silicone.
- 62. Décontamination des empreintes Procédés de décontamination en fonction du matériau d'empreinte 4- Empreintes au polyéther: Ces matériaux d'empreinte, bien que d'aspect très proche des silicones, sont en fait hydrophiles, c'est-à-dire sensibles aux phénomènes d'imbibition. La décontamination prolongée par immersion n'est donc pas recommandée parce qu'elle entraînerait, quelle que soit la solution utilisée, des variations dimensionnelles et même une altération de la reproduction de l'état de surface.
- 63. Décontamination des modelés de travail Même si le traitement des empreintes a été fait correctement, les risques de contamination croisée ne sont pas totalement éliminés ; c'est la raison pour laquelle les modèles de travail doivent aussi subir un traitement de décontamination.
- 64. Décontamination des modelés de travail Plusieurs solutions ont été proposées: - Vaporiser une solution d’hypochlorite de sodium à o,5%; - Immerger les modèles pendant 10 mn dans la même solution ; - Utiliser une solution de sulfate de calcium saturée et d’hypochlorite de sodium à 5,25%; - Mettre le modèle à 100 °C pendant 15 mn dans un four.
- 65. Décontamination des modelés de travail De nouveaux plâtres permettront très prochainement d'augmenter encore ces températures jusqu'à 200 °C, voire plus, sans aucune interférence sur les propriétés du plâtre ; ce type de matériau pourrait permettre une décontamination plus simple, plus sûre et surtout plus rapide. Quel que soit le type des prothèses, elles doivent, avant d'être livrées, subir un traitement de décontamination et être mises dans des sachets étanches.
- 66. Décontamination des modelés de travail Les modèles en plâtre peuvent être décontaminés à l'aide d'un spray d'hypochlorite de sodium à 0,5 %. La décontamination des modèles peut être faite dans un four à 100 °C pendant 15 minutes.
- 67. La décontamination des pièces prothétique avant leur acheminement au cabinet. Quel que soit le type des prothèses (résine, céramique, métal, composite), une désinfection par immersion dans une solution à 0,5% d’hypochlorite de sodium pendant 30mn est réaliseé, suivie d’un rinçage à l’eau courante et d’un nettoyage aux ultrasons dans de l’eau distillée.
- 68. La décontamination des pièces prothétique avant leur acheminement au cabinet. Pour toutes les retouches faites sur des prothèses adjointes au laboratoire ou en clinique, on doit, au préalable, rincer l'appareil sous l'eau puis le tremper pendant quelques minutes dans une solution à 0,5 % ou 1 % d'hypochlorite de sodium et le rincer à nouveau, afin d'éliminer les risques de contamination croisée par projection lors du fraisage ou du polissage.
- 69. Asepsie au laboratoire ■ Tout ce qui entre dans le laboratoire en provenance d’une salle opératoire doit être : stérilisé, si stérilisable, ou désinfecté adéquatement. ■ Tout ce qui entre dans le laboratoire en provenance d’un laboratoire extérieur, même si le laboratoire procède à une désinfection, doit être : stérilisé, si stérilisable, ou désinfecté adéquatement. ■ Tout ce qui quitte le laboratoire et qui est destiné à aller en bouche doit être : stérilisé, si stérilisable, ou désinfecté adéquatement. .
- 70. Asepsie au laboratoire Articulateurs Fraises : -acier carbone acier -carbure de tungstène Stériliser Porte-empreintes : -aluminium -chrome (plaqué) -résine acrylique Stériliser -Plastique Stériliser à froid Agents de polissage : Jeter nettoyer et désinfecter
- 71. Asepsie au laboratoire Pierres montées : diamant abrasive(polissage) Stériliser Nettoyer et désinfecter Spatules, bols, couteaux, cire d’occlusion Guide de couleurs Nettoyer et désinfecter Pointes à polir, roues, disques et brosses Stériliser
- 72. L’exercice de la chirurgie dentaire est l’un des actes où la rupture de la chaîne de stérilisation est la plus fréquente. Le cabinet dentaire constitue un lieu privilégié en matière de contamination microbienne ; virale ; bactérienne ou mycosique. Le risque zéro n’existe pas, par contre, nous pouvons le réduire grâce aux moyens de prévention et de contrôle ; c’est le but de la chaîne de stérilisation au cabinet dentaire.
- 73. 1-DROUHET G. Prédésinfection : une étape incontournable dans la chaîne de stérilisation. Clinic, 2004; Hors série : pp 5-14. 2-DROUHET G, MISSIKA P. Maîtrise de la chaîne de stérilisation. Journal de Parodontologie et d'Implantologie Orale ; 24(2): pp.91-105. 3-FERREC G. Stérilisation du matériel de chirurgie au cabinet dentaire. AOS 2007 ; 237: pp.61-81 4-Jean barbeau.Daniel grenier:contrôle des infections Médecine dentaire; Edition 2009. 5-MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES. Guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie. Deuxième édition, Juillet 2006.
- 74. 5- MISSKA P, DROUHET G. Hygiène, Asepsie, Ergonomie- Un défit permanent. Collection JPOI, Edition CDP, 2001. 6-SILVIN A-M, DROUHET G. Le nécessaire pour un nettoyage optimal au cabinet dentaire. Clinic 2004 ; Hors-série : pp.47-51. 7- Thiveaud D . Grimoud M., Marty N: Hygiène : structures, matériels, méthodes; 23-815-A-10;EMC 2005.
- 76. INTRODUCTION 1-Rappel anatomique sur la cavité buccale 2-La muqueuse buccale : 2-1 Description histologique : 2-1-1 L’épithélium : -Cellules épithéliales kératinocytes. -Cellules non kératinocytes. 2-1-2 Le chorion. 2-1-2 La jonction épithélium-chorion. 2-2 Variations histologiques selon la topographie.
- 77. 4- L’organe dentaire : 4-1 Définition. 4-2 Description histologique : 4-2-1 L’émail. 3- Les maxillaires : 3-1 Définition. 3-2 Description histologique. 3-2-1 Le maxillaire supérieur. 3-2-2 La mandibule.
- 78. 4-2-2 Le complexe pulpo-dentinaire. 5- Le parodonte : 5-1 Définition. 5-2 Description histologique : 5-1 La gencive. 5-2 Le cément. 5-3 Le ligament alvéolo-dentaire. 5-4 L’os alvéolaire. CONCLUSION
- 79. La cavité buccale est délimitée par le palais, le plancher buccal, les joues et les lèvres, ainsi que la luette et les voûtes palatines de part et d’autre de la luette. La cavité buccale désigne à proprement parler l’espace frontal et latéral fermé par les dents et principalement occupé par la langue. Toute la cavité buccale est tapissée d’une muqueuse buccale.
- 80. ·La cavité buccale proprement dite. Centrale: cavité buccale proprement dite. Périphérique: vestibule de la bouche. La cavité buccale forme le premier segment du tube digestif. Elle est située à la partie inférieure de la face et ouverte vers l'avant et l'arrière .Elle est subdivisée en deux parties par les arcades alvéolo-dentaires : ·La cavité périphérique répondant au vestibule de la bouche ;
- 81. - C’est la muqueuse qui revêt la paroi interne des lèvres et la cavité buccale ; -elle est en continuité avec la peau à la jonction vermillon, versant externe des lèvres. Elle se poursuit en arrière avec la muqueuse digestive (pharynx) et respiratoire (larynx). -Elle est revêtue d’un épithélium malpighien non ou peu kératinisé. -elle est perforée par les dents au niveau des gencives et contracte ainsi une jonction étanche avec la dent.
- 82. - C’est la muqueuse qui revêt la paroi interne des lèvres et la cavité buccale ; -elle est en continuité avec la peau à la jonction vermillon, versant externe des lèvres. Elle se poursuit en arrière avec la muqueuse digestive (pharynx) et respiratoire (larynx). -Elle est revêtue d’un épithélium malpighien non ou peu kératinisé. -elle est perforée par les dents au niveau des gencives et contracte ainsi une jonction étanche avec la dent.
- 83. Description histologique: L’épithélium : Cellules épithéliales ou kératinocytes Dans les zones kératinisées se superposent les couches suivantes : 1-le stratum germinatum (couche basale ou germinative) -Repose sur la membrane basale. -Les cellules, cubiques ou cylindriques, ont un gros noyau très chromophile. -Elles sont disposées en une ou deux assises. -Elles sont le siège de nombreuses mitoses ;
- 84. Description histologique: L’épithélium : Cellules épithéliales ou kératinocytes Dans les zones kératinisées se superposent les couches suivantes : le stratum spinosum (ou couche squameuse) composé de cellules polygonales ou arrondies accrochées les unes aux autres par des ponts linéaires correspondant aux desmosomes
- 85. Description histologique: L’épithélium : Cellules épithéliales ou kératinocytes Dans les zones kératinisées se superposent les couches suivantes : le stratum granulosum (ou couche granuleuse) est formé de cellules aplaties renfermant dans leur cytoplasme de fines granulations de kératohyaline, colorées en violet par l’hématoxyline ;
- 86. Description histologique: L’épithélium : Cellules épithéliales ou kératinocytes Dans les zones kératinisées se superposent les couches suivantes : – le stratum corneum (ou couche kératinisée) constitué de fines squames acidophiles de kératine.Au sein de cette couche persistent souvent quelques noyaux résiduels pycnotiques, ou des espaces clairs représentant l’emplacement de noyaux dégénérés. Cet aspect caractérise la parakératose.
- 87. Description histologique: L’épithélium : Cellules épithéliales ou kératinocytes Dans les zones kératinisées se superposent les couches suivantes : – le stratum corneum (ou couche kératinisée) constitué de fines squames acidophiles de kératine.Au sein de cette couche persistent souvent quelques noyaux résiduels pycnotiques, ou des espaces clairs représentant l’emplacement de noyaux dégénérés. Cet aspect caractérise la parakératose.
- 88. Description histologique: L’épithélium : Cellules épithéliales ou kératinocytes Dans les zones non kératinisées: la couche granuleuse est absente. Les cellules conservent jusqu’en surface un noyau rond et leur cytoplasme renferme un glycogène abondant, PAS (acide périodique Schiff) positif, disparaissant après digestion par l’amylase.
- 90. Description histologique: L’épithélium : Cellules non kératinocytes Mélanocytes: Cellules de Langerhans Cellules de Merkel Cellules inflammatoires Souvent dénommées cellules claires, elles possèdent en effet un halo clair périnucléaire. On distingue:
- 91. Cellules non kératinocytes Mélanocytes: Nés de la crête neurale ectodermique, Ils sont susceptibles de se multiplier dans certaines conditions et entraînent alors une pigmentation endogène brunâtre. Situés dans l’assise basale de l’épithélium, ils sécrètent la mélanine, pigment brunâtre. En microscopie électronique, ce sont des cellules étoilées, dendritiques, qui, à l’inverse des kératinocytes, sont dépourvues de desmosomes et de tonofilaments.
- 92. Cellules non kératinocytes Cellules de Langerhans Proches parentes des macrophages. En microscopie optique, elles siègent surtout dans la région suprabasale de l’épithélium, mais sont parfois en plein corps muqueux. Ces cellules, globuleuses, ont un cytoplasme clair, abondant et un noyau allongé. Dépourvues de desmosomes, elles ont de multiples prolongements arborescents qui s’insinuent entre les kératinocytes (cellules dendritiques) et contractent des rapports avec les lymphocytes T intraépithéliaux..
- 93. Cellules non kératinocytes Cellules de Merkel Sans doute dérivées de la crête neurale, elles sont situées dans l’assise basale de l’épithélium. On les observe dans la gencive et le palais . Ce sont des cellules rondes, sans prolongements dendritiques. Elles peuvent posséder quelques tonofilaments, voire quelques desmosomes. Elles renferment dans leur cytoplasme des granules de catécholamines. Elles joueraient un rôle sensoriel en libérant un transmetteur aux fibres nerveuses adjacentes.
- 94. Cellules non kératinocytes Cellules inflammatoires Ce sont surtout des lymphocytes, rarement des polynucléaires
- 95. Description histologique: Le chorion ou lamina propria: Le chorion est le tissu conjonctif qui est sous-jacent aux différents types d’épithélium. Il se divise en deux zones : - une zone superficielle, ou papillaire, comblant les papilles conjonctives entre les crêtes épithéliales - une zone profonde, ou couche réticulaire, qui contient des faisceaux de collagène denses tendant à se disposer parallèlement à la surface Il renferme des fibroblastes, des vaisseaux sanguins, des nerfs et des fibres participant aux défenses immunitaires (lymphocytes, plasmocytes, monocytes et macrophages).
- 96. Description histologique: Jonction épithélium-chorion c’est la lame basale (basal lamina) hautement organisée. On y distingue : – la lamina densa, couche de matériel granulofilamenteux de 50 nm d’épaisseur, parallèle à la membrane basale cellulaire épithéliale, mais séparée d’elle par la lamina lucida. Elle contient du collagène IV
- 97. Variations histologiques selon la topographie la muqueuse masticatrice -Elle tapisse gencives et palais dur, -aide à la compression mécanique des aliments. Kératinisée en surface, solidement amarrée aux structures osseuses sous-jacentes (palais et os alvéolaire), - Elle présente des crêtes épithéliales longues s’invaginant profondément dans le tissu conjonctif. Ce dernier est riche en fibres collagènes
- 98. Variations histologiques selon la topographie la muqueuse bordante -Revêtant versant muqueux des lèvres, joues, plancher et face ventrale de la langue, palais mou, -Elle est flexible. -Elle se laisse distendre par les aliments. Non kératinisée en surface, - Elle ne présente que des crêtes épithéliales basales peu accusées. Son chorion, très vascularisé, est connecté aux muscles sous-jacents par une sous-muqueuse de texture lâche
- 99. Variations histologiques selon la topographie la muqueuse spécialisée cantonnée au dos de la langue, est kératinisée comme les muqueuses masticatrices. De plus, elle est pourvue de papilles intervenant dans la fonction gustative :
- 100. Variations histologiques selon la topographie la muqueuse spécialisée – les papilles filiformes, élevures coniques, ont un axe conjonctif mince, revêtu d’un épithélium très kératinisé ; – les papilles fongiformes, en forme de champignon sont plus larges à leur extrémité supérieure qu’à leur base (fig 3). Les crêtes basales épithéliales sont très marquées ; – les papilles caliciformes, circumvallées, sont entourées à la base par un sillon profond au fond duquel s’abouchent les glandes salivaires accessoires séreuses de von Ebner ;
- 101. Variations histologiques selon la topographie la muqueuse spécialisée – les bourgeons du goût, supports de la fonction du goût, sont en majeure partie situés au niveau des papilles. -les papilles foliées sont formées de tissu lymphoïde à disposition folliculaire caractéristique.
- 102. Rappel anatomique: la mandibule – elle est pourvu d’une branche horizontale médiane et de deux branches montantes droite et gauche. Celles-ci présentent à leur extrémité supérieure deux apophyses : le coroné et le condyle. le maxillaire de structure beaucoup plus complexe, apparaît creusé sur la ligne médiane des fosses nasales. Il forme le plancher de l’orbite en haut. Il présente deux cavités sinusiennes latérales, les sinus maxillaires.
- 103. Eléments histologiques figurés dans l’os Les cellules: • Les ostéoblastes: Ce sont des cellules ostéoformatrices cubiques situées à la surface externe et interne du tissu osseux en croissance. • Les ostéocytes: Ce sont des ostéoblastes différenciés, incapables de se diviser, entièrement entourés par la MEC osseuse minéralisée. Les ostéocytes siègent dans des logettes (ostéoplastes).
- 104. Eléments histologiques figurés dans l’os Les cellules: • Les ostéoclastes: Ce sont des cellules post-mitotiques, très volumineuses, de 20 à 100 μm de diamètre, plurinucléées, hautement mobiles, capable de se déplacer à la surface des travées osseuses d’un site de résorption à un autre. • Les cellules bordantes: Les cellules bordantes sont des ostéoblastes au repos, susceptibles, s’ils sont sollicités, de redevenir des ostéoblastes actifs
- 105. Eléments histologiques figurés dans l’os La matrice extracellulaire: • La matrice organique: composée de microfibrilles de collagène I, de protéoglycanes, d’ostéopontine , d’ostéonectine, d’ostéocalcine, de sialoprotéine osseuse et de thrombospondine, La MEC osseuse contient des cytokines et facteurs de croissance sécrétés par les ostéoblastes . • La phase minérale: Elle est constituée de cristaux d’hydroxy-apatite (phosphate de calcium cristallisé) et de carbonate de calcium
- 106. Structures histologiques de l’os Le tissu osseux compact (ou cortical ou haversien) Il est principalement constitué d’ostéones ou systèmes de Havers fait de lamelles osseuses . Les tissus squelettiques cylindriques disposées concentriquement autour du canal de Havers. Entre les lamelles, se situent les ostéoplastes contenant le corps cellulaire des ostéocytes.
- 107. Structures histologiques de l’os Le tissu osseux spongieux (ou trabéculaire) Il est formé par un lacis tridimensionnel de spicules ou trabécules de tissu osseux, ramifiés et anastomosés, délimitant un labyrinthe d’espaces intercommunicants occupés par de la moelle osseuse et des vaisseaux.
- 108. Structures histologiques des maxillaires La mandibule: La mandibule présente une coque de tissu d'os compact recouvrant un tissu d'os spongieux traversé en son milieu par le canal mandibulaire. Le maxillaire: L'os maxillaire est formé de tissu osseux compact et spongieux au niveau des processus alvéolaires, palatin et zygomatique. A l'intérieur du corps se trouve une cavité vide, le sinus maxillaire, qui communique avec les fosses nasales.
- 109. Définition: C’ est un organe dur, blanchâtre, composé d'une couronne et d'une ou plusieurs racines implantées dans la cavité buccale, plus particulièrement dans l'os alvéolaire des os maxillaires (maxillaire et mandibule), et destiné notamment à broyer les aliments. Il est constitué par quatre tissus que sont: émail, dentine, cément et pulpe.
- 110. Description histologique : La structure de l’émail passe par deux types d’organisation : • celle de l’émail non prismatique (dit aussi aprismatique) • Et celle de l’émail prismatique L’émail:
- 111. Description histologique : Émail non prismatique Quand tous les cristallites sont parallèles entre eux, on obtient des couches d’émail non prismatique, visibles soit au voisinage de la jonction amélodentinaire (émail non prismatique interne), soit à la surface de l’émail (émail non prismatique externe). L’émail:
- 112. Description histologique : Émail prismatique qui est constitué d’un assemblage de bâtonnets minéralisés, autrefois dénommés prismes, composés de cristaux (cristallites) d’apatites carbonatées, eux mêmes formés d'hydroxyapatite polysubstituées tendus de la jonction amélo-dentinaire à la surface de la couronne et d’une substance inter-prismatique également minéralisée. L’émail:
- 113. Description histologique : L’émail: A. Émail non prismatique externe. B. Émail prismatique. p : prisme ; ip : interprisme.
- 114. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La dentine: Structure histologique: - Elle est traversée, sur toute son épaisseur, par des tubules représentant 10 à 30 % de son volume et assurant sa perméabilité. - Le corps des odontoblastes siège à la périphérie de la pulpe, sans être emmuré dans la matrice qu’il sécrète, à l’inverse de ce qui se passe dans l’os ou le cément, où les cellules productrices sont englobées dans leurs produits de sécrétion.
- 115. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La dentine: -La présence des linges de croissance,ce sont:Les stries de Von Ebner. -La présence d’une dentine ayant un aspect cavitaire c’est la couche granuleuse de tomes. -La présence d’une dentine inter globulaire.
- 116. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La dentine: Les différents types de dentine: Dentine primaire: Elle constitue la majeure partie de la dent,c’ est la première sécrétée par les odontoblastes au tout début de leur différenciation. Elle a une épaisseur de 150 ím. Dentine secondaire: Elle est moins minéralisée que le reste de la dentine primaire. Elle apparue plus tard après la formation complète de la racine
- 117. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La dentine: Les différents types de dentine: Dentine tertiare: Elle est encore dénommée dentine réactionnelle, dentine réparatrice ou dentine secondaire irrégulière. Elle est constituée par des dépôts irréguliers localisés au niveau des odontoblastes préalablement agressés par le stimulus.
- 118. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La pulpe: La pulpe dentaire se définit comme un tissu conjonctif, non minéralisé, vascularisé et innervé, comblant la cavité centrale de la dent.
- 119. Pulpe camérale(dans la chambre pulpaire) Pulpe canalaire (dans les canaux)
- 120. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La pulpe: Histologie de la pulpe dentaire: En microscopie optique, on distingue deux zones dans la pulpe : -Une région périphérique «dentinogénetique»; -Et une région centrale
- 121. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La pulpe: A. La région périphérique «dentinogénetique »: D: dentine O: Les odontoblastes W: zone acellullaire de Weil SO : couche sou-odontoblastique « dite couche cellulaire de Hohl » P: pulpe
- 122. Description histologique : Le complexe pulpo-dentinaire: La pulpe: A. B. La région centrale: contient principalement: -Des fibroblastes -Des cellules mésenchymateuses indifférenciées -Des cellules immunocompétentes, -Des vaisseaux sanguins -Et des nerfs de gros diamètre .
- 123. Le cément: Définition: le cément est un tissu conjonctif spécialisé minéralisé qui recouvre les surfaces radiculaires et , occasionnellement, de petites parties de la couronne dentaire. il se situe entre la dentine radiculaire et le ligament parodontal
- 124. Le cément: Histologie: Cément primaire acellulaire : C’est le premier à apparaître pendant le développement embryologique de la racine. C’est une mince couche de tissu minéralisé lamellaire. C’est un cément fibrillaire fait de deux types de fibres : * Fibres intrinsèques (Il se dépose à partir du collet jusqu’au tiers supérieur de la racine). *Fibres extrinsèques (s’étend du collet de la dent jusqu’aux deux tiers coronaux de la racine).
- 125. Le cément: Histologie: Cément secondaire cellulaire : Recouvre le 1/3 apical de la racine. Riche en cellules, son épaisseur augmente avec l’âge. Il est moins radio-opaque que le cément acellulaire. Il est séparé de la dentine par une zone granuleuse de Tomas et est pénétré par les fibres de Sharpey
- 126. Le cément: Histologie: Cément secondaire cellulaire : Il est caractérisé par la présence de cémentoblastes incorporés dans la matrice. Les cellules présentent un phénotype proche de celui des ostéoblastes du tissu osseux, mais diffèrent de celui des cémentoblastes producteurs du cément acellulaire. Cément cellulaire (coupe usée) Les points correspondent aux cémentocytes.
- 127. La gencive: Definition: La gencive est la partie de la muqueuse buccale qui recouvre les procès alvéolaires et entoure les dents dans leur partie cervicale. La gencive acquiert sa forme et sa texture finale lors de l’éruption des dents.
- 128. La gencive: Definition: Gencive Trait pointillé : limite gencive libre – gencive attachée Trait continu : limite muco-gingivale Vue clinique de la gencive
- 129. La gencive: Histologie: elle est constituée: D’un Épithélium. D’un Chorion. D’une Interface épithélium /chorion.
- 130. La gencive: Histologie: On distingue classiquement trois types d’épithélium gingival : -Épithélium buccal qui tapisse la cavité buccale (1); -Épithélium sulculaire qui fait face à la dent sans y adhérer (2) ; -Épithélium jonctionnel qui réalise l’adhésion entre la gencive et la dent (3). L’épithélium
- 131. La gencive: Histologie: 1- L’épithélium 1. 1L’épithélium buccal ou épithélium oral gingival : Il est de type pavimenteux stratifié Il présente des digitations épithéliales dans le chorion gingival. Il est localisé sur les surfaces vestibulaires et palatines au contact avec le milieu buccal.
- 132. La gencive: Histologie: 1- L’épithélium 1. 1L’épithélium buccal ou épithélium oral gingival : Les cellules qui le composent sont : Les kératinocytes : c’est les plus importantes, elles jouent un rôle dans la synthèse de la kératine.. Les cellules claires ou non épithéliales : les mélanocytes, cellules de Meckel………
- 133. La gencive: Histologie: 1- L’épithélium 1-2 épithélium oral sulculaire : Il constitue la paroi du Sulcus gingival, il s’étend du rebord de la gencive marginale où il est continu avec l’épithélium oral gingival sans démarcation jusqu’à l’épithélium jonctionnel.Il est mince, non kératinisé, ses caractéristiques structurales sont sensiblement similaire à celles de l’épithélium buccal, sauf que les desmosomes sont moins nombreux et les tonofilaments de densité moins importante
- 134. La gencive: Histologie: 1- L’épithélium 1-3. épithélium jonctionnel : c’est un épithélium non kératinisé, sans crêtes épithéliales. Il forme un collet autour de la région cervicale de la dent et contigu à l’épithélium sulculaire.
- 135. A: Sulcus B: Attache épithéliale C: limite apicale de l’EJ Structure de l’EJ Épithélium malpighien du sulcus. Cellules polygonales des différentes couches de l’épithélium buccal.
- 136. La gencive: Histologie: 1- L’épithélium 1-4. l’attache épithéliale : l’épithélium jonctionnel fournit une attache épithéliale qui unit la gencive à la surface dentaire. Les composants morphologiques de l’attache épithéliale, sont d’une part les hémidesmosomes des cellules de l’épithélium jonctionnel adjacent à la surface dentaire et d’autre part une lame basale interposée entre ces cellules épithéliales
- 137. La gencive: Histologie: 1- L’épithélium 1-4. l’attache épithéliale :
- 138. La gencive: Histologie: 1-5 Interface epithelio-conjonctive : Crêtes épithéliales et papilles de tissu conjonctif:au niveau de l’épithélium oral gingival de la gencive marginale et la de gencive attachée la surface basale de l’épithélium présente de nombreuses crêtes interposées entre les papilles du tissu conjonctif adjacent. Au niveau de l’épithélium oral sulculaire les crêtes épithéliales sont rares et courtes.
- 139. La gencive: Histologie: 1-6. membrane basale : Une membrane basale est interposée entre l’épithélium des trois zones épithélium oral gingival ,épithélium oral sulculaire, et le tissu conjonctif, la membrane basale est qualifiée membrane basale externe pour la différencier de la lame basale interne interposée entre l’épithélium jonctionnel et la surface calcifiée dentaire. MBI: Membrane basale interne MBE: Membrane basale externe
- 140. La gencive: Histologie: Le composant tissulaire prédominant de la gencive et du desmodonte est le tissu conjonctif. Les constituants principaux du tissu conjonctif sont : les fibres collagènes (environ 60% du volume du tissu), les fibroblastes (environ 5%), les vaisseaux et la matrice (35%). 2- Le chorion
- 141. Le ligament alveolo-dentaire Définition: Le LAD ou ligament parodontal proprement dit, ou desmodonte, est le tissu conjonctif fibreux, richement vascularisé et innervé qui occupe l’espace périodontal situé entre la racine dentaire et la paroi alvéolaire.
- 142. Le ligament alvéolo-dentaire Histologie: 1. matrice extra-cellulaire : A. les fibres : es fibres collagènes : elles représentent la majeure partie des structures ligamentaires. Les fibres alvéolo-dentaires : la plupart des fibres collagènes sont assemblées en faisceaux ou fibres principales, insérées dans le cément et la paroi alvéolaire, sous forme de fibres de Sharpey.
- 143. Le ligament alvéolo-dentaire groupe trans-septa groupe du rebord alvéolaire groupe horizontal groupe oblique groupe inter-radiculaire groupe apical
- 144. Le ligament alvéolo-dentaire Histologie: Les fibres du ligament gingiva: On y distingue quatre groupes de faisceaux : Les fibres dento-gingivales (1) Les faisceaux circulaires (2) Les fibres dento-périostées (3) Les fibres Alvéolo-gingivales (4)
- 145. Le ligament alvéolo-dentaire Histologie: 1. matrice extra-cellulaire : B.la substance fondamentale : Représente 65 % des composantes du ligament parodontal. C’est un gel polysaccharidique hautement hydraté dans lequel sont incluses les cellules et les fibres matricielles. Elle est principalement composée de macromolécules synthétisées par les fibroblastes.
- 146. Le ligament alvéolo-dentaire Histologie: 2. les cellules : Les cellules du tissu conjonctif : Les fibroblastes : ce sont les cellules principales du ligament, occupe environ 50% du volume tissulaire ligamentaire, ce sont des cellules fusiforme. Les cellules epitheliales : ce sont des vestiges de la gaine épithéliale de Hertwig ou de l’épithélium réduit de l’organe de l’émail. Les cellules de defense : macrophage, mastocytes …
- 147. L’os alvéolaire Situé sous la gencive des deux maxillaires, l’os alvéolaire est creusé d’alvéoles dans lesquelles s’implantent les racines dentaires . Il appartient au parodonte, constitué en dedans par le cément de la racine dentaire et en haut par la gencive. Entre cément et os alvéolaire sont tendus les faisceaux collagènes du ligament périodontal qui s’implantent à l’intérieur de l’os alvéolaire comme dans le cément par leurs fibres de Sharpey.
- 148. L’os alvéolaire Cet os est constitué d’une mince lame d’os compact (lamina dura). Ce tissu haversien est formé de lamelles enroulées concentriquement autour de petites cavités. Il s’y produit en permanence des phénomènes d’ostéoformation et d’ostéodestruction intenses lui conférant souvent un aspect « pagétoïde ». Os alvéolaire : section perpendiculaire avec dent enchâssée dans la loge alvéolaire ; laminadura à gauche ; os spongieux à droite. Hématéineéosine
- 149. L’os alvéolaire Ce remodelage explique l’adaptation aux phénomènes mécaniques que subissent les dents : • sous l’effet d’une pression, il se produit une résorption osseuse ; • sous l’effet d’une traction, il apparaît une ostéogenèse. Os alvéolaire : section perpendiculaire avec dent enchâssée dans la loge alvéolaire ; laminadura à gauche ; os spongieux à droite. Hématéineéosine
- 150. L’os alvéolaire C’est le fait d’une coopération précise entre les ostéoclastes et les ostéoblastes, le tissu osseux est en constant renouvellement. Ce remodelage permanent, dans lequel s’intriquent la résorption et la formation de tissu osseux, s’effectue grâce à des unités fonctionnelles de remodelage où les ostéoclastes et ostéoblastes sont étroitement associés Le remodelage osseux
- 151. L’os alvéolaire Phase d’activation La surface osseuse est normalement recouverte de cellules bordantes qui empêchent l’accès des ostéoclastes à la MEC. Sous l’action de facteurs ostéorésorbants (hormone parathyroïdienne ou PTH, vitamine D3 et prostaglandine Pg E2), les cellules bordantes se rétractent et libèrent l’accès aux ostéoclastes qui peuvent adhérer à la matrice osseuse. Les ostéoclastes proviennent de la fusion de préostéoclastes issus de précurseurs mononucléés, eux-mêmes issus des monocytes sous l’action du M-CSF sécrété par les ostéoblastes. Le remodelage osseux
- 152. L’os alvéolaire Phase de résorption du tissu osseux Chaque ostéoclaste devenu actif se fixe à la matrice sur le lieu de résorption et la phase de résorption de la matrice commence. Elle s’effectue en deux étapes successives : 1) dissolution de la phase minérale par acidification du compartiment de résorption, 2) dégradation de la matrice organique sous l’action d’enzymes protéolytiques lysosomales. Le remodelage osseux
- 153. L’os alvéolaire Phase d’inversion Quand les ostéoclastes ont fini de creuser une lacune, ils meurent par apoptose et sont remplacés par des macrophages qui lissent le fond de la lacune. Phase de formation de tissu osseux Elle comporte 2 temps, au cours desquels les ostéoblastes jouent le rôle majeur : 1) la productionde MEC par les ostéoblastes, 2) la minéralisation de cette MEC. Le remodelage osseux
- 154. L’os alvéolaire La quiescence : C’est une phase plus ou moins longue qui précède l’activation es ostéoclastes Le remodelage osseux
- 155. L’histologie a pour but de visualiser in situ - dans les tissus, les cellules, leurs organites ou la matrice extra- cellulaire (MEC) en déterminant leur situation et leur configuration. L’étude histologique des différentes structures de la cavité buccale permet donc de décrire la morphologie cellulaire et tissulaire en termes d’architecture et d’interactions moléculaires et donc une meilleure compréhension des phénomènes survenant au sein de ce milieu composé d’élément très varié.
- 156. 1- Auriol MM, Le Charpentier Y et Le Naour G. Histologie du parodonte. EMC , 22-007-C-10, 2000, 23 p. 2-Auriol MM, Le Charpentier Y et Le Naour G. Histologie de l’émail. EMC, 22- 007-A-10, 2000, 13 p. 3-M. Auriol; Y .Le Charpentier:Histologie de la muqueuse buccale et des maxillaires; EMC 2-007-M-10. 2000 4-Auriol MM, Le Charpentier Y et Le Naour G. Histologie du complexe pulpodentinaire. EMC , 22-007-B-10, 2000. 5-Chomette G, Auriol M. Histopathologie buccale et cervicofaciale. Paris : Masson, 1986 : 83-93. 6-Goldberg M. Histologie et Biologie buccale. Paris : Masson, 1989
- 158. INTRODUCTION I Définition II Généralités III Les techniques radiologiques : 1-1 Radiographies intra-buccales 1-1 Examens rétro-alvéolaires : 1-1-1 Intérêt 1-1-2 Techniques : -La bissectrice - Long cône (parallélisme) -Localisation d’un objet
- 159. 1-2 Examens rétro-coronaires 1-3 Examens occlusaux 1-4 Les capteurs numériques 2- Radiographies exo-buccales 2-1 Radiographie panoramique 2-2Téléradiographie de profil 2 -3 Scanographie (Dentascan) 2-4 Imagerie par faisceau conique « cone beam » 2-5 Imagerie par resonance magnetique (IRM) CONCLUSION
- 160. Les applications médicales des rayonnements ionisants ont été un des facteurs essentiels des progrès de la santé depuis un siècle. L’imagerie par rayons X en particulier, est aujourd’hui un outil indispensable pour le diagnostic d’un grand nombre de pathologies, l’orientation des traitements et leur suivi. Les radiographies ont toujours été demandées en vue de compléter l’exploration du patient, de confirmer ou d’infirmer un diagnostic déjà posé lors de l’examen clinique.
- 161. La radiographie est le reflet photographique d’un objet enregistré sur un cliché radiographique obtenu par le passage de rayon X antérieur au travers de cet objet. Cette image radiologique doit fournir le maximum de renseignements sur ces tissus traversés par rayonnement et pour ce faire elle doit être de très bonne qualité.
- 162. On distingue deux types d’examens radiologiques : – la radiologie bidimensionnelle, la plus ancienne et encore la plu utilisée, qui est la projection d’un volume sur un plan, type radiographie rétroalvéolaire, orthopantomographie ; – la radiologie tridimensionnelle, qui provient de l’acquisition de coupes scanner X (chaque coupe est une image bidimensionnelle) et à partir desquelles peut être réalisée une reconstruction tridimensionnelle.
- 163. Moins le nombre atomique des éléments qui composent l'objet irradié est élevé, plus la pénétration du rayon est grande. Plomb Acrylique
- 164. Plus que l'objet irradié est épais et dense moins que la pénétrabilité du rayon est grande.
- 165. • Les rayons X grâce à leur longueur d’onde très courte peuvent pénétrer les matériaux. • Les rayons X affectent les émulsions photographiques et radiologiques au même titre que le fait la lumière. • Les rayons X peuvent rendre fluorescents certains cristaux ou composés chimiques. • Les rayons X peuvent détruire ou affecter les tissus vivants.
- 166. -le roentgen (R): exposition dans l'air -le rad (roentgen absorbed dose): unité de dose absorbée -le rem (roentgen equivalent man): dose équivalente à l'homme.
- 167. EXAMEN RADIOLOGIQUE Consultation Examens Complémentaires EXAMEN CLINIQUE Rayons X Radiographie Film
- 168. Film à l’intérieur de la bouche RADIOLOGIE INTRA-ORALE RADIOLOGIE EXTRA-ORALE CLICHE RETROALVEOLAIRE CLICHE RETROCORONAIRE CLICHE OCCLUSAL
- 169. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE RETROALVEOLAIRE ( PERIAPICALE) Visualisation: la totalité de la dent jusqu’à l’apex et la portion des tissus osseux environnants. manifestation pathologique de voisinage.
- 170. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: CLICHE RETROALVEOLAIRE (LA RADIOGRAPHIE PERIAPICALE) IndicationÉtudier un groupe de dents: Caries, obturation, valeur de traitement endodontique, rapport couronne/ racine, fracture radiculaire Voir la dent & les tissues voisins 1 2 3 4 Crête osseuse Trabéculation osseuse
- 171. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: Image claire & fidèle En forme et en taille LOIS DE PROJECTION TECHNIQUE DE PARALLÉLISME TECHNIQUE DE LA BISSECTRICE TECHNIQUE DE LOCALISATION DE L’OBJET Techniques:
- 172. TECHNIQUE DU PARALLELISME 90° Le film est placé parallèlement à l'axe longitudinal des dents. Le rayon central est dirigé perpendiculairement à l'axe longitudinal des dents et du film et forme un angle de 90°. Cette technique exige l'emploi d'un support pour maintenir les rapports de parallélisme entre la dent et le film.
- 173. TECHNIQUE DU PARALLELISME TECHNIQUE DU LA BISSECTRICE Bisséctrice 90° isométrique
- 174. TECHNIQUE DU PARALLELISME TECHNIQUE DU LA BISSECTRICE TECHNIQUE DE LOCALISATION DE L’OBJET Superposition IntérêtÉviter la superposition Visualiser une racine palatine Dissocier deux cannaux
- 175. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE RETROCORONAIRE Visualisation: Couronnes dentaires Espace proximal Espace proximal
- 176. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE RETROCORONAIRE Indication: Dépistage des caries proximales Diagnostic et contrôle des lésions parodontales Recherche des lésions septales
- 177. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE RETROCORONAIRE Technique: Le film est menu d'une longuette cartonnée collée perpendiculairement qui permet de la maintenir en serrant les dents, en occlusion . Le bord inférieur du film coronaire est placé au plancher de la bouche entre la langue et la partie linguale de la mandibule. La languette repose sur la surface occlusale des dents inférieures
- 179. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE OCCLUSAL maxillaire mandibule plancher buccal Vue occlusale des dents Visualisation:
- 180. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE OCCLUSAL Technique Méthode ancienne, maintenu dans le plan occlusal par morsure légère du patient. C’est une technique complémentaire des incidences fondamentales (panoramique ou rétro-alvéolaire) qui procure la 3e dimension, horizontale du volume maxillo-dentaire.
- 181. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: RADIOGRAPHIE OCCLUSAL Technique Incidences ortho-occlusales Le rayon est orthogonal au plan du film (méthode « mensurative »). Incidences dysocclusales Le rayon oblique par rapport au plan du film entraîne une déformation volontaire de l’image.
- 183. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: LES CAPTEURS NUMERIQUES Ce nouveau mode radiographique, introduit par Mouyen en 1987 avec la RadioVisioGraphiet (plus communément appelée RVG), modifie notre schéma initial par le détecteur utilisé.
- 184. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: LES CAPTEURS NUMERIQUES Il faut un certain nombre de composantes pour produire une imagerie numérique directe: -source de rayons X, -un capteur électronique, -une carte d’interface numérique, -un ordinateur avec convertisseur analogique-numérique (CAN), -un moniteur-écran, -un logiciel et une imprimante.
- 185. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: LES CAPTEURS NUMERIQUES AVANTAGES: - offrent de nets avantages sur le traditionnel film : réduction du temps d’exposition, - élimination des produits chimiques pour le développement, production et affichage d’images instantanées ou en temps réel, -amélioration de l’image, -diminution de la dose d’exposition aux rayons X 30 à 50 %, -possibilités de traitements de l’image et stockage des informations sans altération
- 186. LA RADIOGRAPHIE INTRA-BUCCALE: LES CAPTEURS NUMERIQUES INCONVENIENTS: -la rigidité et l’épaisseur du capteur, -le coût initial d’acquisition du système présentement élevé, -la durée de vie inconnue du capteur -La prévention de l’infection pose un autre défi aux cliniciens qui utilisent l’imagerie numérique directe. En effet, les capteurs ne peuvent pas être stérilisés -Il faut éviter tout contact direct de salive avec le récepteur et le câble électrique en vue d’éviter la contamination croisée.
- 188. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : Visualisation des maxillaires et du crâne Diagnostic des anomalies maxillaire,affections des sinus et de l’ATM Juger de la croissance de la face
- 189. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE La radiographie panoramique dentaire développée à partir des travaux de Patero permet de transformer les structures faciales courbes en une image plane et d’obtenir ainsi une image complète des deux maxillaires. Différents types d’appareils de radiographie panoramique existent sur le marché: • Le PANOREX • Le PANELIPSE • L’ORTHOPANTOMOGRAPH • Le PANOGRAPH
- 190. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE Visualisation:
- 191. 1- Orbite. 13- os zygomatque. 2- Canal infra-orbitaire. 14- suture tempor-zygomatique. 3- Fosse nasale. 15- arcade zygomatique. 4- Cloison de la cavité nasale. 16- processus coronoide. 5- Cornet nasal inferieur. 17- condyle mandibulaire. 6- Trou incisif ; au dessus : épine nasale 18- oreille externe avec conduit auditif antérieure et canal naso-palatin externe. antérieur. 7 - Sinus maxillaire. 19- rachis cervical. 8- Palais osseux et plancher de la cavité 20- crete temporale de la mandibule. Nasale. 21- ligne oblique interne. 9 - Voile du palais. 22- canal dentaire inferieur. 10- Tubérosité maxillaire. 23- trou mentonnier. 11- Processus ptérygoide ainsi que pro- 24- face supérieure de la langue. -cessus pyramidal de l’os palatin. 25- corticale de rebord inferieur de l la mandibule 12- fosse ptérygo-palatine. 26- os hyoide 27- flou du corps mandibulaire contolateral.
- 192. La région dento alvéolaire Le type de dentition Dénombrement et identification des dents Morphologie coronaire et radiculaire Situation de la crête alvéolaire État des espaces desmodontaux Denture temporaire: Enfant de 2 ansDenture mixte: Enfant de 10 ansDenture permanante
- 193. La région dento alvéolaire Le type de dentition Dénombrement et identification des dents Morphologie coronaire et radiculaire Situation de la crête alvéolaire État des espaces desmodontauxAgénésie de la 12, la 22 et persistance de la 63 Présence de 4eme molaire en état de germe
- 194. La région dento alvéolaire Le type de dentition Dénombrement et identification des dents Morphologie coronaire et radiculaire Situation de la crête alvéolaire État des espaces desmodontauxProcessus carieux sur la 12Anomalie de structure: dysplasie de l’email Anomalie de structure: dentinogénèse imparfaiteréaction péri-apicale au niveau de la 44 Résorption radiculaire pathologique de la 62 et la 22
- 195. La région dento alvéolaire Le type de dentition Dénombrement et identification des dents Morphologie coronaire et radiculaire situation de la crête alvéolaire État des espaces desmodontaux Lyse horizontale localisé au bloc incisivo-canin inférieurelyse angulaire
- 196. La région dento alvéolaire Le type de dentition Dénombrement et identification des dents Morphologie coronaire et radiculaire Niveau de la crete alvéolaire État des éspaces desmodontaux élargissement desmodental 14,15
- 197. La région dento alvéolaire Le type de dentition Dénombrement et identification des dents Morphologie coronaire et radiculaire Niveau de la crete alvéolaire État des éspaces desmodontaux Epaississement de la lamina dura au niveau de la 18,21,31,36, 37, 44 et la 47.
- 198. Région maxillaire et mandibulaire Cavités naso sinusiennes Le canal dentaire inférieur La lignemylohyoidienne Sinus asymetrique et dents antrales
- 199. Région maxillaire et mandibulaire Cavités naso sinusiennes Le canal dentaire inférieur Structures maxillaires latérales Canal dentaire inferieur
- 200. Région maxillaire et mandibulaire Cavités naso sinusiennes Le canal dentaire inférieur Ligne mylohyoidienne Ligne mylo-hyoidienne
- 201. Asymétries Calcifications Images Radioclaires Traumatismes Ankyloses L’articulation temporo mandibulaire
- 202. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE Indication: Patient édenté: • Aspect de la trabéculation osseuse; • Épaisseur de la fibro-muqueuse; • Persistance d’apex; • Kystes résiduels
- 203. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE Indication: Patient denté: les nouveaux patients maladies parodontales l’analyse du stade de dentition Les diagnostics pathologique,pré-chirurgical et traumatologique Le diagnostic implantaire, l’analyse des articulations temporo-mandibulaires et l’analyse des sinus
- 204. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE Technique: En phase préparatoire : - retrait de tout objet métallique en interférence possible : boucles d’oreille, collier métallique, piercing, pinces ou barrettes à cheveux, prothèses et dispositifs orthodontiques amovibles, etc…
- 205. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE Technique: Description de la procédure - Position du patient : • Assis ou debout selon le type d’appareillage. • Le dos le plus droit possible, les cervicales dans l’alignement du tronc sans projection vers l’avant, les épaules basses. • En bout à bout incisif, le plan d’occlusion légèrement incliné vers le bas en fonction de l’angle inter incisif et des pro-alvéolies existantes.
- 206. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : RADIOGRAPHIE PANORAMIQUE Technique: Description de la procédure - Position du tube : Légère inclinaison du tube (5 à 10°) avec rayon central de bas en haut durant toute la rotation. - Temps de rotation : de 13 à 21 s. - Distance foyer-film : de 50 à 60 cm selon les appareils.
- 207. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : TELERADIOGRAPHIE DE PROFIL Visualisation: Visualisation nette sagittale de l’ensemble des structures dento- faciales et des points nécessaires aux analyses céphalométriques. Visualisation nette du profil cutané. Visualisation nette sagittale de l’ensemble de la tête (tables internes et externes).
- 208. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : TELERADIOGRAPHIE DE PROFIL Indications: En prothèse: elle est utilisée pour: • Détermination du plan d’occlusion chez l’edente total. • Détermination des dimensions verticales: On peut réaliser une téléradiographie de profil en occlusion avant extractions. Celle-ci est comparée à une seconde téléradiographie réalisée lors de l’essayage des maquettes. Cette comparaison permet de contrôler et au besoin modifier la hauteur des bourrelets d’occlusion
- 209. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : TELERADIOGRAPHIE DE PROFIL Indications: En ODF: indispensable pour déterminer un plan de traitement et sa surveillance sur des tracés effectués à partir des points anatomiques repérés sur les clichés. En chirurgie maxillo faciale : elle est utile pour localiser : les dents incluses, kystes, tumeurs, ou TRT de fracture de siége latéral
- 210. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : TELERADIOGRAPHIE DE PROFIL Techniques: Pour exécuter un profil on place le capteur (plaque de phosphore, film) parallèle au plan sagittal médian de la tête du patient. Le rayon central passera par les deux olives et la tête radiologique sera à 1,50 mètre du patient. Selon le type de capteur et la performance de l'appareil on peut obtenir des temps d'exposition qui varient énormément jusqu’à 6 secondes.
- 211. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) • L’image tomodensitométrique fait appel aux rayons X et repose sur l’absorption différentielle du rayonnement par les différentes structures anatomiques traversées. Le faisceau de rayons X est étroitement collimaté, réalisant des coupes fines (0,5 à 1 mm d’épaisseur) du sujet traversé (ici les maxillaires). Principe:
- 212. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) • Les récepteurs du rayonnement sont constitués par des détecteurs électroniques qui transforment le rayonnement en signal électrique, lui même traduit en information numérique traitée par ordinateur. Le scanner ou tomodensitomètre permet la mesure précise de la densité des structures étudiées. Principe:
- 213. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) Il s’agit d’un logiciel de reconstruction spécifique dentaire. A partir d’une coupe en incidence axiale qui correspond au plan de référence, le radiologue choisie et trace une ligne curviligne parallèle à l’axe de la mandibule. DENTASCAN
- 214. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) DENTASCAN Le scanner couplé au dentascanner est un examen très performant qui ne doit pas être limité au bilan pré- implantaire. Il a de nombreuses indications en pratique quotidienne même s’il ne doit pas se substituer aux techniques radiologiques classiques Indication:
- 215. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) DENTASCAN En implantologie: examen de base du bilan préimplantair. Localisation Etude topographique d'une dent incluse d'un corps étranger Etude des rapports avec le canal mandibulaire avec éventuellement les sinus maxillaires ou avec les dents adjacent Préciser un doute sur une fracture radiculaire devant une anomalie clinique ou une fine image linéaire radio claire sur un cliché retro-alvéolaire Indication:
- 216. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) DENTASCAN Recherche une duplication canalaire d'une racine Recherche ou/et préciser une petite lésion péri dentaire Bilan d'une pathologie tumorale Etude osseuse des articulations TM, notamment l'étude des surfaces articulaires des condyles mandibulaires Etude sinusienne Recherche d'une déhiscence de la corticale de l'infrastructure du sinus maxillaire dans le cadre d'une communication bucco- sinusienne. Indication:
- 217. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) DENTASCAN Dans le cadre de l’étude odontologique, il doit être réalisé une centaine de coupes axiales, perpendiculaires aux apex des dents à étudier. L’épaisseur de ces coupes est de 1 millimètre, elles sont jointives mais chevauchées tous les 0,5 mm. L’examen est centré soit sur le maxillaire soit sur la mandibule ou éventuellement sur les deux en cas d’examen double. Technique:
- 218. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : SCANNER (TOMODENSITOMETRIE) DENTASCAN A partir de ces cent coupes, un logiciel spécifique ou dentascanner permet d’obtenir des reconstructions curvilignes parallèles à l’arcade dentaire rappelant le panoramique dentaire et des reconstructions coronales obliques perpendiculaires à l’arcade dentaire. Ces images sont ensuite reproduites sur des films en grandeur réelle sans agrandissement permettant au praticien d’effectuer toutes les mesures nécessaires. Technique:
- 219. Reconstructions dentascanner mandibulaires panoramiques Reconstructions dentascanner mandibulaires coronales obliques
- 220. Dent de sagesse incluse dont les apex entourent le canal mandibulaire. l’étude du canal mandibulaire et de ses rapports sur toute sa longueur
- 222. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR FAISCEAU CONIQUE « CONE BEAM » Cone beam computed tomography (CBCT) Le tomographe volumétrique à faisceau conique, que nous appellerons “CBCT” pour faire plus rapide, travaille non plus sur un faisceau RX mince, mais avec un faisceau conique, ce qui lui permettra en une seule révolution de balayer l’ensemble de la zone à radiographier.
- 223. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR FAISCEAU CONIQUE « CONE BEAM » Indications Explorations pré-implantaires: Explorations des sinus de la fac et de la base du crâne Localisation du canal dentaire à la mandibule L’appréciation exacte de la taille et de la localisation des lésions périapicales en raison de l’absence des superpositions et des possibilités de reconstructions bi et tridimensionnelles;
- 224. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR FAISCEAU CONIQUE « CONE BEAM » Indications En ODF et chirurgie maxillofaciale Localisation de dents de sagesse et rapports avec le canal mandibulaire Pour créer des modèles virtuels 3D
- 225. Cone Beam : évaluation pré- implantaire maxillaire
- 226. Association numérique entre une empreinte tridimensionnelle intra-orale et une radiographie tridimensionnelle cone beam
- 227. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR FAISCEAU CONIQUE « CONE BEAM » Technique: Un ensemble solidaire tube à rayons X — capteur plan tourne autour de la tête du patient pendant une émission pulsée ou continue de rayons X. La série d’images recueillies sur le capteur plan pendant la rotation est traitée par l’ordinateur pour aboutir à l’obtention d’un volume numérique de forme cylindrique. L’ordinateur utilise ce volume pour reconstruire trois séries de coupes parallèles entre elles selon trois plans orthogonaux X, Y et Z .
- 228. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR FAISCEAU CONIQUE « CONE BEAM » Technique: On n’obtient pas une image 3D, mais une reconstitution 3D. Car dès que l’image est affichée sur l’écran de l’ordinateur, elle n’est qu’en 2D ; la 3D est toujours virtuelle, et on ne l’exploite qu’en se déplaçant avec la souris dans les axes X, Y et Z.
- 230. COMPARAISON ENTRE SCANNER ET CONE BEAME Scanner Cone beam Technique Volume numérisé acquis par la superposition des coupes obtenudirectement par la reconstruction informatique des données initiales Artefact Artefact cinétique -Artefact métallique -plus exposée aux artéfacts cinétiques -moins sensible aux artéfacts métalliques Irradiation Élevé notablement inférieure à celle du scanner 30 à 50 fois inférieur Limites l’utilisation de voxels isotopiques de petite taille permet une résolution spatiale meilleure qu’en scanner et donc image plus nette.
- 231. COMPARAISON ENTRE SCANNER ET CONE BEAME Représentation comparative du mode d’acquisition au cours d’un scanner (coupes) et d’un examen par faisceau conique (volume).
- 232. COMPARAISON ENTRE SCANNER ET CONE BEAME Artéfacts métalliques du scanner supérieurs à ceux du Cone Beam (même patient).
- 233. COMPARAISON ENTRE SCANNER ET CONE BEAME Comparaison scanner (a) et cone beam (voxels 125) (b) d’un kyste radiculo- dentaire avec dépassement de pâte sur 27 et réaction d’épaississement muqueux du sinus
- 234. LES DIFFERENTS TECHNIQUES EXTRA-ORAUX IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE IRM Parties molles de la face Articulation temporo- mandibulaire Excellente visualisation des condyles et plus particulièrement des ménisques os ménisque Visualisation:
- 235. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE IRM Pathologie du massif facial ; Processus tumoraux ou inflammatoires ; analyse des différentes composantes osseuses, musculaires, méniscales et synoviales, d’où l’intérêt de ce type d’examen dans le bilan du dysfonctionnement des ATM Indication:
- 236. RADIOGRAPHIE EXTRA-BUCCALE : IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE IRM L’IRM est la seule méthode d’imagerie permettant une étude complète des différents composants articulaires. Elle participe également au bilan des autres pathologies de l’ATM, notamment tumorales, traumatiques et inflammatoires. Indication:
- 237. LE PRINCIPE ALARA Le Principe ALARA est l'acronyme anglophone de Principe As Low As Reasonably Achievable. Selon ce principe l'exposition de l'homme et de l'environnement au rayonnement ionisant doit être aussi faible que raisonnablement possible. On tient également compte des facteurs économiques et sociaux. C’est l'un des principes de base de la protection contre le rayonnement.
- 238. LE PRINCIPE ALARA A partir de principe ALARA découle 03 principes fondamentaux PRINCIPE DE JUSTIFICATION IMISATIONPRINCIPE D’ OPTIMISATION PRINCIPE DE LIMITATION
- 239. LE PRINCIPE ALARA PRINCIPE DE JUSTIFICATION : Toute activité susceptible de soumettre des personnes à une exposition aux rayonnements ionisants ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par ses avantages LE BÉNÉFICE DOIT ÊTRE SUPÉRIEUR AU RISQUE POTENTIEL TOUTE ACTIVITÉ NON JUSTIFIÉE EST INTERDITE.
- 240. LE PRINCIPE ALARA PRINCIPE DE D’OPTIMISATION: Le niveau des expositions des populations et des individus aux rayonnements ionisants doit être maintenu au plus bas niveau que l’on peut raisonnablement atteindre, SANS NUIRE À LA QUALITÉ DE L’INFORMATION RECHERCHÉE
- 241. LE PRINCIPE ALARA PRINCIPE DE LIMITATION: les limites de dose définies par le législateur ne doivent pas être dépassées. Ce principe ne s’applique pas aux doses médicales reçues par le patient.
- 242. La radiographie est un examen très courant et absolument indispensable de nos jour en médecine dentaire. Elle doit: - venir confirmer l’observation clinique - Ne peut être considéré comme un moyen unique de diagnostic. - Une radiographie panoramique donne une vue d’ensemble des structures anatomiques osseuses et dentaires D’autre part, à ses côtés, on trouve l’imagerie numérique qui tend à amélioré de la qualité de la radiologie conventionnelle.
- 243. 1-BONNET, E et al. Sémiologie radiologique. EMC Editions Scientifiques et Médicales Elsevier, Paris,Odontologie, 23-722-A- 10,2001,12p. 2- Bhatia HP, Goel S, Srivastava B. Denta Scan; Journal of Oral Health REVIEW; 6(1)25-27.2012. 3- CAVEZIAN,R et al. Imagerie dento maxillaire. 3ème édition .par : Elsevier Masson, 2006.366p. 4-Code de la Santé Publique : Guide des indications et des procédures des examens radiologiques en odontostomatologie . 1ère édition – Mai 2006
- 244. 5-Hodeza C. Griffaton-Taillandier , J.-L. Bensimon : Imagerie par faisceau conique « cone beam ». Applications en ORL . Annales françaises d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale .128, 77—91.(2011) 6- Pasquet G et Cavezian R : Moyens diagnostiques en imagerie odonto-stomatologique cone beam : résultats ; J Radiol ;90:618-23 .2009 . 7-PASLER, F; VISSER, H. Pocket Atlas of Dental Radiology. New York: Thieme, 2007.352p.
- 245. 7-THOMAS, L. Radiologie dentaire numérique. 2011.177p. 8-. Zimmermann E, J. Brau J. , Conigliaro A , . Schuliar Y : Imageries numériques tridimensionnelles :développement et intérêt criminalistique en odontologie médico-légale ; 4, 161— 170 ; (2013).
- 246. MERCIPour votre attention !
