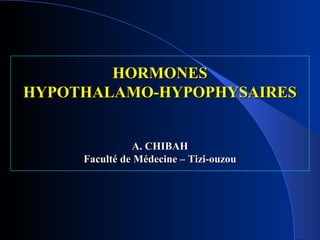
Hhh diapo.ppt
- 1. HORMONES HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRES A. CHIBAH Faculté de Médecine – Tizi-ouzou
- 2. Introduction Le complexe hypothalamo-hypophysaire est un ensemble constitué par : Hypothalamus ( HT). Tige pituitaire. Hypophyse ( HP). L’hypothalamus = cellules neurosécrétrices qui assurent une fonction relais ente le système endocrinien et le système nerveux ( impulsions électriques et molécules informatives). L’hypophyse = 2 lobes, l'un formé de tissu nerveux et l'autre de tissu glandulaire. Lobe antérieur ou adénohypophyse : cellules endocriniennes qui produisent et libèrent plusieurs hormones indispensables à la croissance, reproduction, homéostasie,… Le lobe postérieur ou neurohypophyse : essentiellement axones et cellules gliales. Il libère des neurohormones qu'il reçoit préfabriqués de l’HT. Il est bien plus un site de stockage qu'une glande endocrine. De manière générale, la plupart des hormones hypophysaires réglées par l’ HT stimulent au niveau périphérique une autre glande et l’amène à sécréter une troisième hormone dans le sang.
- 3. L’hypothalamus Constitué de nombreux noyaux Hypothalamus antérieur Noyaux para-ventriculaire, supraoptique, pré-optique et suprachiasmatique Hypothalamus médian Noyau arqué et noyau tubéro-latéral
- 7. Hormones hypothalamiques Hypothalamus = Relais qui intègre un nombre considérable de signaux transmis à partir du SNC au moyen de neurotransmetteurs. Existence de 2 mécanismes de régulation: - Système de rétrocontrôle (effet feedback): glement (-) - Sécrétion selon un rythme particulier à chaque hormone (périodicité différente). Exple: Circadien ou nycthéméral pour ACTH et TSH. 28 jours pour les hormones du cycle menstruel Hypothalamus hypophysiotrope : transmission par voie sanguine. 1 - Hormones hypophysiotropes d’activation ou releasing factors (RF). 2- Hormones hypophysiotropes d’inhibition ou inhibing factors (IF).
- 8. L'hypothalamus : neurones de synthèse d'ocytocine et vasopressine (AVP) ou hormone antidiurétique (ADH). Ces neurohormones sont transportées le long des axones jusqu'à la neurohypophyse où elles sont emmagasinées. Elles seront déversées dans les capillaires sanguins. L'hypothalamus possède d’autres neurones dotés d'axones très courts qui déversent des facteurs d'inhibition et de libération dans les capillaires du système porte hypothalamohypophysaire qui rejoint l'adénohypophyse. Ces facteurs ou libérines, sont: La somatolibérine (GHRH) La corticolibérine (CRH) La gonadolibérine (GnRH) La thyréolibérine (TRH) La dopamine (PIF=Prolactin Inhibiting Factor) La somatostatine (SRIH=Somatotropine Release Inhibiting Hormone) : inhibe la libération de l'hormone de croissance (GH), de la coticotrophine (ACTH) et de l'hormone thyréotrope (TSH).
- 11. Hormones post-hypophysaires Hormone antidiurétique (ADH) ou Vasopressine Ocytocine
- 12. Nature chimique des hormones hypothalamo-hypophysaires
- 14. Hormones adénohypophysaires glandotropes et non-glandotropes
- 15. 1 – Hormones de l’hypophyse postérieure
- 16. 1- L’ocytocine
- 17. 1.1.Ocytocine : Effets et régulation Sur l'utérus Elle entraîne la contraction du muscle utérin, en particulier lors de l'expulsion . La sensibilité de l'utérus croît au cours de la gestation pour atteindre son maximum à l'accouchement. Elle est donc fonction de l'imprégnation en progestérone et œstrogènes (thérapeutique lorsque les contractions utérines sont insuffisantes). Sur la glande mammaire: Contraction des cellules myoépithéliales des acini et des fibres musculaires des canaux excréteurs, ce qui provoque l'expulsion du lait En l'absence de succion, le lait est retenu dans la glande mammaire par des éléments sphinctériens du mamelon.
- 19. Régulation de la production d’ocytocine Remarque (régulation) : Pour l'utérus, on a un rétrocontrôle positif puisque la distension provoque une sécrétion d'ocytocine et que cela entraîne en retour un accroissement de la distension, cela jusqu'à l'expulsion.
- 20. 2- L’hormone antidiurétique « ADH »
- 21. 2.1. ADH : Effets et régulation Favorise la réabsorption de l'eau (tube distal et canal collecteur). L'action de l'ADH s'effectue sur 2 types de récepteurs: Les récepteurs V1 dépendants du phosphatidylinositol, du Ca++ et de la calmoduline Les récepteurs V2 ont un mécanisme AMP cyclique dépendant. Régulation de la sécrétion de l'ADH - L'osmolarité plasmatique - Le volume des liquides extracellulaires - Le système rénine-angiotensine.
- 25. Régulation de la production d’ADH
- 26. Pathologie de l’ADH 1- Défaut de production d’ADH ⇒ Diabète insipide (D.I) ou diabète cranial Clinique : syndrome pp sans glucosurie (5-20 litres) Diag. Diff: Diab.sucré, diab.insipide néphrogénique, potomanie Exploration et diag. Biologique: D. Urinaire sur diurèse des 24 h (VN= 1010-1015) Si D.I : D.urinaire basse. Dosage statique de l’ADH plasmatique Exploration dynamique : Test de restriction hydrique (stimulation de l’ADH) Mesure de la diurèse +D.urinaire. Sujet normal : diurèse , D.urinaire Sujet malade : diurèse , D.urinaire En fin d’épreuve : administration d’ADH en iv pour différencier les 2 types de DI. Si DIV : la diurèse se corrige 15-30 mn après. Si DIN : la diurèse ne se corrige pas.
- 27. Étiologies : déficit génétique en ADH, lésion cellulaire hypoth- hypoph.(traumatique, infect, tumorale. Anomalie génétique ou structurale des récepteurs rénaux à l’ADH. Trt : ADH par voie nasale (gttes ou spray) si DIV Transplantation si DIN. 2 – Excès de production ou sécrétion inadaptée d’ADH Clinique: Oligurie, prise de poids, symptomato. Neuro-musculaire. Biologie: Hémodilution par hypervolémie : Troubles électrolytiques , hypoglycémie, hypoprotidémie, hyponatrémie (affectant cellules excitables). Osmolarité U , Osmolarité plasm. Exploration : 1 – Tests statiques : - Dosage de l’ADH : 40ng / l voir +++ - Diurèse - D et Osm. urinaires
- 28. 2– Tests dynamiques : Test de surcharge hydrique ( épreuve de freinage). ⇒ On donne à boire 25 ml / kg de poids en 30 mn. ⇒ Mesurer ensuite : Diurèse, D.urinaire, Osm. Plasma ( Natrémie) Sujet normal : • 90 % de l’eau éliminé dans les 4 h. • D.ur en fin de l’épreuve. • Natrémie normale. Sujet malade : • 40-60 % d’eau seulement éliminée • Hyponatrémie. Étiologies : Tumeurs ectopiques au niveau des branches. Tumeurs hypothalamiques hypersécrétantes en ADH Trt : Chirurgie
- 29. 2 – Hormones de l’hypophyse antérieure
- 30. L’antéhypophyse ou l’adénohypophyse est un organe hétérogène composé de 06 types de cellules différentes. Cellules somatotropes (GH) : 50% Cellules mammotropes (Prl) : pendant la grossesse. Cellules mélano-corticotropes (ACTH, MSH…) Cellules thyréotropes (TSH). Cellules gonadotropes (LH, FSH) Cellules non sécrétoires.
- 31. 1- La proopiomélanocortine (POMC) Axe Corticotrope
- 32. C’est un exemple montrant que dans certains cas plusieurs peptides et protéines complètement différents sont codés simultanément par un même gêne. Précurseur = 267 Aa Séquences nucléotidiques correspondant aux: - ACTH. - α, β, γ mélanotropine (MSH) (action de synthèse de mélanine et de dispersion de grains de mélanine dans la peau). - β, γ lipotropine (LPH) (action lipolytique). - β endorphine (action analgésique puissante).
- 33. La proopiomélanocortine (POMC) Produits dérivés de la maturation protéolytique de la POMC
- 34. Les différentes fonctions des peptides dérivés de la POMC Les différentes fonctions des peptides dérivés de la POMC
- 36. ACTH Rôle principal s’exerce sur le cortex surrénalien: - Stimulation de la synthèse et de la libération des hormones corticosurrénaliennes et plus particulièrement du cortisol. - Augmentation de la synthèse protéique dans le cortex surrénalien ( effet trophique ). CRF : Polypeptide de 41 Aa = principal régulateur de la synthèse de la POMC et donc de l’ACTH. Le stress et l’horloge biologique ont une action par l’intermédiaire d’autres sécrétagogues : AVP, Ocytocine, Na, GABA... Action synergique de tous ces éléments pour moduler la sécrétion des cellules corticotropes lors d’une situation de stress. Rétrocontrôle (-) exercé par les glucocorticoïdes (cortisol) sur les sécrétions d’ACTH et du CRF. L’ACTH suit un rythme circadien avec une augmentation 1 à 2 h avant l’éveil avec des concentrations indétectables la nuit. Le rythme du CRF est nycthéméral (responsable de celui de
- 37. 2- Hormone de croissance Axe somatotrope
- 38. Effets Les effets de la GH portent sur : La stimulation de la croissance squelettique et tissulaire (effet le plus spectaculaire). C’est un effet indirect ou médié par les IGF ou somatomédines. IGF I = Somatomédine A IGF II = Somatomédine C Action sur les métabolismes : effet direct ( non médié)
- 42. Régulation de la production de la GH La sécrétion de la GH est pulsatile et épisodique: Pics nocturnes pendant la phase du sommeil Pics diurnes reliés à l’alimentation, l’exercice et l’émotion. Entre les pics, la GH est indétectable. (un dosage isolé de la GH est dénué de signification) 2 facteurs hypothalamiques régulent sa sécrétion . La somatolibérine ou GHRH stimule la sécrétion de GH. la somatostatine ou SIRH (SS) l'inhibe. IGF-I exercent le rétrocontrôle La GHRH est stimulée par l'hypoglycémie (AGL, quelques Aa), le sommeil profond, le stress et l'exercice. La sécrétion pulsatile de GH est due à l'alternance de sécrétion de GHRH et SIRH. Il existe aussi un rétrocon – trôle (-) par la GH sur ces hormones hypothalamiques.
- 43. Pathologie de la GH 1- Déficit en GH: retard de croissance. Nanisme harmonieux : Baisse proportionnelle de l’allongem- ent de tous les os, taille des viscères réduite Déficit en IGF1: Absence ou anomalie. Pathologie du récepteur de la GH : type LARON (pygmés). Tests statiques: • Dosage de la GH : effondrée • Hypoglycémie Tests dynamiques : Test à la GHRH (permet de situer l’étage) ⇒ Injection de GHRH + dosage de la GH 30 mn après. - Si pic de GH (10 μg/L) : atteinte hypothalamique. - Si absence de pic : atteinte hypophysaire. Remarque : inutile de pratiquer ce test dans un retard de croissance avec une GH normale. Trt: Adminis. GHRH dans l’atteinte HT et GH dans l’atteinte HP
- 44. 2- Excès de production de la GH: En fonction de l’age, on distingue: Gigantisme chez l’enfant: augment. Proportionnelle de la taille de tous les organes. Acromégalie chez l’adulte : croissance osseuse anormale même après soudure des cartilages de conjugaison : dysmorphies notamment du volume des tissus mous (peau, langue, viscères, etc…), une reprise de la croissance des os courts (maxillaire inférieure, phalanges) Clinique : en plus des dysmorphies, possibilité de diabète sucré. Biologie: Dosage de la GH sans stimulation : 10 – 25 μg/L. Étiologies : Tumeurs HT hypersécrétantes en GHRH Tumeurs ectopiques hyperproductives en GHRH d’origine pancréatique Trt : Chirurgie – Radiothérapie.
- 46. Effets Le rythme de sécrétion est circadien avec plusieurs pics au cours du nycthémère , pulsatile (toutes les 20 mn). Les taux augmentent progressivement au cours de la grossesse Les taux de base atteignant un max. juste avant l'accouchement En post-partum, la succion du mamelon entraîne en quelques minutes une montée à des taux très élevés. L'action sur la glande mammaire est la plus évidente: initiation et maintien de la lactation. Effet sur la croissance : de la synthèse protéique, rétention azotée…sans pour autant avoir les mêmes performances que la GH
- 49. Pathologie de la Prolactine 1- Hyperprolactinémies dues à: - Tumeurs HP (Prolactinomes) - Hypothyroïdie I (TRH augmenté). - Tumeurs ectopiques. - Puberté précoce. 2- Hypoprolactinémies: - Tumeurs HP ou lésions tumorales. 3- Indications du dosage de la prolactine : Chez la femme - Signes d’insuffisance gonadique : Aménorrhée- stérilité insuffisance lutéale- baisse de la libido. - Galactorrhée. Chez l’homme: Galactorrhée – baisse de la libido.
- 50. 4- Gonadotrophines: LH et FSH Axe gonadotrope
- 52. FSH : Glycoprotéine constituée de 2 chaînes peptidiques inhibée par : Les oestrogènes chez la femme La testostérone et l’inhibine chez l’homme. Effets biologiques : Chez la femme : - Stimule la maturation du follicule ovarien. - Stimule au niveau de la granulosa l’aromatase qui convertit les androgènes en oestradiol. - La sécrétion d’œstrogènes. - production de l’inhibine (rétrocontrôle sur la FSH et GnRH) Chez l’homme : - Intervient sur l’activité des tubes séminifères (spermatogenèse). - Action sur les cellules de Sertoli en : Synthétisant l’inhibine (rétrocontrôle – sur FSH et GnRH) Synthétisant l’ABP (transport de la testostérone intratesticulaire). Aromatisation de la testostérone en Oestradiol.
- 53. LH : Hormone lutéinisante Glycoprotéine constituée de 2 chaînes peptidiques α et β Les oestrogènes et la progestérone chez la femme La testostérone chez l’homme. Effets biologiques : Chez la femme - Déclenche l’ovulation et stimule la production ovarienne d’œstrogènes et de progestérone. La thèque répond à la LH en augmentant la synthèse d’androgènes (androstènedione) qui seront convertis en oestrogènes (principalement l’œstradiol) par les cellules de la granulosa. La régulation parait ne dépendre que de l’œstradiol avec 3 phases (- puis + puis -) Chez l’homme : - Stimule la stéroidogenèse ( testostérone essentiellement ) par les cellules de Leydig DHT VIRILISATION. - La testostérone déprime la sécrétion de LH.
- 56. Effets Au J1du cycle de Gn-RH stimule la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse. La FSH et la LH stimulent la croissance du follicule . les cellules de la thèque, commencent à fabriquer des oestrogènes (oestradiol) . En dessous d'un certain seuil de concentration, les oestrogènes ont une action inhibitrice sur la libération de la FSH et de la LH. L'hypophyse continue de les synthétiser mais ne les libèrent pas dans la circulation. Au-delà d'un certain seuil de concentration , les oestrogènes ont une action activatrice sur l'hypophyse qui libère brutale – ment de grande quantité de LH et dans une moindre mesure de FSH.
- 57. La bouffée de LH ainsi produite (ou pic de LH) a deux conséquences : Elle déclenche la rupture de la paroi ovarienne et l'éclatement du follicule de de Graff qui libère l'ovocyte, c'est l'ovulation. Elle provoque la reprise de la méiose dans l'ovocyte de premier ordre qui termine sa première division et entame la deuxième division jusqu'à la métaphase II devenant ainsi un ovocyte de deuxième ordre, couramment appelé ovule. La LH favorise également la transformation du reste du follicule en corps jaune puis les taux de FSH et LH diminuent rapidement. Le corps jaune fabrique de grandes quantité de progestérone et un peu d'œstrogènes. Ces 2 hormones exercent une puissante action inhibitrice sur la fabrication et la libération de FSH et de LH par l'hypophyse empêchant ainsi le développement de nouveaux follicules.
- 58. Avec la diminution du taux de LH disparaît l'activation du corps jaune qui régresse et se résorbe progressivement. En même temps que le corps jaune régresse, la production de progestérone diminue, et l'inhibition qu'elle exerçait sur l'hypophyse disparaît, elle aussi, progressivement. La diminution du taux des hormones ovariennes à la fin du cycle (26ème à 28ème jours) met fin à l'inhibition de la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse et un nouveau cycle recommence. Si un embryon s'implante dans la muqueuse utérine, l'activité du corps jaune est maintenue par une hormone ayant la même action que la LH mais produite par l'unité foeto-placentaire , l'HCG ou gonadotrophine chorionique humaine. La production de progestérone par le corps jaune d'abord puis par le placenta ensuite empêche alors le développement de nouveaux follicules pendant toute la durée de la grossesse.
- 60. Le cycle menstruel La phase menstruelle : Elle dure de 3 à 5 jours, l'épaisse couche fonctionnelle de l'endomètre se détache de la paroi utérine en provoquant des saignements. Le sang et les tissus qui se détachent s'écoulent dans le vagin et constituent les règles. La phase proliférative : Elle dure du 6ème au 14ème jour. Sous l'effet des oestrogènes l'endomètre se reforme, la couche fonctionnelle s'épaissie et se creuse de glandes, une nouvelle vascularisation se met en place et des récepteurs à la progestérone se forment dans les cellules endométriales. La phase sécrétoire : Elle correspond à la phase lutéale, allant de l'ovulation jusqu'à la fin du cycle. Pendant cette phase l'épaisseur de la muqueuse continue de s'accroître. Sous l'effet de la progestérone, les glandes secrètent du glycogène dans la cavité utérine. Ce nutriment est destiné à nourrir un éventuel embryon.
- 62. 5- Thyréostimuline: TSH Axe thyréotrope
- 64. Effets biologiques Glycoprotéine composée de 2 chaînes α et β. La chaîne α est identique pour FSH et LH. Contrôle le développement et l’activité sécrétrice de la thyroïde via l’augmentation de l’AMPc. Augmente le volume et la vascularisation de la thyroïde Régulation Stimulée : Par la TRH et indirectement par la grossesse ( rétrocontrôle par la Prl ) et le froid. Inhibée : Par SRIH et rétroinhibée par T3 et T4.
