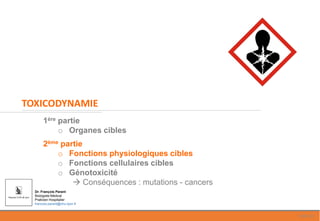
03_Toxicodynamie – 2ème partie
- 1. TOXICODYNAMIE 1ère partie o Organes cibles 2ème partie o Fonctions physiologiques cibles o Fonctions cellulaires cibles o Génotoxicité Conséquences : mutations - cancers mars 21 Dr. François Parant Biologiste Médical Praticien Hospitalier francois.parant@chu-lyon.fr
- 2. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est ? Le cas du DISTILBÈNE® Quels sont les perturbateurs endocriniens avérés/suspectés ? Les enjeux de la recherche LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21 Fonctions physiologiques cibles Exemple des PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (Endocrine Disrupting Chemicals - Endocrine Disruptors)
- 3. Rappels : Tout d’abord qu’est-ce qu’une HORMONE ? mars 21 Une hormone est • une substance chimique biologiquement active, • synthétisée par des cellules glandulaires • sécrétée dans le sang où elle circule, • … et agissant à distance de son lieu de synthèse sur des récepteurs spécifiques d'une cellule cible.
- 4. Rappels : LE SYSTÈME ENDOCRINIEN et ses HORMONES mars 21 Insuline Testostérone Thyroxine (T4) et la Triiodothyronine (T3) Médullosurrénale o Adrénaline Corticosurrénale o Cortisol o Aldostérone o Déhydroépiandrostérone (DHEA) Œstrogènes o Œstrone (E1) o Œstradiol (E2) o Œstriol (E3) Progestérone Hormones de l’axe hypothalamo- hypophysaire GnRH FSH – LH CRH ACTH Une glande endocrine est une glande qui sécrète des hormones
- 5. Les perturbateurs endocriniens altèrent le fonctionnement habituel du système hormonal en interagissant avec : UN PERTURBATEUR ENDOCRINIEN, qu'est-ce que c'est ? mars 21 x o la synthèse o le transport x o le mode d’action x o la dégradation … des hormones x x
- 6. UN PERTURBATEUR ENDOCRINIEN, qu'est-ce que c'est ? Les perturbateurs endocriniens se caractérisent donc : • par un effet toxique indirect • via les modifications physiologiques qu'elles engendrent mars 21 * exemples de cancers hormono-dépendants (dépendant de l'activité d'une hormone) : cancers thyroïdiens, de la prostate, du sein et de l'ovaire, et du testicule *
- 7. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est ? Le cas du DISTILBÈNE® Quels sont les perturbateurs endocriniens avérés/suspectés ? Les enjeux de la recherche LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21
- 8. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Le cas du DISTILBÈNE mars 21 o Il a été prescrit aux femmes pendant la grossesse pour prévenir les fausses couches, les risques de prématurité et traiter les hémorragies gravidiques. o Le diéthylstilbestrol ou D.E.S. est une hormone de synthèse commercialisée entre 1950 et 1977 en France et vendue sous les noms de Distilbène®
- 9. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Le cas du DISTILBÈNE mars 21 o Le D.E.S. s’est révélé nocif pour les enfants exposés in utero et surtout pour les filles À l’âge adultes, les filles « DES » : Difficultés à être enceinte Difficultés à mener une grossesse à terme (grossesses extra- utérines, fausses couches, grande prématurité ...) Risque plus élevé de cancers du vagin et du col
- 10. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Distilbène : également des conséquences sur la 3ème génération ! mars 21 L’HYPOSPADIAS est une malformation du fœtus masculin qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face inférieure du pénis au lieu de son extrémité Affectant, selon les études, entre une et huit naissances masculines pour 1 000; ce type de malformation semble en augmentation depuis une cinquantaine d'années, comme d'autres malformations génitales. Les perturbateurs endocriniens, également impliqués dans d'autres malformations génitales, semblent être l'une des principales causes ou la principale cause de cette augmentation
- 11. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21 Fœtus Jeunes enfants Adolescents (puberté) Jeunes adultes (fertilité)
- 12. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est ? Le cas du DISTILBÈNE® Quels sont les perturbateurs endocriniens avérés/suspectés ? Les enjeux de la recherche LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21
- 13. Les substances susceptibles d’avoir un effets perturbateur endocrinien LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21 Nombreuses !! Les produits chimiques et sous-produits industriels qui peuvent interférer avec le système endocrinien de l'homme ou de l'animal. Il comporte à l'heure actuelle plus d'un millier de produits, de nature chimique variée. Parmi les plus fréquents, on peut citer : Les phytoestrogènes naturellement présents dans certaines plantes (soja, luzerne) Les phytoestrogènes sont un groupe de composés non stéroïdaux, produits naturellement par les plantes, qui du fait de la similarité de leur structure moléculaire avec l'estradiol (17β-estradiol) ont la capacité de provoquer des effets œstrogéniques ou anti-œstrogéniques • des polluants : des produits de combustion comme les dioxines, les furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)… • des produits industriels ou domestiques comme : o les phtalates, le bisphénol A (utilisés dans les plastiques) o les parabènes (?), conservateurs utilisés dans les cosmétiques o les organochlorés (DDT, chlordécone…) utilisés dans les phytosanitaires o l'étain et dérivés utilisés dans les solvants
- 14. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS • Les phtalates sont un groupe de produits chimiques dérivés (sels ou esters) de l’acide phtalique • Les phtalates sont couramment utilisés comme plastifiants des matières plastiques (= additif utilisé pour les rendre plus souple et flexible) mars 21 • ll existe une dizaine de phtalates (souvent désignés sous leurs noms abrégés) utilisés industriellement : DEHP, DBP, BBP, DIDP, DINP, etc. Ils n’ont pas tous la même nocivité Depuis janvier 2007, aucun jouet ou article de puériculture destiné aux enfants de moins de trois ans ne doit contenir plus de 0,1 % de DEHP, de DBP et de BBP ( phtalates les plus problématiques) Moins restreints, le DINP, le DIDP et le DNOP ne sont plus autorisés dans les objets qui se mettent dans la bouche Les PHTALATES
- 15. Autrefois très présent dans le PLASTIQUE DES BIBERONS, LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Le BISPHÉNOL A • c'est un perturbateur endocrinien œstrogéno-mimétique capable de se lier, entre autres, aux récepteurs α et β des œstrogènes. • Son action serait environ 1 000 fois inférieure à celle de l’estradiol En 2013, l'interdiction du bisphénol A dans les contenants destinés à des enfants de moins de trois ans Depuis le 1er janvier 2015, l'interdiction du bisphénol A a été généralisée aux conditionnements directement en contact avec les denrées alimentaires : canettes, boîtes de conserve et couvercles métalliques mars 21 = BPA
- 16. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS Les PARABÈNES mars 21 • Ses propriétés antibactérienne et antifongique font qu'il est généralement utilisé comme conservateur notamment dans les cosmétiques. Les parabènes les plus courants sont appelés méthylparabène, éthylparabène, propylparabène, isopropylparabène, butylparabène, isobutylparabène et benzylparabène Actuellement, il n’y a pas de consensus scientifique sur le potentiel toxique des parabènes • L'utilisation de parabènes porte à controverse en raison de leur capacité à activer les récepteurs des œstrogènes, induisant une possible action sur la fertilité et les tumeurs œstrogéno-dépendantes, comme le cancer du sein
- 17. Un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est ? Le cas du DISTILBÈNE® Quels sont les perturbateurs endocriniens avérés/suspectés ? Les enjeux de la recherche LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21
- 18. LES ENJEUX DE LA RECHERCHE mars 21
- 19. LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21 ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 20 000 enfants suivis ! Cohorte ELFE Cohorte PELAGIE
- 20. DÉVELOPPEMENT DE TESTS IN VITRO POUR IDENTIFIER LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS mars 21
- 21. TOXICODYNAMIE 1ère partie o Organes cibles 2ème partie o Fonctions physiologiques cibles o Fonctions cellulaires cibles o Génotoxicité Conséquences : mutations - cancers François Parant Biologiste Médical Praticien Hospitalier francois.parant@chu-lyon.fr mars 21
- 22. POISONS DE L’HÉMOGLOBINE o Rappels : Globules rouges - Hémoglobine - Hème - Fer o Agents méthémoglobinémisants o Monoxyde de carbone o Plomb : poison inhibiteur de la synthèse de l’hème POISONS DES MITOCHONDRIES o Cyanures FONCTIONS CELLULAIRES CIBLES mars 21
- 23. LES GLOBULES ROUGES = érythrocytes = hématies mars 21 Nombre moyen de globules rouges : o 4,6 à 6,2 T/L chez l'homme (1 T = 1012, soit mille milliards) o 4,2 à 5,4 T/L chez la femme Son cytoplasme est riche en hémoglobine, qui assure le transport du dioxygène (O2) Cellules sans noyau de forme biconcave (cette forme leur confère une élasticité importante, qui permet le transport de dioxygène à travers certains capillaires étroits)
- 24. L’HÉMOGLOBINE mars 21 Les types d’hémoglobine normale incluent: • L’Hb A (a2/b2) qui constitue environ 95 à 98% de l’Hb retrouvée chez l’adulte; contient deux chaînes protéiques alpha (a) et deux chaînes protéiques bêta (b). • L’Hb A2 (a2/d2) qui constitue environ 2 à 3% de l’Hb; contient deux chaînes protéiques alpha (a) et deux chaînes protéiques delta (d). • L’Hb F (a2/g2) qui constitue jusqu’à 2% de l’Hb chez l’adulte; contient deux chaînes protéiques alpha (a) et deux chaînes protéiques gamma (g); il s’agit d’une hémoglobine primaire produite par le fœtus pendant la grossesse; sa production chute généralement peu après la naissance. Une molécule d’hémoglobines (Hb) est composée : • de quatre sous-unités de globine (chaîne protéique formée d’acides aminés) • … liées chacune à une molécule d’hème (qui contient le fer).
- 25. LA MOLÉCULE D’HÉME mars 21 État d'oxydation du fer : Fe2+ (ferreux)
- 26. FIXATION DE L’OXYGÈNE SUR L’HÉMOGLOBINE mars 21 Dioxygène Globine Hème Globine
- 27. POISONS DE L’HÉMOGLOBINE o Rappels : Globules rouges - Hémoglobine - Hème - Fer o Agents méthémoglobinémisants o Monoxyde de carbone o Plomb : poison inhibiteur de la synthèse de l’hème POISONS DES MITOCHONDRIES o Cyanures FONCTIONS CELLULAIRES CIBLES mars 21
- 28. La MÉTHÉMOGLOBINE mars 21 La méthémoglobine est une forme anormale de l'hémoglobine dans laquelle le cation de fer de l'hème est à l'état d'oxydation +3 (ferrique), et non à l'état d'oxydation +2 (ferreux) qui est celui de l'hémoglobine La méthémoglobine (MetHbFe3+) ne peut pas fixer l’oxygène Asphyxie L’hémoglobine (HbFe2+) fixe l’oxygène
- 29. AGENTS MÉTHÉMOGLOBINÉMISANTS mars 21 *Industrie chimique : fabrication du 4,4'-MDI (monomères de départ utilisé pour la production industrielle de POLYURÉTHANE) ANILINE Agents méthémoglobinisants rencontrés en milieu professionnel* Aniline
- 30. POISONS DE L’HÉMOGLOBINE o Rappels : Globules rouges - Hémoglobine - Hème - Fer o Agents méthémoglobinémisants o Monoxyde de carbone o Plomb : poison inhibiteur de la synthèse de l’hème POISONS DES MITOCHONDRIES o Cyanures FONCTIONS CELLULAIRES CIBLES mars 21
- 31. LE MONOXYDE DE CARBONE mars 21 L’hémoglobine a une affinité 210 fois plus forte pour le CO que pour l’oxygène (formation préférentielle de carboxy-hémoglobine = HbCO) Voir cours « GAZ TOXIQUES »
- 32. POISONS DE L’HÉMOGLOBINE o Rappels : Globules rouges - Hémoglobine - Hème - Fer o Agents méthémoglobinémisants o Monoxyde de carbone o Plomb : poison inhibiteur de la synthèse de l’hème POISONS DES MITOCHONDIES o Cyanures FONCTIONS CELLULAIRES CIBLES mars 21
- 33. Le PLOMB mars 21 SATURNISME Plomb : Inhibition de la synthèse de hème (inhibition de la Ferrochelatase) Anémie Rem. Lead = plomb en anglais
- 34. PLOMBÉMIE = concentration de Pb dans le sang mars 21 Plus les enfants ont du plomb dans le sang, plus leur QI diminue Seuil toxique chez l’adulte Chez l’enfant SATURNISME (intoxication au plomb) & Anémie
- 35. POISONS DE L’HÉMOGLOBINE o Rappels : Globules rouges - Hémoglobine - Hème - Fer o Agents méthémoglobinémisants o Monoxyde de carbone o Plomb : poison inhibiteur de la synthèse de l’hème POISONS DES MITOCHONDRIES o Cyanures FONCTIONS CELLULAIRES CIBLES mars 21
- 36. LES MITOCHONDRIES mars 21 Une cellule primitive anaérobie douée de la capacité de phagocytose englobe une bactérie alpha pourpre, capable de faire de la respiration oxydative. L'association profite aux deux : la cellule peut respirer et la bactérie peut se nourrir en échange. Ceci pourrait avoir eu lieu il y a plus de 2 milliards d'années ENDOSYMBIOSE « Centrales énergétiques » des cellules ADN mitochondrial Organites intracellulaires des cellules eucaryotes
- 37. L’ADN MITOCHONDRIAL (ADNmt) mars 21 La transmission de cet ADN est non mendélienne car il est uniquement transmis par la mère
- 38. Rôle des mitochondries : RESPIRATION AÉROBIE CELLULAIRE mars 21 La molécule d'ATP (adénosine triphosphate) permet le stockage temporaire de l'énergie dans la cellule
- 39. mars 21 Rôle des mitochondries : RESPIRATION AÉROBIE CELLULAIRE Les différentes étapes de la respiration aérobie : Glycolyse Cycle de Krebs Chaîne respiratoire mitochondriale
- 40. mars 21 Rôle des mitochondries : RESPIRATION AÉROBIE CELLULAIRE L'essentiel de l'énergie chimique potentielle est produite par le cycle de Krebs sous forme de pouvoir réducteur (NADH + H+ et CoQ10H2). Ce pouvoir réducteur est ultérieurement utilisé dans la chaîne respiratoire des mitochondries pour produire 11 autres molécules d'ATP via un gradient de protons et une ATP synthase Le cycle de Krebs
- 42. MÉCANISME TOXIQUE DES CYANURES mars 21 x Inhibition de la chaîne respiratoire mitochondriale (par inhibition du Cyt C) Acide cyanhydrique* : H-C≡N (gaz) Cyanure de potassium : N≡C- + K+ Cyanure de sodium : N≡C- + Na+ *= cyanure d’hydrogène Cyanures
- 43. FDS Cyanure de sodium mars 21 Production d’acide cyanhydrique gazeux Cyanures
- 44. EXPOSITIONS AUX CYANURES mars 21 o Fumées d’incendie (cyanures, monoxyde de carbone, suies) o Expositions professionnelles o industries chimiques réactif de synthèse industrielle o industrie aurifère technique d’extraction de l’or par cyanuration o Amandes amères (amandiers sauvages) ≠ Amandes douces o Pépins de pommes o Amandes des noyaux d'abricots o Noyaux de cerise …. contiennent de l’amygdaline qui se convertit en cyanure après l’ingestion Risque réel pour la santé uniquement si consommation +++ Cyanures
- 45. EXPOSITIONS AUX CYANURES mars 21 Cyanures
- 46. TOXICODYNAMIE 1ère partie o Organes cibles 2ème partie o Fonctions physiologiques cibles o Fonctions cellulaires cibles o Génotoxicité Conséquences : mutations - cancers François Parant Biologiste Médical Praticien Hospitalier francois.parant@chu-lyon.fr mars 21
- 47. CHROMOSOMES - ADN LA GÉNOTOXICITÉ, QU'EST-CE QUE C'EST ? CONSÉQUENCES o Mutations o Cancers GÉNOTOXICITÉ – MUTAGÈNES - CANCÉRIGÈNES mars 21
- 48. CHROMOSOMES ET ADN mars 21 L'Homme possède 46 chromosomes répartis en 23 paires
- 49. CHROMOSOMES ET ADN mars 21 Acide désoxyribonucléique
- 50. STRUCTURE DE L’ADN mars 21
- 51. STRUCTURE DE L’ADN mars 21 ADN : désoxyribose (pas de OH en position 2) ARN : ribose A et G = bases puriques T et C = bases pyrimidiques Bases azotées de l’ADN A-T : 2 liaisons C-G : 3 liaisons
- 54. CHROMOSOMES - ADN LA GÉNOTOXICITÉ, QU'EST-CE QUE C'EST ? CONSÉQUENCES o Mutations o Cancers GÉNOTOXICITÉ – MUTAGÈNES - CANCÉRIGÈNES mars 21
- 55. LA GÉNOTOXICITÉ, qu'est-ce que c'est ? = AGENTS GÉNOTOXIQUES • L’ADN des chromosomes n’est pas une structure inerte, stable, qui maintiennent l'information génétique dans un stockage statique. mars 21 Des altérations de l'ADN peuvent se produire o Ces phénomènes d’altération ne sont pas rares o Ils peuvent être spontanés (désaminations fréquentes des bases) o Ils peuvent être induits o Erreurs lors de la réplication de l’ADN par l’ADN polymérase o Agressions de l’ADN par un agent physique ou chimique ... mais la cellule dispose de processus permettant la réparation de l’ADN
- 56. LA GÉNOTOXICITÉ, qu'est-ce que c'est ? mars 21
- 57. LA GÉNOTOXICITÉ, qu'est-ce que c'est ? mars 21 Altération de bases Cassure simple brin Cassure doubles brins Pontage intra-brin Pontage inter-brin Site apurinique Pontages ADN-Protéines
- 58. mars 21 Agents génotoxiques PHYSIQUES Exemple des ultraviolets (UVB)
- 59. mars 21 UVB Liaison covalente entre deux thymines voisines Exemple des ultraviolets (UVB) Agents génotoxiques PHYSIQUES
- 60. mars 21 Kink = entortillement Agents génotoxiques PHYSIQUES
- 61. mars 21 Schéma du mécanisme de réparation par excision-resynthèse Agents génotoxiques PHYSIQUES o Identification des liaisons covalentes T=T o Section de part et d’autres de T=T puis excision o Mise en place des bases manquantes
- 62. mars 21 Réparation sans erreur Agents génotoxiques PHYSIQUES Le mécanisme de réparation commet une erreur
- 63. mars 21 Liaison covalente avec une guanine Exemple benzo[a]pyrene Agents génotoxiques CHIMIQUES
- 64. mars 21 Exemple benzo[a]pyrene Agents génotoxiques CHIMIQUES
- 65. CHROMOSOMES - ADN LA GÉNOTOXICITÉ, QU'EST-CE QUE C'EST ? CONSÉQUENCES o Mutations o Cancers GÉNOTOXICITÉ – MUTAGÈNES - CANCÉRIGÈNES mars 21
- 66. MUTATIONS mars 21 Génotoxicité Lésion de l’ADN Mutation Modification définitive de l’ADN Du latin « mutare » = changer
- 68. Les différents types de MUTATIONS mars 21 Mutations modifiant la ploïdie Changements du nombre de chromosomes * Exemple de toxique mitotique : La colchicine provoque les anomalies mitotiques conséquences de la désorganisation des microtubules Conséquence d’une toxicité mitotique* Exemple d’anomalie de ploïdie : Trisomie 21 Rappel : cellules diploïdes normales • 46 chromosomes • 23 paires
- 69. mars 21 Mutations chromosomiques Changements structuraux des chromosomes o Anneaux o Cassures o Translocations o Réarrangements chromosomiques o Etc. Les différents types de MUTATIONS
- 70. mars 21 Les différents types de MUTATIONS
- 71. mars 21 Les différents types de MUTATIONS
- 72. mars 21 Mutations géniques Changements des séquences de nucléotides Les différents types de MUTATIONS
- 73. mars 21 Rappel : • ADN T • ARN U Les différents types de MUTATIONS
- 74. mars 21 Les différents types de MUTATIONS
- 75. mars 21 Une cellule subie une série de mutations la rendant cancéreuse Les cellules cancéreuses prolifèrent sans contrôles et forment une tumeur LE PROCESSUS DE CANCÉRISATION
- 76. mars 21 CANCERS
- 77. LA PRÉVENTION DU RISQUE CMR mars 21 Agents Cancérogènes – Mutagènes - Reprotoxiques Classification : • Groupe • Classe • Catégories et sous catégories … de dangers Étiquetage - Le pictogramme GHS 08 La prévention du risque CMR
- 78. mars 21 Agents Cancérogènes – Mutagènes - Reprotoxiques Certains agents chimiques ont, à moyen ou long terme, des effets : o cancérogènes o mutagènes o ou toxiques pour la reproduction Ils sont dénommés Agents CMR
- 79. AGENTS CMR et PRÉVENTION DU RISQUE CMR mars 21 Agents Cancérogènes – Mutagènes - Reprotoxiques Classification : • Groupe • Classe • Catégories et sous catégories … de dangers Étiquetage - Le pictogramme GHS 08 La prévention du risque CMR
- 80. mars 21 Classification des agents CMR GROUPES CLASSES CATÉGORIES et SOUS-CATÉGORIES de dangers Selon le règlement CLP : trois groupes de dangers • Dangers physiques • Dangers pour la santé • Dangers pour l’environnement Les agents CMR sont classés dans le groupe • Dangers pour la santé
- 81. mars 21 Classification des agents CMR GROUPES CLASSES CATÉGORIES et SOUS-CATÉGORIES de dangers Dangers physiques Dangers pour la santé Dangers pour l’environnement Les agents CMR appartiennent au groupe des agents dangereux pour la santé Les classes de danger définissent la nature du danger
- 82. mars 21 Classification des agents CMR GROUPES CLASSES CATÉGORIES et SOUS-CATÉGORIES de dangers Dangers physiques Dangers pour la santé Dangers pour l’environnement Les catégories de danger permettent une gradation du degré du danger 1A Cancérogène avéré 1B Cancérogène présumé 2 Cancérogène suspecté
- 83. AGENTS CMR et PRÉVENTION DU RISQUE CMR mars 21 Agents Cancérogènes – Mutagènes - Reprotoxiques Classification : • Groupe • Classe • Catégories et sous catégories … de dangers Étiquetage - Le pictogramme GHS 08 La prévention du risque CMR
- 84. mars 21 Étiquetage des agents CMR
- 85. mars 21 Étiquetage des agents CMR
- 86. Pictogramme SGH08 mars 21 Les agents suivants sont associés aux pictogramme GHS08 Allergisants respiratoires CMR STOT (Specific target organ toxicity)
- 87. o Tous les Agents Chimiques Dangereux (ACD) classés « CMR » (Cancérogènes-Mutagènes- Reprotoxiques) sont étiquetés avec le pictogramme SGH08 (sauf agents nocifs si allaitement) o … mais un ACD avec le pictogramme SGH08 ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un CMR mars 21 Étiquetage des agents CMR
- 88. mars 21 Catégories et sous- catégories de dangers Pictogramme – mentions d’avertissement Mentions de dangers Pour l’homme : CMR avéré CMR présumé CMR suspecté En résumé
- 89. LA PRÉVENTION DU RISQUE CMR mars 21 Agents Cancérogènes – Mutagènes - Reprotoxiques Classification : • Groupe • Classe • Catégories et sous catégories … de dangers Étiquetage - Le pictogramme GHS 08 La prévention du risque CMR
- 90. mars 21 LA PRÉVENTION DU RISQUE CMR Quand un agent CMR est repéré sur le lieu de travail, sa SUPPRESSION ou sa SUBSTITUTION s’impose, chaque fois qu’elle est techniquement possible
- 91. mars 21 LA PRÉVENTION DU RISQUE CMR
- 92. mars 21 Sujet Les cancers professionnels
