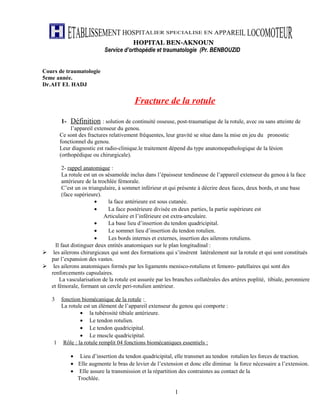
Fracture de la rotule
- 1. HOPITAL BEN-AKNOUN Service d’orthopédie et traumatologie (Pr. BENBOUZID Cours de traumatologie 5eme année. Dr.AIT EL HADJ Fracture de la rotule 1- Définition : solution de continuité osseuse, post-traumatique de la rotule, avec ou sans atteinte de l’appareil extenseur du genou. Ce sont des fractures relativement fréquentes, leur gravité se situe dans la mise en jeu du pronostic fonctionnel du genou. Leur diagnostic est radio-clinique.le traitement dépend du type anatomopathologique de la lésion (orthopédique ou chirurgicale). 2- rappel anatomique : La rotule est un os sésamoïde inclus dans l’épaisseur tendineuse de l’appareil extenseur du genou à la face antérieure de la trochlée fémorale. C’est un os triangulaire, à sommet inférieur et qui présente à décrire deux faces, deux bords, et une base (face supérieure). • la face antérieure est sous cutanée. • La face postérieure divisée en deux parties, la partie supérieure est Articulaire et l’inférieure est extra-artculaire. • La base lieu d’insertion du tendon quadricipital. • Le sommet lieu d’insertion du tendon rotulien. • Les bords internes et externes, insertion des ailerons rotuliens. Il faut distinguer deux entités anatomiques sur le plan longitudinal : les ailerons chirurgicaux qui sont des formations qui s’insèrent latéralement sur la rotule et qui sont constitués par l’expansion des vastes. les ailerons anatomiques formés par les ligaments menisco-rotuliens et femoro- patellaires qui sont des renforcements capsulaires. La vascularisation de la rotule est assurée par les branches collatérales des artères poplité, tibiale, peronniere et fémorale, formant un cercle peri-rotulien antérieur. 3 fonction biomécanique de la rotule : La rotule est un élément de l’appareil extenseur du genou qui comporte : • la tubérosité tibiale antérieure. • Le tendon rotulien. • Le tendon quadricipital. • Le muscle quadricipital. 1 Rôle : la rotule remplit 04 fonctions biomécaniques essentiels : • Lieu d’insertion du tendon quadricipital, elle transmet au tendon rotulien les forces de traction. • Elle augmente le bras de levier de l’extension et donc elle diminue la force nécessaire a l’extension. • Elle assure la transmission et la répartition des contraintes au contact de la Trochlée. 1
- 2. • Participe au centrage de l’appareil extenseur en s’opposant aux forces de subluxation par les formations capsulo-ligamentaires internes. Alors qu’en extension, la rotule transmet surtout les forces de traction, lors de la flexion, sa surface articulaire postérieure subit en plus des contraintes en pression. Ces notions biomécaniques présentent un intérêt thérapeutique : • Rétablir la continuité de l’appareil extenseur. • Eviter les patelliformes totales qui augmentent le travail du quadriceps. • Restituer une surface articulaire congruente afin de transmettre de façon très homogène les forces de compression. 4 mécanismes : • Mécanisme direct : le plus fréquent, Choc direct avec réception sur la face antérieure du genou, pouvant entraîner des ouvertures cutanées (syndrome de tableau de bord). • -Mécanisme indirect : flexion forcée sur quadriceps contractée (fracture Transversale), ou en extension contrariée du genou. 5 classification : En fonction du respect on non de l’intégrité de l’appareil extenseur on distingue : A. Fractures interrompant la continuité l’appareil extenseur : 1) Fractures transversales : classification de MOULAY et RICARD • Type 1 : fracture transversale simple • Type 2 : fracture transversale complexe avec un trait de refond le plus souvent inférieur. • Type 3 : fracture communitive pouvant s’accompagnant d’un tassement antéro-posterieur 2
- 3. 2) Fractures de la base de la rotule : Correspond à une désinsertion du tendon quadricipital. 3) Fracture de la pointe de la rotule : Correspond à une désinsertion du tendon rotulien. B. Fractures n’interrompant pas la continuité l’appareil extenseur : 1- Fracture verticale : Trait sagittal, peu déplacée, elles consolident sans séquelles après traitement orthopédique. 2- Fractures parcellaires : Supero-externe ou supero-interne. A différencier avec la patella biparteta. Fractures parcellaires externes 3- Fractures osteochondrales : Elles font suite a une série de luxation ou subluxation de la rotule, leur diagnostic est difficile et se comportent comme un corps étranger intra-articulaire. 3
- 4. Luxation de la rotule 4- Fractures en étoile : fracture éclatement de la rotule 6- Diagnostic positif : • Interrogatoire : il doit rechercher ; Circonstances et mécanisme de l’accident. Antécédents medico-chirurgicaux. Heure de l’accident. Heure du dernier repas. • Examen clinique : Impotence fonctionnelle. Perte l’extension active du genou avec extension passive très douloureuse. La palpation recherche un écart inter-fragmentaire. Gros genou sans reliefs anatomiques, avec un choc rotulien +, témoignant d’une hémarthrose. Apprécier l’état cutané. Rechercher une lésion associée. • Radiologie : Des que le diagnostic suspecté il faut immobilisée le genou par une attelle radio-transparente. Le bilan radiologique comporte : Radio standard genou de face et de profil. Radio de genou en flexion de 30°. Incidences axiales. TDM et IRM pour les lésions osteochondrales. 4
- 5. Incidences axiales : femoro-patellaires 7- Diagnostic différentiel : a) Autres ruptures de l’appareil extenseur : -Rupture du tendon rotulien ou tendon quadricipital. -Radio et l’échographie redressent le diagnostic. b) patella bipartita : Ne pas confondre Les patella bipartita, qui ressemblent aux fractures parcellaires du rebord supéro-externe et qui sont des mauvaises fusions d’un noyau d’ossification. Elles sont fréquentes et sont souvent bilatérales. Elles peuvent poser des problèmes médico- légaux en cas traumatisme lorsque l’on ne dispose pas de radios antérieures au traumatisme 8- Traitement : A. But : Réduction parfaite restituant l’anatomie.. Contention solide afin de permettre une rééducation précoce. Avoir un genou stable, mobile et indolore. Eviter les complications. B.Methodes : Traitement orthopédique : est réservé aux seules fractures non déplacées Ponction d’une hémarthrose dans des conditions d’asepsie rigoureuse. Ïmmobilisation par un plâtre cruro-malleolaie (genouillère plâtrée) pendant 4 à 6 semaines avec rééducation isométrique précoce. Ponction du genou Traitement chirurgical : La voie d’abord est médiane verticale allant de la base a la pointe de la rotule avec arthrotomie pour contrôler la qualité de la réduction. Méthodes conservatrices : 5
- 6. • Cerclage équatorial : rassemblement des différents fragments par un fil métallique autorisant un remodelage secondaire. Fil métallique, est un mauvais procédé, car il n’empêche pas l’écartement des fragments, lors de la flexion du genou. On aboutit à des consolidations vicieuses avec des rotules allongées, aux surfaces irrégulières génératrices de conflits douloureux et d’arthrose. • Haubanage armé sur 2 broches : Réalisant un montage dynamique, permettant la transformation des forces de traction en forces de compression, et permettant ainsi une rééducation. Il est beaucoup plus satisfaisant. C’est un cerclage prenant appui à travers les fibres du tendon quadricipital et du tendon rotulien, au contact de l’os et passant en avant de la rotule. Il entraîne une mise en compression des fragments osseux. Il est d’autant plus efficace, que la distance est large, entre le bord antérieur de la rotule et le point d’application du cerclage (système analogue aux barres de flèches qui éloignent les haubans du mat, d’un bateau). Le procédé du hauban est amélioré par la mise place de 2 broches longitudinales et parallèles, qui traversent les deux fragments principaux et qui ont l’avantage de maintenir la réduction. Un cerclage métallique en huit, prenant appui sur les broches, est serré et il apporte un élément de compression. Ce procédé permet une mobilisation rapide et active du genou, dont l'effet apporte une mise en compression des fragments dès la sollicitation en flexion. • Vissage simple : est possible, mais uniquement dans les fractures horizontales et surtout polaires inférieures. La solidité de l’ostéosynthèse n’est pas aussi bonne qu’avec un hauban, car les forces de traction s’exercent sur le filet de la vis qui ne saurait résister beaucoup à l’arrachement. La rééducation de la flexion doit être très douce. . Méthodes avec résection : • Patellectomie partielle : petit fragment, communition majeur d’une parie de la rotule. • Patellectomie totales : d’indication exceptionnelle réservée aux communitions importantes non osteosynthesables . 9- Evolution et complication : Bien traitées, les fractures de la rotule consolident en 5 à 6 semaines. Les complications sont : o Nécrose cutanée. 6
- 7. o Sepsis qui peut évoluer vers une arthrite. o Déplacement secondaire. o Cal vicieux source d’arthrose femoro patellaire. o Raideur du genou. ___________________________________________________________________________ 7
