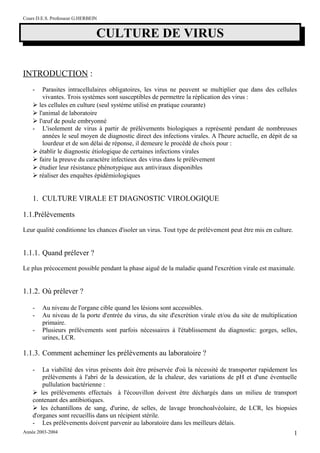
CULTURE DE VIRUS
- 1. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN CULTURE DE VIRUS INTRODUCTION : - Parasites intracellulaires obligatoires, les virus ne peuvent se multiplier que dans des cellules vivantes. Trois systèmes sont susceptibles de permettre la réplication des virus : les cellules en culture (seul système utilisé en pratique courante) l'animal de laboratoire l'œuf de poule embryonné - L'isolement de virus à partir de prélèvements biologiques a représenté pendant de nombreuses années le seul moyen de diagnostic direct des infections virales. A l'heure actuelle, en dépit de sa lourdeur et de son délai de réponse, il demeure le procédé de choix pour : établir le diagnostic étiologique de certaines infections virales faire la preuve du caractère infectieux des virus dans le prélèvement étudier leur résistance phénotypique aux antiviraux disponibles réaliser des enquêtes épidémiologiques 1. CULTURE VIRALE ET DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE 1.1.Prélèvements Leur qualité conditionne les chances d'isoler un virus. Tout type de prélèvement peut être mis en culture. 1.1.1. Quand prélever ? Le plus précocement possible pendant la phase aiguë de la maladie quand l'excrétion virale est maximale. 1.1.2. Où prélever ? - Au niveau de l'organe cible quand les lésions sont accessibles. - Au niveau de la porte d'entrée du virus, du site d'excrétion virale et/ou du site de multiplication primaire. - Plusieurs prélèvements sont parfois nécessaires à l'établissement du diagnostic: gorges, selles, urines, LCR. 1.1.3. Comment acheminer les prélèvements au laboratoire ? - La viabilité des virus présents doit être préservée d'où la nécessité de transporter rapidement les prélèvements à l'abri de la dessication, de la chaleur, des variations de pH et d'une éventuelle pullulation bactérienne : les prélèvements effectués à l'écouvillon doivent être déchargés dans un milieu de transport contenant des antibiotiques. les échantillons de sang, d'urine, de selles, de lavage bronchoalvéolaire, de LCR, les biopsies d'organes sont recueillis dans un récipient stérile. - Les prélèvements doivent parvenir au laboratoire dans les meilleurs délais. Année 2003-2004 1
- 2. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN - Au laboratoire, si la mise en culture doit être différée de quelques heures ils doivent être maintenus entre 2 et 6°C. Au-delà de 36 heures, une congélation à –80°C ou en azote liquide doit être envisagée; par contre, la congélation à une température voisine de –20°C est proscrite. 1.2. Culture virale in vivo - Le recours à l'animal de laboratoire ou à l'œuf de poule embryonné est devenu exceptionnel, même si ces procédés sont encore employés pour l'isolement de certains virus : Souriceaux nouveau-nés pour les coxsachie-virus A, Œufs de poules embryonnés pour les virus de la grippe. 1.3. Culture virale in vitro L'inoculation en culture cellulaire est le procédé le plus souvent utilisé pour l'isolement des virus. Elle doit se faire dans un environnement bien équipé qui permet le respect des règles de sécurité vis-à-vis du risque infectieux, lequel peut nécessiter un confinement strict des activités de culture virale dans un laboratoire adapté de haute sécurité. 1.3.1. Généralités sur les cultures cellulaires - La plupart des cellules en culture doivent adhérer à un support verre neutre ou plastique spécialement traité pour survivre et proliférer. D'autres à l'inverse se multiplient en suspension. C'est le cas des cellules lymphoblastoïdes et de certaines cellules malignes. - Les milieux de culture doivent satisfaire aux exigences nutritionnelles des cellules : eau, sels minéraux, glucose, acides aminés, vitamines constituent le milieu de base (milieu de Eagle) auxquels sont ajoutés des facteurs de croissance apportés par du sérum animal (de veau le plus souvent) des antibiotiques, éventuellement des antifongiques, une substance tampon (bicarbonate de sodium, TRIS ou HEPES) permettant de contrôler le pH des cultures, et du rouge de phénol comme indicateur de pH. - les différents réactifs dont les n° de lot doivent être soigneusement notés sont choisis en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques et microbiologies compatibles avec les cellules utilisées. Pour certains réactifs comme les sérums animaux il est parfois nécessaire de tester plusieurs lots afin de choisir le plus adapté à la multiplication des cellules utilisées et à la réplication des virus recherchés. 1.3.2. Cellules adhérentes utilisées en virologie médicale - Dans la mesure où il n'existe pas un virus permissif à tous les virus cultivables, deux catégories de cellules sont habituellement entretenues dans les laboratoires de Virologie : les cultures de cellules issues de tissus normaux et les lignées continues (voir tableau ci-joint) - Les cultures primaires et secondaires proviennent de tissus normaux d'origine humaine ou animale, prélevés sur des organismes adultes ou embryonnaires. Les cellules, séparées par action de la trypsine et placées dans le milieu de culture se fixent sur la paroi du récipient et se multiplient jusqu'à former un tapis continu fait d'une seule couche cellulaire. Elles conservent globalement l'aspect qu'elles avaient dans le tissu d'origine et l'on observe, selon le cas soit des cultures de cellules épithélioïdes, de morphologie polygonale, soit des cultures des cellules fibroblastiques, fusiformes. Arrivées à confluence, elles cessent de se multiplier par inhibition de contact. Cette culture dite primaire peut elle aussi être dissociée par la trypsine et donner naissance à de nouvelles cultures Année 2003-2004 2
- 3. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN dites secondaires qui peuvent à leur tour être entretenues par "passages". Le nombre de passages en série n'est pas illimité : deux à trois seulement pour les cellules épithélioïdes, une cinquantaine au maximum pour les cellules fibroblastiques embryonnaires. Ces dernières qui conservent tous les caractères des cellules normales constituent des souches diploïdes, telles les cellules MRC5 (fibroblastes pulmonaires d'embryons humains). - les lignées continues, caractérisées par leur capacité de prolifération infinie, proviennent soit de tumeurs malignes (cellules HeLa issues d'un carcinome du col utérin), soit de la transformation spontanée ou viro-induite de cultures primaires ou secondaires (exemple: cellules Vero ou MK2 qui dérivent de cellules de rein de singe). Le nombre de chromosomes des lignées continues est variable (lignées cellulaires hétéroploïdes). Leur croissance est souvent plus rapide que celles des cellules diploïdes et leur nombre de passages théoriquement illimité. Des propriétés nouvelles pouvant être acquises par les cellules à l'occasion de leurs passages répétés, elles doivent être congelées à un nombre de passage donné et le stock régulièrement reconstitué. La congélation des cellules en azote liquide doit être progressive en présence de diméthylsulfoxyde (DMSO). La décongélation, en revanche doit être rapide. - En dehors des réserves propres à chaque laboratoire, il existe des banques de cellules dont la plus importante est l' ATCC (American Type Culture Collection). 1.3.3. Choix des cultures à inoculer - Le choix de cultures cellulaires dépend du virus recherché. C'est ainsi que le CMV est isolé uniquement sur fibroblastes humains diploïdes alors que le virus herpès simplex peut l'être sur de nombreux types cellulaires. Certains virus ne sont pas cultivables in vitro (cf. tableau ci-joint). - Habituellement les prélèvements sont inoculés sur deux ou trois types de cellules (au minimum une lignée diploïde et une lignée continue), après aspiration du surnageant de culture, et sont laissés en contact une heure à 37°C avec la couche cellulaire. Après addition d'un milieu neuf, les cultures sont incubées à 37°C, en atmosphère enrichie de 5% de CO2. Les cultures primaires de rein de singe ne sont plus utilisées. 1.3.4. Identification du virus isolé - Les cellules sont examinées tous les deux ou trois jours au microscope optique inversé. - Du fait de leur multiplication, certains virus induisent des modifications morphologiques caractéristiques appelées effet cytopathogène (ECP), visibles soit à l'état frais (arrondissement ou rétraction des cellules, foyers de lyse) soit après fixation et coloration des cellules mises en culture sur des lamelles (inclusion intranucléaire ou cytoplasmique selon le site de multiplication du virus). Cet ECP est souvent évocateur d'un virus ou d'une famille de virus. - L'identification précise fait appel à des techniques immunologiques (inhibition du pouvoir infectieux par neutralisation de l'ECP, test d'immunofluorescence ou immunoenzymatique, inhibition de l'hémaglutination) utilisant des anticorps spécifiques, monoclonaux de préférence, voire des techniques de virologie moléculaire. - Le délai d'apparition de l'ECP dépend du titre infectieux de l'inoculum et du cycle de multiplication du virus. Il peut varier de deux jours à six semaines. Une étape préalable de centrifugation de l'inoculum sur les cellules sensibles augmente la sensibilité de la culture. - Des techniques de culture rapide ont été développées pour certains virus (CMV, HSV, VZV, ADV, entérovirus). Elles reposent sur la centrifugation de l'inoculum sur des cellules sensibles et la détection, avant que n'apparaisse l'ECP, d'antigènes viraux précoces ou très précoces à l'aide d'anticorps monoclonaux spécifiques de ces antigènes, par un test d'immunofluorescence ou immunoenzymatique. Elles permettent de réaliser plus rapidement la détection et l'identification du virus. Outre leur rapidité, elles peuvent comporter un aspect semi-quantitatif si l'on dénombre les cellules marquées par rapport à la taille de l'inoculum. Année 2003-2004 3
- 4. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN - En dehors de l'ECP, la multiplication virale peut être détectée par la mise en œuvre d'autres moyens (par exemple, détection de l'antigène p24 pour le HIV-1 ou d'une activité transcriptase réverse pour les rétrovirus). 1.4. INTERPRETATION - Le succès d'un isolement viral dépend de la qualité des prélèvements et des cellules, du titre infectieux du prélèvement, et du caractère cultivable du virus. Les risques d'échec sont nombreux et la négativité des cultures ne permet pas d'éliminer l'infection virale. - Habituellement la présence d'un virus dans un prélèvement est significative de son implication dans la pathologie observée (exemple : entérovirus dans le LCR, virus herpès simplex dans un liquide vésiculaire). - Cependant la présence d'un virus infecté dans un prélèvement ne témoigne pas obligatoirement de son pouvoir pathogène: les virus de la famille de herpesviridae sont souvent excrétés de façon intermittente ou chronique dans divers liquides biologiques (comme la salive pour EBV ou les urines pour CMV). De même, les adénovirus et les entérovirus peuvent être éliminés dans les selles après l'infection aiguë. C'est dire que l'interprétation des résultats peut être difficile; elle doit se faire en fonction du contexte clinique, du virus isolé, et de la connaissance de l'état immunitaire du patient. 2. CULTURE VIRALE ET ÉTUDE LA SENSIBILITÉ AUX ANTIVIRAUX : TEST PHÉNOTYPIQUE - les tests phénotypiques permettent de déterminer la concentration d'une substance antivirale qui inhibe la réplication d'un virus donné de 50% (CI50) ou de 90% (CI90) vore de 99% (CI99). - La culture du virus en l'absence de l'antiviral est prise comme référence pour le calcul des concentrations. Ils sont habituellement réalisés sur des cultures cellulaires (permissives au virus étudié) en microplaque de 24, 48 ou 96 puits, soit après un titrage préalable de la suspension virale et l'utilisation d'un inoculum à une concentration voulue soit par la technique de l'échiquier qui consiste à tester directement les différentes dilutions de la suspension virale avec différentes concentrations d'antiviral. - La multiplication virale dans la culture cellulaire peut être mesurée par une quantification de l'ECP (dénombrement des plages de lyse, dénombrement des cellules vivantes par colorimétrie, pourcentage de réplicats présentant un ECP) ou par une quantification des antigènes ou des acides nucléiques produits. - Ces tests peuvent être utilisés pour étudier la sensibilité des souches virales vis à vis d'une association d'antiviraux. Ils sont limités à quelques virus (HSV, CMV, VZV, RSV, HIV). Ils sont longs, fastidieux, peu standardisés, et restent du ressort du laboratoire spécialisé ou du laboratoire de référence. Ils sont utiles pour surveiller l'évolution de la résistance des virus au traitement antiviraux, en particulier chez les patients immunodéprimés et pour étudier le déterminisme génétique de la résistance. Ils servent également de référence pour évaluer des techniques plus accessibles comme la recherche de mutations spécifiques. Année 2003-2004 4
- 5. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN DETECTION D'ANTIGENES VIRAUX 1. INTRODUCTION - Devant la difficulté, la lenteur voire l'impossibilité rencontrée pour cultiver certains virus, les techniques immunologiques sont une alternative intéressante dans le diagnostic direct d'une infection virale. - La détection directe d'antigènes viraux dans les produits pathologiques présente l'avantage d'être relativement simple et rapide à mettre en œuvre et de ne pas nécessiter le maintien de l'infectiosité du virus. Elle s'inscrit au premier plan dans le diagnostic rapide de diverses infections et à ce titre permet la mise en route de mesures prophylactiques ou thérapeutiques immédiates. - A l'inverse, elle manque de sensibilité et ne s'applique donc qu'aux infections où des quantités importantes de virus sont produites. - L'utilisation de ces techniques est à envisager dans le cadre d'une stratégie de diagnostic global de l'infection virale et ne saurait être dissociée-lors de l'interprétation des résultats- des autres approches directes (culture cellulaire, détection de génomes viraux) ou indirectes (sérologie). - Ne sera considérée dans ce chapitre que la détection directe d'antigènes viraux à partir de produits pathologiques à l'exclusion de toutes les techniques immunologiques utilisées en complément d'autres approches diagnostiques (identification d'un virus à partir de culture cellulaire, révélation immunologique de technique moléculaire, immunomicroscopie électronique). 2. PRINCIPE GENERAL - Les virus sont riches en constituants protéiques ou glycoprotéique pouvant faire l'objet d'une reconnaissance immune par les anticorps spécifiques. Ces anticorps constituent des outils diagnostic précieux ; il peut s'agir d'anticorps polyclonaux d'origine humaine (produits à l'occasion d'infection naturelle) ou le plus souvent animale (obtenus par immunisation expérimentale) ; de plus en plus, sont utilisés les anticorps monoclonaux (d'origine habituellement murine) dont le grand intérêt réside dans la précision de l'épitope reconnu. Le choix de ce dernier est bien sûr capital dans la stratégie diagnostique ; il peut être intéressant d'utiliser des anticorps dirigés contre des antigènes de groupe capables de reconnaître plusieurs virus appartenant à un même genre (adénovirus ou entérovirus) ou au contraire de cibler un épitope spécifique de type (différenciation entre virus herpes simplex type 1 et 2). - La deuxième étape de toute réaction immunologique consiste à visualiser le complexe antigène-anticorps ; pour ce faire de nombreuses techniques sont disponibles : agglutination de particules sensibilisées (hématies, latex, particules de gélatine), fluorochrome, marqueurs enzymatiques (technique ELISA et ses très nombreuses variantes). Le système de marquage peut être lié directement à l'anticorps primaire ou, le plus souvent fixé sur un anticorps secondaire dirigé contre les immunoglobulines de l'espèce animale chez laquelle a été produit l'anticorps primaire. Année 2003-2004 5
- 6. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN 3. CHAMPS D'APPLICATION EN VIROLOGIE - La détection directe d'antigènes viraux dans des produits pathologiques est limitée en pratique par la sensibilité de la technique qui est directement proportionnelle à la quantité de virus présente dans le prélèvement. En d'autres termes, le champs d'application est restreint au prélèvement riche en matériel infectieux (tableau ci-joint). Par contre, du fait de la bonne conservation des structures antigéniques, le prélèvement peut être conservé plusieurs heures à quelques jours (même si cela n'est pas conseillé) à 4°C, voire à température ambiante, avant d'être transmis au laboratoire. 3.1. Prélèvements de selles - Au cours des gastro-entérites virales, les quantités de virus présents dans les selles sont comprises entre 108 et 1012 particules virales par gramme de selle. Une recherche directe de rotavirus, d'adénovirus, ou d'astrovirus peut être réalisée à partir d'un échantillon de selle diarrhéique par agglutination de particules de latex sensibilisées ou par techniques immunoenzymatiques (les secondes étant plus sensibles). 3.2. Prélèvements de sécrétions respiratoires - Au cours des viroses respiratoires, il est possible de mettre en évidence les antigènes du virus causal dans les cellules du tractus respiratoire. - Les prélèvements adaptés à cette détection sont les écouvillonnages et les aspirations rhinopharyngées, les sécrétions trachéobronchiques et les liquides de lavage bronchoalvéolaire. - La détection peut se faire directement à partir de la sécrétion respiratoire par technique immunoenzymatique (test unitaire, microplaque) ou après lavage et fixation des cellules du prélèvement sur une lame pour immunofluorescence. - Les virus qui peuvent être mis en évidence par ces méthodes sont les virus grippaux type A et B (des sous-typages de virus A sont même possibles), le virus respiratoire syncytial, les virus parainfluenzae, les adénovirus et les coronavirus. La sensibilité de ces techniques en particulier pour les trois dernières familles de virus est assez faible et un résultat négatif ne permet pas d'exclure le diagnostic. - Dans les pneumopathies rougeoleuses ou de l'immunodéprimé, il est possible de visualiser les antigènes du virus de la rougeole, du virus herpes simplex ou du CMV dans des sécrétions du tractus respiratoire inférieur. 3.3. Lésions cutanéo-muqueuses - En cas d'éruption vésiculeuse (virus herpes simplex, virus varicelle zona) il est possible de mettre en évidence des antigènes viraux à partir des lésions cutanéo-muqueuses, par technique imunoenzymatique ou par immunofluorescence. - Le prélèvement doit être d'excellente qualité et comporter une quantité suffisante de cellules infectées ; pour ce faire il est conseillé de soulever le plafond de la vésicule avec une aiguille courte ou un vaccinostyle stérile et de frotter énergiquement la base de la lésion avec un petit écouvillon en dacron de manière à détacher les cellules ; l'écouvillon est ensuite déchargé dans un petit volume de milieu de transport (technique immunoenzymatique) ou sur une lame pour immunofluorescence (aucune fixation n'est requise avant le transport). Année 2003-2004 6
- 7. Cours D.E.S. Professeur G.HERBEIN 3.4. Leucocytes du sang périphérique - En cas de virémie à cytomégalovirus, il est possible de mettre en évidence la protéine pp65 du virus dans le noyau des polynucléaires à l'aide d'un anticorps monoclonal. Cette technique requiert une séparation préalable des leucocytes. La révélation peut se faire par immunofluorescence ou technique immunoenzymatique. Il est possible de quantifier la lecture en dénombrant le pourcentage de cellules marquées. 3.5. Antigènes viraux dans le sérum - les antigènes du virus de l'hépatite B (antigènes HBs, antigènes HBe) sont recherchés par technique immunoenzymatique dans le sérum au cours des infections aiguës ou chroniques dues à cet agent. - L'antigène p24 du virus HIV-1 est détecté par technique immunoenzymatique dans le sérum lors de la phase précoce de la primoinfection et à la phase tardive de l'évolution de la maladie. 3.6 Autres prélèvements - de façon plus ponctuelle, des détection d'antigènes peuvent être effectuées par immunohistochimie ou immunofluorescence à partir de biopsie (virus herpes simplex dans le poumon, CMV au niveau digestif ou pulmonaire, virus de la rage dans le système nerveux central). - En conclusion, il convient de retenir tout particulièrement la rapidité d'exécution et la facilité de mise en œuvre des méthodes de détection directe des antigènes viraux (cf. tableau ci-joint), mettant ces techniques à la portée d'un grand nombre de laboratoires non spécialisés. Année 2003-2004 7
