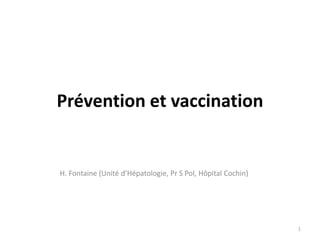
Fontaine préventio et vaccination du16
- 1. Prévention et vaccination H. Fontaine (Unité d’Hépatologie, Pr S Pol, Hôpital Cochin) 1
- 2. Prévention adaptée aux modes de contamination : très globalement Hépatites virales A B et D C Hépatite E Sanguin + ++ selon les pays et la date de transfusion +++ selon la date de transfusion ++ Sexuel + +++ + sauf chez HSH où +++ - Pays d’endémie +++ +++ +++ +++ Alimentaire +++ - - +++ Le risque de transmission materno-fœtal est à la fois sanguin et lié à la zone géographique2
- 3. Hépatites A et E 3
- 4. Prévention de l’hépatite A Contamination : -alimentaire -transmission oro-fécale -sujet contact Vaccination : -sujets partant en zone d’endémie (si non immuns) -sujets contacts (vaccination la plus rapide possible) -hépatite chronique B ou C, hépatopathie sévère Schéma vaccinal : -classique M0 et M6 -peut être associé au vaccin hépatite B VHA = 1° cause de transplantation hépatique pour hépatite virale chez l’enfant 4
- 5. Prévention de l’hépatite A • Vaccination si facteur de risque (ne pas oublier les sujets contacts) • Règles d’hygiène universelles • Traitement des eaux usées 5
- 6. Prévention de l’hépatite E : forme classique Principales caractéristiques de la forme classique : -génotype 1 -en pays en voie de développement (Inde +++) -transmission oro-fécale -risque = hépatite aiguë sévère au 3° trimestre de la grossesse -mais pas de chronicité Prévention : -ne pas aller dans les pays concernés au 3° trimestre de la grossesse -règles d’hygiène universelles -traitement des eaux usées -vaccin homologué en Chine 6
- 7. Prévention de l’hépatite E : forme récente Principales caractéristiques de la forme récente : -génotype 3 -Europe (1°cause d’hépatite virale aiguë dans le sud de la France) -transmission alimentaire (charcuterie mal cuite et gibier) et sanguine -risque = hépatite aiguë -forme chronique rare mais décrite chez les patients immunodéprimés avec risque de cirrhose et de formes décompensées (efficacité de la ribavirine) Prévention : -éviter charcuterie avec de la viande mal cuite (figatelle en Corse) -éviter le gibier mal cuit -dépistage des élevages de porcs atteints -dépistage des dons du sang -pas de vaccin disponible 7
- 8. Revenons aux hépatites B, C et D 8
- 9. Facteurs de risque de contamination de l’hépatite B (et D) • Sexuel (2/3 des cas déclarés en France) • Sanguine : – Transmission materno-fœtale (ASE et Chine +++) : 80 % des enfants de mère Ag HBe + et 30 % des mères Ag HBe-, puis 70-90 % de formes chroniques) – Horizontale (Afrique) : 30 % de passage à la chronicité chez les enfants contaminés entre 1 et 4 ans – Toxicomanie par voie veineuse et nasale – Transfusionnelle – Patients très médicalisés (transfusions de produits sanguins, greffe d’organe, soins invasifs) – Tatouages, acupuncture, piercing (en fonction des conditions de réalisation) – Sujets vivant en institution • Séjour en pays d’endémie (verticale = transmission materno- fœtale, horizontale, sexuelle) 9
- 10. Facteurs de risque de contamination de l’hépatite C • Sanguine : – Toxicomanie par voie veineuse et nasale (y compris par le petit matériel : seringue, cuillère, coton, aiguille, filtre, eau…) – Transfusionnelle – Patients très médicalisés (transfusions de produits sanguins, greffe d’organe, soins invasifs), en particulier les dialysés – Tatouages, acupuncture, piercing (en fonction des conditions de réalisation) – Sujets vivant en institution (prison +++) – Transmission materno-fœtale : de 3 à 10 % selon co-infection VIH et virémie C • Sexuelle selon les pratiques : 1/10 millions de rapports dans les couples hétérosexuels stables mais fréquente chez les HSH surtout si pratiques « sanglantes », co-infectés par le VIH, MST • Séjour en pays d’endémie 10
- 11. Populations à risque Hépatites B et D Hépatite C Patients transfusésAvant 1980 Avant 1990 Toxicomanes par voie veineuse ou nasale Partenaires sexuels multiples, rapports non protégés, HSH, pratiques à risque Séjour, voyage ou origine d’un pays endémique Tatouages, piercing, acupuncture Sujets en institution (prisons +++) Patients co-infectés par le VIH, ou déjà infectés par le VHC ou le VHB Patients très médicalisés, (dialysés, greffés, CEC…) Enfants nés de mère infectée 11
- 12. Prévention de l’hépatite B (et D) : la théorie et la pratique • Vaccination +++ • Sexuel : préservatifs • Séjour en pays d’endémie : prévention des transmissions verticale, horizontale et sexuelle 12
- 13. Prévention de l’hépatite B (et D) : la théorie et la pratique • Sanguine : – Transmission materno-fœtale (selon les moyens financiers du pays) : • dépistage des mères au 1° trimestre de la grossesse • séro-vaccination de l’enfant dans les 12 premières heures de vie (selon la médicalisation des grossesses et des accouchements) – Horizontale (Afrique) : vaccination des familles, de la population générale en zone de forte endémie, – Toxicomanie par voie veineuse et nasale : utilisation de matériel à usage unique – Transfusionnelle : le dépistage des dons par PCR depuis 2010 en France a réduit le risque actuel à 1/3 x 106 dons – Patients très médicalisés (transfusions de produits sanguins, greffe d’organe, soins invasifs) – Tatouages, acupuncture, piercing : matériel à usage unique – Sujets vivant en institution 13
- 14. Prévention de l’hépatite C • Sanguine : – Toxicomanie : utilisation de matériel à usage unique (incidence actuelle = 5000/an en France ) – Transfusionnelle : dépistage des dons du sang par PCR en France depuis 2010 réduisant le risque à 1 tous les 3 à 4 ans – Patients très médicalisés, (dépistage des donc du sang et d’organe, règles d’hygiène universelle, matériel à usage unique, dialyse +++) – Tatouages, acupuncture, piercing : matériel à usage unique – Sujets vivant en institution (prison +++) : prévention de la contamination par usage de drogues, dépistage systématique et traitement préférentiel (reco AFEF 2015) – Transmission materno-fœtale : de 3 à 10 % selon co-infection VIH et virémie C • Sexuelle selon les pratiques : préservatifs et diminution du réservoir • Séjour en pays d’endémie 14
- 15. Vaccination contre l‘hépatite B 15
- 16. Vaccination B : généralités Vaccin composé de l’Ag HBs obtenu par recombinaison génétique et adsorbé sur de l’aluminium Monovalents: -Engerix® -Genhevac® -HBV vaxpro® Associés à d’autres vaccins: -Twinrix® (VHA) -Infanrix® (hexavalent) : DTC polio HI Efficace si déclenche une production d’AC anti-HBs ≥ 10 U/L 16
- 17. Facteurs de risque d’échec • Âge : – > 30 ans chez l’homme – > 40 ans chez la femme • Homme • Surpoids • Tabagisme • Consommation excessive d’alcool • Allèles HLAII RDBA et DQB1 • Co-morbidités: -diabète -insuffisance rénale -cirrhose -immunodépression -VIH -greffe d’organe -traitement immunosuppresseur 17
- 18. Schémas standards et leur efficacité M0 M1 M6 à 12 1° injection à 2 mois de vie (avec DTC Polio et Haemophilus Influenzae B) AC ≥ 10 U/L chez 90 %, 1 mois après la dernière injection -99 % nourrissons -95 % enfants -95 % des adultes immunocompétents à fonction rénale normale Efficacité plus durable si AC ≥ 100 U/L M0 M1 M12M2 Si nécessité d’obtention d’une efficacité rapide 18
- 19. Quand faut-il faire des rappels dans la population générale ? Si AC ≥ 10 U/L après un vaccin dans l’enfance Protection > 30 ans Pas de rappel nécessaire En cas de doute sur l’efficacité d’un vaccin dans l’enfance Refaire une injection + contrôle des AC 1 mois après AC ≥ 10 U/L AC < 10 U/L Refaire la vaccination 90 % 10 % 19
- 20. Autres populations Adolescents (11-15 ans) M0 – M1 – M6 M0-M6 (Engerix® ou Genhevac®) Nouveau-né de mère Ag HBs né à terme M0 – M1 – M6 (Engerix®/Genhevac 10®) + 100 UI d’Ig anti-HBs en IM + contrôle des AC 1 mois après V3 Nouveau-né de mère Ag HBs né avant 32 semaines ou pesant moins de 2 kg M0 – M1 – M2 – M6 Adulte avec indication à une protection rapide Engerix® : J0 – J7 – J21 – M12 Genhevac® : J0 – J10 – J21 – M12 20
- 21. Autres populations : exposition professionnelle Résultat même ancien AC HBs > 100 UI/L Pas d’antériorité d’AC HBs > 100 UI/L AC anti-HBc AC HBs ≥ 10 Ag HBs – ADN VHB - Ag HBs + OU ADN VHB + AC HBs<10 Ag HBs – ADN VHB - AC HBs ≤100 Ag HBs – AC HBs>100 Ag HBs – Vaccin documenté Vaccin pas documenté AC HBs <10 AC HBs 10-100 Avis spécialisé Revacciner + contrôle Immunisé AC HBs <10 AC HBs ≥10 Immunisé AC HBc +AC HBc - 21
- 22. Revaccination d’un sujet exposé à un risque professionnel Si doute sur une vaccination antérieure, refaire une injection et contrôle des AC HBs 1 mois après AC HBs > 10 U/L Considéré comme immunisé Pas de rappel nécessaire Pas de sérologie ultérieure AC HBs < 10 UI/L Une dose + contrôle des AC HBs à 1-2 mois à répéter pour obtenir AC > 10 UI/L sans dépasser 6 injections au totalNon répondeur Aptitude ? Sérologie/an 22
- 23. Schémas en cas de co-morbidités Hépatopathie sans cirrhose Surconsommation d’alcool M0 – M1 – M2 – M6 double dose Double vaccination VHA-VHB 75 % 60 % Cirrhose M0 – M1 – M2 – M6 double dose 42 % Insuffisance rénale Dialyse* M0 – M1 – M2 – M6 double dose 85 % Infection par le VIH M0 – M1 – M2 – M6 double dose 82 % * À vacciner dès les 1° stades de l’IRC, contrôle des AC HBs/an Observance faible Toxicomanes J0 – J7/10- J21 – M12 Engerix®/Genhevac® 23
- 24. Schémas en cas de co-morbidités Avant greffe d’organe solide J0 – J7 – J21 simple dose ? Transplantation rénale Classique : M0 – M1 – M2 – M6 double dose Mieux : J0 – J7 – J21 avant greffe puis M6 à 1 après et rappels/3-5 ans 30 % 84 % * contrôle des AC HBs/an et rappel/3 à 5 ans en moyenne (dès que nécessaire en pratique) Autre transplantation d’organe solide M0 – M1 – M2 – M6 +/- M8 – M9 double dose Greffe médullaire M6 – M7 – M8 – M18 double dose 24
- 25. Que faire chez un non répondeur ? AC HBs < 10 UI/L après schéma recommandé selon le contexte Refaire 1 à 3 doses jusqu’à obtention des AC > 10 UI/L Double dose de vaccin VHA et VHB ? X 1 X 3 Efficacité 59 % Efficacité 95 % 25
- 26. Politique vaccinale mondiale Théorie : la politique doit varier selon la prévalence de la zone géographique -forte (≥ 8 %) : Afrique subsaharienne, ASE, Chine -intermédiaire : bassin méditerranéen, Russie, Europe de l’Est, Moyen Orient -faible (≤ 2 %) : Europe du Nord-Ouest, Amérique du Nord Amérique du Sud Directives de l’OMS : mise en place de programmes de vaccination généralisée Avant 1995 si forte prévalence le + souvent à la naissance Avant 1997 si faible prévalence -dès la naissance chez tous en théorie -mais souvent dans la pop à risque seulement 26
- 27. Politique vaccinale actuelle en France Identification, dépistage, et vaccination des personnes à risque Contrôle de l’hépatite B par vaccination des nourrissons et rattrapage des adolescents < 15 ans 1. Sujets vivant en institution (psychiatrie, handicap, autres collectivités…) 2. Relations sexuelles avec partenaires sexuels multiples 3. Voyages (séjours fréquents et/ou prolongés en pays de forte ou moyenne endémie) 4. Résidence en pays de forte ou moyenne endémie 5. Professionnels ou bénévoles en contact avec des patients à risque, prélèvements biologiques, dispositifs médicaux, linges, déchets,… incluant secouristes, gardiens de prison, éboueurs, égoutiers, policiers, tatoueurs, thanatopracteurs … 6. Patients candidats à recevoir des produits dérivés du sang (dont dialysés, hémophiles…) 7. Patients candidats à une greffe d’organe, tissu, cellules 8. Personnes vivant sous le même toit qu’un sujet contact dot les enfants de mère infectée 9. Partenaires sexuels d’un patient infecté 10. Personnes incarcérées 27
- 28. WHO-UNICEF estimates of HepB3 coverage http://www.who.int/vaccines/globalsummary/immunization/timeseries/tswucoveragehepb3.htm Pays Vaccination des nourrissons Taux de CV (3 doses) Allemagne Depuis 1995 87 % Italie Depuis 1991 96 % Espagne Depuis 1992 96 % Portugal Depuis 2000 97 % États-Unis Depuis 1995 92 % France Depuis 1994 29 % Taux de couverture vaccinale anti-VHB chez les nourrissons pas optimal en France en 2007 28
- 29. Le remboursement de Infanrixhexa® a un impact positif sur la couverture vaccinale contre l’hépatite B J. Gaudelus & R.Cohen : Vaccinoscopie : couverture vaccinale vis-à-vis de la rougeole, de la rubéole, des oreillons et de l’hépatite B en France en 2008 – Médecine & Enfance Avril 2008 Proportion d’enfants âgés de 6 à 8 mois ayant reçu au moins 1 dose avant 6 mois 29
- 30. Le remboursement de Infanrixhexa® a un impact positif sur la couverture vaccinale contre l’hépatite B J. Gaudelus & R.Cohen : Vaccinoscopie : couverture vaccinale vis-à-vis de la rougeole, de la rubéole, des oreillons et de l’hépatite B en France en 2008 – Médecine & Enfance Avril 2008 Proportion d’enfants âgés de 6 à 8 mois ayant reçu au moins 1 dose avant 6 mois 70% de couverture vaccinale au T4 2011 30
- 31. Couverture vaccinale des nourrissons échantillon généraliste des bénéficiaires CnamTS/InVS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tauxdecouverturevaccinale CV 1 dose (à 6 mois) CV 3 doses (à 24 mois) Année de naissance Remboursement Vaccin hexavalent 31
- 32. Couverture vaccinale 3 doses des nourrissons Dress, remontée des services de PMI/InVS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Certificats de santé du 24è mois Année de collecte (année de naissance) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) 32
- 33. Couverture vaccinale encore faible à 15 ans Année d’enquête Couverture GSM (6 ans) Vaccinale hépatite CM2 (11 ans) B 3 doses 3ème (15 ans) 2000-2001 62 % 2001-2002 33.1% 2002-2003 33.5% 2003-2004 42.4% 2004-2005 38.9% 2005-2006 37.8% 2007-2008 45.8% 2008-2009 43.1% Données Dress/Dgesco/InVS 33
- 34. Chez l’adulte, sur l’interrogatoire Sont vaccinés : -43 % des usagers de drogues -63 % des HSH -90 % des professionnels de santé Impact attendu (simulation InVS 2008) = diminution : -des hépatites aiguës (3000) -dont les formes fulminantes (5) -des formes chroniques (100) -de la mortalité par cirrhose et CHC Mais actuellement 80 % des hépatites B aiguës déclarées (DO depuis 2013) auraient pu être évitées par vaccination selon les recommandations de l’incidence des hépatites aiguës B en France de 20 000/an début 90 à 2300/an en 2000 34
- 35. Bénéfices de la vaccination 35
- 36. Diminution aux US de l’incidence des hépatites B aiguës entre 1990 et 2006 Annemarie Wasley & al : Surveillance for Acute Viral Hepatitis - United States, 2006 : March 21, 2008 / 57(SS02);1-24 La vaccination contre l’hépatite B a été mise en place chez les nourrissons à partir de 1991 . La couverture vaccinale des enfants âgés de 19 à 35 mois a augmenté très rapidement avec des taux de plus de 80 % dès 1996 pour atteindre 92,4 % en 2004. Depuis 1990, la baisse la plus importante de l’incidence de l’hépatite B aiguë a été observé dans le groupe de sujets de < 15 ans (98%) et dans la tranche d’âge 15-24 ans (93%). 36
- 37. Réduction du taux d’infection chronique Alaska Thaïlande Indonésie Shangaï Taiwan Gambie Chine HBsAg (%) 5.2% 0% 5.4% 0.8% 6.2% 2.0% 8.8% 0.5% 9.8% 0.7% 12.0% 0.9% 14.6% 1.4% 1 3 5 7 9 11 13 15 avant vaccination après vaccination 37
- 38. Disparition de CHC et hépatite B aiguë 25 ans après la vaccination McMahon BJ, Bulkow LR, Singleton RJ et al. Hepatology 2011 Dans les années 70, prévalence de l ’AgHBs entre 6 et 20% des patients vivant enAlaska avec prévalence élevée de CHC survenant dans 1/3 des cas avant 30 ans. A partir de 1984, programme de vaccination systématiques des nouveaux-nés, dépistage de masse et vaccination de rattrapage des séronégatifs en Alaska Effet de cette campagne sur les taux d ’hépatite B et de CHC chez l’enfant 25 ans plus tard Incidence annuelle des hépatites B aigues symptomatiques chez les enfants en Alaska entre 1981 et 2010 Prévalence de l’hépatite B chronique chez les enfants < 20 ans en Alaska entre 1988 et 2008 Une vaccination systématique des nouveaux-nés et une vaccination de rattrapage des enfants séronégatifs a permis en Alaska d’éliminer l’hépatite B chronique et le CHC chez l’enfant 38
- 39. Bénéfiques supposés associés à la vaccination en France (InVS) • Chez les enfants vaccinés entre 1994 et 1997, ont été évitées: – environ 20 000 infections – 8000 hépatites aiguës – 800 infections chroniques – 40 hépatites fulminantes • Ces résultats ont été obtenus en grande partie grâce à la couverture vaccinale élevée obtenue chez les adolescents à cette époque (76% à 11 ans, 65% chez les adolescents plus âgés)… 39
- 40. Effets secondaires de la vaccination • Locaux (3 à 10 %) : douleur, rougeur, œdème au point d’injection • Généraux (1 à 6 %) : -fièvre, fatigue, arthralgies, myalgies, céphalées -réactions anaphylactiques (1/600 000 doses) -myofasciite à macrophages liés à l’aluminium mais balance bénéfice- risque jugée comme bénéficiant à la vaccination dans les populations à risque -vaccin et maladies démyélinisantes (SEP) déclarées en 1997 à l’Agence du Médicament, 3 ans après la vaccination des nourrissons et rattrapage chez les adolescents débutée (1994)… 40
- 41. Risque relatif (odd ratio [OR]) de neuropathie démyélinisante associé à la vaccination anti-VHB OR = 3.1 [1.5-6.3]163 cas/1604 témoinsHernán et al. OR = 0,9 [0,6-1,5] < 1 an : 0,8 [0,4-1,8] 1-5 ans : 1,6 [0,8-3,0] > 5 ans : 0,6 [0,2-1,4] 440 cas/950 témoinsDe Stefano et al. OR = 0,9 [0,5-1,6] < 2 ans : OR = 0,7 [0,3-1,8] 192 cas/645 témoinsAscherio et al. > 2 mois : OR = 1,4 [0,8-2,4], ≤ 12 mois : OR = 1,6 [0,6-3,9], 520 cas/2505 témoinsAbenhaim et al. 0-2 mois OR = 1,8 [0,7-4,6] 2-12 mois OR = 0,9 [0,4-2,0] 402 cas/722 témoinsTouzé et al. <2 mois : OR = 1,7 [0,8-3,7]121 cas/121 témoinsTouzé et al. Risques associés à la vaccination 41
- 42. RR = 0,71 [0,4-1,26] 643 patients Etude cas cross-over Confavreux et al 9 cas /288657 enfants versus 5 cas/289651 enfants après la campagne Cohorte d’enfantsSadovnick et al 1 an RR =1,0 [0,3-3,0] 2 ans RR = 1,0 [0,4-2,4] 3 ans RR = 0,9 [0,4-2,1] cohorte de 134 698 sujets Zipp et al. Risque relatif (odd ratio [OR]) de neuropathie démyélinisante associé à la vaccination anti-VHB Risques associés à la vaccination 42
- 43. KIDSEP1 • 356 patients avec une maladie démyélinisante (âge moyen de 9,2 ans +/- 4,6 ans) suivis dans une cohorte : une récidive d’atteinte démyélinisante centrale traduisant une SEP a été observée chez 146 patients (41%) au cours d’un suivi de plus de 5 ans. • 33 de ces patients avaient été exposés au vaccin contre le VHB et 28 au vaccin anti-tétanique. Mikaeloff & al on the behalf of Kidsep study group of the French Neuropaediatric Society : Hepatitis B vaccine and rik of relapse after a first childhood episode of CNS inflammatory demyelinisation : Brain (2007), 130, 1105-1110 Risques associés à la vaccination 43
- 44. Mikaeloff & al on the behalf of Kidsep study group of the French Neuropaediatric Society : Hepatitis B vaccine and rik of relapse after a first childhood episode of CNS inflammatory demyelinisation : Brain (2007), 130, 1105-1110 Période post-vaccinale considérée Vaccination anti-Hépatite B Vaccination anti-tétanique Toute durée 1,09 (0,53 – 2,24) 1,08 (0,63 – 1,83) 3 ans 0,78 (0,32 – 1,89) 0,99 (0,58 – 1,67) 6 mois 0,38 (0,05 – 2,79) 1,22 (0,59 – 2,53) Risque de récidive de SEP chez l’enfant selon le vaccin L’exposition au vaccin anti-VHB n’augmente pas le risque de récidive d’atteinte démyélinisante, quelle que soit la durée de suivi KIDSEP1 Risques associés à la vaccination 44
- 45. • 143 enfants SEP ont été comparés à 1122 enfants témoins. • Le taux de vaccination contre l’hépatite B dans les 3 ans avant la date index (première poussée de SEP) est identique dans les deux groupes et de l'ordre de 32 %. Mikaeloff Y, Caridade G, Rossier M, Suissa S, Tardieu M. Hepatitis B vaccination and the risk of childhood-onset multiple sclerosis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Dec;161(12):1176-82 KIDSEP2 Risques associés à la vaccination 45
- 46. • La vaccination contre l'hépatite B n’était pas associée à une augmentation du risque de première poussée de SEP Odd Ratio ajusté de 1,03 (avec IC 95% : 0,62 - 1,68) • Et ce : - quel que soit l’intervalle de temps entre la vaccination et la première poussée de démyélinisation - quel que soit le nombre d’injections de vaccin - quel que soit le type de vaccin utilisé Mikaeloff Y, Caridade G, Rossier M, Suissa S, Tardieu M. Hepatitis B vaccination and the risk of childhood-onset multiple sclerosis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2007 Dec;161(12):1176-82 KIDSEP2 Risques associés à la vaccination 46
- 47. 47
- 48. Étude cas-témoins sur le risque de survenue d’un épisode démyélinisant du système nerveux central chez l’enfant vacciné contre l’hépatite B • Etude cas-témoins sur la cohorte KIDSEP (349 enfants de moins 16 ans ayant eu un épisode démyélinisant aigu du SNC (EDA) entre 1994 et 2003. • Évaluation du risque d’EDA chez l’enfant vacciné contre le VHB pour différentes périodes suivant la vaccination. chez 349 enfants appariés à 2941 enfants témoins indemnes d’affection démyélinisante centrale sur l’âge, le sexe, et le lieu de naissance Y. Mikaeloff et al. Neurology 2008 Risques associés à la vaccination 48
- 49. • Pas d’augmentation du risque d’EDA chez les enfants -dans les trois années qui suivent la vaccination contre le VHB: OR = 0,74 ; IC95 % [0,54-1,02]) -ni dans les années suivantes (OR = 0,93; IC95% [0,65-1,31]). Mais une analyse en sous-groupe des enfants ayant respecté le calendrier vaccinal fait apparaitre un risque significativement augmenté de: - EAD : OR = 1,74 ; IC95 % [1,03-2,95]) - SEP : OR = 2,77; IC95% [1,23-6,24]) plus de trois ans après la vaccination chez les enfants vaccinés par Engerix B®. Risques associés à la vaccination Y. Mikaeloff et al. Neurology 200849
- 50. Résumé des débats de la Commission nationale de pharmacovigilance du 30/09/2008 • Réserves importantes vis-à-vis des résultats des analyses en sous-groupes et de la multiplicité des tests effectués (environ 160) expliquant une augmentation très importante du risque de première espèce • La justification de l’analyse restreinte aux enfants observants au calendrier vaccinal officiel n’apparaît pas claire. • Les analyses en sous-groupes conduisent à réduire considérablement les effectifs : risque de biais de sélection • Erreur d’interprétation pour la différence entre Engerix B® et les autres vaccins (parce que le lien avec le risque de SEP est significatif pour Engerix B® et non significatif pour les autres vaccins) en l’absence d’un test d’interaction significatif, d’autant que les intervalles de confiance des OR des différents vaccins se chevauchent 50
- 51. • Après en avoir délibéré, la Commission Nationale de Pharmacovigilance a adopté (23 voix pour, 7abstentions et 1 voix contre) les éléments de conclusion suivants : -le résultat principal de cette étude ne montre pas d’association chez l’enfant entre l’exposition à une vaccination contre le VHB et un épisode de démyélinisation aiguë centrale ; -en raison des multiples limites évoquées lors de la séance, la Commission Nationale de Pharmacovigilance considère que les résultats de l’analyse du sous-groupe d’enfants ayant respecté le calendrier vaccinal présentent les caractéristiques d’un résultat fortuit ; -le rapport bénéfice/risque de la vaccination contre le VHB, quel que soit le vaccin contre l’hépatite B, ne saurait être remis en cause sur la base de ce seul résultat d’analyse de sous- groupe dans la population pédiatrique. • La Commission a jugé néanmoins souhaitable de poursuivre le suivi national de pharmacovigilance des vaccins contre le VHB. Conclusions des débats de la Commission nationale de pharmacovigilance du 30/09/2008 51
- 52. 52
- 53. Réduction des risques et prévention des hépatites B et C chez les usagers de drogues (UD) 53
- 54. Spécificités chez les usagers de drogues prévalence de < 1% à 44 % (Coquelicot 2004) dont la moitié ignorent leur statut Plus de co-infection Plus de surconsommation d’alcool Plus de contaminations multiples Réservoir de contamination Difficultés de prise en charge Lésions plus sévères Besoins différents 70 % des 5000 nouveaux cas par an sont toxicomanes 54
- 55. • 1987 : libéralisation de la vente des seringues • Campagnes d’information auprès des usagers • Utilisation de matériel à usage unique (aiguilles et petit matériel) • Steribox • Création de centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD, CSAPA) • Traitements de substitution aux opiacés • Amélioration de l’accès au traitement (PEC sociale – migrants +++) • PEC des personnes détenues (prévalence VHC = 5 %) UD : mesures en cours 55
- 56. UD : limites des mesures de prévention • Efficacité moindre que sur le VIH -pouvoir infectant, résistance au chauffage et à la dessication -maladie longtemps asymptomatique • Utilisation des traitements substitutifs par voie IV • Difficultés d’accès aux soins • Manque d’information sur le rôle contaminant du petit matériel • 50 % des pharmacies vendent des steribox2 • Difficultés plus importantes en dehors des grandes villes • Contamination majeure à la 1° utilisation de drogues (faite par l’usager chez seulement 1/3) 56
- 57. UD : mesures en cours de développement • Traiter les patients usagers de drogues infectés afin de réduire le réservoir • Développer les seringues avec espace mort réduit • Développer le « kit base » (matériel pour diminuer la contamination au cours de le consommation de crack) • Diffusion de matériel à usage unique (aiguille + petit matériel) • Séance éducatives adaptée aux patients • Diversifier les approches éducatives (communautaires, médicosociales…) • Développer le dépistage par les TROD (liquide craviculaire, résultat 30 mn) • Développer la consultation sur place dans les CAARUD et les CSAPA • Actions de rue et auprès des foyers de vie de migrants • Prise en charge spécifique des femmes (post-traumatique fréquent, transmission materno-fœtale) 57
- 58. UD : salles de consommation • Permet un 1° contact avec des populations difficiles à atteindre • Meilleures conditions d’hygiène et de sécurité • Réduction des décès • Accès à la PEC globale (sociale, conseil, dépistage, orientation..) Mais difficultés d’acceptation par l’opinion générale 58
- 59. Prévention en dehors de l’usage de drogues : dons de sang et d’organes 1971 : dépistage de l’Ag HBs 1988 : dépistage des AC HBc et mesure des ALAT (arrêtée en 2004) 1990 : dépistage des AC anti-VHC 2001 : dépistage de l’ARN VHC 2010 : dépistage de l’ADN VHB Séropositivité chez 10 000 donneurs après auto-questionnaire et entretien : -B: 1,03 -C : 0,58 Risque résiduel de transmission (secondaire à la « fenêtre silencieuse ») -B : 1/2,5 millions de dons (20j) -C : 1/ 10 millions de dons (10j) 59
- 60. Prévention en dehors de l’usage de drogues : en milieu de soins – VHC de patient à patient Signalement des infections nosocomiales depuis 2001 puis intervention du CCLIN Gestes à risque avant 2001 (jusqu’à 15 % des contaminations par le VHC) : -dialyse -autres gestes digestifs invasifs -anesthésie générale -auto-piqueurs et lecteurs de glycémie Recommandations émises par la DGS : -1994 : utilisation de dispositifs médicaux à usage unique -1996 : amélioration de la désinfection des endoscopes -1997 : stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé -1999 : prévention de la transmission des agents infectieux véhiculés par le sang et d’autres liquides biologiques au cours des soins 2 cas décrits entre 2011 et 2013 60
- 61. Prévention en dehors de l’usage de drogues : en milieu de soins – VHB de patient à patient Signalement des infections nosocomiales depuis 2001 puis intervention du CCLIN FDR avant 2000 : -chirurgie digestive -orale -gynécologique -biopsie myocardique Hépatite aiguë B à DO depuis 2003 Risque difficile à estimer mais faible 61
- 62. Prévention en dehors de l’usage de drogues : en milieu de soins –de soignant à soigné Risque exceptionnel actuellement et à évoquer seulement si : -acte invasif (chirurgical) -soignant virémique -contact direct ou indirect sur peau ou muqueuses lésées VHC • 20 cas publiés entre 1996 et 2007 • par « recontact » : FDR -pas de visibilité du champ opératoire -geste chirurgical confiné -palpation des aiguilles à suture • 2005 : 9/an (chirurgie et dentaire) VHB FDR : -chirurgie, -non respect des précautions standard, -soignants vaccinés avec un ATCD d’hépatite chronique ignoré -ADN > 2000 UI/L (100 %) 62
- 63. Recommandations du rapport du Haut Conseil de Santé Publique 1. Mesures de dépistage et de vaccination contre le VHB chez les soignants (QS) 2. Dépistage régulier du VHC et du VIH de la responsabilité des soignants…. 3. Prise en charge de l’infection chronique pour faire diminuer la charge virale : « facile » pour le B mais pas pour le C !!!!!! 4. Respect du secret médical et éviter toute stigmatisation du soignant infecté 5. Restriction d’activité éventuelle 63
- 64. Exposition professionnelle Surveillance des cas de contamination par AES pour -le VIH (1991), -le VHC(1997) -et le VHB (2005) VHC • 70 cas entre 1997 et 2012 • Dont la moitié évitables • FDR : - IDE - prélèvement sanguin - aiguilles creuses VHB • Risque de contamination : -6 % si Ag HBe – et 30 % si + • Aucun cas déclaré depuis 2005 • Etude de la couverture vaccinale en 2009 : -IDE 91 % -médecins 71 % -sages-femmes : 66 % -AS : 93 % 64
- 65. Tatouages et piercing Tatouages et piercing = FDR de contamination discuté mais possible -1.information des sujets obligatoire sur le risque -2.matériel à usage unique -3.désinfection, stérilisation et élimination des déchets spécifiques -4.guides de procédure -5.contrôle -6.vaccination du personnel recommandée -7.déclaration à la préfecture et formation obligatoire du personnel 65
- 66. Transmission sexuelle VHB (QS) -préservatifs -vaccination VHC • Transmission faible chez les couples hétérosexuels monogames : 1/190 000 rapports (éviter les rapports traumatisants et pendant les règles sans préservatifs) • Plus fréquente chez les HSH infectés par le VIH dans un contexte de multi partenariat, traumatiques, plus ou moins associé à la prise de produits psycho-actifs (SLAM) • Information ++++ 66
- 67. Transmission intra-familiale VHB Vaccination des personnes vivant sous le même toit VHC Eviter le partage du matériel de toilette 67
- 68. Transmission mère-enfant : rappel de généralités Il faut : -1.informer la mère de son infection et du risque de transmission -2.ne pas contre-indiquer la contraception orale ou mécanique sauf si cirrhoses décompensées -3.dépister le partenaire et le vacciner contre le VHB -4.faire un bilan avant la grossesse (sévérité, indication thérapeutique) -5.ne pas prescrire d’entécavir chez une patiente avec un désir d’enfant -6.pas de grossesse pendant traitement anti-viral C et 4 mois après l’arrêt de la ribavirine chez la femme et 6 chez l’homme -7.en cas de cirrhose : -rechercher une HTP avant la grossesse ou à son début -suivi renforcé -programmer une césarienne si troubles de l’hémostase ou HTTP menaçante 68
- 69. Transmission mère-enfant du VHB Dépistage obligatoire au cours du 1° trimestre de la grossesse : Ag HBs Information de la patiente et de son entourage Bilan minimum : -ALAT, ASAT -ADN VHB -sérologies VIH, VHC, VHD -TP, albuminémie -échographie hépatique Dépistage et vaccination de l’entourage Mode d’accouchement non modifié Allaitement non déconseillé Risque à l’amniocentèse = 0-2,9 % (placenta antérieur) à préférer à la biopsie de trophoblaste ADN VHB au 6° mois de grossesse ≤107UI/ml Sérovaccination à la naissance >107UI/ml Tenofovir 3 mois avant l’accouchement Et sérovaccination à la naissance Avis spécialisé hépatologique systématique 69
- 70. Transmission mère-enfant du VHC Dépistage recommandé au cours du 1° trimestre de la grossesse : AC VHC Mode d’accouchement non modifié - Pas de prévention de la TMF Allaitement non déconseillé sauf si saignement au niveau du mamelon Risque à l’amniocentèse +/- 0% mais effectifs faibles (à préférer à la biopsie de trophoblaste) Dépistage de l’enfant vers 18 mois par sérologie ARN VHC - Risque de TMF nul S’assurer de l’absence de risque persistant de contamination ARN VHC + Information de la patiente et de son entourage Dépistage de l’entourage Bilan minimum : -ALAT, ASAT -ADN VHB -sérologies VIH, VHB -TP, albuminémie -échographie hépatique Avis spécialisé hépatologique systématique 70
- 71. Conclusions • Prévention et vaccination font mieux et moins cher que prise en charge et traitement • Mais sont parfois difficiles à mettre en oeuvre dans la vraie vie • Attention à ne pas diminuer les efforts malgré l’efficacité des traitements actuels qui restent difficiles d’accès pour le VHC et à long terme pour le VHB • Ne pas oublier la prévention secondaire pour éviter surinfection, progression rapide de la fibrose et l’évolution vers la cirrhose 71
- 72. 72