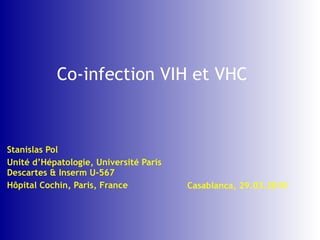
Co-infection VIH-VHC
- 1. Co-infection VIH et VHC Stanislas Pol Unité d’Hépatologie, Université Paris Descartes & Inserm U-567 Hôpital Cochin, Paris, France Casablanca, 29.03.2010
- 2. Prévalence du VHC et du VHB chez les patients infectés par le VIH ( Etude EUROSIDA) Sud : 623 = 44,9 % Nord : 346 = 24,5 % Centre : 280 = 22,9 24,3 % Est : 412 = 47,7 % Sérologie VHC (+) : 34 % (1 685 / 4 957 pts) Sérologie VHB (+) : 9 % (530 / 5 883 pts) J. Rockstoh et al., CROI 2004 Larsen C et al. BEH 2005; 23: 109-112
- 3. Augmentation des hépatites aiguës C chez les homosexuels masculins VIH+ Vogel M et al. J Antimicrobial Chem 2009
- 5. Histoire naturelle de la cirrhose hépatite chronique carcinome hépatocellulaire Décompensation Ascite Hémorragie digestive cirrhose décès foie normal
- 6. Progression vers la cirrhose et la décompensation de la cirrhose VHC : Impact du VIH Risque relatif 95 % IC ( ) Thomas et al, Hepatology 2002 Cirrhose compensée Benhamou Combined Makris Solo Pol 1 2 10 Cirrhose décompensée 175 Combined Makris Lesens Telfer Eyster 1 6 10
- 7. Survie des patients mono- et co-infectés avec cirrhose décompensée Pineda et al, Hepatology 2005
- 8. Survie des patients mono- et co-infectés avec CHC Puoti M et al. AIDS 2004
- 9. Cytotoxicité directe Cytotoxicité immunomédiée "restauration" Hépatite Chronique Alcool Drogues Médicaments VHC ou VHB VIH MultiTt antiVIH NASH Hépatotoxicité médicamenteuse Pol et al. CID 2003
- 12. Reporting Rate [ Pts / (TRXs*10,000) ] lamivudine + zidovudine 0 nevirapine efavirenz lamivudine didanosine abacavir zidovudine zalacitabine nelfinavir indinavir ritonavir saquinavir saquinavir mesylate amprenavir delavirdine stavudine 2 4 «Hépatites médicamenteuses» 1996-2000 FDA data base NNRTI’s NRTI’s PI’s
- 13. Hépatotoxicité des antirétroviraux Soriano V et al. AIDS 2008 RAL MRV ETV Risque Élevé Risque Faible ddI d4T AZT 3TC FTC ABV TDF EFV NVP SQV ATV LPV APV DRV TPV RTV T20 NRTI NNRTI PI Newer ARVs
- 15. Histoire naturelle de la cirrhose hépatite chronique carcinome hépatocellulaire Décompensation Ascite Hémorragie digestive cirrhose décès foie normal Traiter
- 16. PegIFN + ribavirine et co-infection ACTG5071 APRICOT RIBAVIC Laguno No. with Peg+RBV 66 289 205 52 Type of pegIFN 2a 2a 2b 2b IDUs - 62 % 81 % 75 % Cirrhotics 11 % 15 % 40 % (F3-F4) 19 % Genotypes 1-4 77 % 67 % 69 % 63 % Normal ALT levels - 0 15 % 0 Mean CD4 count - 520 525 512 On HAART - 84 % 82 % 94 % Tx discontinuation - 25 % 41 % 25 % EOT (ITT) 41 % 49 % 36 % 52 % SVR (ITT) 27 % 40 % 27 % 44 %
- 17. VPP et VPN des Réponses virologiques rapides (RVR) chez les patients VHC traités F. Poordad # 305 AASLD 2007 *North-C study not included because attainment of RVR was basis of enrollment; Wong data not included because same cohort as Davis et al (both Manns’ cohorts). 1Payan C et al. Gut . 2007;56:1111-1116; 2Pearlman B et al. Hepatology . 2007;44(suppl 1):318A; 3Mangia A et al. N Engl J Med . 2005;352:2609-2617; 4Davis GL et al. Hepatology . 2003;38:645-652; 5Wong JB et al. Hepatology. 2002;36:281A. Abstract 472; 6Segadas-Soares JA et al. Hepatology. 2006;44(4 suppl 1):S334. Abstract 384; 7Dalgard O et al. Hepatology . 2004;40:1260-1265; 8Dalgard O et al. J Hepatol . 2007;46(suppl 1):S57; 9Crespo M et al. J Viral Hepat . 2007;14:228-238; 10 Carrat F et al. JAMA . 2004;292:2839-2848; 11Laguno M et al. AIDS . 2004;18:F27-F36; 12Moreno L et al. AIDS . 2004;18:67-73; 13MuirAJ et al. N Engl J Med . 2004;350:2265-2271; 14Kamal SM et al. Gut . 2005;54:858-866; 15Hasan F et al. Am J Gastroenterol . 2004;99:1733-1737; 16El-Zayadi A-R et al. Am J Gastroenterol . 2005;100:2447-2452.
- 21. Bénéfices : inactivation et réversion de la fibrose voire de la cirrhose Mallet V et al. Antiviral Therapy 2007 A B
- 22. Histoire naturelle de la cirrhose carcinome hépatocellulaire Décompensation Ascite Hémorragie digestive cirrhose décès foie normal Surveiller hépatite chronique
- 23. Dépistage échographique du CHC Le rapprochement du délai des échographies augmente l’incidence de détection des nodules mais pas celle de la détection des petits CHC Trinchet JC et al. EASL 2007 , A 126 1 200 cirrhotiques (87,5 % Child A, 12,5 % Child B) 2,0 % 2,9 % 0 10 20 30 40 50 60 70 Mois 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 p = 0,72 CHC < 3 cm Echo tous les 6 mois Echo tous les 3 mois 2 ans
- 24. Radiodestruction d’un nodule de CHC
- 25. VO grade 2
- 27. Histoire naturelle de la cirrhose carcinome hépatocellulaire Décompensation Ascite Hémorragie digestive cirrhose décès foie normal Traiter et surveiller TH TH hépatite chronique
- 28. Histoire naturelle de la cirrhose carcinome hépatocellulaire Décompensation Ascite Hémorragie digestive cirrhose décès foie normal Anticipation du traitement antiviral: Plus d’efficacité Moins d’effets secondaires TH TH hépatite chronique
- 29. Traitement antifibrosant du co-infecté non répondeur ou intolérant?
- 30. Traitement antifibrosant du co-infecté non répondeur ou intolérant? - Espoir des années 2005 - Déception des années 2007-2008
- 34. Sherman et al. CROI 2008, A 59 Évolution fibrose Analyse sur échantillons appariés (n = 45) Traitement d’entretien chez le co-infecté ACTG 5178-SLAM C PEG-IFN (n = 44) Pas de TRT (n = 42) Analyse intermédiaire n = 45 patients (n = 24) (n = 21) Progression Patients VIH-VHC non répondeurs à S12 d’une bi-TRT PEG-IFN RBV (n = 96) Observation PEG-IFN n = 24 n = 21 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Changement en valeur absolue du score de fibrose (METAVIR)
- 36. Transplantation hépatique pour CHC chez le co-infecté VIH/VHB ou VHC (2) Récidive tumorale : 4/15 VIH+ (26 %) versus 7/53 VIH- (13 %) ; p = NS Survie globale après transplantation Duclos-Vallée JC et al. AASLD 2008 , Abstract 70 Survie (%) Mois 100 80 60 40 20 0 0 10 20 30 40 50 60 Suivi VIH- : 25 + 16 mois Log-rank ; p = 0,01 24 mois VIH+ VIH- 94 % 98 % 72 % 72 % Suivi VIH+ : 20 + 15 mois
Notes de l'éditeur
- L’incidence de l’hépatite aiguë C par transmission sexuelle chez les homosexuels masculin a beaucoup augmenté dans les dernières années. Elle est passé de 0,5 à 6/1000 patients année de 1999 à 2003 ( Brown, Sex Transm Inf 2004). En angletterre depuis 2002 , 222 cas ont été observé chez des patients homosexuels VIH + dans 4 hôpitaux de Londres et Brighton. Le diagnostic d’hépatite aiguë C repose sur la constatation d’une séroconversion VHC ( Ac anti VHC et ARN VHC sérique) dans les 6 derniers mois ou sur la présence d’une hépatite aiguë ( ALAT > 10 fois la normale) avec ARN VHC positif et la notion de transaminases normales dans l’année précédente. Les auteurs rapporte une série de 111 patients homosexuels VIH +, ayant présenté pendant cette période une hépatite aiguë C. L’age moyen des patients étaient de 36 ans , 65% étaient sous traitement antirétrovirale multiple et 30% avaient eu une syphilis diagnostiquée dans l’année précédente. 88% avaient une hépatite liée au génotype 1 , 8% au génotype 3 et 4% au génotype 4. L’étude phylogénétique montre une origine commune avec 4 clusters identifiés 2 pour le génotype 1 ( 78 patients pour le génotype 1a , 7 patients pour le génotype 1b), 6 patients pour le génotype 3a. Cette analyse phylogénétique suggère une origine commune de la contamination chez la plupart des patients. Les auteurs se sont donc intéressés aux facteurs de risque et aux pratiques sexuelles des patients pour rechercher des comportements à risque en comparant 60 patients avec 130 patients homosexuels VIH + mais sans VHC. Cette étude montre que le risque de transmission est plus important si les patients fréquente les sites internet , les clubs sexuels les backroom et les sauna. Le nombre de partenaires sexuels est plus important sur les 12 derniers mois et le risque de transmission avec les pratiques sexuelles potentiellement traumatiques. De plus les patients contaminés ont plus souvent recours à l’utilisation de drogues notamment par voie nasale et étaient plus souvent atteints de maladie sexuellement transmissible . Cette étude démontre la nécessité de renforcer le message de prévention au sein de la communauté homosexuelle.
- L’enquête MORTAVIC 2005 a pour objectif de déterminer la mortalité hépatique chez les patients infectés par le VIH à travers un observatoire trimestriel réalisé dans les service d’infectieux et de médecine interne du réseau GERMIVIC. Cette enquête a été comparée à celle réalisée les années précédentes par le même réseau. En 2004, 24 000 patients VIH ont été vus dans ces services dont 19,4 % étaient co-infectés par le VHC. 313 décès ont été notifiés dont 287 documentés. Depuis l’introduction des multithérapies antirétrovirales (MTAV) l’incidence annuelle de la mortalité globale a chuté passant de 8 % à 1,2 % en 2005 (p < 0,01), de même que l’incidence annuelle de la mortalité liée au VIH. Par contre, la mortalité hépatique est la deuxième cause de mortalité principalement en rapport avec la co-infection par le VHC et la consommation d’alcool. La majorité des patients qui décèdent de maladie hépatique ont, en 2005, une multithérapie antirétrovirale et un taux de CD4 moyen à 237, témoignant d’un bon contrôle de l’immunodépression.
- A VERIFIER VALEURSSSSSSSSSSSSSSSSS
- Commentaires : voir diapositive précédente.
- Un grand nombre de malades co-infectés non répondeurs ou rechuteurs après un premier traitement ont été traités de façon non optimale (faibles doses de Ribavirine, diminution de dose d’IFN, arrêt prématuré des traitements). Dans ce contexte, l’intérêt de cette étude qui regroupe des malades non répondeurs et des malades rechuteurs et dont l’effectif est réduit est de montrer qu’il est possible d’obtenir une réponse virologique soutenue en retraitant ces malades selon les recommandations actuelles. Ces résultats justifient l’intérêt des essais thérapeutiques d’optimisation (facteurs de croissances, éducation thérapeutique, forte doses….) proposés actuellement en attendant la possibilité d’utiliser les antiviraux spécifiques dans cette population.
- Cette étude est réalisée à partir de la cohorte RIBAVIC et s’intéresse aux facteurs associés à la survenue d’une atteinte hépatique sévère définie par : une décompensation cirrhotique, un CHC, une transplantation hépatique ou un décès lié au foie. Tous les malades ayant présenté un de ces évènements étaient non répondeurs au traitement anti-VHC. Cependant, probablement en raison du faible nombre d’évènements observés, la non réponse au traitement n’apparaît pas statistiquement liée à la survenue d’un évènement définissant l’atteinte hépatique terminale en analyse multivariée. La fibrose ≥F3, un taux de CD4 < 350/ml, un TP < 94% et un taux de plaquettes < 190 000/ml sont par contre associés de façon indépendante à la survenue d’une atteinte hépatique terminale. La fibrose sévère qui a un impact négatif sur la réponse au traitement et qui était fréquente chez les malades inclus dans Ribavic est évoquée par les auteurs comme un possible facteur confondant. La poursuite du suivi de cette cohorte pourra peut être permettre de confirmer le bénéfice de la réponse virologique soutenue sur la morbidité et la mortalité hépatique chez les malades co-infectés.
- Le délai entre les échographies pour le dépistage précoce du CHC chez les cirrhotiques en France doit rester d’environ 6 mois.
- Maintenant que la transplantation chez le patient VIH est bien admise, cette étude rétrospective s’est intéressée aux résultats de la transplantation pour cancer sur cirrhose chez le patient VIH. De 2003 à 2008, 21 patients ayant un carcinome hépato-cellulaire (CHC) sur une cirrhose virale co-infectés par le VIH (groupe VIH+) étaient comparés au 61 autres patients ayant un CHC sur cirrhose virale B ou C (groupe VIH-). Au moment de l’inscription sur la liste, les deux groupes étaient comparables pour le sexe, l’étiologie virale, le nombre de nodules (1,6 ± 1 versus 2,1 ± 2,1), le diamètre maximal du nodule, le critère de Milan et le traitement antérieur par radiofréquence ou chimio-embolisation. Le groupe VIH+ avait un score de MELD significativement supérieur (15 ± 5 versus 9 ± 1 ; p = 0,002) et un âge plus élevé (56 ± 8 versus 49 ± 5 ; p = 0,013) comparé au groupe VIH-. Il y avait une tendance non significative à une sortie de la liste d’attente dans le groupe VIH+ (23 % versus 8 % ; p = 0,06) liée à la progression tumorale chez 4 patients VIH+ et la progression de la maladie VIH chez 1 patient. Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes en termes de délai d’attente sur la liste, du type de transplantation (donneur vivant, domino ou donneur cadavérique), des transfusions sanguines peropératoire et de la mortalité postopératoire précoce. Il n’y avait pas de différence non plus pour les caractéristiques tumorales retrouvées sur l’explant du foie natif (voir tableau). La récidive tumorale était retrouvée chez 4/15 (26 %) patients VIH+ et 7/53 (13 %) VIH- ; p = NS. La survie après transplantation était significativement moins bonne chez les patients VIH+ (cf. graphique).
