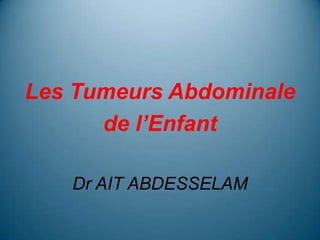
Tumeurs abd enfant
- 1. Les Tumeurs Abdominale de l’Enfant Dr AIT ABDESSELAM
- 3. Ce sont des tumeurs développées dans la cavité abdominale Elles peuvent être intra ou retro péritonéales parfois abdominopelviennes Les étiologies sont dominées par les tumeurs malignes: nephroblastome, neuroblastome, lymphom e Le pronostic dépend du type de la tumeur, de la précocité du diagnostic et de
- 4. Diagnostic positif d’une tumeur abdominale Circonstances de découverte Fortuite par les parents ou le médecin Devant une ↑↑ du volume de l’abdomen S. d’appel généraux: amaigrissement , fièvre, douleur abdominal, hématurie, s. de compression, Devant des s.de dissémination :dlrs osseuses, nodules cutanés, ecchymose péri orbitaire, hépatomégalie nodulaire
- 5. L’examen clinique L’ inspection: voussure de l’abdomen, circulation veineuse collatérale La palpation: Précisera les caractères de la tumeur: siège , limites, consistance, volume, mobilité, sensibilité . Eliminera un gros foie , une splénomégalie non tumoraux Le TR complètera l’examen L’examen de la vulve chez la fille est
- 7. Echographie T. anéchogène T. échogène ou hétérogène • tumeur liquidienne • tumeur solide ou mixte = tumeur bénigne = tumeur maligne ? - neuroblastome - néphroblastome multikistique unikistique - lymphome - rhabdomyosarcome - héptoblastome Quels examens complémentaires ? Quelle prise en charge ?
- 9. Tumeur liquidienne 1. tumeur multikistique • Lymphangiome kystique abdominal malformation vasculaire lymphatique mésentérique / épiplooïque hémorragies intra-kystiques poussées inflammatoires infections
- 10. Exérèse chirurgicale ± résection intestinale ...risque de récidive si exérèse incomplète
- 11. Tumeur unikistique Dans les deux sexes duplication digestive kyste du cholédoque kyste de l’ouraque globe vésical chez la fille ovaire :kyste fonctionnel, tératome mature hématocolpos
- 12. Hématocolpos Jeune fille pubère aménorrhée primaire caractères sexuels IIaires douleurs cycliques Diaphragme vaginal
- 14. TUMEUR SOLIDE
- 15. Tumeur solide ou mixte Néphroblastome Neuroblastome Lymphome terrain imagerie marqueurs biopsie
- 16. Terrain âge Néphroblastome Lymphome 1 - 5 ans âge médian 7 - 8 ans 98% avant 7 ans 15% avant 1 an 5 ans exceptionnel avant 2 ans Neuroblastome 0 - 5 ans 95% avant 6 ans 35% avant 1 an
- 17. Terrain Signes associés anomalies génito-urinaires Nephroblasotme Sd hémi-hypertrophie altération de l’état général douleurs osseuses Neuroblastome métastases orbitaires
- 19. Anomalies génito-urinaires Cryptorchidie Ambiguïté sexuelle Anomalies rénales Hypospadias
- 20. Néphroblastome Syndrome de prédisposition Syndrome WAGR Aniridie Malformations Génito-urinaire Retard mental Syndrome de Denys-Drash Troubles de différenciation sexuelle (pseudo- hermaphrodisme masculin) Sclérose mésangiale Syndrome de Wiedemann-Beckwith Viscéromégalie (foie, reins, surrénales, rate) Macroglossie Omphalocèle Hémihypertrophie corporelle Néphroblastome, hépatoblastome, corticosurrénalome, RMS
- 21. Bilan locorégional Quels examens d’imagerie ? Echographie ASP TDM / IRM
- 22. ASP Syndrome de masse Répartition des clartés digestives Calcifications
- 23. ASP Calcifications Fines :neuroblastome Larges : tératome
- 24. Imagerie Scanner abdominal IRM abdominale
- 25. Localisation Tumeur rétropéritonéale Origine rénale : néphroblastome Origine suprarénale : neuroblastome Tumeur intra-péritonéale Lymphome Localisation hépatique : hépatoblastome Localisation pariétale : TMM
- 27. Néphroblastome
- 28. Néphroblastome Cliché d’abdomen Fin d’IV après scanner Retentissement sur les cavités excrétrices
- 29. Marqueurs tumoraux Catécholamines urinaires Métabolites : HVA, VMA, dopamine Neuroblastomes : 85% LDH Non spécifique, reflète la masse tumorale Neuroblastome, lymphome AFP, ßHCG Hépatoblastome Valeur diagnostique Tumeurs germinales malignes Valeur pronostique Surveillance
- 30. Données histologiques • Néphroblastome : pas de biopsie Sauf présentation atypique (âge, calcifications) ou absence de réponse sous CT • Lymphome Epanchement pleural ou ascite Adénopathie superficielle Moelle osseuse Masse tumorale abdominale : plus rarement • Neuroblastome Nodule cutané Tumeur primitiveMoelle (myélogrammes et BOM)
- 31. En résumé... Approche basée sur l’échographie Tumeurs abdominales malignes Age Localisation Marqueurs Approche multidisciplinaire
- 32. LE NEPHROBLASTOME « TUMEUR DE WILMS »
- 33. EPIDEMIOLOGIE GENETIQUE Tumeur à point de départ rénal Représente 5 à 11℅ des cancers de l’enfant et 95℅ des cancers du rein 1 à 2 cas ⁄ million ⁄ an Age moyen: 3 ans 5% de formes bilatérales
- 34. CERTAINES MALFORMATIONS CONGEITALES – »RISQUE ACCRU DE SURVENUE D’UN NEPHROBLASTOME Syndrome WAGR Aniridie Malformations Génito-urinaire Retard mental Syndrome de Denys-Drash Troubles de différenciation sexuelle (pseudo- hermaphrodisme masculin) Sclérose mésangiale Syndrome de Wiedemann-Beckwith Macroglossie Omphalocèle Hémihypertrophie corporelle Viscéromégalie (foie, reins, surrénales, rate) Néphroblastome, hépatoblastome, corticosurrénalome, RMS
- 35. DIAGNOSTIC CLINIQUE La découverte fortuite (parents) ou systématique (médecin) d’une masse abdominale est le mode de révélation habituel (80 %) : • indolore, ferme, lisse. • volumineuse à développement antérieur, dans l’hypochondre • rapidement évolutive (l’examen était parfois normal quelques semaines avant) • fragile et devant être examiner avec précaution car pouvant se rompre • isolée, chez un enfant en bon état général. D’autres signes peuvent être plus rarement associés ou révélateurs : • hématurie, HTA • syndrome abdominal aigu dominé par la douleur
- 37. BIOLOGIE Il n’existe pas de signes biologiques permettant de porter le diagnostic de néphroblastome Le dosage des métabolites urinaires des catécholamines, normal, est systématique pour le diagnostic différentiel du neuroblastome. Une anémie Le bilan rénal est le plus souvent normal
- 38. L’imagerie L’ASP confirme l’existence d’un syndrome de masse devant une opacité refoulant les clartés digestives, et dépourvue de calcifications
- 39. L’imagerie • L’échographie montre une masse tumorale intra rénale, déformant les contours du rein, pleine, solide (hyperéchogène), souvent hétérogène présentant des plages hypoéchogènes (remaniements nécrotiques).
- 40. L’imagerie Le scanner, non indispensable au diagnostic confirme les données de l’échographie en montrant la tumeur intra- rénal hétérogène Il établit un bon bilan de l’extension intra abdominale: adénopathies , foie, vx…. Il permet l’évaluation de la réponse au traitement
- 41. L’imagerie L’injection de produit de contraste permet l’étude des vaisseaux rénaux et de la veine cave, où peuvent siéger une thrombose tumorale. des clichés d’urographie réalisés au décours de la TDM avec injection permettentd’objectiver l’opacification caractéristique des voies urinaires observées dans un néphroblastome avec bouleversement de l’architecture normale des cavités pyélocalicielles qui apparaissent étirées, déformées amputées
- 42. L’imagerie Volumineuse masse rénale gauche hétérogène développée aux dépens de la face antérieure du rein avec le parenchyme rénal hyperdense encore fonctionnel
- 43. L’imagerie Masse développée aux dépens du rein droit dont on ne perçoit plus qu’une mince bande de parenchyme hyperdense en périphérie de la masse (flèche blanche). Respect de la ligne médiane : aorte (>). Rein gauche normal.
- 44. L’imagerie Masse rénale droite solide hétérogène (M). Parenchyme rénal sain (flèche noire). Adénopathies pré- aortiques (flècheblanche). Aorte (<). Foie (F
- 45. L’IMAGERIE Image lacunaire située dans l’oreillette droite du cœur (flèche) : thrombose tumorale de la veine cave inférieure étendue à l’oreillette droite
- 46. L’imagerie • Masses rénales bilatérales, de densité solide, hétérogène. • Le parenchyme rénal sain restant apparaît hyperdense : • signe de l’éperon avec encorbellement des lésions • tumorales (flèches blanches). • Diagnostic : néphroblastome bilatéral
- 47. Ce bilan radiologique simple est habituellement suffisant pour porter le diagnostic de néphroblastome, qui permettra de débuter le traitement sans preuve histologique et devra être confirmé secondairement par l’examen anatomo-pathologique de la pièce d’exérèse. Un néphroblastome ne doit jamais être biopsié. Dans certains cas, une biopsie à l'aiguille fine est réalisée dans des formes douteuses,(âge élevé, échostructure inhabituelle…)
- 48. Bilan d’ extension • A la recherche de métastases, comprend : L’étude échographique du foie et du rein controlatéral La radiographie de thorax. (les métastases pulmonaires sont les plus fréquentes). Le scanner thoracique
- 49. Bilan d’extension TLT de face et profil: nodules pulmonaires
- 50. Bilan d’extension • Scanner thoracique. Confirmation des images nodulaires métastatiques dans les deux poumons (flèches)
- 51. Diagnostic différentiel L’échographie permet d’éliminer les masses liquidiennes : malformations kystiques, hydronéphrose. Le diagnostic peut se discuter avec les autres masses pleines rétro péritonéales : Abcès du rein (syndrome infectieux) Localisation rénale d’un lymphome, d’un sarcome Tumeur rhabdoïde du rein (pronostic redoutable) (découverte anatomo-pathologique) Autres tumeurs du rein bénignes : tumeur de Bolande (néphrome mésoblastique) du nourrisson imposant l’exérèse de première intention chez l’enfant de moins de 6 mois. Autres tumeurs rétro péritonéales extra rénales, en particulier: -neuroblastomes imposant le dosage des métabolites urinaires descatécholamines : HVA, VMA, Dopamine -hépatoblastome et tumeur germinale (tératome) pouvant imposer un dosage de l'Alpha Foeto-Protéine et de la bêta HCG
- 52. Pronostic L’EXTENSION • Stade I : tumeur limitée au rein, en capsulée, d’exérèse complète. • Stade II : tumeur franchissant la capsule rénale mais dont l’exérèse a été totale. • Stade III : exérèse incomplète ou tumeur rompue (par traumatisme biopsie) ou ganglions du hile rénal envahis • Stade IV : métastases hématogènes. • Stade V :néphroblastome bilatéral synchrone.
- 53. Pronostic La variété histologique a une importance considérable, avec une distinction pour : • Les formes d’histologie “standard”, contenant en proportion variable 3 types de tissu : blastémateux indifférencie , du tissu à différenciation épithéliale + ou - poussée (glomérules, tubules)et des éléments mésenchymateux (fibroblastiques ou musculaires). • Les formes d’histologie “défavorables” (10% des cas) en particulier sarcomateuses et anaplasiques ou blastémateuse prédominante
- 54. TRAITEMENT Principes La néphrectomie reste le temps essentiel du traitement. Elle est toujours précédée d’une chimiothérapie de réduction tumorale, facilitant grandement l’exérèse, avec un risque de rupture tumorale minime. Cette chimiothérapie est débutée sur des arguments cliniques et radiologiques, et sanspreuve histologique. La confirmation anatomo-pathologique du diagnostic sur la pièce d’exérèse et l’établissement du stade permettent de déterminer le traitement post-opératoire qui repose sur la chimiothérapie et dans certains cas sur la radiothérapie.
- 55. TRAITEMENT Méthodes Chirurgie C’est une chirurgie programmée et réglée, faite après une chimiothérapie néoadjuvante Abord large transpéritonéal Néphrectomie totale élargie avec ligature première du pédicule vasculaire et résection basse de l’uretère, en passant au large de la tumeur Avec exérèse des ganglions du hile et de tous les ganglions régionaux suspects et examen soigneux de la cavité péritonéale et du rein controlatéral La néphrectomie partielle est réservée aux formes plurifocales.
- 56. TRAITEMENT Methodes chimiothérapie Le néphroblastome est très chimio-sensible. Les principales drogues actives et utilisées sont : La VINCRISTINE. L’ACTINOMYCINE D. L’ADRIAMYCINE (Toxicité cardiaque) Les intérêts de la chimiothérapie sont : • la réduction tumorale préopératoire (souvent rapide et importante pouvantatteindre 50 % du volume initial et faciliter grandement la chirurgie). • la destruction des métastases (micrométastases ou avérées) et des cellules résiduelles post-opératoires
- 57. TRAITEMENT Radiothérapie Le néphroblastome est très radio sensible et même radio curable. selon des protocoles extrêmement précis avec une grande efficacité pour des doses assez faibles (15 à 30 grays). L’intérêt de la radiothérapie est : -le traitement post-opératoire des cellules tumorales résiduelles du lit opératoire. -le traitement des métastases. La toxicité importante de la radiothérapie chez le jeune enfant a amené à privilégier dans tous les cas possibles l’usage de la chimiothérapie: - toxicité à court terme : en particulier digestive. • - toxicité à long terme : ralentissement de la croissance osseuse avec risque de scolioses
- 58. Indications Dans tous les cas Chimiothérapie préopératoire et néphrectomie. Selon le stade local défini en post-opératoire : • Stade I : chimiothérapie post-op à 2 drogues (vincristine - actiD) • Stade II: chimiothérapie post-op à 3 drogues (vincristine - actiD -adria) • Stade III : radiothérapie post-op et chimio post-op à 3 drogues. • Stade IV:Chimiothérapie pré et post-opératoire à 3 drogues. exérèse ou irradiation des métastases en cas de régression incomplète. • Stade V: Néphrectomie partielle bilatérale et traitement selon le stade local de chaque côté. Histologie défavorable : renforcement de la chimiothérapie par les autres drogues actives (mais plus toxiques) : Carboplatine, Ifosfamide, Vépéside.
- 59. EVOLUTION SURVEILLANCE La guérison est obtenue dans 90 % des cas et peut-être quasi-affirmée après 2 ans. La survenue de métastases ou d’une récidive locale dans les 2 premières années après le diagnostic est possible essentiellement dans les stades III et les histologies défavorables et doivent être dépistées par une surveillance trimestrielle comprenant - un examen clinique, -une radio pulmonaire -une écho abdominale Le pronostic des stades III = environ 70 % de guérison Le pronostic des histologies défavorables = environ 50 % de guérison. La surveillance doit être ensuite menée jusqu’à l’âge adulte pour le diagnostic et le traitement des séquelles tardives éventuelles
- 60. NEUROBLASTOME
- 61. DEFINITION Tumeur embryonnaire du tissu sympathique dérivé de la crête neurale, localisée au niveau des formations nerveuses du système sympathique Localisation rétropéritonéale (médullo-surrénale et chaîne paravertébrale), thoracique, cervicale, pelvienn e La différenciation cellulaire est variable. Quand elle est mature, la tumeur prend le nom de
- 63. EPIDEMIOLOGIE Abdomen = 3ème lieu d’ élection des cancers de l’ enfant (après les leucémies et les tumeurs cérébrales) Dans les tumeurs abdo, 40% sont des neuroblastomes, 30% néphroblastomes, 11% tératomes, 10% lymphomes, 4% tumeurs hépatiques, 5% autres Touche 1enfant/100 000/an
- 64. TERRAIN Age de 1 Age de 1 à 6 ans 6 ans Pic de fréquence à 2ans Sex ratio = 1 Associations existantes avec la neurofibromatose de Von Recklinghausen et maladie Hirschsprung colique totale
- 65. DIAGNOSTIC CLINIQUE Souvent révélé par ses métastases : Osseuses : Douleurs osseuses Exophtalmie et ecchymose périorbitaire (syndrome de HUTCHINSON) Compression médullaire: neuroblastome en sablier Hépatiques : syndrome de PEPPER Avant 6 mois Infiltration hépatique diffus avec hépatomégalie majeure de croissance rapide Associées parfois à des méta cutanées Sous cutanées: (nodules palpables)
- 67. Diagnostic clinque (2) Altération de l’état général : asthénie, fièvre, pâleur Masse abdominale isolée, dure polylobée, de croissance lente Neuroblastome médiastinal : toux, dyspnée Neuroblastome cervical : dysphonie, dysphagie, attitude vicieuse de la tête Diarrhée (sécrétion de VIP) Ataxie et opsomyoclionie (hypotonie , syndrome cérébelleux, clonies mb sup + yeux
- 68. Biologie Marqueurs urinaires élevés par sécrétion de catécholamines HVA: acides homo-vanilique VMA : acide vanyl- mandilique Noradrénaline et adré Dopamine Se dosent sur les urines des 24h (avec régime sans thé, chocolat, vanille, banane) Dans le sang : β HCG (-), LDH, ferritine
- 69. Diagnostic paraclinique Radiologique Masse hétérogéne, non kystique, mal limitée Rétropritonéale, indépendante du rein qu’elle refoule et comprime Méta hépatiques ? Echographie abdominale
- 70. Diagnostic para-clinique ASP Masse abdominale Calcifications Lésion osseuses : élargissement des trous de conjugaison des tumeurs intrarachidiennes, érosions costales, ostéolyses métastatiques Rapports avec les tissus mous: anses digestives refoulées, reins déplacés,
- 71. BILAN D’EXTENSION IRM ou TDM Masse avec vaisseaux , reins, moelles Métastases ganglionnaires, osseuses, hépatiques, médiastinales Scintigraphies au MIBG (méta-iodo-benzyl-guanidine) Masse fixante Recherche de méta Permet la surveillance Myélogrammes (10), BOM (2) sous AG, R.P (face et profil) Radio osseuses centrées sur les lésions Génétique : analyse chromosomique (ploïdie, délétions, oncogènes)
- 75. PRONOSTC Age de l’enfant : meilleur avant 1 an Topographie : meilleur frome thoracique, localisée, de petite taille Degré d’extension : classification d’Evans I : tumeur limitée à son site d’origine II : tumeur dépassant son site sans franchir la ligne médiane III: tumeur franchissant la ligne médiane, englobant les vaisseaux , ou les ganglions controlatéraux IV : atteint ganglionnaire, osseuse, ou viscérale à distance IV S : stade I ou II avec méta hép, cutanée, ou médullaire (syndrome de Pepper)
- 76. BIOLOGIE • Sont de mauvais pronostic l’amplification de l’oncogène N-myc, l’élévation des LDH sg, la délétion du bras court du chr 1 • Taux de survie : stade I 90%, Stade IV 30%
- 77. TRAITEMENT Chimiothérapie (Oncovin, Endoxan, Cisplatine) selon des protocoles Chirurgie : sont première soit après poly- chimiothérapie Radiothérapie Greffe de moelle
